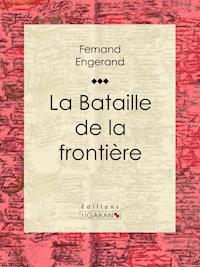
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"La Bataille de la frontière est un roman historique captivant écrit par Fernand Engerand. Ce livre nous plonge au cœur d'une époque tumultueuse, celle de la Première Guerre mondiale, et nous fait revivre les événements qui ont marqué la bataille de la frontière franco-allemande.À travers une plume habile et immersive, l'auteur nous transporte dans les tranchées, où les soldats français et allemands se font face dans un combat acharné. On y découvre le courage et la résilience des hommes qui ont dû faire face à l'horreur de la guerre, mais aussi les sacrifices et les pertes qu'ils ont dû endurer.Engerand nous offre un récit poignant, riche en détails historiques et en émotions. Il nous fait vivre les moments de tension, d'angoisse et d'espoir qui ont marqué cette période sombre de l'histoire. À travers ses personnages, l'auteur nous permet de mieux comprendre les enjeux et les conséquences de cette bataille décisive.La Bataille de la frontière est un livre qui nous rappelle l'importance de se souvenir de ces événements tragiques, mais aussi de rendre hommage à ceux qui ont combattu pour défendre leur pays. C'est un roman incontournable pour tous les amateurs d'histoire et de récits poignants.
Extrait : ""Le 20 mai 1915, les six grandes associations industrielles et agricoles d'Allemagne adressaient au chancelier de Bethmann-Hollweg un mémoire confidentiel sur les conditions de la paix future ; entre autres choses il y était dit : « La fabrication des obus nécessite des quantités de fer et d'acier dont on ne pouvait se faire une idée autrefois…"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016512
©Ligaran 2015
J’eus, au cours de la guerre, le redoutable et peut-être funeste avantage, ayant entrevu la vérité sur les débuts de la guerre – sur ce mois d’août 1914, le plus tragique assurément de toute l’histoire de la France – d’avoir osé la dire.
Ayant trouvé le mot de la prétendue énigme, de Charleroi, je l’ai donné et par là dévoilé les erreurs dont on avait abusé l’opinion, les causes de l’invasion et de la cruelle occupation du plus riche quartier de la France, celles enfin des difficultés et des souffrances sans nombre qui s’ensuivirent.
J’ai tenu le flambeau, dont parle Vigny, et « dont les yeux faibles détestent la lumière ». On m’en fit grief. Dire si tôt la vérité, erreur politique ! gémissait-on. Non. Que si erreur il y avait eu, elle n’eut pas, au surplus, été que mienne, mais également celle du gouvernement, dont en 1918 la censure autorisa la publication de mes articles du Correspondant puis celle de mon livre. Le gouvernement, ce faisant, avait assurément ses raisons ; peut-être les trouverait-on en rapprochant la date où parurent ces articles de celle des évènements militaires qui se produisirent alors sur le front allié.
Je prévois pour ce nouveau livre une autre critique. Il est le quatrième d’une série sur la frontière : idée fixe, dira-t-on. Quatre livres sur le même objet, c’est beaucoup, je le reconnais, mais ce n’est pas trop quand le sujet est d’une telle importance. Assurément j’eusse préféré « boucler le dossier » et passer à un autre sujet. Je n’éprouverai aucune confusion d’une telle critique, et si j’ai un remords, c’est, au cours de ma vie parlementaire, d’avoir trop regardé ma circonscription et pas assez la frontière. Le devoir actuel d’un représentant de la France est de renverser son champ de vision d’avant-guerre.
Après Charleroi, j’étudie donc aujourd’hui un autre coin de la bataille de la frontière d’août 1914 ; Briey. Voici comment j’y fus amené.
Mon livre : Le Secret de la Frontière : Charleroi subit le tir de barrage le moins inattendu. J’avais déclaré qu’il « n’était que pour quelques-uns » ; son tirage avait été volontairement limité, l’éditeur ni l’auteur ne voulant tirer profit de la révélation d’un tel malheur national. Mon but était d’empêcher la légende de se substituer à la vérité historique. Je me félicitais presque du silence quasi-universel de la presse.
Un hasard politique vint le rompre.
En janvier 1919, au cours d’une interpellation à la Chambre sur la politique métallurgique du gouvernement, l’interpellateur, ayant évoqué la question de Briey, dont j’avais dans mon livre exposé la gravité fit appel à mon témoignage ; je ne le lui refusai pas, je ne pouvais le lui refuser. Je signalai donc la double cause de nos difficultés métallurgiques au cours de la guerre : la non-défense, 1914, de Briey, le pays du fer, et du Nord, le pays de la houille. L’émotion fut vive ; M. Viviani la porta à son comble en affirmant que cet abandon de Briey provenait du fait du commandement et non du gouvernement, que le recul de 10 kilomètres, prescrit à nos troupes le 30 juillet, n’avait été pour rien dans cette mesure, prévue dans le plan de concentration.
Bien d’autres choses furent encore dites, hors de cette question, qui, d’accessoire dans la pensée de l’interpellateur, devint principale dans la pensée publique. Par Briey la question du début de la guerre était posée. Cette fois, la grande presse, comme mue par un chef invisible, fit rage : sabotage de la victoire ! scandale parlementaire ! ! légende de Briey ! ! !… Je laissai passer l’orage.
La Chambre décida, comme conclusion du débat, nommer une commission d’enquête « rôle et la situation de la métallurgie en France ». Un tel programme était illimité alors que, par contre, les pouvoirs de la Chambre étaient extrêmement limités, la malignité publique les disait même périmés.
La perte de Briey ayant été l’origine certaine et la cause principale de nos difficultés métallurgiques, son examen s’imposait d’abord. La Commission rechercha donc les raisons de cet immense malheur, le ministre M. Loucheur, n’hésita pas à qualifier de « catastrophe » : c’était conséquemment l’examen des évènements militaires du début de la guerre sur ce point du front de bataille français.
Les chefs qui avaient participé à ces batailles ou qui furent associés à leur préparation apportèrent leur témoignage. Le général de Castelnau d’abord, le maréchal Joffre enfin avertirent la Commission qu’au point de vue stratégique, Briey n’était que la partie d’un tout et que, pour comprendre ce grave détail, il était nécessaire d’envisager l’ensemble, de connaître le plan de concentration et les plans successifs d’opérations.
Et la Commission se vit obligée, pour remplir le mandat que lui avait donné la Chambre, d’orienter dans ce sens son enquête. Elle recueillit des témoignages qui resteront d’importantes contributions à l’histoire de la guerre. Mais le public, mal renseigné, ne comprit pas comment une Commission chargée d’enquêter sur la métallurgie portait ses investigations sur les graves problèmes du début de la guerre : la situation lui parut paradoxale ; elle l’était apparemment, mais trop compliquée pour lui pouvoir être congrûment expliquée.
Le rapport sur cette question de Briey me fut confié. C’était une occasion exceptionnelle de pousser plus à fond cette question du début de la guerre que, le premier, j’avais posée, et ce dans des conditions sans égales puisque les témoignages pouvaient être requis et reçus sous la foi du serment, et que, comme rapporteur, je devais avoir la communication des documents officiels essentiels.
Les témoignages reçus furent nombreux, et plusieurs seront, pour l’histoire, des documents de premier ordre.
Pourtant, si autorisés que fussent ces témoins et si évidemment sincères leurs dépositions, il apparut vite qu’ils ne pouvaient suffire à manifester pleinement la vérité. Le témoignage direct sur des faits de guerre –et surtout pour une guerre aussi longue –par ceux qui en furent les acteurs, est, en effet, très délicat : le souvenir subit inévitablement des déformations ; la mémoire, après de telles épreuves, risque, sinon de s’oblitérer, au moins de n’être pas toujours fidèle ; l’idée fixe peut, et de la meilleure foi, l’impressionner…
Un fait surtout imposait une grande réserve. Au début de la guerre les commandants d’armée ne furent pas mis au courant du plan général d’opérations ou, plus exactement, de la pensée du général en chef. Le général Berthelot, qui apparaît un peu comme le chef irresponsable des opérations d’août 1914, a déclaré à la Commission de Briey que « l’ensemble du plan d’opérations était inconnu d’une manière générale des commandants d’armée, mais qu’il était en réalité connu par les chefs d’état-major qui avaient participé à l’établissement de ce plan ». En fait, de propos délibéré, le Grand Quartier Général ignora les commandants d’armée, et par-dessus leur tête ne communiquait qu’avec leurs états-majors. Ces généraux d’armée ne furent que des exécutants supérieurs, sans contact avec le général en chef, ne recevant de lui aucune indication personnelle…
Ainsi, dans le cas spécial de Briey, le rôle de l’armée de Lorraine, créée le 19 août et mise sous le commandement du général Maunoury, était essentiel, puisque cette armée, reliant les 3e et 2e armées, avait pour mission investissement de Metz, combiné avec la défense des Hauts-de-Meuse. Or, le général de Castelnan, à la gauche de qui cette armée devait opérer, n’en soupçonna même pas l’existence ; le général Ruffey la croyait pour partie sous ses ordres et ne fut avisé ni de son existence ni de sa mission ; et son commandant le général Maunoury fut jeté en pleine bataille avec cette armée qu’il ne connaissait pas et qui ne le connaissait pas, sans savoir ce que faisaient les armées entre lesquelles il se trouvait.
Un tel état de choses a amené des malentendus terribles et des oppositions de témoignages presque tragiques.
Exclusivement confinés dans le secteur de leur armée, ne soupçonnant souvent rien de ce qui se passait à leurs côtés, tenus dans l’ignorance de la pensée du commandement, parfois même –on le verra –inexactement renseignés par lui, ces commandants d’armée n’ont à peu près rien su de l’ordre général de la grande bataille à laquelle ils participèrent et qu’ils ne connurent que par les réactions qu’elle produisit sur leur armée…
Leur témoignage était assurément nécessaire, il reste important ; il contient des éléments de vérité, mais non toute la vérité.
Cette pensée du commandement, cette vue d’ensemble des opérations le gouvernement ne la possédait pas plus que ces éminents agents d’exécution.
Avant la guerre aucune organisation solide et rationnelle des rapports entre le haut commandement et le gouvernement n’avait été établie, et, la guerre venue, le Grand Quartier Général avait purement et simplement « chambré » le gouvernement. L’aveu formel en fut fait, le 28 mars 1919, devant la Commission de Briey par le général Messimy, ministre de la Guerre en août 1914 : « Presque tout ce que je sais du début de la guerre – a-t-il déclaré – je l’ai appris depuis deux mois, depuis que je suis rentré au Parlement, depuis que j’ai compulsé les archives et lu les diverses publications récemment parues sur cette période obscure pour moi comme pour tous les Français. »…
Dans ces conditions le contrôle des témoignages devait être demandé aux pièces et documents officiels : ce fut ma tâche.
Cette tâche, le Ministre de la Guerre l’a facilitée en mettant à ma disposition, sinon tous les documents nécessaires, au moins tous ceux qui se trouvaient réunis alors à la Section historique.
Les pièces essentielles me furent procurées ; elles sont suffisantes pour éclairer le sujet envisagé, mais non pour asseoir un jugement certain et encore moins pour établir des responsabilités.
Dans les deux mois de mai et de juin 1919 où je fis ces recherches, les documents innombrables sur la guerre n’étaient pas encore réunis à Paris. La Section historique n’en possédait qu’une partie assez réduite : les documents relatifs aux armées étaient à Montpellier ; le Grand Quartier Général détenait à Chantilly ses archives particulières, et le ministère de la Guerre n’avait que le surnombre des épreuves photographiques de ces derniers. Ce n’était donc qu’une sélection, mais très impartialement faite, car des pièces de toute importance s’y trouvaient, qui auraient pu facilement être écartées.
Enfin, et c’est là un point grave, le 1er septembre 1914, lors de l’avance des Allemands sur Paris, l’ordre fut donné par le général en chef de détruire les documents existant dans les coffres-forts des membres du Conseil supérieur de la guerre, ainsi que les plans antérieurs au plan 17. M. le ministre de la Guerre, en me confirmant le fait, m’a déclaré que l’ordre avait été en partie exécuté et qu’il n’avait pas été dressé d’inventaire des documents ainsi détruits. Il manque donc une source essentielle de documentation, et cette lacune risque de rendre difficile l’œuvre de l’historien.
L’état des dossiers communiqués, le nombre des pièces, l’insuffisance de leur classement et l’absence de toute méthode scientifique ont encore été des obstacles sérieux.
Un tel état de choses ne permet donc qu’une explication, un exposé impartial des faits envisagés ; je me suis seulement efforcé de les comprendre, d’en suivre le déroulement et l’enchaînement. Sachant combien la vérité est difficile à dégager sur des faits aussiproches, aussi obscurs, et où tant de passions sont aux prises, et que, pour se parfaire, l’œuvre de l’historien exige une documentation plus complète et aussi le témoignage de l’ennemi, j’ai estimé ne pouvoir pas formuler un jugement ni des conclusions qui seraient prématurées et risqueraient peut-être de n’être pas tout à fait justes.
Ce livre n’est donc qu’un simple exposé de la perte de Briey, qui n’est, au vrai, que la question même du début de la guerre. Les deux sources essentielles de sa documentation sont les dépositions reçues par la Commission de Briey et les pièces mises à ma disposition par le ministre de la Guerre.
Par cet enchaînement de circonstances, cette enquête sur Briey est devenue en quelque sorte l’examen critique de mon livre sur Charleroi et le mandat parlementaire, qui me fut donné, m’a permis d’en trouver les pièces justificatives.
Dans l’ordre général de la bataille de la frontière et des échecs successifs qui la marquèrent, Briey fut le pendant de Charleroi : Charleroi nous obligea à abandonner le pays de la houille, Briey le pays du fer.
On a parlé d’énigme de Charleroi ; rien pourtant n’est moins énigmatique que notre revers de Charleroi. La Germanie avait trois entrées dans la maison française, les trouées de Belfort, de Charmes et de l’Oise ; nous avions solidement verrouillé les deux premières portes, nous avons laissé la troisième grande ouverte, l’ennemi est entré par là. Charleroi est le prototypede la bataille perdue, de la surprise stratégique la plus complète, de la faute de commandement la plus extraordinaire que jamais peut-être l’Histoire ait enregistrée.
Bien plus exactement on pourrait prononcer le mot d’« énigme de Briey », car, suivant la définition académique, il n’est pas de « chose plus difficile à définir, à connaître à fond ». On trouve là le mystère le plus épais, le secret le plus étroit, le réseau le plus serré d’obscurités voulues.
C’est que du fait d’une autre « tragique erreur » on passa à Briey près d’une victoire qui eut pu influer profondément sur le cours de la guerre. Sans doute pour éviter l’irritation d’une telle déception, on couvrit ces faits d’une ombre épaisse, quasi impénétrable. Ce mystère de Briey s’expliquait au cours de la guerre ; après il n’a plus sa raison d’être ; ma mission fut d’essayer de le faire disparaître, de rechercher la vérité.
Ce faisant j’ai été amené à reconnaître que dans mon livre sur Charleroi, il existait une erreur précisément sur ce point de Briey.
Je la proclame avec d’autant moins d’embarras qu’elle est la preuve de l’indépendance absolue de mon jugement. J’avais au surplus annoncé que des erreurs y étaient inévitables, car on n’arrive pas d’un coup, sur un aussi formidable sujet, à la vérité, mais je prévoyais que ces erreurs seraient de détail et non de fond : l’examen critique auquel je me suis livré a confirmé cette prévision.
Le fait capital, la surprise du haut commandement français devant le mouvement débordant de l’aile droite allemande est maintenant hors de conteste et acquis à l’Histoire.
Un point du livre doit être rectifié –et c’est précisément l’objet du présent.
Étudiant le dispositif général du front français avant la remontée de la 5e armée sur la Sambre, j’écrivais (page 417) : « Il faut observer que dans ce dispositif, les deux ailes étaient indépendantes : entre elles se trouvait toute la région de Briey, sans défense, en sorte qu’il n’y avait pas une armée et un front, mais deux groupes d’armées. » Et, une fois la 5e armée remontée sur la Sambre, je montrais qu’à l’armée allemande, dont l’unité de front était absolue, nous opposions trois groupes d’armées sans liaison » (page 432).
À l’appellation de « la bataille des frontières » que M. Hanotaux avait donnée à cet engagement général d’août 1914, j’avais donc substitué celle de : « les batailles de la frontière » arguant de ce qu’il n’y avait qu’une frontière – celle du Nord ne faisant qu’un avec celle de l’Est puisque visée par la même menace – et qu’il y eut plusieurs batailles parce qu’il y eut plusieurs armées distinctes et sans liaison et avec des objectifs séparés.
Il m’est apparu, après ce nouvel examen, que l’appellation exacte doit être ; la bataille de la frontière.
C’est qu’en effet je voyais plusieurs armées, principalement du fait de la solution de continuité entre le groupe des 2e et 1er armées et le groupe des 3e et 4e, solution de continuité qui précisément était la région de Briey et de la Woëvre, et, avec bien d’autres, je recherchais les raisons de ce « vide de Briey ».
Or l’étude, que j’ai été amené à faire pour remplir le mandat que me donna la Commission de Briey, m’a permis de reconnaître que ce vide était plus apparent que réel. Il n’existait pas dans la pensée initiale du commandement ni dans le plan d’opérations annexé au plan 17, et, quand le mouvement débordant de l’aile droite ennemie le créa, il fut –trop tardivement, il est vrai –comblé par une armée, dont on dissimula presque l’existence, peut-être parce qu’elle était le témoin d’une grave erreur : l’armée de Lorraine, postée sur les Hauts-de-Meuse, face à Briey.
Il n’y eut donc pas deux armées distinctes, il y eut une armée en deux tronçons sans liaison ; il n’y eut pas deux ailes sans centre, il y eut une aile droite, très distante du centre, et une aile gauche, plus distante encore. Si la liaison n’exista pas sur le terrain, elle existait dans la pensée du commandement, parce que ces trois éléments, devaient coopérer à une même action d’ensemble.
Et cette région de Briey et de la Woëvre ne fut pas négligée, comme les apparences portaient à le croire. L’objectif initial de notre plan de concentration et qui, par malheur, demeura trop longtemps celui du haut commandement, fut l’investissement de Metz, et cet investissement devait se faire en partie par Briey.
C’est là que le général en chef escomptait primitivement la décision. Briey c’est la bataille attendue et préparée à l’est quand l’ennemi montait son attaque par le nord. L’erreur fut de s’hypnotiser trop longtemps sur cet objectif. Quand cette erreur ne put pas ne pas être reconnue, quand le haut commandement se vit contraint par la manœuvre de l’ennemi détendre son front de bataille pour parer à ce mouvement débordant dont il n’osa pas, au premier coup et malgré les avertissements donnés, voir l’extension par-delà la rive gauche de la Meuse, il n’abandonna pas la région de Briey, il y établit l’armée de Lorraine, qui devait se substituer à la 3e armée pour procéder à l’investissement de Metz.
L’énigme de Briey, c’est l’armée de Lorraine.
Armée fantôme, pourrait-on presque dire. En mai 1919, quand je commençai mon enquête, le ministère de la Guerre n’en soupçonnait pas l’existence ; il n’y avait pas de dossier de l’armée de Lorraine ; c’est, je crois, sur ma demande, qu’il fut créé.
Singulière destinée : établie sur le papier le 19 août 1914, constituée en fait le 21, elle fut dissoute le 25. Au cours de la bataille, dite de Virton, le 22 août, son inaction, imposée par le commandement et sans doute aussi par les circonstances même de sa constitution, empêcha la 3e armée de remporter une victoire qui eut pu être de sérieuse conséquence ; victoire, cette armée de Lorraine la saisissait, le 25, à l’heure même où elle recevait l’ordre de se dissoudre. Charleroi était survenu dans l’intervalle et force était de parer sans délai à la menace ennemie sur Paris sans défense.
Il y eut donc un drame de Briey comme il y eut un drame de Charleroi, et l’on fit le silence sur Briey plus encore que sur Charleroi.
C’est que ce coin du champ de bataille fut le seul où nous ayons eu vraiment une supériorité numérique incontestable et le seul surtout où le front ennemi eut chance de pouvoir être brisé. Une mauvaise organisation, la dispersion, l’inexistence même du commandement, une fâcheuse utilisation ou plus exactement l’inutilisation des moyens dont nous disposions empêchèrent un succès dont les conséquences eussent pu être grandes. Toute une armée de réserve, à sept divisions, resta comme immobilisée sur le champ de bataille, deux jours inerte, sans marcher au canon –et par ordre !
Le général Belin, sous-chef d’état-major au débutde la guerre, a dit à la Commission de Briey que le plan du général en chef avait failli réussir : ce fut sans doute là.
Le général Ruffey commandait la 3e armée ; il escomptait, le 22 août, le concours de deux divisions de réserve de cette armée de Lorraine ; elles lui firent défaut en pleine bataille. Le 31 août, après qu’il fut relevé de son commandement, le général Ruffey se présenta au Grand Quartier Général, et le général en chef le retint à déjeuner. Après le repas, les convives éloignés, l’ex-commandant de cette 3e armée mit l’entretien sur cette journée du 22 août : « Quel succès pour nos armes, disait-il, si l’armée de Lorraine avait marché au canon ou si j’avais eu à ma disposition les divisions de réserve sur lesquelles je croyais pouvoir compter : avec ces 40 000 hommes de troupes fraîches et la 7e division de cavalerie, nous aurions ramassé toute la gauche ennemie à bout de souffle. » Le général Ruffey affirme que, mettant un doigt sur ses lèvres, le général Joffre aurait répondu : « Chut ! il ne faut pas le dire ! »
Le général Ruffey, qui n’a rien d’un politique, fut choqué de ce propos. On le peut expliquer par le moment où il fut dit : le silence sur un tel malheur était alors nécessaire ; la guerre finie et gagnée, il ne l’est plus…
Pour terminer, un mot personnel.
Dans mon livre sur Charleroi, j’ai, le premier, révélé le rôle du général Lanrezac, le pressentiment qu’il eut dès la première heure de la manœuvre allemande, ses avertissements réitérés au Grand Quartier Général, le dédain avec lequel ces avertissements prophétiques furent accueillis. Et j’ai montré comment, à Charleroi, pressentant une menace de double enveloppement pour la 5e armée et l’armée anglaise, et osant prendre sur lui de rompre un combat qui ne pouvait aboutir qu’à un nouveau Sedan, il sauva la France en sauvant l’aile gauche française et rendit ainsi possible, après une rude retraite, le rétablissement de la Marne.
Je ne sais s’il est dans l’histoire militaire d’exemple d’une plus clairvoyante volonté. Je n’avais pas caché mon admiration pour un tel chef et je l’avais même accentuée parce qu’il était et qu’il est encore la victime de la plus grande injustice. Le général Lanrezac fut sacrifié pour des prétextes diplomatiques, en fait parce qu’il avait eu raison contre tous.
Rien n’est plus facile que d’établir une légende ; il suffit d’un étourdi et d’une dizaine de bavards. C’est ainsi qu’on prétendit que le général Lanrezac avait « inspiré » mon livre sur Charleroi, que j’étais son porte-plume, certains dirent même son avocat.
Le point de départ de cette légende fut, je crois, un propos de Polybe dans son article quotidien du Figaro du 28 mai 1918 où il commentait la tragique surprise du Chemin-des-Dames. Je ne pouvais, à un pareil moment, soulever une polémique ; le point de vue personnel disparaissait dans l’angoisse nationale. Je me contentai de demander à M. Joseph Reinach si c’était à mon livre qu’il avait fait allusion ; très franchement il ne me cacha pas qu’il avait cru reconnaître le général Lanrezac comme mon « inspirateur ». Je lui demandai de remettre à des temps moins malheureux la controverse et je laissai prescrire mon droit de réponse : depuis, malgré mon insistance, il ne me fut pas possible de l’exercer…
Cette explication, qu’il ne m’a pas été permis de donner à ceux du Figaro, je la dois à mes lecteurs.
Je répète que j’ai pour le général Lanrezac la plus haute et la plus reconnaissante admiration ; que j’ai la conviction, la certitude même, que, le 23 août 1914, en rompant le combat impossible de Charleroi, il sauva la France en lui gardant sa 5e armée, dont la présence maintint l’unité de front et permit la Marne. J’ajoute qu’à Guise il vit aussi plus clair que le haut commandement, que là encore, pour la seconde fois, sa clairvoyance et sa décision nous préservèrent d’un nouveau revers et qu’il sut, par son habileté manœuvrière, changer un insuccès stratégique en un succès tactique. J’ai reçu le témoignage de nombre de ses compagnons d’armes et des plus illustres qui, me remerciant de lui avoir enfin rendu justice, regrettaient de ne l’avoir pas eu pour chef au début de la guerre, tous déploraient sa disgrâce, déclarant que ce fut un malheur national que d’avoir privé l’armée et la France d’un tel chef.
Si donc mon œuvre avait été « inspirée » par le général Lanrezac, je ne le cacherais pas ; si j’avais été son « défenseur », ce serait pour moi un très grand honneur, et je le revendiquerais hautement ; mais ce n’est pas.
Le Correspondant, en juillet 1917, avait déjà publié trois de mes articles sur la frontière du nord et de l’est et l’esprit d’offensive. Mon dessein fut alors de relater le jeu de notre frontière militaire pendant la guerre, et, pour être parfaitement libre, je ne voulus prendre ma documentation d’aucun des chefs qui avaient participé à ces tragiques actions d’août 1914. Mon jugement ne se fit que par l’étude du livre de M. Hanotaux. Un esprit critique, que près de vingt ans de vie parlementaire ont assez affiné, me fit vite reconnaître le sens de la bataille de Charleroi et les causes de nos revers, et il m’apparut avec évidence qu’un chef, au moins, avait vu, prévu, annoncé, en un mot eu raison contre un Grand Quartier Général aveuglé. Mon jugement, alors, fut fait sur le général Lanrezac et je désirai naturellement le pouvoir connaître pour avoir de lui quelques précisions sur ce grand drame, dont il avait été l’acteur le plus clairvoyant.
Ne le connaissant pas, je fis solliciter par deux de ses camarades l’honneur d’un entretien : c’était fin août 1917. Le général Lanrezac, absent de Paris, répondit, le 1er septembre, qu’il ne pourrait me recevoir avant le mois d’octobre. Date fut prise ultérieurement pour le 27 du dit mois : le 25, le général tombait gravement malade, et l’entrevue projetée ne put avoir lieu que le 27 novembre.
Que l’on consulte la collection du Correspondant : à cette date, quatre de mes articles avaient déjà paru et le cinquième était sous presse ; dans les deux derniers, intitulés : « La genèse de Charleroi », toute ma pensée sur le grand drame est déjà très nettement formulée, et mon jugement posé.
Le général Lanrezac, assurément, me donna des précisions et me révéla des points particuliers et personnels, que je n’aurais pu autrement connaître. Ces révélations ne firent que confirmer mon jugement et n’en modifièrent aucune des bases essentielles. Le général Lanrezac pourrait dire que, pour ce qui est des grandes lignes, il ne m’apprit rien, car ce qu’il me découvrit, je l’avais préalablement deviné et même consigné par écrit.
Tout cela, je le puis établir par lettres, accompagnées de leurs enveloppes, timbrées par la poste.
L’admiration est donc absolument sincère que j’ai exprimée pour ce grand chef, à qui nous devons tant et que Y Histoire, j’en suis convaincu, placera parmi les meilleurs serviteurs de la France au cours de cette guerre. Mais il ne fut pas plus mon « inspirateur » que je ne fus son « défenseur » : je m’honore d’être maintenant son ami.
Cette confession publique était nécessaire. Les pièces officielles, que j’ai été à même de consulter au ministère de la Guerre, au cours de mon enquête sur Briey, établissent la réalité parfaite de mes affirmations sur le général Lanrezac et la claire vue qu’il eut de la situation.
Je ne veux pas qu’on puisse encore suspecter mon indépendance ni qualifier d’apologie intéressée ou même amicale une vérité historique désormais acquise.
F.E.
27 janvier 1920.
Le 20 mai 1915, les six grandes associations industrielles et agricoles d’Allemagne adressaient au chancelier de Bethmann-Hollweg un mémoire confidentiel sur les conditions de la paix future ; entre autres choses il y était dit :
« La fabrication des obus nécessite des quantités de fer et d’acier dont on ne pouvait se faire une idée autrefois… Si la production de fer brut et d’acier n’avait pas été doublée depuis le mois d’août (1914) la continuation de la guerre eût été impossible.
« Comme matière première pour la fabrication de ces quantités de fer brut et d’acier, « la minette » (minerai lorrain) prend une place de plus en plus importante, car ce minerai seul peut êtreextrait chez nous en quantités qui augmentent rapidement. La minette couvre en ce moment 60 à 80 0/0 de la fabrication du fer brut et de l’acier. Si la production de la minette était troublée, la guerre serait quasiment perdue. »
Ce mémoire fut publié, en septembre 1915, par le Comité des Forges de France. Ce jour-là, ce qu’on a appelé assez improprement la question de Briey – et qui est celle de l’ensemble du bassin minier lorrain – était posée devant l’opinion et les pouvoirs publics.
En décembre 1917, les métallurgistes allemands insistaient et accentuaient l’aveu. L’Association des industriels allemands du fer et de l’acier et l’Association des métallurgistes allemands adressaient un nouveau mémoire au gouvernement et au haut commandement en vue de l’annexion des bassins miniers de la Lorraine française à l’empire allemand ; les exposants y signalaient ainsi le péril terrible où l’Allemagne se fût trouvée si l’armée française avait pu maintenir sur ce point de Briey l’intégrité de la frontière :
« Notre production de fer brut ne s’est élevée en 1915 et 1916 qu’à 60 et 68 0/0 de la production du temps de paix ; nous n’aurions même pu obtenir ce rendement si de la forteresse de Longwy, située près de La frontière, les Français avaient bombardé avec des canons à longue portée, immédiatement après la déclaration de guerre, les objectifs faciles et dominants que présentaient les vastes constructions des puits et des forges des bassins luxembourgeois et lorrain, s’ils avaient aussitôt fait sauter leurs propres mines et leurs usines dans le voisinage de la frontière.
« Par bonheur pour nous, les Français n’ont pas réussi à détruire les organisations des districts situés des deux côtés de la frontièrefranco-allemande ; sans cela notre artillerie n’ayant pu être approvisionnée en munitions, le sort de la guerre eut été réglé en quelques semaines a notre désavantage. L’Allemagne eût été sans doute obligée d’abandonner de grands territoires sur la rive gauche du Rhin, et elle aurait perdu avec ses principaux gisements de minerai de fer –le bassin lorrain –une des sources les plus importantes de sa force, en même temps que sa situation prépondérante dans le monde…
« Même au cas où nous aurions, à la suite de la perte de la Lorraine, poussé la production de nos autres mines, nous eussions disposé de moyens de guerre sept et huit fois moindres que ceux de nos adversaires, et les empires du Centre eussent été certainement contraints, dans un bref délai, à déposer les armes.
« C’est grâce à la célérité avec laquelle ont été menées les opérations que le peuple allemand a échappé à un tel dénouement. La Belgique a été franchie ; les Français, dès le premier choc, ont été rejetés de l’autre côté de la frontière, et la guerre a été portée très avant en pays ennemi. En remportant ces succès, nous avons sauvegardé notre bassin de Lorraine et conquis, avec une partie importante du territoire français, de grands trésors de minerai de fer que nous avons mis au service de la guerre. Les mines que nous avons remises en exploitation dans le bassin de la Lorraine française firent si bien, au cours de l’année 1917, que nous pûmes, grâce à elles, faire face à tous les besoins de notre artillerie. »
Ce document, d’une importance sans égale, fut, pour la première fois, publié et commenté par M. Maurice Barrès dans quatre articles de l’Écho de Paris du 25 février au 8 mars 1918.
La question de Briey n’est pas née au Parlement ; l’opinion, dès 1916, en fut saisie par la presse, où elle fut agitée des côtés les plus divers : par Maurice Barrès et par moi-même dans l’Écho de Paris ; par le général Verraux et par Gustave Téry dans l’Œuvre ; par le général Malleterre dans le Temps ; par le sénateur Henry Bérenger dans Paris-Midi, par bien d’autres encore qu’on ne peut rappeler.
Tous ne voyaient là qu’un moyen de hâter la fin de la guerre en troublant l’exploitation par les Allemands de ce minerai de fer, qu’ils n’avaient pour ainsi dire que là, et tous signalaient avec insistance au commandement et au gouvernement cet objectif capital.
Le 29 mai 1916, M. Henry Bérenger, rapporteur de la Commission de l’armée, présentait à la Délégation sénatoriale des grandes Commissions son rapport sur « le minerai de fer, le coke métallurgique et la conduite de la guerre actuelle ». La Commission de l’armée du Sénat prenait en conséquence une délibération ainsi motivée :
« La Commission… constatant qu’il résulte d’une déclaration officielle du ministère des Travaux publics, en date du 26 mai 1916, que si l’Allemagne était privée des 30 millions de tonnes de minerai de fer de la Lorraine et du Luxembourg, l’empire allemand serait dans l’impuissance de continuer la guerre actuelle… appelle de la manière la plus pressante l’attention du gouvernement sur cette question vitale… »
En décembre 1916, de mon côté, je saisissais la Chambre, réunie en Comité secret, de cette question de Briey : je ne fus ni écouté, ni entendu.
À la longue et la réflexion aidant, on put se rendre compte du péril effroyable qu’avait fait courir à la France la perte de cette région de Briey, l’âme même de notre métallurgie.
L’évaluation du dommage a été faite par le Comité consultatif des arts et manufactures et consignée dans le Rapport général sur l’industrie française, publié en 1919 par le ministère du Commerce. Je ne fais qu’en transcrire les données essentielles :
« L’invasion de 1914 nous a privés de 83 0/0 de notre production de minerai de fer, en laissant 9 0/0 dans la zone des armées, d’une exploitation très difficile ; –de 62 0/0 de notre production de fonte, en laissant 19 0/0 dans la zone des armées et nous réduisant 19 0/0 de nos moyens ; –enfin de 60 0/0 environ de notre production d’acier. »
La perte de Briey et l’occupation de la région houillère du Nord furent l’origine et la cause essentielle de toutes nos difficultés métallurgiques et pesèrent du plus lourd poids sur les finances du pays.
M. Loucheur, ministre de la Reconstitution industrielle, l’a énergiquement déclaré à la Commission de Briey :
« Je considère que le fait de n’avoir pas sauvé à tout prix les usines de Briey est une chose extrêmement regrettable et qu’avoir été privé de toute la métallurgie du Nord et de l’Est est une chose-effroyable, qui pouvait avoir de terribles conséquences.
… La perte de Briey a été une catastrophe.
J’estime que le fait d’avoir été privé de toute la métallurgie de l’Est, du Nord et du Pas-de-Calais a pu, à un moment donné, mettre en péril le pays et, de plus, lui a coûté, au point de vue dépense à l’étranger, un prix énorme puisque de ce fait il a fallu payer en dollars et en livres toute une série de produits que nous aurions pu avoir autrement. »
La justification de ce mot de catastrophe se trouve encore dans le rapport du maréchal Foch, présenté le 25 février 1919 à la Conférence de la Paix, et connu sous le nom de Mémoire du gouvernement français sur la fixation au Rhin de la frontière occidentale de l’Allemagne et l’occupation interalliée des ponts du fleuve :
Avant même la déclaration de guerre –y peut-on lire –l’Allemagne a occupé un territoire d’où la France tirait 90 0/0 de sa production de minerai, 86 0/0 de sa production de fonte, 75 0/0 de sa production d’acier, et 95 hauts fourneaux sur 127 sont tombés aux mains de l’ennemi. Cette situation a permis à l’Allemagne de multiplier ses ressources de guerre, en même temps qu’elle privait la France de ses moyens de défense les plus nécessaires. Elle a failli aboutir à la prise de Paris en septembre 1914, de Dunkerque, deCalais et de Boulogne six semaines plus tard. Tout cela n’a été possible que parce que, à nos portes, à quelques jours de marche de notre capitale, l’Allemagne disposait de la plus formidable place d’armes offensive que l’histoire ait jamais connue. »
Et le maréchal Foch, dans ce même mémoire, affirmant le grand but de guerre que fut pour l’Allemagne le minerai de Briey, déclarait que « l’Allemagne a reconnu explicitement que, si elle a pu mener la dernière guerre, c’est en se saisissant par une attaque brusquée du minerai français sans lequel jamais, au grand jamais, elle n’aurait pu conduire victorieusement cette guerre. »
Si la perte de Briey fut « une catastrophe » au point de vue français, la perte de Thionville en eût pu être une comparable au point de vue allemand. Le 26 mai 1916, la Direction des mines remettait à M. le sénateur Henry Bérenger une note officielle où l’on peut relever cette déclaration catégorique :
« Si la région de Thionville était occupée par nos troupes, l’Allemagne serait réduite aux quelques 7 millions de tonnes de minerais pauvres qu’elle tire de la Prusse et de divers autres États ; toutes ses fabrications seraient arrêtées. Il semble donc que l’on puisse affirmer que l’occupation de la région de Thionville mettrait immédiatement fin à la guerre, parce qu’elle priverait l’Allemagne de la presque totalité du métal qui lui est nécessaire pour ses armements. »
De fait, en 1913, redisons-le une fois de plus, sur 50 millions et demi de tonnes de minerai que consommait la métallurgie allemande, 28 millions et demi provenaient de la Lorraine annexée et du Luxembourg, et, sur les 14 millions demandés à l’étranger, 4 millions environ étaient en provenance de Briey.
L’extraction de ce minerai lorrain était concentrée sur la frontière même, dans un rayon d’une trentaine de kilomètres. Le bassin lorrain annexé n’était en effet exploité que du Luxembourg jusqu’au sud de la rivière d’Orne ; le reste était gardé comme réserve. La partie exploitée s’étendait de la frontière aux coteaux de la Moselle ; le point le plus éloigné était à 12 ou 13 kilomètres, les plus rapprochés de 2 à 5 kilomètres ; les mines où se relevaient les plus fortes extractions se trouvaient sur la frontière même.
Ainsi, en défendant ce coin de notre frontière, nous eussions pu tenir sous le canon et rendre inutilisables ces mines d’où l’Allemagne tirait les deux tiers de son minerai.
C’était certainement là le défaut de la cuirasse de l’Allemagne.
Comme on le voit, le problème de Briey est double : gardant étroitement sur ce point notre frontière, nous tenions sous le canon les mines de fer, d’où les Allemands tiraient la quasi-totalité du minerai de fer nécessaire à leur métallurgie – perdant la région de Briey, nous perdions, nous, non seulement la quasi-totalité de notre production de minerai de fer, mais encore les trois quarts de notre production de fonte et plus de la moitié de notre production d’acier.
L’importance de cette région de Briey était double, économique et stratégique.
Le côté stratégique sera seul envisagé dans ce livre ; je laisse provisoirement le point de vue économique, qui se ramène à cette question : Comment le gouvernement de la République laissa-t-il se concentrer la quasi-totalité de notre production minière et métallurgique, c’est-à-dire l’âme même de notre défense nationale, sur la frontière franco-allemande, sous le canon de Metz. L’examen d’un tel problème n’est autre, en effet, que l’histoire de la métallurgie française pendant un demi-siècle : ce sera l’objet d’un autre livre.
L’histoire d’une telle erreur doit être écrite : c’est l’une des plus terribles leçons de cette terrible guerre. L’enseignement n’en doit pas être perdu ; il faut, au contraire, qu’il soit incessamment rappelé puisqu’aussi bien les conditions de notre victoire ou plus exactement de la paix qui nous fut faite, n’ont pas écarté le danger et semblent même le faire renaître.
Un point seulement doit être préalablement éclairci.
Il est acquis que dans les prévisions successives des plans de concentration, jamais n’entra la défense directe de ce coin, pourtant capital, de la frontière et que la région de Briey ne fut l’objet, à aucun moment, d’aucun projet de défense fixe, qu’elle demeura même en deçà du périmètre de la couverture.
Le pourquoi de cette énigme stratégique sera donné dans les chapitres suivants, ainsi que les raisons d’une négligence d’apparence si invraisemblable.
Il s’agit préalablement de reconnaître si l’État-Major soupçonna l’importance économique et, parce qu’économique, stratégique de cette partie de la frontière, et s’il fut exactement tenu au courant par les organes administratifs compétents d’une situation intéressant si étroitement la défense nationale.
Sut-il, en un mot, toute l’importance qu’avait pour la France, la région de Briey, siège principal et quasi unique de sa métallurgie ; sut-il surtout l’importance qu’avait pour l’Allemagne la région de Thionville, réserve minière quasi unique de sa métallurgie ?





























