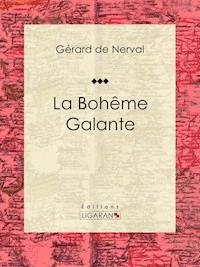
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "...Car toute littérature est nationale, n'étant créée que pour répondre à un besoin, et conformément au caractère et aux mœurs du peuple qui l'adopte ; d'où il suit que, de même qu'une graine contient un arbre entier, les premiers essais d'une littérature renferment tous les genres de son développement futur, de son développement complet et définitif..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335031003
©Ligaran 2015
La grande famille littéraire a suivi pieusement le convoi funèbre de Gérard de Nerval. À quoi bon répéter les circonstances de sa fin tragique ? Cette âme si douce n’est pas responsable de la mort violente qui l’a délivrée ; la fatalité a tout fait. Imitons les anciens, qui jetaient un voile sur la tête des victimes désignées par le sort au sacrifice. Ne faisons pas de bruit autour de la tombe de celui dont la vie fut si muette, si vague, si glissante… Ô terre ! sois-lui légère ! dit une épitaphe grecque, il a si peu pesé sur toi !
Qui n’a connu parmi nous, et qui n’a aimé à première vue ce poète au sourire d’enfant qui regardait le monde avec des yeux aussi lointains que les étoiles ?
La poésie n’était pas pour lui ce qu’elle est, ce qu’elle doit être pour les autres, une lyre qu’on prend, et qu’on dépose pour vaquer aux choses extérieures ; elle était le souffle, l’essence, la respiration même de sa nature.
Lorsque la première jeunesse est passée, il vient un moment où la Muse, comme la nourrice de Juliette, frotte d’absinthe le bout de ses seins, pour sevrer ceux que son lait enivre, les avertir que tout n’est pas poésie en ce monde, et les renvoyer aux soins et aux soucis de la vie active. Gérard de Nerval ne connut jamais cet amer sevrage des désillusions. Ses amis les plus intimes nous le montrent commençant presque au sortir du collège cette existence fantastique qui planait sur la réalité, sans s’y reposer. Jamais il ne s’inquiéta de l’avenir, du lendemain, du pain quotidien ; l’argent était trop lourd pour sa main fébrile ; elle ne savait tenir que cette chose légère comme l’oiseau dont elle est tombée : la plume du poète et du conteur. On eût dit qu’il avait fait vœu de pauvreté, avant d’entrer dans la vie, entre les mains de la divinité du rêve.
Dès ce temps-là, on remarquait en lui un instinct mobile et nomade qui depuis ne fit que grandir et se développer. Il aimait le voyage, le changement de lieu, la course aventureuse et sans but ; il s’enfonçait avec volupté dans la fuite, ses départs ressemblaient à des évasions. On le cherchait, on le demandait, on s’inquiétait de son absence ; quelque temps après on le voyait revenir souriant, effaré, ravi, comme s’il revenait du pays des fées.
Il alla de bonne heure en Allemagne ; il y retourna souvent ; il en parlait la langue, il savait par cœur ses poètes et ses philosophes ; ce fut là, peut-être, un des malheurs de sa destinée. Il faut avoir la tête forte et l’équilibre sûr pour descendre impunément dans le puits de la science germanique ; il en sort des vapeurs qui troublent et qui enivrent. L’Allemagne est le pays des hallucinations de l’intelligence ; l’ombre de ses antiques forêts contemporaines de Tacite obscurcit encore son génie ; elle y a laissé des traînées de vertige et d’obscurité. Gérard, si disposé déjà aux idées mystiques, subit l’influence de ses doctrines ténébreuses ; son esprit s’enfuma de mystagogie et de sciences occultes ; il sortit des universités et des tavernes de la jeune Allemagne dans l’égarement de l’écolier du Faust, après la consultation que vient de lui donner Méphisto.
Plus tard, il partit pour l’Orient avec quelques pièces d’or dans sa poche ; mais plus sa bourse était légère, plus il allait vite. Il avait la confiance touchante de ces premiers croisés qui partaient, eux aussi, pour la Palestine, sans vivres, sans armes, sans vaisseau, et demandaient, dans leur simplicité, à chaque bourgade qu’ils apercevaient : « N’est-ce pas là cette Jérusalem ou nous allons ? » Il a raconté lui-même, dans un livre qui est un chef-d’œuvre, les fantasques aventures de ce pèlerinage. D’autres relations complètent son récit, et nous le montrent s’acclimatant en Égypte au fatalisme et à la frugalité du désert, errant comme les derviches des Mille et une Nuits, couchant dans les bazars parmi les chameliers des caravanes, s’enivrant de soleil, de paresse et de liberté.
Là encore l’air du lieu lui fut malsain et funeste. Son séjour au Caire, la capitale du magisme et de la cabale de l’Orient, exalta ses tendances vers l’inconnu. La vieille Égypte communiqua à ses idées la plaie des ténèbres dont Moïse l’a frappée jadis. Les sphinx du Nil achevèrent ce que les fées du Rhin avaient commencé. Ses rêves s’embrouillèrent, son imagination tomba dans l’incohérence ; les dieux païens, les génies arabes, les démons du Talmud, les esprits des légendes, tous les revenants des mythologies défuntes, vinrent y faire leur sabbat, comme sur les ruines d’un temple écroulé.
Il y a douze ans, la maladie spirituelle qui couvait en lui éclata au dehors par une explosion violente et soudaine. La science parvint à le calmer ; mais il ne guérit jamais bien de cette première crise. Ce don fatal d’abstraction de la terre qu’il possédait à un si haut degré, son mélancolique parti pris de vivre en dehors de la vie réelle, des lectures, des études, des recherches et des idées fixes bizarres, surexcitèrent de plus en plus ses dispositions maladives. Il ne fuyait pas le monde, mais il vivait sur la lisière, pour ainsi dire, rôdant autour de la société d’un air étranger, et toujours ayant derrière lui un champ de liberté vaste comme la mer, dans lequel il s’échappait au moindre froissement, comme un captif qui s’éloigne d’une côte hostile à force de rames. Ses amis avaient beau le suivre du cœur et du regard, ils le perdaient de vue pendant des semaines, des mois, des années. Puis, un beau jour, on le retrouvait par hasard dans une ville de l’étranger, ou de la province, ou plus souvent encore en pleine campagne, songeant tout haut, rêvant les yeux ouverts, attentif à la chute d’une feuille, au vol d’un insecte, au passage d’un oiseau, à la forme d’un nuage, au jeu d’un rayon, à tout ce qui passe par les airs de vague et de ravissant. Jamais on ne vit folie plus douce, délire plus tendre, excentricité plus inoffensive et plus amicale. S’il se réveillait de son sommeil, c’était pour reconnaître ses amis, les aimer, les servir, redoubler envers eux de dévouement et de bienvenue, comme s’il avait voulu les dédommager de ses longues absences par un surcroît de tendresse.
Chose étrange ! au milieu du désordre intellectuel qui l’envahissait, son talent resta net, intact, accompli. Les fantaisies de son imagination prenaient, en se reflétant sur le papier, des formes aussi pures que les empreintes des camées antiques. Il dessinait ses rêves avec un crayon presque raphaélesque d’élégance et de légèreté. Vous souvenez-vous de celle jeune fille de Sycione à laquelle Plutarque attribue l’invention de la peinture ? Un soir, elle vit l’ombre de son amant vaciller sur le mur, à la clarté de la lampe ; elle prit un charbon éteint dans le trépied domestique, courut à la vague image et l’enferma dans un pur contour. Ainsi Gérard dessinait nos chimères, colorait des fantômes, mais d’une main toute grecque et d’un style sobre et clair comme la ligne d’une fresque de Pompeïa. On devine pourtant le point de vue fantastique sous lequel il peignait les figures de ses romans et de ses poèmes, à je ne sais quel jour de lune qui les éclaire. Ses Femmes du Caire, ses Filles du Feu, elles vivent, elles sont charmantes ; mais l’impondérable légèreté de leur démarche trahit leur surnaturelle origine. Elles vous apparaissent baignées et flottantes dans le fluide diaphane de l’évocation magnétique ; leurs yeux brillent de l’étrange scintillation des étoiles ; leurs pieds rasent la terre, leurs gestes expriment des signes mystérieux, leurs costumes mêmes tiennent de la nuée et de l’arc-en-ciel. Chut ! parlez plus bas, ou, comme la fiancée de l’Albano de Jean-Paul, elles vont s’évaporer, se fondre, et se résoudre en une larme tiède qui vous tombera sur le cœur.
Cependant, il y a quelques mois, l’esprit de Gérard subit une seconde éclipse. Dès lors, il fit nuit dans sa tête, mais une nuit pleine d’astres, de météores, de phénomènes lumineux. Son existence ne fut plus qu’une vision continue entrecoupée d’extases et de cauchemars. Lui-même a raconté les mystères de sa vie rêveuse dans cet étonnant récit intitulé : Aurélia, ou le Rêve et la Vie, qu’une Revue publiait le mois dernier. C’est une apocalypse d’amour, le Cantique des cantiques de la fièvre, la dictée d’un fumeur d’opium, l’essor d’une âme qui monte au ciel avec des ailes de chauve-souris, un mélange ineffable de poèmes et de grimoires, de fantasmagories et de ravissements. Pour qui sait lire, il était évident que l’esprit qui concevait de tels rêves n’appartenait plus à ce monde, qu’il avait franchi depuis longtemps la porte d’ivoire ; et que, pareil à ce moine espagnol qui sortait la nuit de son sépulcre pour aller achever dans sa cellule une exégèse commencée, lui, s’échappait de l’empire silencieux des songes pour venir les raconter à la terre. Aussi l’admiration qu’éprouvèrent ses amis à la lecture de ce chef-d’œuvre en démence fut-elle mêlée de pressentiment et d’effroi.
Personne cependant ne s’attendait à la catastrophe de sa mort. Son ivresse morale était si douce, si calme, si résignée ! On comptait pour lui sur l’ange qui guide les pas des enfants, et qui promène par la main les somnambules au bord des toits et des précipices. La maladie a trompé la surveillance de l’invisible gardien ; elle a profité d’un moment où il détournait la tête pour l’enlever brusquement. Paix à cette âme en peine de l’idéal ! puisse-t-elle avoir passé sans transition des vains songes de beauté qu’elle poursuivait ici-bas à la contemplation de l’éternelle Beauté ! puisse cet esprit errant qui ne connut jamais le repos s’être fixé dans la Lumière qui ne s’éteint pas.
Il est mort, on peut le dire, de la nostalgie du monde invisible : ouvrez-vous, portes éternelles ! et laissez entrer celui qui a passé son temps terrestre à languir et à se consumer d’attente sur votre seuil.
Que sa triste fin enseigne la sérénité et la force aux rêveurs, aux chercheurs, aux mélancoliques, à tous ceux que la vie dégoûte et qui aspirent aux choses éthérées ! La loi de la pesanteur qui fixe au sol les pieds humains doit gouverner le monde moral comme elle régit l’univers physique. Regardons l’infini, mais ne nous pendions pas trop sur le parapet de réalité qui nous en sépare, l’abîme attire ; il appelle !… Il faut savoir plier à temps son bagage de chimères, et se mettre, dépouillé de rêves, mais tranquille et résigné, à la suite des autres hommes.
PAUL DE SAINT-VICTOR.
Le cavalier GURINI (Pastor fido).
Mon ami, vous me demandez si je pourrais retrouver quelques-uns de mes anciens vers, et vous vous inquiétez même d’apprendre comment j’ai été poète, longtemps avant de devenir un humble prosateur. – Ne le savez-vous donc pas ? vous, qui avez écrit ces vers :
C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenne que nous nous étions reconnus frères –Arcades ambo, bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet.
Le vieux salon du Doyenné, restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d’une échelle, où il peignait sur un des quatre dessus de glace un Neptune, – qui lui ressemblait ! Puis, les deux battants d’un ! porte s’ouvraient avec fracas : c’était Théophile. Il cassait en s’asseyant, un vieux fauteuil Louis XIII. On s’empressait de lui offrir un escabeau gothique, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, – pendant que Cydalise Ire ou Lorry, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l’immense salon.
Quelqu’un de nous se levait parfois, et rêvait à des vers nouveaux en contemplant, des fenêtres, les façades sculptées de la galerie du Musée, égayée de ce côté par les arbres du manège.
Vous l’avez bien dit :
Ou bien, par les fenêtres opposées, qui donnaient sur l’impasse, on adressait de vagues provocations aux yeux espagnols de la femme du commissaire, qui apparaissaient assez souvent au-dessus de la lanterne municipale.
Quels temps heureux ! On donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées, – on jouait de vieilles comédies, ou mademoiselle Plessy, étant encore débutante, ne dédaigna pas d’accepter un rôle : – c’était celui de Béatrice dans Jodelet. – Et que notre pauvre Édouard Ourliac était comique dans les rôles d’Arlequin !
Nous étions jeunes, toujours gais, quelquefois riches… Biais je viens de faire vibrer la corde sombre : notre palais est rasé. J’en ai foulé les débris l’automne passé. Les ruines mêmes de la chapelle, qui se découpaient si gracieusement sur le vert des arbres, et dont le dôme s’était écroulé un jour, au dix-septième siècle, sur onze malheureux chanoines réunis pour dire un office, n’ont pas été respectées. Le jour où l’on coupera les arbres du manège, j’irai relire sur la place la Forêt coupée de Ronsard :
Cela finit ainsi, vous le savez :
Vers cette époque, je me suis trouvé, un jour, encore assez riche pour enlever aux démolisseurs et racheter en deux lots les boiseries du salon, peintes par nos amis. J’ai les deux dessus de porte de Nanteuil ; le Watteau de Vattier, signé ; les deux panneaux longs de Corot, représentant deux Paysages de Provence ; le Moine rouge, de Châtillon, lisant la Bible sur la hanche cambrée d’une femme nue, qui dort ; les Bacchantes, de Chassériau, qui tiennent des tigres en laisse comme des chiens ; les deux trumeaux de Rogier, où la Cydalise, en costume régence, – en robe de taffetas feuille morte, – triste présage, – sourit, de ses yeux chinois, en respirant une rose, en face du portrait en pied de Théophile, vêtu à l’espagnole. L’affreux propriétaire, qui demeurait au rez-de-chaussée, mais sur la tête duquel nous dansions trop souvent, après deux ans de souffrances, qui l’avaient conduit à nous donner congé, a fait couvrir depuis toutes ces peintures d’une couche à la détrempe, parce qu’il prétendait que les nudités l’empêchaient de louer à des bourgeois. – Je bénis le sentiment d’économie qui l’a porté à ne pas employer la peinture à l’huile.
De sorte que tout cela est à peu près sauvé. Je n’ai pas retrouvé le Siège de Lérida, de Lorentz, où l’armée française monte à l’assaut, précédée par des violons ; ni les deux petits Paysages de Rousseau, qu’on aura sans doute coupés d’avance ; mais j’ai, de Lorentz, une maréchale poudrée, en uniforme Louis XV.– Quant à mon lit Renaissance, à ma console Médicis, à mes buffets, à mon Ribeira, à mes tapisseries des quatre éléments, il y a longtemps que tout cela s’était dispersé. – Où avez-vous perdu tant de belles choses ? me dit un jour Balzac. – Dans les malheurs ! lui répondis-je en citant un de ses mots favoris.
Reparlons de la Cydalise, ou plutôt, n’en disons qu’un mot : – Elle est embaumée et conservée à jamais dans le pur cristal d’un sonnet de Théophile, – du Théo, comme nous disions.
Le Théophile a toujours passé pour gras ; il n’a jamais cependant pris de ventre, et s’est conservé tel encore que nous le connaissions. Nos vêtements étriqués sont si absurdes, que l’Antinoüs, habillé d’un habit, semblerait énorme, comme la Vénus, habillée d’une robe moderne : l’un aurait l’air d’un fort de la halle endimanché, l’autre d’une marchande de poisson. L’armature solide du corps de notre ami (on peut le dire, puisqu’il voyage en Grèce aujourd’hui) lui fait souvent du tort près des dames abonnées aux journaux de modes ; une connaissance plus parfaite lui a maintenu la faveur du sexe le plus faible et le plus intelligent ; il jouissait d’une grande réputation dans notre cercle, et ne se mourait pas toujours aux pieds chinois de la Cydalise.
En remontant plus haut dans mes souvenirs, je retrouve un Théophile maigre… Vous ne l’avez pas connu. Je l’ai vu, un jour, étendu sur un lit, – long et vert, – la poitrine chargée de ventouses. Il s’en allait rejoindre, peu à peu, son pseudonyme, Théophile de Viau, dont vous avez décrit les amours panthéistes, – par le chemin ombragé de l’Allée de Sylvie. Ces deux poètes, séparés par deux siècles, se seraient serré la main, aux champs Élysées de Virgile, beaucoup trop tôt.
Voici ce qui s’est passé à ce sujet :
Nous étions plusieurs amis, d’une Bohème antérieure, qui menions gaiement l’existence que nous menons encore quoique plus rassis. Le Théophile, mourant, nous faisait peine, – et nous avions des idées nouvelles d’hygiène, que nous communiquâmes aux parents. Les parents comprirent, chose rare : mais ils aimaient leur fils. On renvoya le médecin, et nous dîmes à Théo : « Lève-toi… et viens boire. » La faiblesse de son estomac nous inquiéta d’abord. (Il s’était endormi et senti malade à la première représentation de Robert le Diable.) On rappela le médecin. Ce dernier se mit à réfléchir, et, le voyant plein de santé au réveil, dit aux parents : « Ses amis ont peut-être raison. »
Depuis ce temps-là, le Théophile refleurit. – On ne parla plus de ventouses, et on nous l’abandonna. La nature l’avait fait poète, nos soins le firent presque immortel. Ce qui réussissait le plus sur son tempérament, c’était une certaine préparation de cassis sans sucre, que ses sœurs lui servaient dans d’énormes amphores en grés de la fabrique de Beauvais ; Ziégler a donné depuis des formes capricieuses à ce qui n’était alors que de simples cruches au ventre lourd. Lorsque nous nous communiquions nos inspirations poétiques, on faisait, par précaution, garnir la chambre de matelas, afin que le paroxysme, dû quelquefois au Bacchus du cassis, ne compromît pas nos têtes avec les angles des meubles.
Théophile, sauvé, n’a plus bu que de l’eau rougie et un doigt de champagne dans les petits soupers.
Revenons-y. – Nous avions désespéré d’attendrir la femme du commissaire. – Son mari, moins farouche qu’elle, avait répondu, par une lettre fort polie, à l’invitation collective que nous leur avions adressée. Comme il était impossible de dormir dans ces vieilles maisons, à cause des suites chorégraphiques de nos soupers, – munis du silence complaisant des autorités voisines, – nous invitions tous les locataires distingués de l’impasse, et nous avions une collection d’attachés d’ambassades, en habits bleus à boutons d’or, de jeunes conseillers d’État, de référendaires en herbe, dont la nichée d’hommes déjà sérieux, mais encore aimables, se développait dans ce pâté de maisons, en vue des Tuileries et des ministères voisins. Ils n’étaient reçus qu’à condition d’amener des femmes du monde, protégées, si elles y tenaient, par des dominos et des loups.
Les propriétaires et les concierges étaient seuls condamnés à un sommeil troublé – par les accords d’un orchestre de guinguette choisi à dessein, et par les bonds éperdus d’un galop monstre, qui, de la salle aux escaliers et des escaliers à l’impasse, allait aboutir nécessairement à une petite place entourée d’arbres, – où un cabaret s’était abrité sous les ruines imposantes de la chapelle du Doyenné. Au clair de lune, on admirait encore les restes de la vaste coupole italienne qui s’était écroulée, au dix-septième siècle, sur les onze malheureux chanoines, – accident duquel le cardinal Mazarin fut un instant soupçonné.
Mais vous me demanderez d’expliquer encore, en pâle prose, ces quatre vers de votre pièce intitulée : Vingt ans.
Pourquoi du Sabbat… mon cher ami ? et pourquoi jeter maintenant de l’absinthe dans cette coupe d’or, moulée sur un beau sein ?
Ne vous souvenez-vous plus des vers de votre Cantique des Cantiques, où l’Ecclésiaste nouveau s’adresse à cette même reine du matin :
Nous reprendrons plus tard ce discours littéraire et philosophique.
La reine de Saba, c’était bien celle, en effet, qui me préoccupait alors, – et doublement. – Le fantôme éclatant de la fille des Hémiarites tourmentait mes nuits sous les hautes colonnes de ce grand lit sculpté, acheté en Touraine, et qui n’était pas encore garni de sa brocatelle rouge à ramages. Les salamandres de François 1er me versaient leur flamme du haut des corniches, où se jouaient des amours imprudents. Elle m’apparaissait radieuse, comme au jour où Salomon l’admira s’avançant vers lui dans les splendeurs pourprées du matin. Elle venait me proposer l’éternelle énigme que le Sage ne put résoudre, et ses yeux, que la malice animait plus que l’amour, tempéraient seuls la majesté de son visage oriental. – Qu’elle était belle ! non pas plus belle cependant qu’une autre reine du matin dont l’image tourmentait mes journées.
Cette dernière réalisait vivante mon rêve idéal et divin. Elle avait, comme l’immortelle Balkis, le don communiqué par la huppe miraculeuse. Les oiseaux se taisaient en entendant ses chants, – et l’auraient certainement suivie à travers les airs.
La question était de la faire débuter à l’Opéra. Le triomphe de Meyerbeer devenait le garant d’un nouveau succès. J’osai en entreprendre le poème. J’aurais réuni ainsi dans un trait de flamme les deux moitiés de mon double amour. – C’est pourquoi, mon ami, vous m’avez vu si préoccupé dans une de ces nuits splendides où notre Louvre était en fête. – Un mot de Dumas m’avait averti que Meyerbeer nous attendait à sept heures du matin.
Je ne songeais qu’à cela au milieu du bal. Une femme, que vous vous rappelez sans doute, pleurait à chaudes larmes dans un coin du salon, et ne voulait, pas plus que moi, se résoudre à danser. Cette belle éplorée ne pouvait parvenir à cacher ses peines. Tout à coup elle me prit le bras et me dit : « Ramenez-moi, je ne puis rester ici. »
Je sortis en lui donnant le bras. Il n’y avait pas de voiture sur la place. Je lui conseillai de se calmer et de sécher ses yeux, puis de rentrer ensuite dans le bal ; elle consentit seulement à se promener sur la petite place. Je savais ouvrir une certaine porte en planches qui donnait sur le manège, et nous causâmes longtemps au clair de lune, sous les tilleuls. Elle me raconta longuement tous ses désespoirs.
Celui qui l’avait amenée s’était épris d’une autre ; de là une querelle intime ; puis elle avait menacé de s’en retourner seule ou accompagnée ; il lui avait répondu qu’elle pouvait bien agir à son gré. De là les soupirs, de là les larmes.
Le jour ne devait pas tarder à poindre. La grande sarabande commençait. Trois ou quatre peintres d’histoire, peu danseurs de leur nature, avaient fait ouvrir le petit cabaret et chantaient à gorge déployée : Il était un raboureur, ou bien : C’était un calonnier qui revenait de Flandre, souvenir des réunions joyeuses de la mère Saguet. – Notre asile fut bientôt troublé par quelques masques qui avaient trouvé ouverte la petite porte. On parlait d’aller déjeuner à Madrid, – au Madrid du bois de Boulogne, – ce qui se faisait quelquefois. Bientôt le signal fut donné, on nous entraîna, et nous partîmes à pied, les uns se trompant de femmes et se trompant de chemin, – vous vous en souvenez, – les autres escortés par trois gardes françaises, dont deux étaient simplement MM. d’Egmont et de Beauvoir ; – le troisième, c’était Giraud, le peintre ordinaire des gardes françaises.
Les sentinelles des Tuileries ne pouvaient comprendre cette apparition inattendue qui semblait le fantôme d’une scène d’il y a cent ans, où des gardes françaises auraient mené au violon une troupe de masques tapageurs. De plus, l’une des deux petites marchandes de tabac si jolies qui faisaient l’ornement de nos bals n’osa se laisser emmener à Madrid sans prévenir son mari, qui gardait la maison. Nous l’accompagnâmes à travers les rues. Elle frappa à sa porte. Le mari parut à la fenêtre de l’entresol. Elle lui cria : « Je vais déjeuner avec ces messieurs. » Il répondit : « Va-t’en au diable ! c’était bien la peine de me réveiller pour cela ! »
La belle désolée faisait une résistance assez faible pour se laisser entraîner à Madrid, et moi je faisais mes adieux à Rogier en lui expliquant que je voulais aller travailler à mon scénario : « Comment ! tu ne nous suis pas ; cette dame n’a plus d’autre cavalier que toi… et elle t’avait choisi pour la reconduire. – Mais j’ai rendez-vous à sept heures chez Meyerbeer, entends-tu bien ! »
Rogier fut pris d’un fou rire. Un de ses bras était pris par la Cydalise ; il offrit l’autre à la belle dame, qui me salua d’un petit air moqueur. J’avais servi du moins à faire succéder un sourire à ses larmes.
J’avais quitté la proie pour l’ombre… comme toujours !
Nous conterons le reste de l’aventure. Mais vous m’avez rappelé, mon cher Houssaye, qu’il s’agissait de causer poésie, et j’y arrive incidemment. – Reprenons cet air académique que vous m’avez reproché.
Je crois bien que vous vouliez faire allusion au Mémoire que j’ai adressé autrefois à l’institut, à l’époque où il s’agissait d’un concours sur l’histoire de la poésie au seizième siècle. J’en ai retrouvé quelques fragments qui intéresseront peut-être les lecteurs de l’Artiste, comme le sermon que le bon Sterne mêla aux aventures macaroniques de Tristam Shandy.
Il faut l’avouer, avec tout le respect possible pour les auteurs du grand siècle, ils ont trop resserré le cercle des compositions poétiques ; sûrs pour eux-mêmes de ne jamais manquer d’espace et de matériaux, ils n’ont point songé à ceux qui leur succéderaient, ils ont dérobé leurs neveux, selon l’expression du Métromane : au peint qu’il ne nous reste que deux partis à prendre, ou de les surpasser, ainsi que je viens de dire, ou de poursuivre une littérature d’imitation servile qui ira jusqu’où elle pourra ; c’est-à-dire qui ressemblera à cette suite de dessins si connue, où, par des copies successives et dégradées, on parvient à faire du profil d’Apollon une tête hideuse de grenouille.
De pareilles observations sont bien vieilles, sans doute, mais il ne faut pas se lasser de les remettre devant les yeux du public, puisqu’il y a des gens qui ne se lassent pas de répéter les sophismes qu’elles ont réfutés depuis longtemps. En général, on paraît trop craindre, en littérature, de redire sans cesse les bonnes raisons ; on écrit trop pour ceux qui savent ; et il arrive de là que les nouveaux auditeurs qui surviennent tous les jours à cette grande querelle, ou ne comprennent point une discussion déjà avancée, ou s’indignent de voir tout à coup, et sans savoir pourquoi, remettre en question des principes adoptés depuis des siècles.
Il ne s’agit donc pas (loin de nous une telle pensée !) de déprécier le mérite de tant de grands écrivains à qui la France doit sa gloire ; mais, n’espérant point faire mieux qu’eux, de chercher à faire autrement, et d’aborder tous les genres de littérature dont ils ne se sont point emparés.
Et ce n’est pas à dire qu’il faille pour cela imiter les étrangers ; mais seulement suivre l’exemple qu’ils nous ont donné, en étudiant profondément nos poètes primitifs, comme ils ont fait des leurs.
Car toute littérature primitive est nationale, n’étant créée que pour répondre à un besoin, et conformément au caractère et aux mœurs du peuple qui l’adopte ; d’où il suit que, de même qu’une graine contient un arbre entier, les premiers essais d’une littérature renferment tous les germes de son développement futur, de son développement complet et définitif.
Il suffit, pour faire comprendre ceci, de rappeler ce qui s’est passé chez nos voisins : après des littératures d’imitation étrangère, comme était notre littérature dite classique, après le siècle de Pope et d’Adisson, après celui de Vieland et de Lessing, quelques gens à courte vue ont pu croire que tout était dit pour l’Angleterre et pour l’Allemagne…
Tout ! Excepté les chefs-d’œuvre de Walter Scott et de Byron, excepté ceux de Schiller et de Gœthe ; les uns, produits spontanés de leur époque et de leur sol ; les autres, nouveaux et forts rejetons de la souche antique : tour abreuvés à la source des traditions, des inspirations primitives de leur patrie, plutôt qu’à celle de l’Hippocrène.
Ainsi, que personne ne dise à l’art : Tu n’iras pas plus loin ! au siècle : Tu ne peux dépasser les siècles qui t’ont précédé !… C’est là ce que prétendait l’antiquité en posant les bornes d’Hercule : le Moyen Âge les a méprisées, et il a découvert un monde.
Peut-être ne reste-t-il plus de mondes à découvrir ; peut-être le domaine de l’intelligence est-il au complet aujourd’hui et peut-on en faire le tour, comme du globe ; mais il ne suffit pas que tout soit découvert ; dans ce cas même, il faut cultiver, il faut perfectionner ce qui est resté inculte ou imparfait. Que de plaines existent que la culture aurait rendues fécondes ! que de riches matériaux, auxquels il n’a manqué que d’être mis en œuvre par des mains habiles ! que de ruines de monuments inachevés… Voilà ce qui s’offre à nous, et dans notre patrie même, à nous qui nous étions bornés si longtemps à dessiner magnifiquement quelques jardins royaux, à les encombrer de plantes et d’arbres étrangers conservés à grands frais, à les surcharger de dieux de pierre, à les décorer de jets d’eau et d’arbres taillés en portiques.
Mais arrêtons-nous ici, de peur qu’en combattant trop vivement le préjugé qui défend à la littérature française, comme mouvement rétrograde, un retour d’étude et d’investigation vers son origine, nous ne paraissions nous escrimer contre un fantôme, ou frapper dans l’air comme Entelle : le principe était plus contesté au temps où un célèbre écrivain allemand envisageait ainsi l’avenir de ta poésie française :
« Si la poésie (nous traduisons M. Schlegel) pouvait plus tard refleurir en France, je crois que cela ne serait point par l’imitation des Anglais ni d’aucun autre peuple, mais par un retour à l’esprit poétique en général, et en particulier à la littérature française des temps anciens. L’imitation ne conduira jamais la poésie d’une nation à son but définitif, et surtout l’imitation d’une littérature étrangère parvenue au plus grand développement intellectuel et moral dont elle est susceptible : mais il suffit à chaque peuple de remonter à la source de sa poésie et à ses traditions populaires pour y distinguer et ce qui lui appartient en propre et ce qui lui appartient en commun avec les autres peuples. Ainsi l’inspiration religieuse est ouverte à tous, et toujours il en sort une poésie nouvelle, convenable à tous les esprits et à tous les temps : c’est ce qu’a compris Lamartine, dont les ouvrages annoncent à la France une nouvelle ère poétique, » etc.
Mais avions-nous en effet une littérature avant Malherbe ? observent quelques irrésolus, qui n’ont suivi de cours de littérature que celui de la Harpe. – Pour le vulgaire des lecteurs, non ! Pour ceux qui voudraient voir Rabelais et Montaigne mis en français moderne, pour ceux à qui le style de la Fontaine et de Molière paraît tant soit peu négligé, non ! Mais pour ces intrépides amateurs de poésie et de langue française que n’effraye pas un mot vieilli, que n’égaye pas une expression triviale ou naïve, que ne démontent point les oncques, les ainçois et les ores, oui ! Pour les étrangers qui ont puisé tant de fois à cette source, oui !… Du reste, ils ne craignent point de le reconnaître, et rient bien fort de voir souvent nos écrivains s’accuser humblement d’avoir pris chez eux des idées qu’eux-mêmes avaient dérobées à nos ancêtres.
Nous dirons donc maintenant : Existait-il une littérature nationale avant Ronsard ? mais une littérature complète, capable par elle-même, et à elle seule, d’inspirer des hommes de génie, et d’alimenter de vastes conceptions ? Une simple énumération va nous prouver qu’elle existait : qu’elle existait, divisée en deux parties bien distinctes, comme la nation elle-même, et dont par conséquent l’une, que les critiques allemands appellent littérature chevaleresque, semblait devoir son origine aux Normands, aux Bretons, aux Provençaux et aux Francs ; dont l’autre, native du cœur même de la France, et essentiellement populaire, est assez bien caractérisée par l’épithète de gauloise.
La première comprend : les poèmes historiques, tels que les romans de Rou (Rollon) et du Brut (Brutus), la Philippide, le Combat des 30 Bretons, etc. ; les poèmes chevaleresques, tels que le St-Graal, Tristan, Partenopex, Lancelot, etc. ; les poèmes allégoriques, tels que le roman de la Rose, du Renard, etc., et enfin toute la poésie légère, chansons, ballades, lais, chants royaux, plus la poésie provençale ou romane tout entière.
La seconde comprend les mystères, moralités et farces (y compris Patelin) ; les fabliaux, contes, facéties, livres satiriques, noëls, etc. ; toutes œuvres où le plaisant dominait, mais qui ne laissent pas d’offrir souvent des morceaux profonds ou sublimes, et des enseignements d’une haute morale parmi des flots de gaieté frivole et licencieuse.
Eh bien ! qui n’eût promis l’avenir à une littérature aussi forte, aussi variée dans ses éléments, et qui ne s’étonnera de la voir tout à coup renversée, presque sans combat, par une poignée de novateurs qui prétendaient ressusciter la Rome morte depuis seize cents ans, la Rome romaine, et la ramener victorieuse, avec ses costumes, ses formes et ses dieux, chez un peuple du nord, à moitié composé de nations germaniques, et dans une société toute chrétienne ? ces novateurs, c’était Ronsard et les poètes de son école ; le mouvement imprimé par eux aux lettres s’est continué jusqu’à nos jours.
Il serait trop long de nous occuper à faire l’histoire de la haute poésie en France, car elle était vraiment en décadence au siècle de Ronsard ; flétrie dans ses germes, morte sans avoir acquis le développement auquel elle semblait destinée ; tout cela parce qu’elle n’avait trouvé pour l’employer que des poètes de cour qui n’en tiraient que des chants de fêtes, d’adulation et de fade galanterie ; tout cela faute d’hommes de génie qui sussent la comprendre et en mettre en œuvre les riches matériaux. Ces hommes de génies se sont rencontrés cependant chez les étrangers, et l’Italie surtout nous doit ses plus grands poètes du Moyen Âge ; mais, chez nous, à quoi avaient abouti les hautes promesses des douzième et treizième siècles ? À je ne sais quelle poésie ridicule, où la contrainte métrique, ou des tours de force en fait de rime tenaient lieu de couleur et de poésie ; à de fades et obscurs poèmes allégoriques, à des légendes lourdes et diffuses, à d’arides récits historiques rimes, tout cela recouvert d’un langage poétique plus vieux de cent ans que la prose et le langage usuel, car les rimeurs d’alors imitaient si servilement les poètes qui les avaient précédés, qu’ils en conservaient même la langue surannée. Aussi tout le monde s’était dégoûté de la poésie dans les genres sérieux, et l’on ne s’occupait plus qu’à traduire les poèmes et romans du douzième siècle dans cette prose qui croissait tous les jours en grâce et en vigueur. Enfin il fut décidé que la langue française n’était pas propre à la haute poésie, et les savants se hâtèrent de profiter de cet arrêt pour prétendre qu’on ne devait plus la traiter qu’en vers latins et en vers grecs.
Quant à la poésie populaire, grâce à Villon et à Marot, elle avait marché de front avec la prose illustrée par les Joinville, les Froissart et les Rabelais ; mais, Marot éteint, son école n’était pas de taille à le continuer : ce fut elle cependant qui opposa à Ronsard la plus sérieuse résistance, et certes, bien qu’elle ne comptât plus d’hommes supérieurs, elle était assez forte sur l’épigramme : la tenaille de Mellin1, qui pinçait si fort Ronsard au milieu de sa gloire, a fait proverbe.
Je ne sais si le peu de phrases que je viens de hasarder suffit pour montrer la littérature d’alors dans cet état d’interrègne qui suit la mort d’un grand génie, ou la fin d’une brillante époque littéraire, comme cela s’est vu plusieurs fois depuis ; si l’on se représente bien le troupeau des écrivains du second ordre se tournant inquiet à droite et à gauche et cherchant un guide : les uns fidèles à la mémoire des grands hommes qui ne sont plus, et laissant dans les rangs une place pour leur ombre ; les autres tourmentés d’un vague désir d’innovation qui se produit en essais ridicules ; les plus sages faisant des théories et des traductions… Tout à coup un homme apparaît, à la voix forte, et dépassant la foule de la tête : celle-ci se sépare en deux partis, la lutte s’engage, et le géant finit par triompher, jusqu’à ce qu’un plus adroit lui saute sur les épaules et soit seul proclamé très grand.
Mais n’anticipons pas : nous sommes en 1549, et à peu de mois de distance apparaissent la Défense et Illustration de la Langue française, et les premières Odes pindariques de Pierre de Ronsard.
La défense de la langue française, par J. Dubellay, l’un des compagnons et des élèves de Ronsard, est un manifeste contre ceux qui prétendaient que la langue française était trop pauvre pour la poésie, qu’il fallait la laisser au peuple, et n’écrire qu’en vers grecs et latins ; Dubellay leur répond : « que les langues ne sont pas nées d’elles-mêmes en façon d’herbes, racines et arbres ; les unes infirmes et débiles en leurs espérances, les autres saines et robustes et plus aptes à porter le faix des conceptions humaines, mais que toute leur vertu est née au monde, du vouloir et arbitre des mortels. C’est pourquoi on ne doit ainsi louer une langue et blâmer l’autre, vu qu’elles viennent toutes d’une même source et origine : c’est la fantaisie des hommes ; et ont été formées d’un même jugement à une même fin : c’est pour signifier entre nous les conceptions et intelligences de l’esprit. Il est vrai que par succession de temps, les unes, pour avoir été curieusement réglées, sont devenues plus riches que les autres ; mais cela ne se doit attribuer à la félicité desdites langues, mais au seul artifice et industrie des hommes. À ce propos, je ne puis assez blâmer la sotte arrogance et témérité d’aucuns de notre nation, qui n’étant rien moins que grecs ou latins, déprisent ou rejettent d’un sourcil plus que stoïque toutes choses écrites en français. »
Il continue en prouvant que la langue française ne doit pas être appelée barbare, et recherche cependant pourquoi elle n’est pas si riche que les langues grecque et latine : « On le doit attribuer à l’ignorance de nos ancêtres, qui, ayant en plus grande recommandation le bien faire que le bien dire, se sont privés de la gloire de leurs bienfaits, et nous du fruit de l’imitation d’iceux, et, par le même moyen, nous ont laissé notre langue si pauvre et nue, qu’elle a besoin des ornements, et, s’il faut parler ainsi, des plumes d’autrui. Mais qui voudrait dire que la grecque et romaine eussent toujours été en l’excellence qu’on les a vues au temps d’Horace et de Démosthènes, de Virgile et de Cicéron ? Et si ces auteurs eussent jugé que jamais, pour quelque diligence et culture qu’on eût pu faire, elles n’eussent su produire plus grand fruit, se fussent-ils tant efforcés de les mettre au point où nous les voyons maintenant ? Ainsi puis-je dire de notre langue qui commence encore à fleurir, sans fructifier ; cela, certainement, non par le défaut de sa nature, aussi apte à engendrer que les autres, mais par la faute de ceux qui l’ont eue en garde et ne l’ont cultivée à suffisance. Que si les anciens Romains eussent été aussi négligés à la culture de leur langue, quand premièrement elle commença à pulluler, pour certain en si peu de temps elle ne fût devenue si grande ; mais eux, en guise de bons agriculteurs, l’ont premièrement transmué d’un lieu sauvage dans un lieu domestique, puis, afin que plutôt et mieux elle pût fructifier, coupant à l’entour les inutiles rameaux, l’ont, pour échange d’iceux, restaurée de rameaux francs et domestiques, magistralement tirés de la langue grecque, lesquels soudainement se sont si bien entés et faits semblables à leurs troncs, que désormais ils n’apparaissent plus adoptifs, mais naturels. »
Nous venons de voir ce qu’il pense des faiseurs de vers latins, et des traducteurs ; voici maintenant pour les imitateurs de la vieille littérature : « Et certes, comme ce n’est point chose vicieuse, mais grandement louable, d’emprunter d’une langue étrangère les sentences et les mots, et les approprier à la sienne : aussi est-ce chose grandement à reprendre, voire odieuse à tout lecteur de libérale nature, de voir en une même langue une telle imitation, comme celle d’aucuns savants mêmes, qui s’estiment être des meilleurs plus ils ressemblent à Héroët ou à Marot. Je t’admoneste donc, ô toi qui désires l’accroissement de ta langue et veux y exceller, de n’imiter à pied levé, comme naguère a dit quelqu’un, les plus fameux auteurs d’icelle ; chose certainement aussi vicieuse comme de nul profit à notre vulgaire, vu que ce n’est autre chose, sinon lui donner ce qui était à lui. »
Il jette un regard sur l’avenir, et ne croit pas qu’il faille désespérer d’égaler les Grecs et les Romains : « Et comme Homère se plaignait que de son temps les corps étaient trop petits, il ne faut point dire que les esprits modernes ne sont à comparer aux anciens ; l’architecture, l’art du navigateur et autres inventions antiques, certainement sont admirables, et non si grandes toutefois qu’on doive estimer les cieux et la nature d’y avoir dépensé toute leur vertu, vigueur et industrie. Je ne produirai pour témoins de ce que je dis l’imprimerie, sœur des muses et dixième d’elles, et cette non moins admirable que pernicieuse foudre d’artillerie ; avec tant d’autres non antiques inventions qui montrent véritablement que, par le long cours des siècles, les esprits des hommes ne sont point si abâtardis qu’on voudrait bien dire. Mais j’entends encore quelque opiniâtre s’écrier : « Ta langue tarde trop à recevoir sa perfection ; » et je dis que ce retardement ne prouve point qu’elle ne puisse la recevoir ; je dis encore qu’elle se pourra tenir certain de la garder longuement, l’ayant acquise avec si longue peine ; suivant la loi de nature qui a voulu que tout arbre qui naît fleurit et fructifie bientôt, bientôt aussi vieillisse et meure, et au contraire que celui-là dure par longues années qui a longuement travaillé à jeter ses racines. »
Ici finit le premier livre, où il n’a été encore question que de la langue et du style poétique ; dans le second, la question est abordée plus franchement, et l’intention de renverser l’ancienne littérature et d’y substituer les formes antiques et exprimée avec plus d’audace :
« Je penserai avoir beaucoup mérité des miens si je leur montre seulement du doigt le chemin qu’ils doivent suivre pour atteindre à l’excellence des anciens : mettons donc pour le commencement ce que nous avons, ce me semble, assez prouvé au premier livre. C’est que, sans l’imitation des Grecs et Romains, nous ne pouvons donner à notre langue l’excellence et lumière des autres plus fameuses. Je sais que beaucoup me reprendront d’avoir osé, le premier des Français, introduire quasi une nouvelle poésie, ou ne se tiendraient pleinement satisfaits, tant pour la brièveté dont j’ai voulu user que pour la diversité des esprits don les uns trouvent bon ce que les autres trouvent mauvais. Marot me plaît, dit quelqu’un, parce qu’il est facile et ne s’éloigne point de la commune manière de parler ; Héroët, dit quelque autre, parce que tous ses vers sont doctes, graves et élaborés ; les autres d’un autre se délectent. Quant à moi, telle superstition ne m’a point retiré de mon entreprise, parce que j’ai toujours estimé notre poésie française être capable de quelque plus haut et merveilleux style que celui dont nous nous sommes si longuement contentés. Disons donc brièvement ce que nous semble de nos poètes français.
« De tous les anciens poètes français, quasi un seul, Guillaume de Loris et Jean de Meun, sont dignes d’être lus, non tant pour ce qu’il y ait en eux beaucoup de choses qui se doivent imiter des modernes, que pour y voir quasi une première image de la langue française, vénérable pour son antiquité. Je ne doute point que tous les pères crieraient la honte être perdue si j’osais reprendre ou émender quelque chose en ceux que jeunes ils ont appris, ce que je ne veux faire aussi ; mais bien soutiens-je que celui-là est trop grand admirateur de l’ancienneté qui veut défrauder les jeunes de leur gloire méritée ; n’estimant rien, sinon ce que la mort a sacré, comme si le temps, ainsi que les vins, rendait les poésies meilleures. Les plus récents, même ceux qui ont été nommés par Clément Marot en une certaine épigramme à Salel, sont assez connus par leurs œuvres ; j’y renvoie les lecteurs pour en faire jugement. »
Il continue par quelques louanges et beaucoup de critiques des auteurs du temps, et revient à son premier dire, qu’il faut imiter les anciens, « et non point les auteurs français, pour ce qu’en ceux-ci on ne saurait prendre que bien peu, comme la peau et la couleur, tandis qu’en ceux-là on peut prendre la chair, les os, les nerfs et le sang.





























