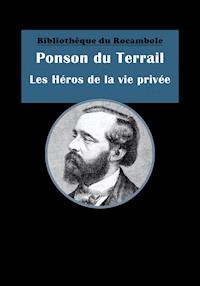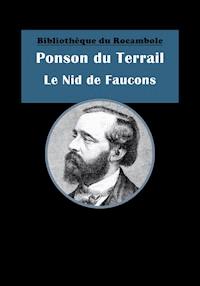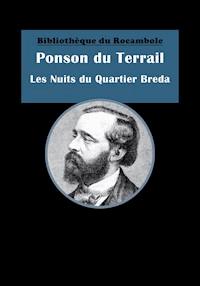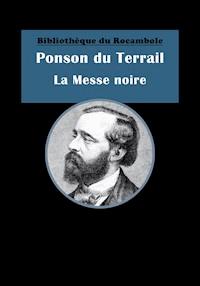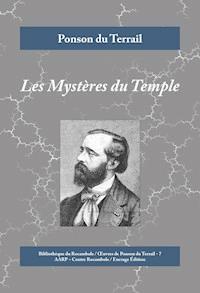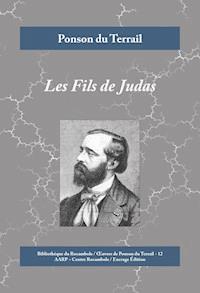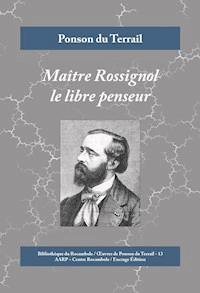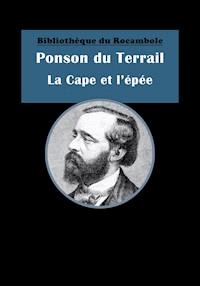
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un roman d'aventures historiques épique et truffé de rebondissements !
La Cape et l’épée n’est pas le premier roman d’aventures historiques écrit par Ponson et pourtant c’est lui qui porte le titre emblématique du genre — dont on trouve des occurrences bien avant lui.
Récit d’amour et de batailles privées plus que de situations et de conflits relevant réellement de la grande Histoire, ce roman possède bon nombre de qualités qui feront le succès de l’auteur : rapidité de l’action, suspense et retournement des personnages, quiproquos... auxquels s’ajoute une morale qui lui est chère : solidité inébranlable de la fraternité et de l’amitié, fidélité aux idéaux de la caste et de la patrie.
L’époque est celle de la mort de François Ier et du début du règne de Henri II. Elle précède donc juste l’époque favorite de Ponson : les guerres de religion, la fin des Valois et la prise du pouvoir par Henri IV... Et y apparaît déjà un personnage qui occupera une place incomparable dans son œuvre : Catherine de Médicis, ici modeste dauphine.
Un véritable classique du genre !
EXTRAIT
À Milan, la noble ville, il y avait, vers l’année 1544, un armurier célèbre, du nom de Guasta-Carne, ce qui voulait dire Gâte-Chair.
Maître Guasta-Carne avait forgé les plus nobles épées qui eussent étincelé depuis un demi-siècle au soleil poudreux des champs de bataille ; il avait ciselé les plus fines armures et trempé les dagues les meilleures qui jamais eussent rebondi sur le haubert d’un gentilhomme.
Il avait fabriqué la cuirasse que François Ier portait à Marignan et le casque qui couvrait la tête de l’empereur Charles-Quint les jours de bataille.
Quand deux gentilshommes avaient querelle d’amour ou d’honneur, et qu’il leur paraissait convenable d’en appeler au jugement de Dieu, c’était chez Guasta-Carne, l’armurier, qu’ils allaient quérir les rapières destinées à cet usage. Le maître n’était point seulement un ouvrier merveilleusement habile, un trempeur justement renommé, c’était encore un professeur sans rivaux en la galante science de l’escrime, un maître d’armes dont la réputation éclatante faisait pâlir la gloire des plus savants tireurs de l’Italie.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ponson du Terrail est né en 1829 et mort en 1871. S'inspirant tout d'abord du genre gothique, Ponson du Terrail se tourne rapidement vers le roman-feuilleton, style dont il devient une figure emblématique. Dans la veine des
Mystères de Paris d'Eugène Sue, il crée le célèbre personnage de Rocambole.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposédans le cadre des ressourcesdu Centre Rocamboleaccessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de Ponson du Terrail - 4
collection dirigée par Alfu
Ponson du Terrail
La Cape et l’épée
1855
AARP — Centre Rocambole
Encrage édition
© 2011
ISBN 978-2-36058-924-1
Préface
d’Alfu
La Cape et l’épée, épisode du règne de Henri II 1 est publié pour la première fois dans le journal L’Assemblée Nationale, du 19 décembre 1855 au 28 mars 1856. A cette époque, Ponson du Terrail a déjà donné dans la presse un certain nombres de feuilletons « de longue haleine », depuis Les Coulisses du monde (1852) jusqu’au Filleul du roi (1855), en passant par Les Cavaliers de la nuit (1852) et La Tour des Gerfauts (1853).
Ce n’est pas son premier roman d’aventures historiques et pourtant c’est celui qui porte le titre emblématique du genre. Un titre dont Ponson n’est pas l’inventeur — plusieurs autres emplois pouvant être trouvés antérieurement, dont celui de Roger de Beauvoir (1837) — et qu’il abandonnera ensuite au profit de : L’Armurier de Milan, désormais employé pour cette œuvre.
Récit d’amour et de batailles privées plus que de situations et de conflits relevant réellement de la grande Histoire, La Cape et l’épée possède bon nombre de qualités qui feront le succès de l’auteur : rapidité de l’action, suspense et retournement des personnages, quiproquos… auxquels s’ajoute une morale qui lui est chère : solidité inébranlable de la fraternité et de l’amitié, fidélité aux idéaux de la caste et de la patrie.
L’action privilégiée entre toutes dans son œuvre, le duel, n’apporte ici, contrairement à l’habitude, que peu de suspense. La chasse — inévitable elle aussi, — pour être moins présente n’en est pas moins très dense.
L’époque est celle de la mort de François Ier et du début du règne de Henri II. Elle précède donc juste l’époque favorite de Ponson : les guerres de religion, la fin des Valois et la prise du pouvoir par Henri IV — qui deviendra le second grand héros ponsonien après Rocambole. Mais déjà apparaît, dans un rôle non négligeable, la figure importante de Catherine de Médicis — ici, jeune épousée à laquelle son mari préfère encore sa maîtresse, Diane de Poitiers.
La Cape et l’épée est très représentatif de l’œuvre de son auteur qui use des grands thèmes de l’autre-littérature — enfant trouvé, jalousie, complot… — pour leur donner, grâce à son talent, un nouvel essor.
Alfu
1Pour une approche plus complète de ce roman, lire la notice qui lui est consacrée dans : Alfu présente Ponson du Terrail. Dictionnaire des œuvres (Encrage, 2008).
1.
A Milan, la noble ville, il y avait, vers l’année 1544, un armurier célèbre, du nom de Guasta-Carne, ce qui voulait dire Gâte-Chair.
Maître Guasta-Carne avait forgé les plus nobles épées qui eussent étincelé depuis un demi-siècle au soleil poudreux des champs de bataille ; il avait ciselé les plus fines armures et trempé les dagues les meilleures qui jamais eussent rebondi sur le haubert d’un gentilhomme.
Il avait fabriqué la cuirasse que François Ier portait à Marignan et le casque qui couvrait la tête de l’empereur Charles-Quint les jours de bataille.
Quand deux gentilshommes avaient querelle d’amour ou d’honneur, et qu’il leur paraissait convenable d’en appeler au jugement de Dieu, c’était chez Guasta-Carne, l’armurier, qu’ils allaient quérir les rapières destinées à cet usage. Le maître n’était point seulement un ouvrier merveilleusement habile, un trempeur justement renommé, c’était encore un professeur sans rivaux en la galante science de l’escrime, un maître d’armes dont la réputation éclatante faisait pâlir la gloire des plus savants tireurs de l’Italie.
La salle d’armes de maître Guasta-Carne était le rendez-vous des plus braves et des plus nobles, qu’ils vinssent de Naples ou de Palerme, de France ou d’Allemagne, de l’Espagne ou des pays flamands.
Il donnait leçon tous les soirs, après avoir fermé son atelier et ses forges, et alors ses ouvriers devenaient ses élèves, et chacun d’eux soupirait bien bas :
— Ah ! si j’avais l’habileté du maître, peut-être me permettrait-il de lever un jour les yeux sur Marianna !…
Marianna était la fille de l’armurier.
Elle avait dix-huit ans ; elle était belle comme les madones de Raphaël d’Urbino, blonde et blanche comme la Fornarina, son modèle, en dépit du soleil italien qui fait aux femmes le teint doré et les cheveux si noirs.
Marianna était, au milieu de ces hommes rudes et batailleurs, dans cette maison où le son du marteau frappant le fer ne s’éteignait que pour faire place au cliquetis du fer froissant le fer, comme un ange de paix que Dieu aurait chargé d’une mission sainte parmi des hommes dont, l’unique occupation consiste à perfectionner la mort. Et le maître aux moustaches grises, les jeunes gens aux barbes noires, devenaient humbles et soumis devant le sourire de Marianna ; les uns oubliaient de forger, l’autre d’allonger le bras et de frapper du bouton de sa rapière le plastron de son élève.
Marianna était la perle de Milan ; gens d’épée ou de justice, gentilshommes ou forgerons, car la cité milanaise était la patrie des armuriers, s’inclinaient sur son passage, admiraient sa beauté, et se disaient, avec un soupir de regret et d’envie, qu’il serait bien heureux celui que maître Guasta-Carne appellerait du nom de fils.
Plus d’un galant seigneur que le récent exemple de l’Espagnol don Juan de Marana eût enhardi en toute autre occurrence, s’en allait parfois à l’église ou se promenait à la brune aux environs de l’atelier, espérant y voir la blonde fille de l’armurier…
Mais il savait bien cependant que si une imprudente parole d’amour s’échappait de ses lèvres, que s’il osait jamais manquer de respect à Marianna, vingt dagues sortiraient du fourreau, vingt rapières menaceraient sa poitrine.
C’eût été folie, en vérité, fût-on le neveu du pape ou l’empereur Charles-Quint lui-même, que de songer à séduire la fille du vieux Guasta-Carne.
Le maître était gentilhomme ; il tenait ses lettres de noblesse du roi Henri VIII d’Angleterre, et certes sa gloire était assez grande pour que maint seigneur de haute lignée pût sans vergogne rechercher son alliance ; mais nul n’y songeait, car Marianna avait dit hautement qu’elle n’épouserait qu’un homme de la profession de sou père, brave et habile comme lui.
Aussi, les vingt lurons qui travaillaient sous les yeux et les ordres du maître, étaient-ils tous épris de Marianna, et rivalisaient-ils de zèle, d’intelligence, de patience et de talent pour mériter un pareil Donneur.
Les pauvres forgerons perdaient leur temps ; un seul peut-être, et celui-là précisément qui s’en souciait moins que les autres, avait su faire battre le cœur de la blonde Marianna. C’était Raphaël.
Qu’était-ce que Raphaël ? Un garçon de vingt-trois on vingt-quatre ans, beau comme une statue de Michel-Ange, intelligent et brave comme Michel-Ange lui-même.
Il était l’enfant d’adoption de Guasta-Carne. Un soir, à la nuit tombante, le maître, alors jeune et fort, et tout récemment marié, passait devant une église, sur une place déserte. Il revenait de donner une leçon d’escrime à un noble seigneur qui logeait aux environs.
Des cris enfantins frappèrent son oreille et lui parurent provenir de l’église. Il s’approcha et trouva, assis sur une marche, un enfant de cinq ans grelottant de froid et pleurant à chaudes larmes.
Aux questions affectueuses de l’armurier, l’enfant répondit qu’il avait été abandonné par sa mère il y avait une heure à peine, et tout ce que Guasta-Carne en put obtenir, c’est qu’il se nommait Raphaël.
L’enfant était beau ; il intéressa le maître d’armes, qui le prit dans ses bras, l’emporta chez lui et le présenta à sa jeune femme :
— Tiens, lui dit-il, en attendant que nous ayons un fruit de notre union, voici un enfant que Dieu nous envoie.
Raphaël, dès ce jour, devint l’enfant de la maison. L’année suivante, Lorenzina, la femme de l’armurier, mit au monde la blonde Marianna, et les deux enfants grandirent ensemble et s’aimèrent tout d’abord comme frère et sœur. Puis la pauvre mère mourut, jeune et belle encore, puis Marianna devint une belle fille de seize ans, et alors elle cessa de jouer avec Raphaël ; et puis encore elle se sentit rougir bien souvent en le regardant… Et Guasta-Carne, qui vieillissait et avait reporté sur les deux enfants l’amour qu’il avait eu pour sa pauvre Lorenzina, Guasta-Carne souriait in petto du trouble naïf de la blonde Marianna.
Raphaël, cependant, était devenu un homme, et son caractère s’était développé avec l’âge. A quinze ans, il était le meilleur élève en escrime de Guasta-Carne ; à vingt, il était presque aussi habile que lui à forger et tremper le fer, à damasquiner une épée, à ciseler en relief les ornements d’une cuirasse.
La réputation du disciple égalait celle du maître en la ville de Milan. A l’atelier, à la salle d’armes, tout le monde s’inclinait devant lui.
Et pourtant, bien qu’on eût pénétré les secrets desseins du vieil armurier, bien que la plupart de ceux qui aimaient Marianna vissent en lui son futur époux, nul n’osait haïr Raphaël, et tous se sentaient entraînés vers lui par une mystérieuse fascination.
Raphaël n’était pourtant rien moins que ce qu’on nomme, dans la langue des ateliers, un joyeux compagnon ; il était, au contraire, toujours sombre, rêveur, cherchant la solitude, et ne se mêlant point à ses camarades les jours de repos et de fête. Son sourire triste, ses façons hautaines auraient dû rebuter les naïves et robustes natures des forgerons qui l’entouraient. Il n’en était rien cependant, et Raphaël était généralement aimé dans la maison et les forges de maître Guasta-Carne.
Le jeune homme, du reste, n’était ni querelleur ni mauvais camarade ; il était courtois, montrait un esprit conciliant en toutes choses, obligeait et rendait service avec empressement, et n’abusait jamais de sa force merveilleuse à l’épée. On citait, dans Milan, un exemple de cette modération.
Un soir qu’il rentrait tranquillement chez lui, il fut abordé par un capitaine de lansquenets qui lui chercha querelle et l’injuria, sous le banal prétexte qu’il sifflotait l’air d’une chanson qui lui remémorait de cruels souvenirs.
Rendez-vous fut pris pour le lendemain, et Raphaël se contenta de désarmer son adversaire à la troisième passe. Le lansquenet, peu satisfait, voulut continuer, et reprit son épée.
— Tenez, lui dit Raphaël, croyez-m’en, restons-en là. Si nous croisons de nouveau le fer, je vous toucherai trois fois, une fois au bras, l’autre à l’épaule, la troisième en pleine poitrine.
Le lansquenet ne voulut rien entendre ; en trois secondes, l’élève de Guasta-Carne eut réalisé sa promesse. Il lui perça le bras, puis l’épaule…
— Cette fois, dit-il, il faudra bien que vous demeuriez satisfait, car je ne vous tuerai point.
Et il jeta son épée et s’en alla, laissant le capitaine un peu calmé.
Raphaël avait eu plusieurs duels dont il s’était constamment tiré sans mort d’homme, mais toujours après avoir montré à son adversaire qu’il le pouvait tuer aisément.
Aussi, à Milan, le respectait-on à l’égal de son vieux maître Guasta-Carne, et le choisissait-on d’ordinaire, pour second, tant on connaissait bien sa nature conciliante.
Les jeunes seigneurs qui fréquentaient la salle d’armes recherchaient avec empressement son amitié ; mais il les tenait à distance, tout comme ses compagnons de l’atelier. Etait-ce dédain, orgueil ou misanthropie ? Nul n’eût pu le dire.
Un seul homme, après Guasta-Carne, jouissait de la confiance de Raphaël et pouvait, à bon droit, se vanter d’être son ami. C’était un Napolitain du nom de Giuseppe, forgeron comme lui et prévôt d’armes.
Giuseppe n’était ni beau, ni jeune, ni amoureux. Il n’avait jamais jeté un regard d’envie et de convoitise sur Marianna ; il ne se mirait qu’avec répugnance dans une glace, et il avouait, sans aucune peine, que la quarantième année avait sonnée pour lui.
Deux passions remplissaient la vie de Giuseppe : un amour immodéré pour le vin de France, et son amitié pour Raphaël.
Tous les crus italiens, depuis les blanquets du Vésuve jusqu’au lacryma-christi, valaient moins pour lui qu’une bouteille de vin bourguignon.
La plus belle fille de Venise ou de Milan n’eût point fait passer à Giuseppe une heure plus agréable, chaque soir, que celle qu’il employait à faire une promenade avec son jeune ami Raphaël.
En retour, Raphaël aimait Giuseppe ; il causait, lui le taciturne et le rêveur, avec abandon, lorsqu’ils étaient seuls ; et peut-être que le prévôt possédait le secret de cette mélancolie hautaine qui faisait le fond de son caractère. Avec lui, le jeune homme se laissait aller à sourire, et la ronde gaieté du Napolitain, cette gaieté nuancée d’un brin de scepticisme épicurien, lui plaisait si fort qu’il s’oubliait souvent à le tutoyer et lui prendre amicalement le bras ; ce qu’il ne faisait jamais avec les autres hôtes de Guasta-Carne.
Or, un soir, un dimanche, vers quatre heures de relevée environ, la salle d’armes et les ateliers de maître Guasta-Carne étaient déserts. C’était fête chômée, et la pieuse Italie observait trop fidèlement les lois de l’Eglise pour travailler durant un pareil jour. De plus, la noble ville de Milan était fort en rumeur, car elle était visitée par des hôtes illustres, et ces deux motifs étaient plus que suffisants pour que le silence et l’isolement régnassent dans la maison si bruyante d’ordinaire de maître Guasta-Carne. Raphaël, seul, était demeuré au logis.
Assis en un coin de la salle d’armes, tenant à deux mains un fleuret dont il appuyait la lame sur son genou, il était rêveur et sombre comme toujours ; il ne songeait ni au temps qui s’écoulait, ni à Marianna la blonde, la jeune et belle Marianna qui s’était approchée. de lui, disant avec son frais sourire :
— Mon cher petit Raphaël, notre père, tu le sais, est prié au festin que les échevins de Milan offrent à Son Altesse le duc Laurent de Médicis et à sa fille, Mme Catherine, qui vient d’épouser le dauphin de France. Or, c’est jour de fête à Milan ; une foule joyeuse parcourt les rues pour aller à la rencontre des nobles Florentins et les saluer au passage.
— Eh bien ? avait demandé brusquement Raphaël à la coquette jeune fille qui s’arrêtait à dessein pour lui laisser le mérite, de la deviner et de prévenir son désir.
— Eh bien ! fit-elle, tu devrais endosser ton pourpoint rouge et bleu mi-parti, celui qui te sied si bien, ceindre ta plus galante épée et offrir ton bras à ta petite sœur Marianna, qui s’ennuie si fort au logis.
Le jeune homme avait froncé le sourcil et répondu :
— Vous oubliez, Marianna, qu’il ne serait nullement convenable de vous voir appuyée à mon bras par les rues de Milan, un jour de fête surtout. Si vous avez la fantaisie de voir le duc Laurent et sa fille, Mme Catherine, pourquoi n’emmenez-vous point votre nourrice, la vieille Beppino ? elle vous formera une plus décente escorte.
La pauvre Marianna avait étouffé un soupir, murmurant :
— Vous avez raison, Raphaël, et je suivrai votre conseil.
Puis elle avait quitté la salle d’armes et était remontée dans sa chambre pour y pleurer à l’aise, car elle sentait bien que Raphaël ne l’aimait pas.
Et Raphaël était demeuré seul, perdu en sa rêverie, tordant son fleuret avec une sombre impatience, et laissant échapper des mots tels que ceux-ci :
— Quelle existence ! forger des cuirasses le jour, enseigner l’escrime le soir, et se nommer Raphaël… Raphaël quoi ?… Ignorer le pays où on est né, le nom de la femme qui vous a porté dans ses flancs, celui du père qui vous a mis au monde… se sentir au cœur une bravoure de preux, dans les veines un sang de roi… être ambitieux assez pour rêver la conquête du monde, et cependant être condamné à passer sa vie au fond d’un atelier d’armurier… c’est à maudire le hasard !…
Il y avait longtemps que Raphaël accusait ainsi le destin, lorsqu’un refrain égrillard et joyeux se fit entendre sur le seuil de la salle d’armes, et arracha le jeune homme à sa noire préoccupation.
C’était Giuseppe, le gros Napolitain qui entrait.
— Bon ! dit-il en apercevant Raphaël, je m’en étais douté, monseigneur… et je savais bien que je vous trouverais ici, sombre, et rêveur, méditant sur les mécomptes de la vie, tandis que la bonne ville de Milan s’ébaudit et s’amuse comme si elle avait bu du vin de France.
— Ah ! te voilà, Giuseppe, fit Raphaël, levant la tête.
— Per Bacco, mon jeune maître, croyez-vous donc que je puisse vous oublier tout un long jour ? Vous me manquiez fort depuis ce matin, et je venais vous chercher.
— Moi ?
— Sans doute. J’ai découvert un petit paradis terrestre, derrière la Strada, une adorable taverne où il se vend le meilleur vin de Bourgogne que j’aie jamais bu de ma vie.
— Ah ! fit Raphaël toujours rêveur.
— Cette taverne, poursuivit Giuseppe, se trouve précisément sur la route que le duc Laurent et sa fille suivront, à la brune, pour se rendre de l’hôtel des Echevins au palais grand-ducal, et nous les y verrons à notre aise…
— Peuh ! murmura le jeune homme, à quoi bon ?
Giuseppe allait sans doute répliquer et faire valoir à son jeune ami d’assez bonnes raisons pour l’entraîner hors de la maison, lorsque deux coups discrets furent frappés à la porte que le Napolitain avait refermée ; sur lui.
— Entrez ! dit Raphaël.
La porte s’ouvrit et livra passage à un gentilhomme drapé dans un court manteau de couleur sombre, et tel qu’en avaient les seigneurs de la cour de France.
C’était un jeune homme de vingt-deux ans environ, pâle et blond, d’apparence délicate, d’une beauté féminine et qu’on eût taxée de mollesse si elle n’eût été éclairée par un regard fier, énergique, étincelant, qui disait qu’un cœur d’homme battait sous cette frêle poitrine.
— Salut ! mes maîtres, dit-il en mauvais italien qu’il prononçait à la française ; n’est-ce point ici la salle d’armes du professeur Guasta-Carne ?
— Oui, mon gentilhomme, répondit Raphaël en français, car il possédait à fond cette langue.
— Pourrais-je le voir ?
— Hélas ! non, messire ; le maître est sorti et ne rentrera que fort tard ; mais demain…
— Demain, il ne serait plus temps. Mais au moins serai-je assez heureux, j’imagine, pour rencontrer un de ses élèves, le signor Raphaël…
— C’est moi, messire.
Le gentilhomme et Raphaël se saluèrent avec courtoisie.
— En quoi puis-je vous être agréable ? demanda ce dernier.
— Je désire prendre une leçon d’escrime.
— Ceci est impossible, messire, répondit Raphaël, car c’est aujourd’hui dimanche, et tout travail est interdit le jour du Seigneur. Mon honoré maître, le seigneur Guasta-Carne, ne voudrait pour rien au monde, qu’on donnât leçon chez lui un jour de fête.
— Pardon, interrompit le gentilhomme, je me permettrai de vous faire observer que la leçon que je vous demande m’est absolument nécessaire. J’ai frappé de mon gant un seigneur florentin en plein visage ; je me bats avec lui demain au point du jour, et je ne suis que très peu versé dans cette noble science que les Italiens possèdent mieux que nous, Français.
— Ceci est différent, répondit gravement Raphaël.
Et il se leva et alla décrocher deux épées appendues au mur.
Raphaël avait examiné d’un coup d’œil rapide le jeune seigneur, et son attitude, son geste, toute sa personne, en un mot, étaient de nature à plaire à un homme qui, tel que l’armurier, était ambitieux et fier.
Le gentilhomme français avait, comme on dit, trop de race pour ne point séduire Raphaël, qui croyait à la race et se désespérait de ne pouvoir connaître sa lignée. Ensuite, il était frêle et délicat ; toute sa force virile paraissait concentrée dans son regard, et Raphaël, qui avait des muscles et des jarrets d’acier, ne pouvait que s’éprendre d’une sympathie protectrice pour cet enfant qui venait lui demander le secret de tuer un homme.
— Pardon, messire, lui dit-il en revenant auprès de lui les épées à la main, puis-je vous faire quelques questions et sur le motif de votre combat et sur votre adversaire ?
— Mais… fit le jeune homme avec hésitation et regardant attentivement Raphaël.
— J’attache à cela une certaine importance. D’abord, parce que selon la taille, la souplesse, l’habileté de l’adversaire, je puis enseigner tel ou tel coup, au lieu de tel ou tel autre. En second lieu, si le motif du combat est léger…
— Il est très grave, répondit le gentilhomme français.
Comme s’il eût pressenti que le jeune seigneur se trouverait plus à l’aise seul avec Raphaël, le Napolitain s’était esquivé de la salle d’armes.
— Signor, dit le Français, il faut que je tue mon adversaire.
— Il vous a donc cruellement offensé ?
— Si cruellement, murmura-t-il, qu’il n’aura jamais assez de sang dans les veines pour laver cette injure.
— Tenez, dit Raphaël, asseyez-vous, messire, nous prendrons leçon tout à l’heure, et, je vous en supplie, confiez-moi le secret de cette querelle. J’ai comme un vague pressentiment que je pourrai vous servir fort en cette occurrence.
Le visage ouvert et noble de Raphaël, sa voix caressante et douce comme celle d’une femme, et cette mystérieuse puissance attractive dont il était doué, subjuguèrent le gentilhomme et gagnèrent sa confiance. Il s’assit auprès de l’armurier et lui dit :
— Pour vous faire comprendre la gravité de l’insulte que j’ai reçue, il faut que je vous raconte une partie de mon histoire. Je suis gentilhomme français, au service du roi, et j’ai accompagné à Florence le maréchal d’Annebaud, qui y vient quérir la fiancée du dauphin, Mme Catherine de Médicis.
Mme Catherine, qui est fort belle, a une dame d’honneur plus belle encore peut-être et qui se nomme Maria di Polve.
La signorina di Polve fit sur moi, la première fois que je la vis, une impression telle que j’en devins éperdument amoureux et résolus de demander sa main. Je me nomme le marquis de Saint-André ; je suis riche ; ma noblesse remonte par-delà les croisades, et je puis prétendre, comme vous le voyez, aux meilleures alliances.
Raphaël s’inclina, attentif.
— La signorina, continua le marquis, ne fut point insensible à mon amour ; elle m’encouragea d’un sourire, et accueillit mes vœux en rougissant. J’allai trouver son père, le comte di Polve, et lui fis ma demande. Le comte se montra charmé, me laissa entendre que mon alliance flattait très fort son orgueil, et me demanda simplement un délai de quelques jours pour dégager sa parole qu’il avait presque donnée, six mois auparavant, à un seigneur de la cour des Médicis, le marchese della Strada.
A ce nom, Raphaël fit un brusque mouvement.
— Vous le connaissez ? demanda le marquis.
— Il est en escrime l’élève de maître Guasta-Carne.
— Ah ! fit le marquis avec indifférence. Eh bien, c’est avec lui que je me bats.
Le front de Raphaël se rembrunit.
— Le marchese, dit-il, est un misérable dont l’Italie tout entière connaît les infamies. Il a employé la ruse ou la force, l’hypocrisie et le mensonge, en mainte circonstance, pour arriver au but ténébreux qu’il s’était fixé. Il est l’âme damnée du duc Laurent, ou plutôt son mauvais génie ; car toutes les cruautés, toutes les injustices qui se commettent à Florence sont inspirées par lui.
— Je le sais, dit le marquis.
— Or, vous le savez, continua Raphaël, il est d’une force herculéenne et d’une brutalité inouïe. Avant de se battre en gentilhomme, il se livre à des violences de facchino, c’est-à-dire de portefaix.
— Je le sais encore, et c’est précisément mon histoire avec lui.
— Ah !
— Le marchese, furieux de voir dédaigner son alliance, a juré ma mort. Pendant quelques jours, il a su dissimuler et se contraindre ; mais il épiait une occasion favorable, et il n’a point tardé à la trouver. Il y a huit jours, vers minuit, tandis que je rentrais en mon logis, je me suis trouvé face à face avec lui, dans une rue obscure et sombre. Il s’est rué sur moi, et m’a enlacé si promptement qu’il m’a été impossible de tirer mon épée. Alors il s’est pris à ricaner et m’a dit : « Vous vous êtes permis de chasser sur mes terres, vous allez voir comment je punis moi-même les braconniers. » Et il m’a battu, souffleté, roué de coups, et m’a laissé pour mort sur la place, après m’avoir craché au visage. La ronde de nuit m’a recueilli et ramené chez moi. Lorsque j’ai été guéri et en état de pouvoir me montrer, j’ai cherché mon ennemi pour lui demander raison de sa brutalité. La cour de Florence était partie pour Milan. Alors je suis venu à Milan et me suis rendu au palais grand-ducal où le duc Laurent se trouvait avec ses officiers et ses gentilshommes ; je suis allé droit au marchese et je lui ai appliqué mon gant sur le visage. Puis je suis sorti pour venir ici, avant même de songer à chercher un second.
— Messire, dit l’armurier, je m’appelle Raphaël et ne me connais que ce nom ; mais je suis de noble race, je le jurerais, car des armoiries étaient brodées sur la chemisette de lin que je portais le soir où maître Guasta-Carne me recueillit sous le porche d’une église. Vous m’étiez inconnu il y a une heure, et voici que je ressens déjà pour vous une secrète sympathie. Voulez-vous m’accepter pour second ?
— De grand cœur ! s’écria le marquis avec un élan de franche reconnaissance.
— Eh bien, dit Raphaël, comptez sur moi. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, vous étiez tué, foi d’armurier, je vous vengerais. Maintenant, prenons leçon, ajouta-t-il.
La leçon dura une heure. Le jeune gentilhomme tirait médiocrement, mais il était leste, bien planté sur ses jarrets ; il comprenait en quelques secondes la parade la plus difficile, et Raphaël, fort ému d’abord en songeant qu’il aurait affaire au terrible marchese della Strada, Raphaël se sentit plus rassuré après la leçon.
Il venait d’enseigner au jeune seigneur une botte terrible que nul au monde, si ce n’est Guasta-Carne et lui, Raphaël, n’avait possédée jusque-là, et dont il n’eût jamais livré le secret à tout autre. La sympathie qui l’entraînait vers le marquis était irrésistible.
— A quelle heure vous battez-vous ? lui demanda-t-il.
— Demain, au point du jour.
— En quel lieu ?
— Sous les remparts, à la porte de Turin.
— J’y serai, dit Raphaël.
— Mais, continua le marquis de Saint-André, puisque vous vous êtes mis à ma disposition d’une façon si courtoise, j’en userai largement. Il faut que vous me rendiez un service, plus grand peut-être, à mes yeux, que celui de m’assister demain.
— Parlez, je suis à vos ordres.
— Je ne veux point reparaître au grand soleil avant d’avoir vengé l’outrage que j’ai reçu et, par conséquent, me présenter devant le duc Laurent et sa fille. Or, la signorina di Polve ne quitte pas Mme Catherine, plus que si elle était son ombre.
— Puisqu’elle est sa dame d’honneur, c’est tout simple…
— Et cependant, je voudrais qu’elle eût de mes nouvelles, si je ne puis la voir une dernière fois.
— Que faire alors ?
— Je voudrais vous charger d’un message.
Raphaël tressaillit.
— Je n’ai rien à vous refuser, dit-il, et cependant j’ai un vague pressentiment que la démarche que je vais faire aura une influence fatale sur ma vie.
Le marquis le considéra avec étonnement.
— Pardonnez-moi, murmura Raphaël, peut-être suis-je fou et superstitieux… mais j’ai toujours devant moi la figure étrange d’une bohémienne, qui me dit un soir la bonne aventure, pendant mon enfance, et il me semble à cette heure entendre sa voix glapissante, sentir, froissée par ses doigts noueux, ma main dont elle étudiait les lignes de son regard glauque et sans rayons.
— Mon Dieu ! fit le marquis, que vous dit-elle donc ?
— Ceci : « Tu es de race illustre, bien que tu ignores le secret de ta naissance. Peut-être le posséderas-tu un jour, ce fatal secret, et alors tu te repentiras amèrement de n’être point né dans un rang inférieur. Or, le jour où tu seras sur la trace de ce mystère, sera précisément celui où tu auras été chargé d’un message d’amour. »
— C’est bizarre ! murmura le marquis. Et, bien que j’aie une maigre confiance aux bohémiennes, je ne veux pas…
— Non ! non ! interrompit vivement Raphaël, advienne que pourra ! Et puis, d’ailleurs, acheva-t-il avec un fier sourire, si je dois connaître mon origine un jour, autant vaut-il que ce soit bientôt… Ce n’est point vivre qu’être armurier et professeur d’escrime, quand on sent battre et gronder dans sa poitrine un cœur de lion comme le mien.
Le jeune marquis de Saint-André regardait à son tour Raphaël, et comme celui-ci s’était senti naguère entraîné vers lui, il éprouvait à son tour les effets puissants de cette séduction mystérieuse, dont l’armurier possédait le secret, à son insu peut-être.
Il lui tendit spontanément la main.
— Vous êtes un noble cœur, lui dit-il, et je vous supplie d’accepter l’offre de mon amitié, qui, je vous le jure, sera éternelle.
— Merci, répondit Raphaël en serrant cette main, et maintenant, croyez-le, c’est entre nous à la vie et à la mort. Parlez : que dois-je faire ? où faut-il aller ?
— Tâchez de pénétrer d’abord au palais grand-ducal ce soir, vers dix heures, pendant le bal que le gouverneur de Milan offre à Son Altesse le duc Laurent de Médicis, d’y voir la signorina Maria, et de lui dire alors : « Le marquis de Saint-André se bat demain avec son rival, le marchese della Strada ; peut-être succombera-t-il dans cette lutte, et il voudrait vous voir une dernière fois… Pouvez-vous lui donner un rendez-vous pour cette nuit même ? »
— J’irai, dit Raphaël. Où vous retrouverai-je ?
— A l’hôtel de la Corne d’Or, mon logis depuis hier. J’y rentre à l’instant même et n’en sortirai plus.
Les deux jeunes gens échangèrent une dernière poignée de main et se séparèrent sur le seuil de la salle d’armes.
En ce moment, Giuseppe reparut.
— Eh bien ! dit-il à Raphaël, êtes-vous prêt, maître, et venez-vous goûter le vin bourguignon dont je vous ai parlé ?
— Non, dit sèchement Raphaël, j’ai autre chose à faire.
Giuseppe baissa la tête, ainsi qu’il convient à un homme habitué à se montrer indulgent pour les caprices d’humeur d’un jeune ami.
— Tu demeureras ici ce soir, Giuseppe, ajouta Raphaël.
— Et pourquoi ? demanda le Napolitain.
— Pour garder la maison.
— Vous sortirez donc ?
— Oui, fit Raphaël d’un ton dégagé ; ne suis-je pas invité aussi bien que le maître Guasta-Carne au bal de ce soir ?
— C’est juste ; mais je croyais…
— Tu as eu tort de croire… Je veux me réjouir aujourd’hui… moi, le taciturne ; une fois n’est point coutume.
2.
Il était dix heures du soir environ. Le palais grand-ducal était étincelant de lumières, retentissant de bruit et d’harmonie.
La noblesse milanaise, conviée à la fête, admirait ce prince que l’histoire surnomma Laurent le Magnifique, et attendait avec impatience l’apparition de sa fille, la belle Catherine, qui allait épouser le dauphin de France et partir pour Paris sous peu de jours.
La princesse Catherine se faisait attendre. Elle procédait à sa toilette de bal et se souciait peu, en apparence du moins, de la curiosité enthousiaste de la noblesse milanaise, puisqu’on dansait depuis plus d’une heure sans qu’elle eût paru encore.
Le bal était travesti, selon la vieille coutume des fêtes italiennes ; les femmes devaient porter un loup de satin et ne se démasquer qu’au matin, lorsqu’un splendide festin réunirait, autour d’une immense table, les nobles hôtes du palais grand-ducal.
Mais une indiscrétion de ses camérières avait trahi d’avance le déguisement de la jeune princesse, et la galante jeunesse de Milan avait formé le complot de saluer de ses bravos frénétiques l’entrée au bal d’une paysanne grecque parée de la pittoresque coiffure des femmes de la Laconie. C’était, disait-on dans les salles du bal, le costume adopté par la jeune et belle princesse. Or, tandis qu’on attendait avec impatience, Mme Catherine était enfermée dans son oratoire, seule avec sa dame d’honneur, la signorina di Polve, qui lui servait, ce jour-là, de femme de chambre.
Les deux jeunes filles étaient assises comme deux sœurs jumelles sur une ottomane et se tenaient les mains, signe évident d’une intimité parfaite établie entre elles lorsqu’elles n’étaient point soumises à l’étiquette rigide qui accompagne, ainsi qu’une duègne austère, les grands de ce monde à peu près en tous lieux.
— Ma mie, disait Mme Catherine avec une joie d’enfant, je m’amuserai comme une folle cette nuit en te voyant l’objet de tous les hommages qui me sont destinés. Nous avons même taille, même tournure toutes deux, les cheveux noirs et les mains blanches ; le visage seul permet de nous distinguer, et, comme notre visage sera soigneusement dissimulé sous les barbes d’un loup, la belle noblesse milanaise s’y trompera très certainement.
Ces paroles de Mme Catherine disaient assez que le déguisement qui lui était destiné serait porté par la signorina, tandis qu’elle-même serait revêtue du costume que chacun attribuait par avance à Maria di Polve.
Les deux jeunes filles étaient déjà costumées ; leur visage seul était découvert.
— Ma mie, dit alors Mme Catherine, qu’en penses-tu ? Il est temps, ce me semble, de paraître à ce bal qu’on donne pour nous. Allons ! mets ton loup et prends ton rôle au sérieux. Je veux danser et m’amuser joyeusement jusqu’au jour, afin de n’avoir point à me coucher ; car, tu le sais, nous repartons demain matin pour Florence.
La signorina Maria obéit, attacha les rubans de son loup, et s’appuya d’un air protecteur, ce qui était indiqué par son rôle de princesse, sur le bras de la véritable Catherine, vêtue en dame de la cour de France.
Au moment où elles sortaient, un jeune homme élégamment vêtu et drapé dans un long manteau qui ne permettait point de voir s’il portait ou non une épée, et, par conséquent, de savoir s’il était ou s’il n’était pas gentilhomme ; un jeune homme, disons-nous, venait à leur rencontre, par le couloir qui conduisait de l’oratoire de la princesse aux salles de bal.
Catherine tressaillit involontairement à sa vue. Cet homme était sans masque et son visage était d’une remarquable beauté ; il avait le geste noble et hardi et les allures d’un grand seigneur.
Il s’inclina courtoisement devant les deux femmes ; puis, instruit sans doute par la rumeur publique, et s’abusant comme devaient s’abuser tous les seigneurs milanais, il s’approcha de la princesse et lui dit tout bas :
— N’êtes-vous point, madame, la signorina Maria di Polve ?
— Oui, répondit Catherine, un peu troublée et ne voulant point trahir son incognito.
— Madame, dit le cavalier à voix basse, il faut absolument que vous m’accordiez une minute d’entretien ; il le faut.
Subjuguée par l’accent grave et mystérieux du jeune homme, la princesse allait indiquer à son interlocuteur la véritable Maria di Polve, lorsqu’un soupçon rapide traversa son cerveau :
C’est peut-être un piège qu’on me tend pour me forcer à trahir mon incognito, pensa-t-elle.
Et d’un geste, elle ordonna à sa dame d’honneur de l’attendre, tandis qu’elle rouvrait la porte de l’oratoire, et, d’un signe, invitait le cavalier à y pénétrer après elle.
— Madame, dit alors Raphaël, car c’était lui, et lorsque la porte eut été refermée sur eux, vous aimez un gentilhomme français, le marquis de Saint-André ?
— Oui, répondit Catherine, troublée.
— Et il vous aime…
— Je le crois, fit-elle, toujours défiante.
— Eh bien ! dit Raphaël, le marquis se bat demain, au point du jour, à la porte de Venise, avec le marchese della Strada. Peut-être sera-t-il tué, ajouta-t-il avec émotion, et il désire vous voir une dernière fois.
— Mon Dieu ! fit la princesse avec effroi.
— Or, il vous supplie, madame, de lui accorder ce dernier rendez-vous ce soir.
— Soit ! murmura Catherine, qui frissonnait sous le poids d’une inexplicable émotion que Raphaël, croyant avoir devant lui la signorina, attribua à son amour pour le marquis.
— Le marquis est logé à l’auberge de la Corne d’Or.
— Eh bien ! murmura Catherine, dont la voix tremblait au souffle de cette étrange émotion qu’elle venait de ressentir à la vue de Raphaël, ce soir, à minuit, j’irai à la Corne d’Or. Qu’il m’attende !
Raphaël s’était pris à écouter cette voix harmonieuse et tremblante, et, lui aussi, il était gagné par un trouble secret, une bizarre et indicible émotion.
Aux dernières paroles de Catherine, il fit un pas de retraite, et la princesse, qui s’était assise pour l’écouter, se leva.
Ce mouvement détacha son masque, dont les agrafes étaient mal nouées, le masque tomba, et tandis qu’elle poussait un petit cri d’effroi, Raphaël éprouva une sensation indéfinissable, une commotion électrique des plus étranges, et il demeura frappé d’étonnement et d’admiration !
Il lui sembla, tant la princesse était incomparablement belle, qu’il avait devant lui une de ces statues divines du musée de Florence que le souffle puissant d’un génie aurait animées.
La princesse rattacha précipitamment son masque et s’enfuit, laissant Raphaël pétrifié au milieu de l’oratoire.
Le jeune armurier demeura là immobile, frappé de stupeur, atteint de vertige pendant plusieurs minutes ; et puis, il retrouva un peu de présence d’esprit, et il s’enfuit, à son tour, éperdu, frissonnant, hors de lui, et murmurant d’une voix étouffée :
— Mon Dieu ! qu’elle est belle !
Dans le regard qu’il avait échangé avec Catherine, il lui avait donné son âme et voué sa vie.
Et cette femme que déjà il aimait et qu’il croyait être Maria di Polve, c’était Catherine de Médicis, la fiancée du roi de France futur.
— Malédiction ! murmura-t-il en s’enfuyant à travers les rues de Milan, malédiction ! cette femme, je l’aime déjà… et c’est elle qu’il aime, lui aussi, cet homme à qui, il y a quelques heures, j’ai juré une éternelle amitié… Malheur ! malheur !
Il oublia que le marquis l’attendait à la Corne d’Or, et il gagna, courant toujours comme un fou, la maison de Guasta-Carne ; puis, il pénétra dans la salle d’armes où Giuseppe sommeillait sur un banc ; il arracha une épée à une panoplie et voulut se la passer au travers du corps.
Mais le Napolitain s’éveilla en ce moment. Il jeta un cri, se précipita sur Raphaël, lui enleva l’épée des mains et la brisa sur son genou.
Raphaël chancela un moment, ainsi qu’un homme foudroyé par le feu du ciel, puis il s’affaissa sur lui-même et murmura avec l’accent de la folie :
— La bohémienne avait raison… Malheur ! malheur !
Giuseppe regardait son jeune ami avec une stupeur profonde, et ne comprenait rien à cet accès de douleur véhémente qui s’était emparé de lui.
Il essaya de le questionner, ce fut en vain ; Raphaël garda un morne silence. Puis, tout à coup, il se redressa vivement et lui dit :
— Tu vas aller à l’auberge de la Corne d’Or.
— Comme vous voudrez, répondit Giuseppe.
— Tu demanderas à parler au marquis de Saint-André, ce gentilhomme à qui j’ai donné une leçon tout à l’heure, et tu lui diras ces simples mots : « Attendez ! on viendra entre onze heures et minuit. »
— C’est bien, dit Giuseppe ; mais je ne vous obéirai, je ne vous quitterai qu’à une condition.
— Laquelle ?
— C’est que vous me donnerez votre parole de ne point recommencer vos extravagances de tout à l’heure.
— Je te la donne.
— Vrai ? fit naïvement le Napolitain.
— Foi de Raphaël !
— Très bien. Je cours à la Corne d’Or.
Et Giuseppe s’en alla un peu rassuré, mais fort intrigué et tout chagrin de la douleur de Raphaël, douleur inexplicable pour lui.
Le jeune armurier demeura quelque temps encore dans la salle d’armes, se promenant à grands pas, laissant bruire sur ses lèvres des mots inarticulés, et livré au plus sombre désespoir.
— Fatalité ! murmurait-il. Jusqu’ici aucune femme, pas même Marianna qu’on dit être ma fiancée, et qui est la plus belle fille de Milan, aucune femme, dis-je, n’a fait battre mon cœur… et voici que je suis pris de folie et saisi de vertige à la vue de celle qui aime et est aimée d’un autre, à la vue de cette femme qui est la fiancée du marquis… Cet homme qui m’a tendu la main et m’a demandé son amitié… Fatalité !
Soudain, Raphaël se souvint du but primitif de la visite du marquis de Saint-André, de son duel du lendemain ; et comme au fond du plus noble cœur, il peut surgir une pensée d’égoïsme, comme un espoir criminel peut briller instantanément, l’espace d’une seconde, dans l’âme la plus loyale, une pensée coupable traversa l’esprit de Raphaël.
S’il allait être tué !, se dit-il.
Mais aussitôt, la chevaleresque nature de l’armurier se révolta, le rouge de l’indignation lui monta au visage, il eut horreur de lui-même, et s’écria :
— Non, non, Raphaël, mon ami, il t’est bien permis d’être le plus malheureux des hommes, de n’avoir ni nom ni famille, d’être condamné à aimer dans l’ombre la femme qu’un obstacle insurmontable sépare de toi, mais il ne t’est point permis de cesser d’être loyal et honnête…
Et alors, puisant un calme subit dans son héroïsme, Raphaël se prit à réfléchir aux conséquences probables de la rencontre du marquis de Saint-André avec le marchese de la Strada, et il songea, avec un douloureux effroi, que son filleul (c’était le nom qu’on donnait alors à l’homme qu’on assistait dans un duel), que son filleul, disons-nous, était de frêle et délicate apparence, qu’il avait le poignet d’une faiblesse extrême, qu’il ne maniait l’épée qu’imparfaitement, et que, s’il ne portait sur-le-champ, aussitôt le fer engagé, cette botte secrète qu’il lui avait montrée, le marchese, dont la force et l’habileté étaient surprenantes, le tuerait raide à la troisième passe.
Et Raphaël frissonna pour son nouvel ami, lui qui n’avait jamais tremblé pour lui-même, et il se prit à chercher le moyen difficile d’éviter un pareil malheur.
Il continua pendant quelque temps encore à se promener de long en large, le front penché, les bras croisés sur sa poitrine, puis tout à coup, il releva la tête et un éclair de joie brilla dans ses yeux : Raphaël avait trouvé le moyen.
— Corpo di Bacco ! s’écria-t-il, laissant échapper le juron favori des salles d’armes italiennes, il ne sera point dit, sur mon honneur, qu’un spadassin sans aveu, un misérable tel que le marchese della Strada, n’ait jamais eu affaire qu’à des adversaires incapables de lui résister. Ce sera moi qui le tuerai… Au lieu d’aller prendre le marquis demain matin, à l’auberge de la Corne d’Or, j’irai directement à la porte de Turin, j’y attendrai son ennemi, je le provoquerai, et il faudra bien qu’il se batte avec moi !…
Et lorsqu’il eut pris cette résolution héroïque, Raphaël quitta la salle d’armes et monta dans la chambre qu’il occupait chez Guasta-Carne.
Il se jeta sur son lit tout vêtu, et essaya de dormir pour faire trêve à sa douleur. Vain espoir !
L’ombre de cette femme à peine entrevue se dressait devant lui avec une désespérante obstination. Elle semblait lui sourire au fond de son alcôve, glisser comme un sylphe derrière ses rideaux, puis s’approcher de lui, se pencher à ses oreilles, souriante, l’œil humide, et lui dire :
— Ce n’est point le marquis de Saint-André que j’aime… c’est toi, toi, Raphaël…
Et Raphaël reculait épouvanté. Il fut aux prises jusqu’au point du jour avec cette terrible et riante vision ; mais aussitôt que les premières lueurs indécises de l’aube glissèrent dans le ciel, l’hallucination disparut ; il sauta à bas de son lit et se redressa calme, froid, énergique, se disant : Allons, Raphaël, il faut aller nous conduire loyalement et assurer le bonheur du marquis.
Et tandis qu’il bouclait son épée de combat et prenait son manteau, ses regards tombèrent sur un objet blanc appendu au chevet de son lit, et cet objet le fit tressaillir.
C’était la chemisette de lin qu’il portait le jour où Guasta-Carne le recueillit et l’adopta, cette chemisette que sans doute lui avait passée sa mère, et dans un coin de laquelle elle avait brodé ses armoiries.
Raphaël examina l’écusson d’un œil rêveur.
— Le seul souvenir, murmura-t-il, que j’aie conservé par-delà mon existence chez Guasta-Carne, c’est celui-ci. Je me vois encore dans une vaste salle gothique aux vitraux peints, couché dans un berceau que des tentures de soie rouge abritaient. Sur la cheminée brillaient deux candélabres dont l’éclat me fatiguait. Un silence profond régnait dans la salle. Il n’y avait auprès de moi qu’une femme… elle était belle et vêtue de noir… elle pleurait… et c’était en me regardant.
« Certainement, cette femme était ma mère… Je ne l’ai vue que cette fois… Un brouillard s’étend sur tout le reste… Fatalité !
« Eh bien, acheva Raphaël, ma mère, qui que tu sois, toi que j’aime ardemment, à l’heure où je vais jouer ma vie, laisse-moi t’envoyer mon dernier souvenir et peut-être mon dernier adieu !
Et il baisa les armoiries de la chemisette et sortit d’un pas ferme, la tête haute, un fier sourire aux lèvres, ainsi qu’il convient à un gentilhomme qui marche au combat comme il irait à une fête…
Tout le monde dormait encore dans la maison de l’armurier ; Raphaël en sortit avec précaution pour n’avertir personne de son départ, puis il gagna la rue et se dirigea vers la porte de Turin où était fixé le rendez-vous, et où il arriva le premier.
Mais peu après il vit apparaître dans l’éloignement un cavalier de haute taille qui s’avançait d’un pas leste et fanfaron, chantant un refrain grivois, et il reconnut le marchese della Strada.
Le marchese avait jugé inutile de s’enquérir d’un second, et il venait seul, laissant traîner sur le sol la pointe de sa redoutable épée.
Alors Raphaël s’assit sur le revers d’un fossé et l’attendit tranquillement.
3.
Le marchese s’avançait d’un air conquérant, respirant à pleins poumons l’air du matin, balayant le pavé de son long manteau et de sa rapière tapageuse, se donnant par avance, enfin, la martiale et pompeuse attitude d’un triomphateur.
— Per Dio ! jurait-il, je crois que mon drôle manquera d’exactitude et se permettra de me faire attendre… Je n’en ai point le loisir cependant, car, dans une heure, il me faudra monter à cheval pour escorter S.A. le duc Laurent et sa fille, Mme Catherine, qui vont repartir pour Florence après avoir passé la nuit au bal… Le bambin aurait-il eu peur ?…
Le marchese n’eut pas le temps de se répondre à ce sujet, car Raphaël se dressa devant lui, et l’apparition du maître d’armes lui causa une sensation des plus désagréables, et le fit même reculer d’un pas.
— Votre serviteur très humble, signor marchese, dit l’armurier en s’inclinant.
— Je suis le vôtre, maître Raphaël. Hé ! corpo di Bacco ! quelle fortune de vous rencontrer !
— Je m’en applaudis tout comme vous, Eccellenza.
— Il y a bien deux ans que nous ne nous sommes vus, maître ?
— Depuis que vous avez renoncé à la salle d’armes, il me semble.
— Per Bacco, n’en savais-je point assez ?
— Oh ! très certainement.
— Vous êtes le meilleur élève de Guasta-Carne.
— Après vous, Signor.
— Peuh ! fit négligemment Raphaël, on ne sait pas.
— Mais, dit le marchese avec une certaine inquiétude, que diable faites-vous donc ici, à pareille heure, et avant le lever du soleil ?
— J’ai une affaire d’honneur.
— Ah ! ah ! moi aussi…
— Je le sais.
— Vous le savez ?
— Sans doute, puisque me voilà…
Le marchese tressaillit.
— Vous plaisantez, dit-il.
— Nullement. Je suis le second du marquis de Saint-André.
— En ce cas, ricana le marchese, votre rôle est inutile, car moi je n’ai pas de second. Nous réglerons bien tout seuls, le marquis et moi, nos petits comptes.
— Ceci est un peu contre les règles, dit tranquillement Raphaël ; mais enfin on peut s’accommoder pour cette fois de cette infraction au code du duel.
— En ce cas, cher Signor, dit le marchese d’un ton impertinent, nous n’abuserons pas plus longtemps de vos loisirs, et vous pouvez rentrer chez vous.
— C’est ce que j’aurais déjà fait, Eccellenza, si le marquis était ici. Mais il est en retard… Il a causé longuement cette nuit, pendant le bal, avec une personne qui lui est chère…
Le marchese pâlit à ces mots.
— Et il est possible qu’il nous fasse attendre quelques minutes…
Le marchese se prit à rire dédaigneusement :
— Etes-vous bien certain, dit-il, que ce soit cette conversation dont vous parlez… qui… ?
— Je vous l’affirme.
— Vous vous trompez, en ce cas.
— Nullement, Signor.
— Le marquis n’a causé avec personne.
— Pardon, ricana à son tour Raphaël, il a reçu à onze heures du soir, à l’auberge de la Corne d’Or, la visite de la signorina Maria di Polve, sa fiancée ; et vous savez que lorsque des amoureux se prennent à causer en tête à tête…
— Vous mentez ! exclama le marchese hors de lui et livide de rage.
Raphaël recula d’un pas, mit la main sur la garde de son épée, et dit au marchese :
— Vous venez de m’insulter, et vous m’en rendrez raison sur-le-champ. En garde ! drôle, misérable assassin, brutal stupide : ce n’est point à un enfant que tu vas avoir affaire, mon maître, c’est à Raphaël l’armurier…
Et comme le marchese hésitait une seconde, Raphaël dégaina, et, du plat de son épée, fouetta le visage du marchese.
Le marchese rugit, dégaina à son tour et tomba en garde.
— Ah ! ah ! dit alors Raphaël tandis qu’ils engageaient le fer, voici, Eccellenza, une bien belle occasion de vous souvenir des leçons de notre maître commun, Guasta-Carne.
— J’y songe, répliqua le marchese, portant à son ennemi le plus terrible coup de quarte qu’eût inventé le vieil armurier.
Le coup fut paré. Le marchese laissa échapper une exclamation de colère.
— Bon ! fit Raphaël, nous sommes de la même école, il est tout simple que nous connaissions la parade de chaque coup.
Ces deux hommes tiraient merveilleusement bien tous les deux ; cependant Raphaël avait une incontestable supériorité, et bientôt le sang du marchese coula par trois blessures légères. L’armurier le ménageait.
— Marchese, disait ce dernier, que l’épée de son adversaire n’avait pu atteindre encore, Dieu m’est témoin que je regarderais votre mort comme œuvre pie, et que je croirais donner un bel exemple au monde en le débarrassant d’un misérable tel que vous… Mais je préfère n’avoir point votre spectre devant les yeux pendant toute ma vie, et je vous fais grâce si vous voulez faire vos excuses au marquis de Saint-André, mon ami.
Le marchese répondit par un blasphème, et se rua sur son ennemi avec une fureur croissante.
En ce moment, un cri retentit à vingt pas.
Ce cri était poussé par le marquis, lequel, après avoir vainement attendu Raphaël, était accouru au rendez-vous pour y être témoin du dévouement de l’armurier. Dans ce cri, le mâle courage du frêle jeune homme semblait se révolter, et il accourait pour faire cesser la lutte et reprendre la place de Raphaël.
Ce cri fut fatal à Raphaël. Pendant une seconde, il cessa d’avoir l’œil rivé sur l’œil de son adversaire pour jeter un coup d’œil rapide au marquis ; le marchese, en tireur consommé, en profita, tira une botte terrible à Raphaël et lui traversa l’épaule.
— Ah ! misérable. ! exclama Raphaël auquel la douleur arracha un autre cri, tu viens de signer ton arrêt de mort.
Et usant d’une feinte habile, il se fendit à fond et creva la poitrine du marchese qui tomba exhalant un dernier blasphème…
Le jeune marquis courut à Raphaël chancelant et le retint dans ses bras.
L’armurier était pâle, et son sang coulait en abondance.
— Ami… ami… murmurait le gentilhomme français avec l’accent du désespoir et les yeux pleins de larmes, qu’avez-vous fait, mon Dieu ! Pourquoi vous êtes-vous battu pour moi ? pourquoi… ?
Un pâle sourire glissa sur les lèvres de Raphaël.
— Je ne sais si j’en mourrai, dit-il ; mais, dans tous les cas, ne vaut-il pas mieux que j’en meure, moi, le déshérité et le maudit, que vous… qui serez heureux ?…
— Ah ! pouvez-vous parler de bonheur, ami, quand je vois votre noble sang couler ?
— Ecoutez, murmura Raphaël, je crois que je vais mourir… et je puis parler… Je vais vous faire un aveu… J’aime une femme qui ne peut être à moi… dont un obstacle invincible me sépare… Une femme que j’ai vue hier, dix minutes, pour la première fois… et à laquelle, je le sens, ma vie eût été liée pour jamais.
— Mais quelle est donc cette femme ? demanda vivement le marquis soutenant toujours Raphaël qui chancelait de plus en plus.
— Celle que vous aimez, celle à qui j’ai porté votre message…