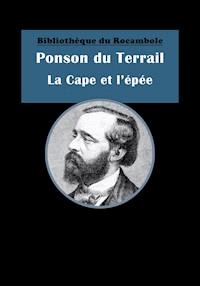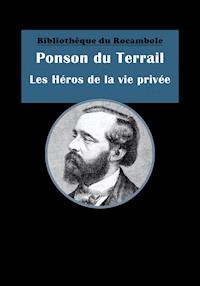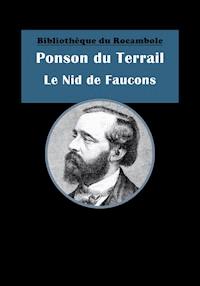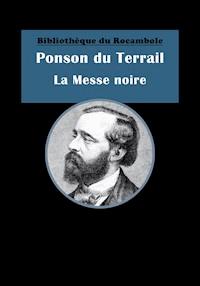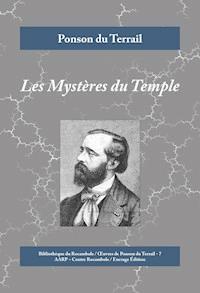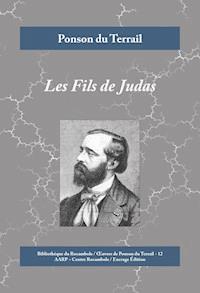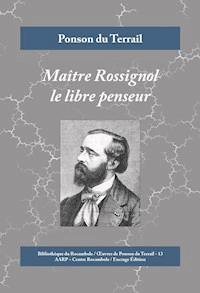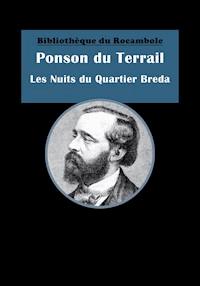
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À travers trois histoires de femmes, l'auteur nous plonge dans le monde littéraire et artistique de son époque.
Ce roman de Ponson possède une particularité unique : c’est le seul roman qui n’ait pas paru dans la presse avant d’être publié en librairie. D’ailleurs, il n’a jamais connu qu’une seule édition, chez Dentu qui a bien pris la précaution d’indiquer le mot « inédit » dans son catalogue des œuvres de Ponson du Terrail. Visiblement, ce dernier a répondu à une demande particulière de l'éditeur officiel de la Société des Gens de Lettres — depuis 1859.
Un des aspects les plus intéressants du roman est son décor social. Il n’est, cela dit, pas atypique chez Ponson qui, dans tous ses romans « contemporains », qu’ils soient des villes ou bien des champs, décrit le monde qui l’entoure. À Paris, il connaît bien l'univers des aristocrates modestes et des petits bourgeois, des domestiques et des artisans, et, surtout, des gens de lettres et des artistes. C’est chez ces derniers qu’il nous fait pénétrer ici.
Un récit social réaliste, sans aucun doute inspiré des contemporains de son auteur.
EXTRAIT
Aspasie donnait un bal.
Pour dire la vraie vérité, Aspasie s’appelait Marguerite.
Mais il serait convenable avant tout de prendre un juste milieu entre les bourgeois féroces qui veulent que chaque lorette soit la fille d’un portier, et le gandin naïf qui les croit issues des Montmorency par les femmes.
Donc il faut vous dire la provenance de Marguerite qui se nommait Aspasie.
Aspasie était la fille d’un petit employé qui avait fait des miracles, avec ses dix-huit cents francs, pour élever sa famille.
Il avait fait un sous-lieutenant de son fils, il voulait que sa fille entrât dans un pensionnat.
Et comme Marguerite, à dix-sept ans, était gentille, spirituelle et gaie, elle avait jeté son bonnet par-dessus le chapeau d’un joli garçon, en guise de moulin.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ponson du Terrail est né en 1829 et mort en 1871. S'inspirant tout d'abord du genre gothique, Ponson du Terrail se tourne rapidement vers le roman-feuilleton, style dont il devient une figure emblématique. Dans la veine des
Mystères de Paris d'Eugène Sue, il crée le célèbre personnage de Rocambole.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposédans le cadre des ressourcesdu Centre Rocamboleaccessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de Ponson du Terrail - 3
collection dirigée par Alfu
Ponson du Terrail
Les Nuits du Quartier Bréda
1865
AARP — Centre Rocambole
Encrage édition
© 2011
ISBN 978-2-36058-923-4
Préface
d’Alfu
Ce roman de Ponson possède une particularité unique : c’est le seul roman qui n’ait pas paru dans la presse avant d’être publié en librairie. D’ailleurs, il n’a jamais connu qu’une seule édition, chez Dentu qui a bien pris la précaution d’indiquer le mot « inédit » dans son catalogue des œuvres de Ponson du Terrail. Visiblement, ce dernier a répondu à une demande particulière de l’éditeur de la Société des Gens de Lettres — dont Dentu était, depuis 1859, l’éditeur attitré.
Un des aspects les plus intéressants du roman est son décor social. Il n’est, cela dit, pas atypique chez Ponson qui, dans tous ses romans « contemporains », qu’ils soient des villes ou bien des champs, décrit le monde qui l’entoure 1. A Paris, il connaît bien son monde, celui des aristocrates modestes et des petits bourgeois, des domestiques et des artisans, et, surtout, les gens de lettres et des artistes.
C’est chez ces derniers qu’il nous fait pénétrer ici. Et l’on ne peut douter une seconde de la véracité de ses personnages, inspirés de ses contemporains au point de ne porter comme nom que des initiales. Ce que confirme la dédicace du livre à Emmanuel Gonzalès — président de la Société des Gens de Lettres, en 1864 et 1865.
Ponson a fréquenté ce Quartier Bréda que le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle de Pierre Larousse définit ainsi :
« Bréda-Street ou Quartier Bréda. — Ce serait perdre son temps que de chercher sur la carte de Paris les limites administratives et l’emplacement officiel de ce séjour […] que le Parisien […] s’obstine à appeler quartier Bréda s’il est un simple bourgeois ; Bréda-Street s’il est jeune, anglomane et gandin. […] D’instinct, on le découvre, pour peu que l’on ait quelques libations à offrir sur l’autel de l’amour clandestin. Pour cela, il suffit de couper d’une diagonale l’espèce de quadrilatère que la commission municipale appelle tout prosaïquement le IXe arrondissement, et qui se compose des quartiers Saint-Georges, de la Chaussée-d’Antin, du Faubourg-Montmartre, de Rochechouart ; le centre sera justement l’église Notre-Dame-de-Lorette, qu’il ne faudrait pas appeler Notre-Dame des lorettes, bien qu’on ait donné son nom à ses plus aimables paroissiennes. […] » (II, 1220)
Mais l’histoire qu’il rapporte n’est pas la sienne. Et c’est avant tout une histoire de femmes. Elles sont trois à tenir le devant de la scène — dont une comédienne !
Aspasie, tout d’abord, qui s’appelle en vérité Marguerite. Elle est la fille d’un petit employé de bureau. Mais elle va recevoir les conseils d’une amie. Ainsi, elle s’en va jouer à Bade et en revient avec plus de 100.000 francs qui lui permettent de vivre sur un grand pied. Elle s’appelle désormais Aspasie et donne des fêtes où l’on se presse.
Léocadie est une amie d’Aspasie. « Son histoire était nébuleuse comme une légende de la vieille Germanie. » Un jour, le riche baron Conrad de Wilmhaüsen, major prussien en retraite, jette sur elle son dévolu. Et Léocadie vient s’installer dans un petit hôtel mitoyen de celui d’Aspasie.
Juliette a vingt-huit ans. Elle a pour amant un romancier prénommé Gérard. Et toute l’histoire va reposer sur leurs amours.
A propos de Léocadie, le personnage négatif du roman, on peut retenir qu’elle est plus forte que sir Williams et Rocambole réunis, ou même que le Docteur rouge ou d’autres : elle parvient en effet bel et bien à ses fins. Ce personnage est tout à fait envoûtant et la fin immorale et pessimiste du roman est vraiment surprenante chez Ponson du Terrail.
Alfu
1Pour une approche plus complète des romans de Ponson du Terrail, lire l’étude qui lui est consacrée : Alfu présente Ponson du Terrail. Dictionnaire des œuvres (Encrage, 2008).
A Emmanuel Gonzales, président honoraire de la Société des Gens de Lettres
Ami et cher maître,
Dans notre jeunesse, — c’était hier, — le quartier Bréda n’était pas ce qu’on croit généralement aujourd’hui.
Tout ce qui tient avec honneur une plume et un pinceau l’habitait, et beaucoup d’entre nous l’habitent encore.
Nos meilleurs comédiens, nos femmes de théâtre les plus spirituelles et les plus jolies se souviennent avec joie de nos maisons blanches à terrasses, du haut desquelles, le soir, nous contemplions la grande ville en rêvant d’être quelque chose un jour.
En inscrivant en tête de mon livre un nom aussi populaire et aussi estimé que le vôtre, n’est-ce pas le placer sous le plus honorable des pavillons et dire au public que Les Nuits du quartier Bréda sont une histoire de jeunesse avec du cœur, du rire et des larmes, et non point une de ces œuvres malsaines qui spéculent sur la dépravation de notre époque pour faire leur chemin dans le monde ?
A vous,
Ponson du Terrail.
A Madame L…L…
Chère madame
Voulez-vous me permettre de dédier ce livre à la femme aimableet spirituelle et à l’amie qu’on trouve toujours.
Votre dévoué,
Ponson du Terrail
Introduction
Il y a quelques mois de cela.
Accoudé tristement à la fenêtre de la petite maison que j’habite dans l’avenue Frochot, tout en haut de la colline blanche que l’on appelle la butte Saint-Georges, et plus ordinairement encore le quartier Bréda, je contemplais mélancoliquement cette ville joyeuse de notre jeunesse que tous ceux que j’avais connus et aimés ont désertée un à un. J’étais maussade et triste, et j’avais, le matin, entewndu sonner ma trente-quatrième année. Où étaient-ils tous ceux qui avaient rêvé, les uns la renommée, les autres la fortune, et tous, l’amour ?
Où étaient-elles, ces bonnes compagnes de nos vingt ans dont le rire retentissait dans nos mansardes et dans nos ateliers ? Celui-ci était devenu célèbre, celle-là s’en allait au bois dans un huit ressorts. Cette autre était applaudie chaque soir au Gymnase ou au Palais-Royal… Et comme je songeais au passé, on m’apporta une lettre que je transcris ici et qui sera la meilleure préface qu’on puisse faire à ce livre qui n’est pas un roman et dont je ne suis pour ainsi dire que l’éditeur :
« Mon cher ami,
C’est une recluse qui t’écrit, une exilée du monde, réfugiée dans un nid de verdure, à cent lieues de notre Paris, où je ne retournerai peut-être jamais.
Car Juliette est morte, mon bon ami ; elle est morte la soubrette piquante à l’œil effronté, morte la coquette pour qui on a fait tant de folies, morte la Dorine du théâtre français de Saint-Pétersbourg.
Je crois même que son cœur a été enterré au Caucase, le lendemain d’un combat meurtrier, avec la dépouille d’un général de trente-six ans.
Mais, chut ! ceci est un secret qui n’est plus à moi seule, et j’estime que le plus sacré de tous est celui qu’on partage avec une tombe.
Juliette est donc morte, le mois dernier, comme poussaient les dernières feuilles et s’épanouissaient les premières roses.
Elle avait juste, ce jour-là, trente-quatre ans, et plus rien dans le cœur, si ce n’est un souvenir.
Que veux-tu que devienne une femme de cet âge qui n’ose plus aimer, et qui, peut-être, ne le pourrait plus ?
Rentrer au théâtre ? m’exposer, après deux années passées à l’étranger, aux coups de plume de quelque petit journaliste qui me trouvera engraissée ?
Et puis, rire quand on a pleuré et qu’on pleure encore… ne faut-il pas y être contraint ?
J’ai de quoi vivre, mon ami, et j’ai besoin de repos. En arrivant à Paris, je suis allée chez Trichon, mon vieux notaire, qui me tripote mes fonds à sa guise, et je lui ai, le poing sur la hanche, tenu ce discours :
— Je veux quitter Paris, vivre à la campagne, habiter une maison entourée d’arbres, adossée à un coteau, dominant une prairie, se mirant dans une rivière, et je veux, en outre, des vaches, des poules, des moutons, des chevaux, toutes sortes d’animaux enfin.
Trichon m’a écoutée en souriant.
— Habituellement, m’a-t-il dit, quand on veut une maison semblable, on la fait bâtir et on commande le site où on la placera au Père éternel, qui est un assez bon paysagiste. Cependant, rassurez-vous, ma chère enfant, je crois que j’ai quelque chose comme ça dans ma clientèle.
— A vendre ?
— Naturellement. C’est un peu loin, par exemple… en Berry. Cela vaut cent mille francs avec la ferme. Il y a un chemin de fer à huit lieues.
Trichon, malgré sa tête pelée et sa barbe grise, est toujours le notaire galant et bel esprit que nous avons connu. Il ne s’est jamais refusé le plaisir de dire une impertinence. Aussi, comme sa proposition me convenait fort, il m’a regardée d’un air malin et m’a dit :
— Quel est donc le petit jeune homme que tu vas enterrer là pendant… six mois ?
Jelui ai jeté mon éventail au nez, et l’ai prié de m’acquérir la maison en question.
Huit jours après, j’étais ici.
Trichon n’avait rien exagéré et mon rêve était réalisé.
J’ai une maison charmante, mon ami ; la fameuse maison blanche aux volets verts de tous les romans — avec des arbres de cent ans et de vieilles grilles seigneuriales, et une prairie d’une lieue, et, pour tout voisinage, un hameau qui se nomme Saint-Firmin et dont j’aperçois, là-bas, dans le vallon, le clocher pointu comme une aiguille.
On m’a dit qu’il y avait à six lieues d’ici une ville assez grande, peuplée de bourgeois hérissés de pruderie, et dont l’unique occupation consiste à s’occuper de la pluie et du beau temps, de la ruine des uns et de la fortune des autres.
Je n’y suis point allée encore et n’en éprouve nullement le besoin.
On m’appelle ici Mme Valneuve, du nom de mon père, que je n’ai jamais porté au théâtre.
Le notaire et le curé me croient veuve, bien que je ne l’aie pas dit.
Quand je suis arrivée, j’étais en demi-deuil : j’achevais de porter celui de mon vieil oncle qui m’a laissé quelque chose.
Jusqu’à présent, on ne s’est pas beaucoup occupé de moi, du moins de ce côté-ci du vallon, car…
Car, mon cher ami, toute médaille a son revers, toute oasis avoisine le désert, et l’Arabie Pétrée touche à l’Arabie Heureuse.
Tu vas en juger.
Ma maison est donc à mi-côte ; plus haut la colline se couvre d’un fouillis de vignes ; au-dessus encore s’élèvent de grands bois qui semblent cerner l’horizon.
A première vue, ce sont là mes colonnes d’Hercule. Il n’en est rien cependant. Un jour, il m’a pris fantaisie de gravir le coteau, d’arriver aux grands bois et de les traverser, et, tout aussitôt, comme Moïse découvrant la Judée du haut d’une montagne, j’ai vu se dérouler devant moi, au nord, un vaste horizon qui ressemble à la Terrepromise à peu près comme la rue aux Ours ressemble au boulevard des Italiens.
Plaines arides, sablonneuses, semées de pins rabougris, coupées de cours d’eau morbide, étangs fiévreux, mouchetées çà et là d’une maison en briques rouges qui prend le nom pompeux de château, telle est la jolie contrée qui m’avoisine.
Cela s’appelle la petite Sologne — la pouilleuse comme ils disent en Berry. Eh bien ! mon ami, dans ce joli pays déshérité de Dieu et des hommes, il se trouve force propriétaires campagnards, demi-hobereaux, demi-manants, dont la langue acérée s’est déjà beaucoup occupée de moi.
Pour les uns je suis veuve, pour d’autres je vis séparée de mon mari.
Une grosse femme assez commune, qui a beaucoup d’argent, un mari maigre et des enfants gras, prétend que j’ai eu une conduite scandaleuse à Rouen. Pourquoi Rouen ?
Au château de la Revessière — voilà un nom qui sonne bien, — une nichée de gentillâtres, le père et les cinq fils, a jeté ses vues sur moi. Je suis bien encore, paraît-il : je suis à mon aise, on me croit riche. Voilà une occasion sérieuse de consolider un peu le manoir qui tombe en ruines.
Donc, on s’occupe de moi un peu partout.
Mais je me retire derrière mes grands arbres, et je me figure qu’on a baissé le rideau sur une mauvaise pièce.
Jete vois et t’entends, d’ici, t’écrier :
— Ah çà ! mais tu dois t’ennuyer horriblement là-bas ?
Non, mon bon ami, je ne pleure plus, je ne ris pas encore ; mais je suis à peu près heureuse. Me voilà presque fermière et à l’abri de Paris.
Car, vois-tu, quand je suis revenue de Pétersbourg, Paris m’a épouvantée.
C’était le tourbillon, le gouffre qui allait m’attirer de nouveau.
On ne renonce ni au théâtre ni à l’amour sans de grands déchirements — le théâtre, cette nourriture de l’orgueil féminin ; l’amour, ce pain du cœur. Il faut s’en aller bien loin, comme j’ai fait, se condamner à ne plus lire un journal, fermer sa porte à tout homme qui n’a pas un faux toupet et des mollets de son.
J’ai souffert, mais est-ce à dire que je ne souffrirais plus encore ? J’ai fait un serment, mais aurais-je eu la force de le tenir à Paris ?
Et puis, si parfait que soit un mort, peut-il rivaliser avec les imperfections d’un vivant ?
Cependant j’ai failli rester… Ah ! nos souvenirs de jeunesse qui nous reprennent un jour à la gorge, qu’en dis-tu ?
Et il faut bien que je te dise une histoire que peut-être tu sais mieux que moi, pour t’expliquer mon hésitation. Cette histoire c’est celle d’un homme que nous appellerons Gérard, si tu veux, et d’une femme nommée Juliette.
Or donc, mon ami, laisse-moi te raconter cela comme un roman.
Ce fut un soir d’hiver que Gérard rencontra Juliette, pour la première fois — lui inconnu encore, elle dans toute la splendeur de sa jeunesse, de son talent et de sa beauté.
Las de valser, ils s’étaient réfugiés dans un petit salon déserté par les joueurs de whist.
Gérard était à genoux ; il tenait, dans ses mains, les deux mains de Juliette et lui murmurait la première strophe de cette chanson de l’amour, éternellement jeune et mélodieuse, et qui sera toujours la même.
Elle l’écoutait, inclinant sa tête intelligente et coquette, souriant pour lui montrer ses dents éblouissantes à travers ses lèvres moqueuses.
Puis, tout à coup, le sourire s’effaça, le regard étincelant de malice devint rêveur ; la voix railleuse eut un timbre plus doux.
— Vous avez vingt ans, lui dit-elle, et je n’en ai que vingt-deux. Vous ne savez rien de la vie, ce que j’en sais, moi, je ne pourrais vous l’apprendre. Peut-être ai-je souffert un peu, mais si peu… vous n’avez pas souffert, vous et le livre de l’amour, ce livre dont vous me parlez, ne s’est point encore ouvert sous vos yeux.
« Si vous m’aimiez, notre amour durerait-il ? Si je vous aimais, serais-je constante ?
« Non, car voyez-vous, mon ami, l’amour vrai, l’amour unique, celui qui monte du cœur au cerveau, au lieu de descendre de la tête au cœur, attend pour naître que la douleur ait mûri l’âme.
« Alors seulement, mon ami, on est indulgent ; on croit, on espère, on pardonne.
« Nous sommes deux enfants, aujourd’hui ; vous, rêvant la renommée ; moi, enivrée de mes triomphes et n’ayant point encore la force de les supporter.
« Nous serions malheureux tous deux, vous me faisant expier parfois votre obscurité, moi vous accablant de ma jeune réputation… attendons… qui sait ?
Et le bruit d’une valse interrompit Juliette, et on vint la chercher, et Gérard soupira…
Peut-être, en sortant de ce boudoir où l’adolescent lui avait timidement effleuré les doigts de ses lèvres, tourna-t-elle la tête pour le revoir encore… Mais le tourbillon l’entraîna, la nuit finit, le jour vint, et cet incendie que Juliette avait allumé dans la tête enthousiaste de Gérard s’éteignit avec trois gouttes de pluie, c’est-à-dire en moins de huit jours.
Juliette avait eu raison : il n’avait pas souffert encore.
Mais à six années de là, ils se retrouvèrent, elle plus belle encore, et lui fatigué mais non lassé d’un labeur qui avait porté ses fruits.
Et ici commence une autre histoire qu’on ne saurait dire en quelques lignes.
Une histoire vraie, un drame intime et réel, mêlé de rires et de larmes, de joies délirantes et de cruels sacrifices, l’histoire d’une vie de deux années dont le souvenir la reprit et qui fit retentir tout à coup dans son cœur où veillait un mort le nom d’un vivant.
Juliette songea à Gérard.
Où était-il ?
Pendant une heure elle courut comme une folle, de rue en rue, dans ce pays Bréda, où Gérard avait demeuré, depuis les hauteurs de la rue des Martyrs jusqu’à la rue Saint-Lazare.
Elle passa devant cette maison où ils s’étaient quittés, un matin, le cœur brisé, mais fermes et dignes comme il convient de l’être à la dernière heure…
Ah ! si elle l’avait rencontré…
Tout à coup, à l’angle de la rue Taitbout, Juliette se trouva face à face avec Clémence Vernier, qui sortait de chez Marguerite Bertin, et qui lui sauta au cou.
En dix minutes Clémence eut raconté à Juliette toute son existence depuis quatre années ; mais Juliette ne comprit, n’entendit qu’une chose, c’est que Clémence avait été la dernière maîtresse de Gérard, et que Gérard était marié.
Et Juliette se sauva chez Trichon le notaire et huit jours après elle était ici, où je viens de prendre la plume pour t’écrire. Je ne te dirai pas que j’ai pris mon parti en brave, mais je suis plus calme et presque heureuse, et je vais te conter l’existence que je mène.
Je me lève de bonne heure et tout aussitôt me voilà dehors, à travers champs et prairies, entourée de trois ou quatre amours de petits chiens qui gambadent autour de moi.
Mon cocher, un mougick du nom de Wassili que j’ai amené de Russie, me dresse un petit cheval du pays que je monterai dans huit jours et qui est vif comme un vaudeville de Duvert et Lauzanne.
J’ai emporté des livres, de la musique, et une grosse main de papier blanc. Sais-tu pourquoi ? Je deviens bas-bleu sur le tard, je veux écrire cette histoire dont je te parlais tout à l’heure, l’histoire de notre jeunesse et de nos amours, de nos joies et de nos misères, à nous tous et nous toutes qui nous réunissions, les soirs d’été, dans le jardinet de Gérard, rue de Laval, tout en haut du quartier Bréda.
Et si, par aventure, tu apprenais quelque jour que Gérard n’est pas complètement heureux, dis-lui donc que je ne tiens pas, comme certains vaudevillistes, à travailler seule, qu’il sera de la pièce s’il lui plaît de venir en Berry se souvenir un peu du temps passé, et qu’il pourra mettre son nom sur l’affiche à côté de celui de ta vieille camarade,
Juliette »
1.
Les théories d’Aspasie
Aspasie donnait un bal.
Pour dire la vraie vérité, Aspasie s’appelait Marguerite.
Mais il serait convenable avant tout de prendre un juste milieu entre les bourgeois féroces qui veulent que chaque lorette soit la fille d’un portier, et le gandin naïf qui les croit issues des Montmorency par les femmes.
Donc il faut vous dire la provenance de Marguerite qui se nommait Aspasie.
Aspasie était la fille d’un petit employé qui avait fait des miracles, avec ses dix-huit cents francs, pour élever sa famille.
Il avait fait un sous-lieutenant de son fils, il voulait que sa fille entrât dans un pensionnat.
Et comme Marguerite, à dix-sept ans, était gentille, spirituelle et gaie, elle avait jeté son bonnet par-dessus le chapeau d’un joli garçon, en guise de moulin.
Ce joli garçon était un acteur.
Marguerite était entrée au théâtre ; de dix-huit à vingt-six ans, son existence avait été celle de toutes les femmes qui adoptent la carrière dramatique comme un moyen et non comme une profession.
Elle avait flotté constamment entre douze cents francs et deux mille d’appointements, entre un sixième d’agent de change et un bon commerçant rangé, entre un mobilier non payé et toujours saisi et la perspective d’un coupon de rente constamment promis à la veille d’une rupture.
Elle n’avait jamais pu faire beaucoup de dettes, elle n’avait jamais aimé ni ruiné personne.
On disait d’elle, au pays de l’amour en commandite : Marguerite est une carroteuse, elle fait tout enpetit.
Pourtant elle avait de l’esprit ; au théâtre elle n’était pas mauvaise ; elle était jolie, elle avait même d’adorables cheveux blonds sur la limite extrême qui sépare cette nuance du rouge.
Mais en tout cela rien d’excentrique, de tapageur, de voyant.
— Tu ne sais pas ce qui plaît aux hommes, lui disait un jour un joli bébé de quarante-trois ans pour qui un adolescent se ruinait.
Avec cela des tocades de fidélité tous les six mois, et l’amour de la famille.
Car il faut bien l’avouer, les pères qui maudissent leurs filles sont de rares exceptions, et les mères qui ne les accompagnent pas dans leur nouvelle existence, confirment la règle.
Le père de Marguerite était à la retraite ; en le renvoyant de son ministère avec huit cents francs de pension, on lui avait donné la croix.
Marguerite lui payait son loyer, lui faisait des chemises et des bas, et lui donnait à dîner trois fois par semaine.
Le bonhomme aimait les bons cigares, il ne se faisait pas trop prier pour en accepter.
Quelquefois, si Marguerite était gênée, il apportait son trimestre dans la maison.
Lorsque Marguerite voulait apaiser un créancier, elle lui envoyait son père.
Un homme décoré, ça faisait toujours son petit effet.
Et Marguerite était arrivée ainsi jusqu’à vingt-six ans, sans position bien sérieuse dans le monde, sans épargnes pour l’avenir, et sans trop d’arriéré pour le passé.
On dit que la fortune frappe, une fois en notre vie, à la porte de chacun.
L’heure de Marguerite n’était point venue.
— Ma petite, lui dit un jour une de ses amies, regarde-moi. Je ne suis pas jeune, je ne suis ni belle ni laide, l’esprit que l’on m’accorde est une mosaïque faite avec les mots de tout le monde, et je n’aimerais pas qu’on pénétrât de trop bonne heure dans mon cabinet de toilette.
« Eh bien ! j’ai trente mille livres de rente, deux chevaux et trois domestiques. Le petit baron Benjamin se ruine pour moi, et je le laisse faire. A ton âge j’étais comme toi. Il faut prendre un parti, il faut te lancer.
— Je le voudraisbien, répondit Marguerite, mais comment ?
— Ma chère, reprit la vieille hétaïre, souviens-toi que les hommes de notre temps demandent à une femme tout ce qui n’est pas de la vertu. Sois bonne fille, économe, rangée, adopte un garçon qui gaspille sa fortune, fais-lui payer ses dettes, vis en pot-au-feu avec lui ; et tu peux être certaine qu’il te quittera pour se marier avec quelque laideron de province. Ruine-le, au contraire, laisse-le se brûler la cervelle, au besoin, etle lendemain il te pleuvra des déclarations et tu verras arriver la file dix millionnaires armés de lingots.
— Mais, dit naïvement Marguerite, pour ruiner un homme, encore faut-il qu’il ait de l’argent ! Et où le trouver ?
— Nous le trouverons.
— Où cela ? demanda Marguerite.
— A Bade, nous partons ce soir.
— Mais je n’ai pas le sou.
— Je te prêterai cinq mille francs.
— Mais je ne puis pas quitter Adolphe comme ça…
— Pars sans lui rien dire, il se consolera comme il pourra.
— Ah ! c’est qu’il m’aime bien !
— L’essentiel est que tu ne l’aimes pas.
A la suite de cette conversation édifiante, Marguerite partit pour Bade.
Huit jours après, un soir, ivre morte de vin du Rhin, elle fit sauter la banque.
— Ma chère, lui dit alors le Mentor femelle, si tu as la force de revenir à Paris, de louer un premier étage rue de la Chaussée-d’Antin, d’avoir trois chevaux à l’écurie, et de repousser impitoyablement l’amour de tout le monde pendant six mois, ta fortune est faite.
Il faut dire à la louange de Marguerite que si la fortune venait tard, elle lui fit néanmoins bon accueil et se montra digne de sa nouvelle position.
Elle revint à Paris avec cent trois mille francs, paya ses dettes mesquines, se meubla un appartement splendide, et parut aux courses d’automne dans un dog-cart attelé en tandem qu’elle conduisait elle-même.
Les journaux avaient annoncé son triomphe à Bade ; elle était désormais classée.
Le jeune homme abandonné, Adolphe, revint et essaya de rentrer dans la place.
— Mon chien aimé, lui dit Marguerite, quand je serai tout à fait posée, tu repasseras et tu seras le chéri de mon cœur. Mais pour l’instant file ton chemin et ne faisons pas de bêtises.
Cette dernière rupture opérée avec le passé, Marguerite devint Aspasie ; et le jour où Aspasie donnait un bal, elle était une des sept ou huit femmes à la mode qui suivent les courses de la Marche et de Chantilly, assistent aux premières représentations avec cent mille écus de diamants au cou et aux bras, et protègent les journalistes et les gens de lettres… qui veulent bien se laisser protéger.
Aspasie avait alors trente-six ans.
Son bal avait été fort beau.
La finance et l’administration s’y étaient coudoyées, la presse avait envoyé une députation et les arts s’y étaient trouvés représentés.
Tout cela au masculin, bien entendu.
En revanche, les plus jolies actrices de Paris, quelques célébrités du turf, quelques reines de la pénombre amoureuse.
On avait soupé à deux heures ; plusieurs intrigues s’étaient nouées entre la dernière polka et le buisson d’écrevisses.
En revanche, il y avait eu deux ruptures, une bouderie et un coup d’éventail, au sujet duquel un jeune officier et un non moins jeune auditeur s’étaient promis de se couper la gorge le lendemain.
La fin du souper avait été le signal du départ.
Seuls, les intimes étaient restés, divisés en deux camps.
Le premier s’était emparé du jardin d’hiver, une serre délicieuse, où il y avait des arbustes de cinq mille francs, et y avait dressé la table du lansquenet de rigueur.
L’autre s’était groupé autour d’Aspasie. Cette femme qui, dix années auparavant, mangeait dans de la faïence, portait des lettres dans de méchants vaudevilles et faisait faire sa photographie, avait maintenant une telle réputation de bon goût et d’esprit, de luxe athénien et d’instincts élevés, que la demi-douzaine de femmes et la douzaine d’hommes qui venaient de se claquemurer avec elle dans sa chambre à coucher, étaient à eux tous comme un résumé délicat de la célébrité parisienne.
Il y avait un grand peintre, un compositeur célèbre, un agent de change, un banquier illustre, un romancier connu, un poète qui cherchait à le devenir, un Américain millionnaire, un Russe qui se vantait d’avoir toutes les cheminées de son château en jade vert.
Parmi les femmes, il y avait une soubrette de Marivaux, une comédienne qui avait joué le rôle d’enfant prodige, une vraie comtesse réfugiée au pays de l’amour vénal, et une superbe fille taillée à l’antique, qui avait dix-neuf ans, une beauté de bouchère et pour cent mille francs de diamants à ses poignets et ses oreilles, que lui avait attachés un homme de la Bourse, appelé Luxor, et qui s’efforçait de justifier son nom égyptien par une prodigalité orientale.
Les amants de ces dames n’étant plus là, Aspasie résuma la situation en ces termes :
— Mes chères belles et mes bons amis, les gens ennuyeux sont partis, fermons les portes, de peur qu’ils ne reviennent, et causons un peu du phénix.
— Comment ! dit le peintre qui n’avait jamais pu se défaire de sa rage du calembour, tu veux nous faire assurer ?
— Il n’est pas question de la compagnie d’assurances le Phénix, répondit Aspasie, mais de ce je-ne-sais-quoi qui est le mobile du monde, l’essieu sur lequel tourne la Terre, la chose dont tout le monde parle à tort et à travers, rare comme l’oiseau égyptien, et que personne ne peut définir.
— Mais tu parles de l’amour ! dit la soubrette.
— Justement.
— Mes enfants, dit l’agent de change, ne vous embarquez pas, je vous prie, vous qui êtes les prêtresses du plaisir, dans ce rôle de Vestales essayant de définir le feu sacré.
— Homme grave, répondit Aspasie, je sais ce que vous allez nous dire : « Les créatures comme nous ne comprennent pas l’amour… » Et voici sur quoi, mon bon ami, vous allez baser votre théorie : « Nous sommes des femmes vénales ; pour que nous aimions, il nous faut des cachemires, des dentelles, des pierreries et du bois de rose ; le huit-ressorts couronne nos feux. »
— Sans doute, dit l’homme grave.
— « La femme du monde, au contraire, allez-vous nous dire, aime par amour ; elle est pleine d’abnégation, elle élève ses enfants, c’est l’ange du foyer, la joie de la maison, l’étoile qui protège le navire. » Là, est-ce bien cela ?
— Parfaitement.
— Mais alors, reprit Aspasie, pourquoi venez-vous ici ?
— Ah ! soupira le banquier, qui avait trois filles à marier dont la plus jeune avait deux ans de plus que sa maîtresse, Antonia la rousse ; c’est la corruption du siècle qui en est la cause.
— Vous vous trompez, mon bon ami, et je vais vous le prouver. D’abord vos femmes vous aiment par amour, soit ; mais à la condition qu’elles auront chevaux, cachemires et bijoux, que la couturière aura carte blanche, et qu’elles allaiteront leurs enfants entre deux polkas et un concert spirituel.
« Je ne pense pas que tout cela soit gratis.
« En outre, vous ne pouvez pas envoyer leurs mères dîner, comme les nôtres, à la cuisine ; vous ne demandez pas des pantoufles chez elles si vos bottes vous blessent, vous vous levez de table pour aller fumer, et le jour où il vous plairait de sommeiller de corps et d’esprit au coin du feu, un bon cigare aux lèvres et un bon dîner dans l’estomac, vous faites votre barbe à la hâte, vous chaussez la cravate blanche et le zéphyr et vous montez à côté de votre cocher, sur le siège du coupé trois-quarts qui renferme votre femme et ses dix-sept jupons ; vous la conduisez dans le monde, et pendant quatre heures, tandis qu’elle danse avec six douzaines de cupidons à moustaches qui prennent votre honneur pour une cible et espèrent mettre dans la plaque tôt ou tard, vous causez de la question romaine, qui ne vous intéresse guère, avec une vieille femme, ou du dernier discours prononcé sur la question du sucre, vous qui n’en avez jamais mis dans votre café.
« Et alors vous vous dites en soupirant : Ah ! que j’étais plus heureux quand j’étais avec Madeleine, ou avec Hortensia, ou encore avec cette vaporeuse Mélanie qui trouvait que je n’étais pas poétique.
— Tu siffles bien, chère vipère ! dit le peintre qui avait écouté la tirade d’Aspasie tout d’une haleine et en oubliant de rejeter la fumée de sa cigarette.
— Réponds-moi, si tu l’oses, dit Aspasie avec un sérieux du dernier bouffon.
— Je sais bien, reprit le peintre, que nous avons l’air de donner raison à ta morale, puisque nous sommes ici ; mais puisque tu nous as parlé de nos ennuis d’intérieur, laisse-moi te parler de nos souffrances à nous tous qui avons eu le malheur demettre le pied dans cet enfer qu’on nomme le monde galant.
« Avons-nous jamais une femme à nous ?
— Jamais, dit Aspasie ; cela est vrai.
— Il semble que nous avons réalisé notre cœur comme une fortune qui était bien solide, en actions industrielles que nous plaçons dans une maison de banque toujours prête à déposer son bilan. Nous vous donnons des turquoises, il nous faut des diamants ; nous vous achetons des hôtels, vous soupirez après des palais.