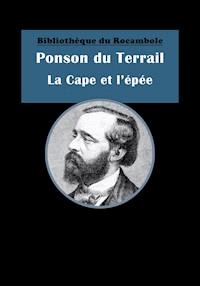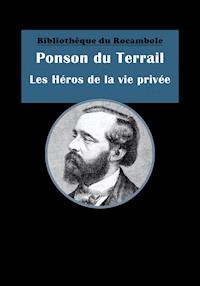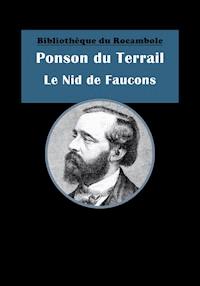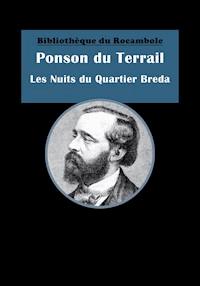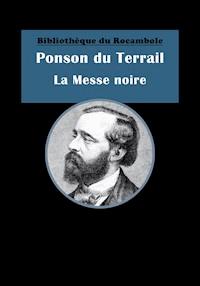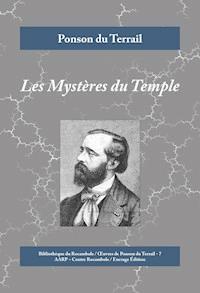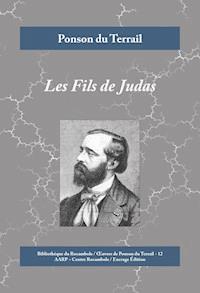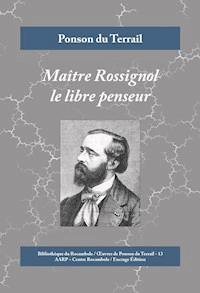
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Œuvres de Ponson du Terrail
- Sprache: Französisch
Quels mystères et secrets cache cet étrange médecin de campagne ?
Ce roman fait exception chez l’auteur en cela qu’il s’agit non plus d’un roman d’aventures criminelles, c’est-à-dire où l’aventure domine — avec ses éléments narratifs : enlèvement, duel, usurpation d’identité, poursuite, etc., — mais bien d’un roman purement criminel dans lequel, sans artifice superflu, un personnage tente de mener à bien une entreprise à but criminel, l’entraînant le plus souvent à commettre des crimes de sang.
La figure du criminel est cette fois celle d’un médecin de campagne, bien éloigné de ces médecins apprentis sorciers que sont le Dr Samuel des Gandins (1860) ou le médecin anonyme de
L’Héritage d’un comédien (1864). Son projet est beaucoup plus modeste mais non moins terrible ; il repose sur l’ambition et sur la haine. En l’absence d’une véritable enquête policière, il n’est démasqué que grâce à un procédé pour le moins exotique.
Un roman au suspense à couper le souffle
EXTRAIT
C’était la veille de Noël.
La neige couvrait la terre, le brouillard rampait au-dessus de la neige et, au travers, apparaissait çà et là un coin de ciel bleu parsemé d’étoiles.
Cependant, l’hiver n’avait pas été rude.
Il avait beaucoup plu en octobre, il avait un peu gelé en novembre ; mais l’été de la Saint-Martin était arrivé, et après lui quelques journées brumeuses.
Le temps était à peine froid et la neige ne durcissait pas ; mais de cette neige à peine consistante s’élevait un brouillard épais, dense, et qui avait des tons rougeâtres.
Deux hommes, l’un à pied, l’autre à cheval cheminaient de compagnie et causaient à mi-voix.
De temps en temps, l’homme à cheval se pressait sur ses étriers comme s’il eût voulu percer le brouillard de son regard, et voir s’il était loin encore du terme de son voyage.
Sur la gauche, un clocher de village perçait la brume ; sur la droite, on entendait un clapotement.
Le village dont la flèche montait dans le ciel gris se nommait Fay-aux-Loges.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Ponson du Terrail est né en 1829 et mort en 1871. S'inspirant tout d'abord du genre gothique, Ponson du Terrail se tourne rapidement vers le roman-feuilleton, style dont il devient une figure emblématique. Dans la veine des
Mystères de Paris d'Eugène Sue, il crée le célèbre personnage de Rocambole.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de Ponson du Terrail - 13
collection dirigée par Alfu
Ponson du Terrail
Maître Rossignol le libre-penseur
1869
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2013
ISBN 978-2-36058-918-0
Préface
d’Alfu
Douzième des quatorze romans de Ponson du Terrail publiés dans Le Petit Moniteur universel du soir à partir de 1865, Maître Rossignol, le libre-penseur paraît en 57 feuilletons, du 25 avril au 20 juin 1869.
Son action se déroule dans l’Orléanais, sous le Second Empire.
Ce roman fait exception chez l’auteur en cela qu’il s’agit non plus d’un roman d’aventures criminelles, c’est-à-dire où l’aventure domine — avec ses éléments narratifs : enlèvement, duel, usurpation d’identité, poursuite, etc., — mais bien d’un roman purement criminel dans lequel, sans artifice superflu, un personnage tente de mener à bien une entreprise à but criminel, l’entraînant le plus souvent à commettre des crimes de sang.
La figure du criminel est cette fois celle d’un médecin de campagne, bien éloigné de ces médecins apprentis sorciers que sont le Dr Samuel des Gandins (1860) ou le médecin anonyme de L’Héritage d’un comédien (1864). Son projet est beaucoup plus modeste mais non moins terrible ; il repose sur l’ambition et sur la haine. En l’absence d’une véritable enquête policière, il n’est démasqué que grâce à un procédé pour le moins exotique.
Dans les romans « de village », Ponson du Terrail décrit les lieux et les personnages avec beaucoup plus de minutie et d’attention que dans d’autres romans.
Il connaît bien le décor qu’il choisit puisqu’il habite une bonne partie de l’année Donnery (Saint-Donat), village voisin de Fay-aux-Loges, non loin de Saint-Florentin, village fictif inspiré de divers localités voisines — dont Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Et il connaît bien la ville d’Orléans.
« La province, plus encore que Paris, est avide des émotions de la cour d’assises. Le lendemain, dès neuf heures, la bonne ville d’Orléans, où d’ordinaire l’herbe pousse dans les rues, était en proie à une grande agitation, et la rue de la Bretonnerie, au milieu de laquelle s’élève le palais de justice, était encombrée d’une foule avide, impatiente, qui remplissait l’air de ses clameurs. » (51).
Et il joue même les guides touristiques :
« Il y a à Orléans trois hôtels : l’hôtel d’Orléans, tenu par Brébant, le père du nôtre, le Brébant du café Vachette ; l’hôtel du Loiret et l’hôtel de la Boule-d’Or. Puis il y a une foule d’auberges. Parmi ces dernières, il en est une dans la rue de Bourgogne qui s’intitule hôtel du Sauvage, et dans laquelle descendent les petits propriétaires des environs. Bazire logeait au Sauvage. » (52).
Ponson du Terrail fait de ses héros des figures complètes à défaut d’être complexes, bien différentes de celles qui peuplent ses romans d’aventures.
De ce point de vue, le personnage de maître Rossignol est tout à fait remarquable.
« Au physique, c’était un homme de quarante-cinq ans, de taille moyenne, d’un visage intelligent et calme, qui n’était dépourvu ni de douceur ni d’énergie. Il était riche : la Grenouillère, une belle ferme de trois cent soixante arpents [180 ha environ], lui appartenait, et il avait, en outre, des bois et des locatures disséminés sur les deux communes de Donnery et de Fay-aux-Loges. Il avait fait ses études au séminaire, en était sorti à dix-huit ans, et s’en était allé à Paris où il avait étudié la médecine. […] Le séminariste défroqué, l’étudiant en médecine qui avait renoncé à prendre ses grades, avaient produit ce qu’on appelle un libre penseur. […] Il n’allait pas à l’église, mais il saluait le curé, et s’il ne voyait pas en lui le ministre de Dieu, il respectait l’homme de dévouement et de charité. » (2).
La question, toutefois, que l’on peut se poser est celle de l’importance à donner au fait qu’il soit libre-penseur. Il faut alors admettre qu’une fois de plus, Ponson appelle à la tolérance face aux idées religieuses et, plus particulièrement, prend la défense de la libre-pensée qui, selon lui, n’exclut pas les valeurs de justice et de tolérance qui ne sont pas le seul apanage des bons catholiques. N’oublions pas que ce texte fut publié à la fin de sa carrière, en 1869.
La pirouette finale est amusante mais peut parfaitement s’expliquer. En effet, on imagine que Ponson, qui a écrit ce roman probablement « sur place », dans sa propriété des Charmettes, à Donnery, à quelques lieues de Fay-aux-Loges, s’est inspiré de figures connues et d’un fait divers très certainement authentique. Il lui fallait donc officiellement prendre ses distances.
1.
C’était la veille de Noël.
La neige couvrait la terre, le brouillard rampait au-dessus de la neige et, au travers, apparaissait çà et là un coin de ciel bleu parsemé d’étoiles.
Cependant, l’hiver n’avait pas été rude.
Il avait beaucoup plu en octobre, il avait un peu gelé en novembre ; mais l’été de la Saint-Martin était arrivé, et après lui quelques journées brumeuses.
Le temps était à peine froid et la neige ne durcissait pas ; mais de cette neige à peine consistante s’élevait un brouillard épais, dense, et qui avait des tons rougeâtres.
Deux hommes, l’un à pied, l’autre à cheval cheminaient de compagnie et causaient à mi-voix.
De temps en temps, l’homme à cheval se pressait sur ses étriers comme s’il eût voulu percer le brouillard de son regard, et voir s’il était loin encore du terme de son voyage.
Sur la gauche, un clocher de village perçait la brume ; sur la droite, on entendait un clapotement.
Le village dont la flèche montait dans le ciel gris se nommait Fay-aux-Loges.
Le clapotement qu’on entendait était celui de la rivière canalisée qui, grossie par les pluies d’automne, coulait à pleins bords.
Le piéton dit au cavalier :
— Nous n’en avons plus que pour une petite demi-heure, monsieur le docteur.
— Ah ! fit l’homme à cheval.
— Nous voici à Fay-aux-Loges.
— Bon !
— Nous allons, en quittant le pays, monter une toute petite côte.
— Et puis ?
— Et puis à gauche, quand nous aurons dépassé les moulins à vent, nous prendrons un sentier qui mène droit à la Grenouillère.
— C’est le nom de la ferme de maître Rossignol ?
— Oui, monsieur.
— Fort bien, dit l’homme à cheval.
Et il retomba dans un profond silence, tandis qu’ils traversaient le village.
Ordinairement Fay-aux-Loges, comme tous les villages possibles, est endormi vers neuf heures du soir ; mais la veille de Noël cela ne saurait être ainsi.
Les bonnes femmes sommeillent au coin du feu, en attendant la messe de minuit ; les hommes passent leur soirée un peu partout, principalement dans les cabarets.
Les rues qui ne jouissent pas des avantages du gaz sont néanmoins éclairées a giorno par les lanternes des fermiers et autres gens de la campagne qui viennent au bourg pour la grande fête nocturne.
Quand il entra dans la grand-rue, l’homme à cheval vit luire dans le brouillard des centaines de lumières ; en même temps la cloche de l’église sonnait le premier coup de la messe.
Il y avait un attroupement d’hommes et de femmes à la porte de Foucault l’aubergiste.
Quelques hommes jouaient au billard ; mais une douzaine de personnes se trouvaient au dehors et la conversation paraissait animée.
— C’est bien drôle tout de même, disait une vieille femme, que notre curé s’absente la veille de Noël, juste à l’heure de la messe de minuit.
— Et pour aller voir des malades qui ne sont pas de sa commune.
— Ah ! dame ! répondit une troisième personne, qui n’était autre que le sacristain, monsieur le curé, avant d’être ici, était à Donnery.
— Qu’est-ce que ça fait ?
— Ça fait qu’il y a laissé de bons souvenirs et des pénitents, à preuve que les femmes de Donnery viennent ici à confesse.
Un brave homme qui avait été soldat et jurait volontiers donna son opinion à son tour :
— Tonnerre de D…, dit-il, faut-il pas laisser les gens mourir comme des chiens ! Le bon Dieu est plus indulgent que vous autres, et il ne se fâchera pas quand on dira la messe un quart d’heure plus tard.
— Pourquoi n’est-on pas allé chercher le nouveau curé de Donnery ? riposta aigrement la vieille sorcière.
— Parce qu’il faut une heure de la Grenouillère à Donnery, et qu’il n’y a pas de la Grenouillère à Fay un grand quart d’heure de chemin.
— C’est égal, dit une autre bonne femme, vous verrez que ça vous portera malheur cette année que notre curé ait mis, un saint jour comme aujourd’hui, les pieds dans une maison comme la Grenouillère.
— Pourquoi donc, mère Legrand ?
— Parce que maître Rossignol, monsieur Rossignol, comme on dit maintenant, est un homme qui ne croit pas à Dieu et qui n’a jamais mis les pieds dans une église.
Ces paroles arrivèrent à l’oreille de l’homme cheval qui passait en ce moment-là devant l’auberge de Foucault et allait s’engager sur le pont du canal.
Il tressaillit et arrêta net son cheval.
— Tiens, dit l’ancien militaire, voilà M. Paumel, le médecin de Saint-Florentin.
— C’est moi ; bonjour, bonnes gens, bonjour, mes amis, dit le docteur. Vous paraissez bien agités, ce soir, à Fay-aux-Loges ?
— C’est la veille de Noël, monsieur ; on ribote un peu en attendant la messe.
— Et on dit du mal de son prochain en attendant le curé, dit le vieux soldat.
— C’est-y à la Grenouillère que vous allez, mon cher monsieur ? fit la mère Legrand.
— Oui, ma bonne femme.
— Eh bien, renvoyez-nous notre curé, car il y est.
— Tiens, voilà Jaquot, dit un autre paysan qui reconnut le piéton qui avait accompagné le médecin.
Jaquot était un enfant de Fay-aux-Loges, et il exerçait à la Grenouillère la profession de berger.
— Tu n’avais donc pas de pain à manger que tu es allé chez ce païen de Rossignol, dit aigrement la vieille à qui, en ce moment, on faisait tort de son curé.
— Je sers qui me paye, répondit Jaquot, et puis je ne dis pas que maître Rossignol soit dévot. Oh non ; il dit même que rien ne prouve qu’il y ait un bon Dieu, mais c’est un honnête homme tout de même, qui n’a jamais fait de tort à personne ; et s’il ne va pas à la messe, son beau-père, sa femme et sa fille y vont, et elles sont charitables au pauvre monde, ce que les bourgeois de par ici ne sont pas tous.
Ayant ainsi défendu son maître, Jaquot, le berger, dit au médecin :
— Allons, monsieur, il ne faut pas nous attarder ; la pauvre Jeannette est bien malade, allez, et le maître, qui s’y connaît un peu, comme il se connaît en toutes choses, dit qu’elle ne passera peut-être pas la nuit.
Le docteur avala un verre de vin chaud que l’avenante Mme Fourault lui avait apporté, souhaita le bonsoir aux gens de Fay, et donna un coup d’éperon à sa monture, qui prit un tout petit trot.
Jaquot courait auprès de lui.
Comme ils arrivaient de l’autre côté du pont, une silhouette noire se détacha sur le fond blanc du brouillard.
Le Dr Samuel reconnut le curé.
— Hé ! monsieur l’abbé, lui dit-il, on vous attend !
— Je le sais, dit le prêtre, mais on ne peut être partout ; et vous aussi on vous attend, docteur ; mais je crains que vous n’arriviez trop tard.
— Ah çà ! dit le médecin, c’est donc un païen, ce Rossignol ?
— Non, dit le curé avec indulgence, c’est un brave homme qui a, selon moi, le tort d’être ce qu’on appelle aujourd’hui un libre penseur. Il est matérialiste, mais il a l’étoffe d’un spiritualiste, et je finirai par le convertir. Bonsoir, docteur.
— Bonsoir, monsieur le curé, répondit le médecin, qui continua son chemin, toujours précédé par Jacquot le berger.
2.
Qu’était-ce donc que maître Rossignol ?
Au physique, c’était un homme de quarante-cinq ans, de taille moyenne, d’un visage intelligent et calme, qui n’était dépourvu ni de douceur ni d’énergie.
Il était riche : la Grenouillère, une belle ferme de trois cent soixante arpents, lui appartenait, et il avait, en outre, des bois et des locatures disséminés sur les deux communes de Donnery et de Fay-aux-Loges.
Maître Rossignol n’était pas précisément un bourgeois, mais il avait plus d’éducation qu’un fermier.
Il avait fait ses études au séminaire, en était sorti à dix-huit ans, et s’en était allé à Paris, où il avait étudié la médecine.
Au bout de sept ou huit ans, il était revenu au pays pour recueillir la succession de son père, et il s’était fait tout simplement fermier.
Il avait alors rencontré une jeune fille qui lui avait plu et qu’il avait épousée.
La jeune fille était riche aussi ; elle avait un frère, plus âgé qu’elle de douze ans, d’une santé délicate et qui n’avait jamais voulu se marier.
Quand elle devint Mme Rossignol, son frère vint vivre avec elle sous le toit de la Grenouillère, et l’union la plus parfaite ne tarda pas à régner entre les deux beaux-frères.
Cependant, maître Rossignol et M. Jules, comme on appelait son beau-frère, n’avaient pas les mêmes idées.
Le séminariste défroqué, l’étudiant en médecine qui avait renoncé à prendre ses grades, avaient produit ce qu’on appelle un libre penseur.
M. Jules et sa sœur étaient, au contraire, des personnes fort religieuses.
Les deux beaux-frères ne se querellaient jamais, mais ils discutaient toujours.
Mme Rossignol essayait bien de les mettre d’accord, mais elle n’y parvenait pas. M. Jules Bertomy, son frère, disait :
— Vous êtes bien malheureux, en vérité, Rossignol, de ne pas croire. Si vous saviez quelles consolations, quelles joies offre la religion chrétienne ; et comme elle nous sert de guide et nous aide à supporter les misères de la vie !
A quoi Rossignol répondait :
— Vous autres, vous faites le bien dans l’espoir d’une vie future pleine de récompenses, et vous redoutez de faire le mal parce que vous craignez un châtiment. Moi, je fais le bien, parce que mon cœur m’y pousse, et si je ne fais pas le mal, c’est que ma conscience est mon seul juge. Je suis donc plus fort que vous, moi qui n’espère rien et ne crains rien.
Mme Rossignol soupirait parfois, mais elle se jetait au cou de son mari et lui disait :
—Tu es si bon, si honnête, que Dieu te fera un jour la grâce de croire en lui.
Rossignol haussait les épaules alors.
— Pourquoi parlez-vous de Dieu ? disait-il ; l’avez-vous jamais vu ? savez-vous où il est ? quelle est sa forme et sa nature ?
— Mais, malheureux, disait Mme Rossignol, qui donc fait pousser le blé, qui donc a créé le soleil, qui donc a fait les étoiles, si ce n’est Dieu ?
Et Rossignol répondait :
— Vous confondez Dieu avec la nature et vous voulez faire une individualité de ce qui n’est qu’une immense harmonie.
Le curé de Fay-aux-Loges était un jeune prêtre plein de zèle et de foi, d’indulgence et de charité.
Il ne refusait jamais une discussion courtoise, et, il faut le dire, Rossignol était athée, mais il n’était pas impie.
Il n’allait pas à l’église, mais il saluait le curé, et s’il ne voyait pas en lui le ministre de Dieu, il respectait l’homme de dévouement et de charité.
Rossignol disait :
— Je ne pense pas comme vous, mais je ne vous force pas à penser comme moi.
Quand sa fille vint au monde, il ne s’opposa pas à ce qu’elle fût baptisée.
Mme Rossignol allait se confesser et remplissait tous ses devoirs.
Rossignol souriait, en esprit fort qu’il était, mais il faisait bon accueil au curé quand, par hasard, celui-ci passait sur les terres de la Grenouillère.
Or, bien des années s’étaient écoulées depuis que maître Rossignol s’était mis franchement à cultiver ses terres.
Sa fille avait grandi.
C’était une belle personne de dix-huit ans au moment où commence notre histoire, belle et sage et élevée chrétiennement, ce à quoi maître Rossignol ne s’était jamais opposé.
On l’appelait Germaine. Elle était blonde, avec de grands yeux bleus, une bouche rose, une taille mince et bien prise.
Plus d’un châtelain du voisinage, plus d’un gentilhomme chasseur passant par la Grenouillère l’avait admirée.
M. Hippolyte de Fontbonne, un pauvre diable qui avait plus d’aïeux que d’écus et vivait au bord de la forêt, dans un pigeonnier qu’on s’obstinait à appeler le château, s’était souvent surpris à regarder mélancoliquement ses vieux portraits de famille et leur avait adressé cette prière mentale : Ah ! si vous vouliez consentir à une petite mésalliance comme j’épouserais la petite Rossignol et les cent mille écus de dot qu’elle aura un jour !
Mme Rossignol, son frère et sa fille étaient au dire du peuple, les anges de la Grenouillère.
Rossignol en était le démon.
Ce malheureux homme, qui ne mettait jamais les pieds à l’église, était fort mal noté.
Il avait beau être humain, charitable, droit en affaires et sûr de parole, on se défiait de lui.
Quand il payait une somme quelconque, on était toujours tenté de faire venir le curé pour qu’il jetât sur les écus une goutte d’eau bénite.
Donc, ce soir-là, les bonnes femmes de Fay étaient fort en colère contre leur desservant, qui, au lieu de leur venir dire la messe de minuit, s’attardait sous le toit d’un païen.
Et cependant, si le curé s’était oublié, c’est qu’il n’avait pu faire autrement.
Il avait administré les derniers sacrements à Jeannette, une vieille servante de la ferme, une pauvre fille qui avait élevé Germaine, servi ses maîtres avec dévouement, et qui se mourait d’un mal non moins épouvantable que subit.
La brave fille, en cueillant le matin de l’herbe pour les vaches, avait été piquée par une mouche charbonneuse.
L’enflure avait envahi la main, gagné le bras, puis l’épaule.
On avait envoyé en toute hâte chercher les deux médecins de Fay.
Ils étaient venus ensemble et avaient secoué la tête en disant qu’il n’y avait pas de remède.
Et comme Germaine pleurait, car Jeannette l’avait tenue enfant sur ses genoux, on avait pensé à M. Bazire.
M. Bazire était un médecin entre deux âges, qu’un drame judiciaire avait mis à la mode.
Peut-être était-il beaucoup plus ignorant que ses confrères ; assurément il n’avait ni l’expérience du Dr Rousselle, ni celle du Dr Jousselin, de Jargeau, mais il avait parlé devant la justice, et un homme qui parle devant la justice est un homme fort.
Il était expert dans bien des cas, le procureur impérial mettait ses lumières en réquisition, et M. Bazire était dévoré de l’ambition d’avoir la croix.
Quand un homme mourait de faim, il admettait volontiers qu’il s’était suicidé.
Si un pauvre diable, las de la vie, se tuait, Bazire cherchait un coupable, et, si on l’avait laissé faire, il l’eût trouvé.
Or, c’était là l’homme qu’on avait envoyé chercher à trois lieues de Fay-aux-Loges pour sauver la servante d’un mal évidemment sans remède.
Et, tout en cheminant vers la Grenouillère, le Dr Bazire se disait que le pays était bien calme depuis longtemps, et que depuis longtemps, lui, Bazire, n’avait parlé devant la justice.
M. Bazire, plus que jamais, mourait d’envie d’avoir la croix…
3.
Le Dr Bazire chevauchait donc avec Jaquot le berger pour compagnon.
On a deviné en partie ce qu’était au moral le Dr Bazire ; au physique, c’était un homme de cinquante ans, petit de taille, légèrement obèse, à la face pâle et presque jaune, aux yeux enfoncés profondément sous l’arcade sourcilière.
Il avait des lèvres minces, sans bords, et qu’on eût dites fendues avec un couteau.
Sa parole était solennelle, son geste grave et empreint d’une sorte de dignité grotesque.
Un médecin qui parle devant la justice doit être encore plus majestueux que ses confrères.
Il affectait des idées religieuses exagérées et pratiquait avec une ferveur qu’on aurait taxée d’hypocrisie.
Tel était l’homme qu’on avait appelé, au désespoir du maître, à la ferme de la Grenouillère.
La Grenouillère avait été, au temps jadis, une manière de château.
La basse-cour était fermée par de gros murs, derniers vestiges d’une clôture féodale, et le bâtiment principal flanqué d’une tour, convertie depuis longtemps en pigeonnier.
On arrivait à la porte par une allée de vieux ormes ventrus, bossus, contournés, mais qui, en été, donnaient une ombre épaisse.
Ensuite, comme on le pense bien, il y avait un certain confort chez maître Rossignol.
Une partie de l’habitation était, comme on dit, meublée bourgeoisement, et le libre penseur avait un cabinet rempli de livres.
Dans la journée, ou plutôt depuis la prime aube jusqu’à la nuit, Rossignol était agriculteur ; il ensemençait un sillon par-ci, surveillait un laboureur par-là, donnait ses ordres et promenait sur ses terres cet œil du maître chanté par le fabuliste.
Mais le soir, après le repas de la famille, il s’enfermait dans cette grande salle qu’il appelait son cabinet, et il étudiait et lisait jusqu’à dix ou onze heures.
Certes, ce n’était pas lui qui avait parlé le premier d’envoyer chercher M. Bazire.
D’abord il ne connaissait ce médecin que de nom.
Saint-Florentin est à quatre lieues de la Grenouillière, et le docteur expert ne rayonnait guère que jusqu’aux portes de Fay.
Ensuite, les études médicales de Rossignol, bien qu’incomplètes, étaient suffisantes pour lui avoir permis dès la première heure de juger le mal sans remède.
Enfin, quand on avait prononcé le nom du Dr Bazire, il avait éprouvé une répugnance bizarre, quelque chose comme le pressentiment d’un malheur autre que celui auquel il fallait s’attendre.
Mais c’était Germaine qui avait demandé le médecin de Saint-Florentin, et Germaine n’avait qu’à parler pour que tout le monde, depuis son père, sa mère et son oncle, jusqu’à la dernière fille de cuisine, s’empressât de faire sa volonté.
Or donc le Dr Bazire arriva.
On avait couché la servante dans une pièce attenante à la salle basse de la ferme.
Mme Rossignol et sa fille, M. Jules Bertomy et son beau-frère entouraient son lit.
Jeannette avait encore toute sa connaissance, mais la vie l’abandonnait et son corps était presque tout noir.
Le docteur la regarda, et, comme son confrère de Fay, il secoua la tête.
Cependant, il regarda maître Rossignol qu’il voyait pour la première fois, et lui dit :
— Etes-vous bien certain que ce soit une mouche charbonneuse qui ait piqué cette femme ?
— Que voulez-vous donc que ce soit ?
— Il me semble que je vois les traces d’un empoisonnement par le phosphore, murmura le docteur, obéissant ainsi à sa manie judiciaire.
Mais la mourante se souleva.
— Ah ! monsieur, dit-elle, jamais je n’ai pensé à m’empoisonner. C’est ce matin que ça m’est arrivé…
— Au fait, dit Bazire, c’est possible ; mais l’enflure est telle, du reste, que toute trace de piqûre a disparu.
Il essaya de quelques remèdes insignifiants, pour l’acquit de sa conscience, et dit tout bas à Mme Rossignol :
— Il faut vous attendre à une catastrophe prochaine. Emmenez votre fille, le spectacle de la mort est toujours affreux pour les jeunes gens.
Puis, tout haut :
— La malade est entourée de trop de monde, dit-il encore, je ne voudrais pas plus d’une personne avec moi auprès d’elle.
Mme Rossignol emmena Germaine, qui fondit en larmes.
Alors Rossignol dit à son beau-frère :
— Quant à vous, mon pauvre Jules, vous savez combien vous avez été souffrant ces temps derniers : allez prendre un peu de repos. Je resterai avec le docteur.
C’était bien là ce que désirait Bazire.
Cet homme était curieux autant que malveillant peut-être ; le mal qu’il avait entendu dire de maître Rossignol le mettait en goût.
Il n’était pas fâché d’étudier ce phénomène d’un homme qui ne croit pas à la vie future.
Or, environ une heure après que Mme Rossignol et Germaine furent parties, la servante perdit connaissance et le délire de l’agonie commença.
— Elle en a pour une heure encore, dit Bazire ; et puis tout sera fini, son âme s’envolera vers le Ciel.
— Vous croyez donc à l’immortalité de l’âme, docteur ? demanda Rossignol.
Maître Rossignol avait la manie de la discussion. Il ne manifestait jamais ses opinions antireligieuses devant sa fille, mais quand il pouvait prendre à partie sa femme ou son beau-frère, et même le curé de Fay, il était enchanté.
Le Dr Bazire s’offrait donc à lui comme une bonne fortune.
C’était un paladin que lui amenait le hasard et qui aurait certainement la courtoisie de rompre avec lui une lance philosophique.
— Mais certainement, répondit le docteur, je crois à l’immortalité de l’âme.
— C’est une consolation pour votre orgueil, dit Rossignol.
— Mon orgueil ?
— Oui ! sans doute, docteur ; l’homme ne veut pas être un animal ordinaire, il ne veut pas retourner tout entier à la mère commune qui est la nature, et il a inventé l’immortalité de l’âme, quand la matière seule est immortelle. Cette idée d’un homme double, matière et esprit, est cependant contraire à la raison.
— Ah ! vous croyez ? ricana Bazire.
— L’homme est une entité, reprit Rossignol. Quand une de ses parties essentielles lui manque, il cesse de vivre.
— Mais son âme…
— Il n’y en a pas. Que deviendrait l’âme d’un homme ivre ? Est-ce l’âme qui a bu le vin ? Non, c’est le corps. Tel poison rend furieux, tel autre plonge dans l’inertie. Cependant le corps réagit sur l’âme, et si l’âme était un esprit, elle serait insensible à ces phénomènes.
— Alors si vous ne croyez pas à l’immortalité de l’âme, vous ne croyez pas à Dieu.
— Je ne dis point cela, mais la définition de cet agent supérieur nous manque…
— Ah ! monsieur, vous êtes impie !
— Vous vous trompez encore, docteur ; je respecte toutes les croyances, et ma famille vous dira que je ne l’ai jamais contrariée dans l’accomplissement de ses pratiques religieuses.
— Monsieur, dit encore Bazire, vous vous convertirez un jour.
— Je suis tout converti, monsieur, car j’ai l’amour de mes semblables et le respect de ma conscience.
Et tandis que Rossignol exposait ainsi sa théorie, le Dr Bazire se disait : Il n’est pas moins vrai que si tu étais jamais accusé d’un crime, on aurait beau jeu à se servir de tes maximes pour te faire condamner !…
La malade râlait pendant ce temps-là, et tout à coup le médecin posa un doigt sur ses lèvres :
— Voici le moment suprême, dit-il.
— Eh bien ! dit Rossignol avec tristesse, regardez bien, docteur, et voyez si quelque chose qui puisse répondre à ce que vous appelez son âme se sépare de son corps… Hélas ! non. Adieu, ma pauvre Jeannette… Il ne restera de toi que ton souvenir !
Et Rossignol essuya une larme, et il se recueillit comme se recueillent ceux qui vont se séparer pour l’éternité.
4.
Huit jours s’étaient écoulés.
Jeannette la servante reposait dans un coin du cimetière de Fay-aux-Loges, et le Dr Bazire s’en était retourné à Saint-Florentin.
L’existence calme et un peu monotone de la Grenouillère avait repris son cours, lorsqu’un nouvel événement tout à fait inattendu vint appeler l’attention sur maître Rossignol et sa famille.
Un matin, la maison eut un hôte de plus.
Quel était-il ?
Un petit garçon de trois ou quatre ans.
Les domestiques, en s’éveillant le matin, trouvèrent M. Jules Bertomy qui le tenait sur ses genoux, et maître Rossignol qui parlait à voix basse à son beau-frère.
D’où venait cet enfant ?
Nul ne le savait, pas même Rossignol.
M. Jules Bertomy était, nous l’avons dit, d’une santé délicate.
Souvent malade, il allait chaque année, en plein été, passer un mois hors du pays.
Tantôt il se rendait à Vichy, dont les eaux lui étaient ordonnées. Tantôt il se rendait simplement à Paris. Mais jamais, jusqu’alors, il ne s’était absenté en hiver.
Or, le surlendemain des funérailles de sa servante, M. Jules Bertomy reçut une lettre chargée.
Une lettre qui, du reste, ne contenait pas de valeurs, mais dont la substance le troubla visiblement.
Quand il eut pris connaissant de cette lettre, il la jeta précipitamment au feu.
Maître Rossignol, qui était auprès de lui en ce moment, laissa échapper un geste de surprise.
Alors M. Bertomy lui dit :
— Vous êtes mon frère, mais vous êtes encore mon ami, et c’est à ce double titre que je fais appel à votre loyauté et à celle de ma sœur.
— Mais de quoi s’agit-il donc ? demanda maître Rossignol.
— Je viens de recevoir une lettre…
— Que vous avez brûlée.
— C’est ce qui m’appelle précipitamment à Paris.
— Pour quoi faire ?
— Mon ami, dit M. Jules Bertomy, je n’ai pas de secret pour vous ; mais le secret de ce voyage ne m’appartient pas. Permettez-moi donc de vous demander votre parole d’honnête homme que vous ne me questionnerez pas.
— Qu’à cela ne tienne ! dit Rossignol.
Et il appela sa femme, à qui M. Bertomy répéta les mêmes paroles.
— Mon ami, dit Mme Rossignol, tu as toujours été pour moi le meilleur des frères, et ce n’est pas moi qui voudrais te chagriner en rien. Garde donc ce secret dont tu nous parles.
— Oui, dit M. Bertomy, mais il peut se faire que je ne revienne pas seul de Paris.
— Ah !
— Et que je vous amène un être que je vous prierai d’aimer comme vous m’aimez.
— Quel qu’il soit, nous l’aimerons, dit maître Rossignol.
M. Bertomy, une heure après, quittait la Grenouillère dans la carriole de la ferme attelée d’un bon gros cheval percheron, et prenait la route d’Orléans, où il allait joindre le train qui part à deux heures de l’après-midi, et arrive à Paris un peu avant cinq heures.
Son absence dura cinq jours.
Il n’avait pas écrit à sa famille ; il n’avait donné signe de vie à personne.
Le soir du sixième jour, tout le monde était couché à la ferme, quand le bruit d’une voiture se fit entendre dans l’avenue de vieux ormes.
Les laboureurs, les valets, les filles de cuisine ou de service dormaient déjà de ce profond sommeil qui est la récompense quotidienne de ceux qui vivent de la vie des champs.
Mme Rossignol et Germaine étaient pareillement couchées dans des chambres contiguës.
Seul, Rossignol ne s’était pas encore mis au lit.
Le fermier avait conservé certaines habitudes de l’homme d’études d’autrefois.
Il travaillait avec un grand feu dans la cheminée et la fenêtre ouverte, quelque rigoureuse que fût la saison.
Il n’y eut donc que lui qui entendit le bruit de cette voiture.
Il quitta la table devant laquelle il compulsait un livre de chimie, car il s’occupait de chimie, le brave homme, et cherchait depuis longtemps une substance propre à combattre l’oïdium, ce fléau des pays vignobles.
Il quitta donc la table et s’approcha de la fenêtre.
La lune éclairait la campagne, et le fermier aperçut fort distinctement une de ces voitures de louage qu’on trouve sur la place du Martroi, à Orléans.
Alors il eut un pressentiment.
C’est peut-être Jules qui revient.
Puis il se souvint des paroles mystérieuses de son beau-frère, et il se dit encore : Peut-être aussi aimera-t-il tout autant rentrer sans bruit à la ferme, surtout s’il ne revient pas seul.
Sur cette réflexion, maître Rossignol prit son chapeau et descendit sans bruit au rez-de-chaussée, ouvrit la porte, traversa la cour et siffla Jupiter.
Jupiter était un énorme chien de montagne qui faisait bonne garde la nuit dans la basse-cour de la Grenouillère. Comme son maître le sifflait, il accourut en bondissant et vint lui lécher les mains.
— Tais-toi ! lui dit Rossignol, qui ne voulait pas que le chien, en aboyant, éveillât les hôtes de la ferme.
Puis il sortit de la basse-cour, emmenant Jupiter avec lui, et il s’en alla à la rencontre de la voiture, qui n’avançait que difficilement dans le chemin défoncé par les pluies de l’hiver.
Maître Rossignol ne s’était pas trompé.
C’était bien M. Jules Bertomy qui revenait.
A la vue de Rossignol, la voiture s’arrêta.
Alors Rossignol s’approcha de la portière :
— Est-ce vous, Jules ? dit-il.
— C’est moi, répondit M. Bertomy à voix basse. Est-ce que tout le monde est couché ?
— Tout le monde.
— J’aime autant cela.
Alors M. Bertomy s’effaça un peu, et un rayon de la lune pénétrant dans la voiture permit à Rossignol de voir un enfant étendu sur les coussins et dormant.
— Ah ! dit-il, c’est donc lui…
— C’est l’être que je vous amène, dit Jules.
— Et vous ne voulez pas qu’on le voie ?
— Pas ce soir, toujours.
— Alors, dit Rossignol, donnez-moi votre bagage, chargez-vous de cet enfant et renvoyons la voiture.
Ce qui fut dit fut fait.
L’enfant dormait si bien qu’il ne s’éveilla point.
Rossignol mit sur son épaule la valise de son beau-frère, et, tandis que la voiture tournait bride, ils prirent à pied le chemin de la ferme.
Le chien n’avait pas aboyé en reconnaissant M. Bertomy.
Le fermier conduisit Jules Bertomy à sa chambre.
Celui-ci plaça l’enfant sur son lit.
— Le pauvre petit a eu bien froid en chemin, dit-il.
— Comme il dort ! dit Rossignol.
— C’est un orphelin, dit Jules Bertomy.
Et il poussa un profond soupir. Alors son beau-frère le regarda.
— Comme vous êtes pâle ! Jules, dit-il ; est-ce que vous souffrez, ce soir ?
— Non, mais j’ai eu beaucoup d’émotions ces jours-ci.
— Ah !
— Et, dit le pauvre homme avec un triste sourire, les émotions ne me valent rien, vous le savez.
Puis, après un silence :
— J’ai consulté un grand médecin de Paris. Il ne m’a rien dit de bon.
— Ah ! fit Rossignol avec inquiétude.
— Je crois bien que je suis poitrinaire.
— Allons donc !
— J’aurais pourtant bien besoin de vivre à présent, murmura-t-il.
Et il regarda l’enfant endormi avec une indéfinissable expression de mélancolie et de tendresse.
5.
Maître Rossignol n’avait qu’une parole.
Il avait promis à son beau-frère de ne pas le questionner, et il ne lui dit pas un mot qui pût ressembler à un point d’interrogation.
Seulement, en rentrant dans sa chambre, il réveilla sa femme et lui fit part de l’arrivée de son frère.
Mme Rossignol avait la même loyauté que son mari.
— C’est bien, dit-elle, nous respecterons son secret. Cependant, une chose m’inquiète, mon ami.
— Laquelle ?
— Cet enfant, on le verra.
— Sans doute.
— Que dirons-nous ?
— Je ne sais pas… Ce qu’il voudra que nous disions.
D’autres que Rossignol et sa femme auraient pu se livrer à maints commentaires.
Mais le libre penseur et la femme chrétienne n’en firent rien.
Ils eussent rougi l’un et l’autre de chercher à sonder ce mystère qu’ils avaient promis à M. Bertomy de respecter.
Le lendemain matin, au petit jour, les domestiques de la ferme, en se levant, virent donc les deux beaux-frères qui causaient à voix basse, tandis que l’un tenait l’enfant sur ses genoux.
D’un geste, Rossignol les éloigna.
Mme Rossignol descendit.
Elle embrassa son frère et se mit à caresser l’enfant, un chérubin de petit garçon rose et blond, qui leva vers elle de grands yeux étonnés et lui dit :
— Est-ce que tu n’es pas maman, madame ?
— Si, mon enfant, répondit la bonne femme, je suis ta mère.
Et elle le couvrit de baisers.
Cependant Rossignol disait à M. Jules Bertomy :
— Tu penses bien, mon ami, que ma femme, pas plus que moi, ne voulons rien savoir ; mais tout le pays, tout le monde voudra savoir quelque chose.
— Cela est vrai, dit M. Bertomy en souriant.
— Que dirons-nous ? demanda à son tour Mme Rossignol.
— Une chose bien simple.
— Ah ! fit la jeune femme.
— Ni toi, ni moi, ne sommes du pays.
— Cela est vrai.
—