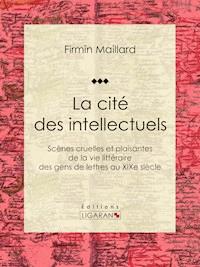
Extrait : "Dans la pièce, les Deux veuves, de Félicien Mallefille, lorsque le garde la Barraque amène au château, M. de Brenne, gentilhomme braconnant sur les terres de la veuve qu'il adore, celle-ci lui dit : – Accusé, quel est votre état , Et l'autre répond : – Celui des gens qui n'en ont pas, homme de lettres..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038477
©Ligaran 2015
I
De la profession littéraire – Traité des origines – Du nom en littérature – Classification bizarre – Débuts et mise en train – Le Grand éditeur de 5 à 7 heures
Dans la pièce, les Deux veuves, de Félicien Mallefille, lorsque le garde la Barraque amène au château, M. de Brenne, gentilhomme braconnant sur les terres de la veuve qu’il adore, celle-ci lui dit : – Accusé, quel est votre état ? Et l’autre répond : – Celui des gens qui n’en ont pas, homme de lettres… Ce fut un tolle dans la petite presse, on cria à l’inconvenance. – « Ah ! çà, disait l’un, est-ce qu’il s’imagine, lui, l’écrivain de tant de romans, de tant de drames et de mélodrames, qu’il n’a pas une profession et ferait-il des bottes ou gâcherait-il du plâtre pour vivre, tandis qu’il n’emploierait à écrire que ses moments d’oisiveté. Nous savons que dans certaines classes de la société, on est assez arriéré pour croire que la qualification d’homme de lettres est synonyme de paresseux, d’incapable, de bohémien, de paria, de débauché, de filou, de pique-assiette, etc. ; la profession d’homme de lettres est la première de toutes les professions ; elle est la plus noble, la plus enviée, la plus utile, puisqu’elle a pour mission de soutenir le progrès matériel et intellectuel, d’aider à son développement, de hâter sa réalisation. La profession de l’homme de lettres est la plus honorable, la plus rude, la moins fertile, mais peu importe ! »
Ces fières paroles émurent un instant Mallefille qui avait cédé à un mouvement d’irritation contre tous ces gens qui – selon Mercier – se vantent de ne pas écrire pour de l’argent et prouvent du reste si bien qu’ils n’en auraient jamais pu faire leur métier…, ces fières paroles venaient d’un journaliste de talent, Charles Desolme, qui disait de lui-même : – Je suis né il y a quelque temps déjà, sur la paille humide des cachots…, et effectivement, il sortait de Mazas, de Blaye et de Lambæsa.
Ah ! pauvre et cher Mallefille, toi qui eus toujours si grand souci de l’honneur de ta profession, de quel sourire amer tu eusses appris que, moins de dix ans après, ce journaliste « dont les libres tendances, a dit un biographe ami, ont été dérangées par un besoin perpétuel de capitaux », était aller rédiger, pour le compte de M. Napoléon III, un journal dans le Lot-et-Garonne……
Les vieux du temps jadis n’étaient pas tendres pour les jeunes gens, ni tendres ni encourageants ; les parents trouvaient en eux un appui qui les fortifiait dans leur défiance instinctive, et que pouviez-vous répondre à un père qui vous lisait ceci, signé Amédée de Céséna : « Qui pourra m’expliquer ce que c’est que cet amphibie, ce que c’est que cet être équivoque qui s’intitule homme de lettres et croit avoir une profession lorsqu’il n’a même pas un métier ? à qui et à quoi sert-il ? à qui et à quoi rend-il service ? L’homme de lettres a beaucoup de rapport avec les utilités de théâtre et avec les domestiques à tout faire. Il est bon à tout parce qu’il n’est propre à rien : Il fera tout aussi bien un article de journal qu’un chapitre de roman ou une scène de vaudeville, ou une chanson à boire. Est-ce là une profession, est-ce même là un métier ? »
Quand on pense au métier qu’à toujours exercé le noble marquis, les vers de Béranger vous viennent aux lèvres :
Auguste Villemot prit la peine de lui répondre : – Voulez-vous, lui dit-il, que tous les gens de lettres aspirent au budget, avec encouragements secrets, avec faveurs d’antichambre, encombrant ainsi l’État de dévouements inquiets, suspects, avides et sans dignité. L’État a bien assez de ses parasites en prose et en vers qui ont tout servi et tout trahi, etc. La pichenette était bien envoyée et le nez du vieux folliculaire dut lui cuire pendant quelque temps, mais il n’en mourut pas, ce qui lui permit, après vingt-sept ans encore de nouvelles et de nombreuses culbutes, de se rencontrer au Soleil… levant, une dernière fois avec M. Édouard Hervé, rédacteur en chef de ce journal. (M. Hervé, que la fermeté de ses convictions fait honorer de ses adversaires même), mais qui n’en a pas moins, en quelques paroles émues, rappelé la vie toute de travail et de luttes de M. de Céséna pendant plus de cinquante ans… Cinquante ans pendant lesquels le dit de Céséna a été tour à tour – avec plus de souplesse que d’éclat, soyons juste, – monarchiste, républicain, socialiste, impérialiste et orléaniste.
Eh bien, la diatribe du Sarde de Céséna n’est rien auprès de celle du Vénitien Scudo (Écoutez !) : « Y a-t-il un dissipateur, un jeune homme échappé de la maison paternelle, chassé par son inconduite d’une administration, d’un atelier, d’un régiment, sans spécialité, sans instruction, incapable d’une occupation honnête, livre a la débauche, à la paresse, à la misère, il se fait écrivain. Il fait des romans, des nouvelles, des vaudevilles, où il régente la société qui n’a pas voulu de lui, etc. ». Et quand Paul de Scudo pense que de tels individus jugent les peintres, les sculpteurs, les musiciens…, les musiciens surtout, son indignation s’accroît encore et tourne à l’épilepsie.
Ce Scudo était un critique musical, compositeur raté qu’une pauvre romance, le Fil de la Vierge, tirée des Perce-neige, poésies de Maurice Saint-Aguet, avait un instant mis en évidence ; il ne pardonnait à personne sa propre impuissance, se fit homme de lettres et tartina longtemps à la Revue des Deux-Mondes. Je le vis une fois au foyer de l’Opéra à je ne sais plus quelle première ; j’étais avec Camille de Vos, qui me dit : – Je vous parie que cet opéra a encore été fait avec le Fil de la Vierge…, allons-nous en assurer, et il aborda Scudo.
– Eh bien, que pensez-vous de ce second acte ?
– Peuh ! fit Scudo, l’auteur n’a pas l’air de savoir ce qu’il veut dire…, absence complète d’originalité, c’est plein d’imitations, de réminiscences…
Et comme il s’arrêtait, de Vos le regardant bien en face, s’écria :
– Ah ! pour ça, oui ; j’ai même retrouvé une mélodie de ma connaissance et de la vôtre, et j’ai salué de la tête cette vieille amie.
– Tiens, cela m’a échappé, dit Scudo.
– Dans la cavatine du ténor au premier acte…
– C’est ma foi vrai, je me rappelle en effet… et Scudo ajouta négligemment : – Ah ! mon cher ami, depuis le temps qu’on me pille, j’en ai pris mon parti et n’y fais plus attention.
– Et maintenant filons, me souffla de Vos, nous n’avons plus rien d’intéressant à tirer du personnage.
Il mourut fou, ce que je trouve relaté d’une façon vraiment touchante dans la Correspondance de son confrère en critique, Hector Berlioz : – 18 août 1864 : Un coup très facile à prévoir de la Providence, Scudo, mon ennemi enragé de la Revue des Deux-Mondes, est devenu fou. – 21 août : Vous savez que ce bon Scudo est reconnu fou et enfermé. Quel malheur ! – 28 octobre : Vous savez que notre bon Scudo, mon insulteur de la Revue des Deux-Mondes, est mort, mort fou furieux ; sa folie, à mon avis, était manifeste depuis plus de quinze ans. La mort a du bon, beaucoup de bon, il ne faut pas médire d’elle.
Berlioz et Scudo étaient cependant deux compositeurs-hommes de lettres ! mais on voit par cet exemple, que les mœurs littéraires échappent même à l’action adoucissante de la musique.
Enfin, état, profession, métier ou carrière (Vapereau ne craint pas de dire : embrasser la carrière littéraire), oui, carrière, à cause des pierres qu’on y rencontrait à défaut de pièces de cent sous, on ne peut nier la multiplicité des considérations qui vous poussent à… l’embrasser.
Par vanité d’abord, car il est certain qu’on ne se fait pas homme de lettres par modestie, comme le disait Vallès à un journaliste qui l’accusait d’être un vaniteux ; oui, par vanité et par paresse ensuite, et entre les deux il y a place pour une infinité de raisons déterminantes que nous n’allons pas détailler, mais dont nous citerons celle-ci donnée par le spirituel auteur des Petits-Paris et qui fait si bien penser à Vallès – que cependant Texier ne connaissait pas à cette époque : « C’est quelquefois parce qu’on a un père cruel qui vous a fait faire, étant jeune, une veste avec ses culottes, ce qui vous a poussé à l’élégie. »
Oui, la vanité… ou le noble amour de la gloire, ce qui est exactement la même chose, avec cette circonstance aggravante, si vous voulez, que le noble amour de la gloire est un besoin immodéré d’occuper les autres de soi – en même temps que le désir très légitime d’extraire quelques sous de leurs poches.
Oui, la paresse ! Il est en effet plus agréable de courir les gazettes avec les avantages moraux et immoraux qu’elles comportent, de travailler à son heure et même de ne pas travailler du tout, que d’user ses fonds de culotte dans une étude de notaire à grossoyer sur des actes ne vous intéressant en aucune façon, ou de suivre des cours de droit ou de médecine avec la perspective terrifiante d’une série d’examens qui vous prendront ce que vous croyez être les plus belles années de votre existence.
Aujourd’hui, du reste, comme la gloire nourrit son homme, cette profession en vaut une autre et elle n’exige pour toute mise de fonds qu’une main de papier, une plume et de l’encre, – du talent… et encore. On a tout perfectionné : à défaut de lettres, avec de bonnes jambes, les reins souples et un front d’airain, on peut très gentiment faire son petit bonhomme de chemin et finir préfet n’importe où.
À l’époque qui nous occupe, l’administration, les ministères qui emploient dix particuliers où trois suffiraient, fournissaient un contingent considérable d’hommes de lettres. Il y avait la des natures laborieuses et prudentes qui ne lâchaient pas le budget et cumulaient volontiers ; les poètes surtout ! Encore aujourd’hui, ces âmes d’élite excellent dans ce double exercice ; émarger, loin d’alourdir leur vol, semble leur donner des ailes et l’élévation de leurs pensées est en rapport immédiat avec l’élévation de leurs émoluments.
M. Camille Doucet est l’idéal du genre ; aussi, ce vers est-il de lui :
Quoiqu’on en dise s’adresse aux gens crottés, poètes ou non, qui ont souvent raison de n’être jamais contents de leur destinée ; seulement M. Doucet a le grand tort d’ajouter :
Ce qui est loin d’être exact, lors même que la rime l’eût obligé d’exagérer de quelques centaines. N’écoutons pas M. Doucet ; il a été gâté par la fortune, il est sorti d’une étude de notaire, cela se voit bien, mais tous les notaires ne finissent pas ainsi.
Il y avait encore M. Juillerat ! dame, je vous cite les célébrités de bureau ; il est de la même école :
Ce n’est pas vrai, mais c’est en débitant des sornettes de ce calibre qu’on fait son chemin, non pas que je veuille dire que M. Juillerat soit arrivé à la gloire, ni qu’il ait gagné beaucoup d’argent, car je ne sais plus quel farceur, discutant sur les droits d’auteur touchés sur les recettes des théâtres de Paris en 1859 et qui s’étaient élevés à 1 011 578 fr. 60, s’écriait comiquement : sur cette somme, M. d’Ennery a touché le million et M. Paul Juillerat, l’auteur des Équipées de Sténio, comédie jouée une seule fois à l’Odéon, a touché les 60 centimes. Mais M. Juillerat était un honnête et galant homme qui sut toujours se contenter de l’aurea mediocritas du poète ami de Janin.
Je lui préfère Ange Pecméja, bien qu’il signât quelquefois chef de bureau aux affaires étrangères, non parce qu’il a fait Rosalie, « chose exquise, à la fois simple et forte, a dit Flaubert, une histoire émouvante comme celle de Manon Lescaut, moins l’odieux Tiberge, bien entendu ! » et que je n’ai pas lue, m’en tenant à Manon Lescaut…., mais parce qu’il m’est resté dans la mémoire certain fragment d’une petite pièce de vers pleine de verve et de crânerie :
CARAMBA
M. Siméon Pécontal eût été très fâché de faire de pareils vers, c’était un mélancolique qui ne comptait plus que sur la postérité :
Allez dire cela aujourd’hui aux ri meurs du cabaret du Pet-au-diable… de compter sur l’avenir !… Il est vrai que M. Pécontal appartenait à une époque où les gens grincheux reprochaient à certains poètes d’être ventriloques et de travailler dans les salons, ce qui, cependant, les fait ressembler à ces Messieurs du Pet-au-diable et de la Truie qui file.
Mais en voilà bien assez, et pour terminer avec ces bureaucrates, je leur dirai, empruntant au Pécontal en question, une strophe bien venue – musicalement parlant :
Après l’administration comme pépinière, vient le professorat : cela commence par le pion, pionnant ou ayant pionné, et cela finit par l’École Normale. Les Normaliens arrivèrent presque tous ensemble et se précipitèrent dans la mêlée poussés par l’espoir d’échapper aux épreuves pénibles que leur réservait la carrière universitaire. Sarcey, dans ses Souvenirs, en quelques pages pleines de bonhomie et de franchise, s’est expliqué là-dessus, et ce qu’il a dit pour lui est aussi vrai pour les autres. Ils furent mal accueillis par la petite presse.
Sarcey surtout qui avait dit un peu brutalement certaines vérités…
Théodore de Banville les criblait de ses flèches :
LA MALLE DE VOLTAIRE
Mais ils tinrent bon, gardèrent, la malle et restèrent maîtres de la place. Ces combattants de la première heure s’appelaient About, Taine, Prévost-Paradol, Assolant, J.-J. Weiss, Édouard Hervé, Antoine Grenier, Anatole Claveau, Alexandre Monin qui mourut jeune…, c’est lui qui aimait à dire au cours d’un article : pendant que je suis en verve…, Henri d’Audigier, etc. On voit par ces noms que si l’École Normale ne fait pas des hommes de grand caractère, elle fait au moins des hommes de savoir et de talent. Je n’ai mis le nom de d’Audigier, qui n’avait ni beaucoup d’esprit ni beaucoup de talent, que comme l’exception servant à confirmer la règle. Il y a bien d’autres élèves à l’École Normale qui, par des travaux sérieux, ont acquis dans les lettres une situation respectable…, mais je n’écris pas l’histoire de l’École Normale et je n’ai cité ces cinq ou six écrivains qu’en raison du bruit qu’ils ont fait au milieu du grand silence impérial.
Le professorat mène aux lettres de bien des façons et s’il y entraîne les pères, l’horreur qu’il inspire aux fils les y convie également ; je n’en veux d’autre preuve que les nombreux fils de professeurs que je tiens au bout de ma plume : – Massol, de la Morale indépendante, C. Hippeau, Cherbuliez, Mézières, Caro, William Duckett, Arnould Frémy, Émile Chasles, Jules Vallès, Paschal Grousset, Arthur Arnould, J. Aicard, Adolphe Jullien, Marius Topin, quelques des Essarts, un plus grand nombre de Wailly, etc.
Nous avons aussi le fils d’hommes de lettres dont les débuts sont d’autant plus doux et faciles que le père aura laissé un nom plus glorieux, sous lequel plus tard gémira son infortuné rejeton ; on lui parlera de Racine fils… et il n’aura d’autre consolation que de se figurer qu’il eût été un grand homme également, si son père ne l’avait précédé. Aussi, peut-on dire que le fils d’auteur qui a encore un peu de respect et d’affection pour la mémoire de son père, est un oiseau rare ou un fameux lapin ! Quand il est plus fort que son père, cela va bien, mais s’il a un fils……, gare alors pour celui-ci, car il faut que tout se paye, et il ne lui reste guère d’autre ressource que de se lancer dans les beaux-arts.
Il y avait les fils de Victor Hugo, le fils d’Alexandre Dumas qui a résisté, lui, et fait une maison à côté, le fils de L. Laya, l’Ami des lois, le fils de Legouvé, le fils et la fille de George Sand, les fils du chevalier de Fonvielle, le fils de Léon Halévy, de Paulin Paris, de Noël Parfait et d’Eugène Pelletan, d’Arsène Houssaye, de François de Martonne, de Paul de Kock, de Dupeuty, de Lockroy, de Rochefort-Lucay, de Théophile Gautier, etc. On compte même des petits-fils : – Marty-Laveaux, qui, ne se contentant pas du nom de son père, le comédien, y avait ajouté le nom de son grand-père, le grammairien ; – E. Villetard, de Mazade, Émile Augier, Oscar Honoré, etc.
Maintenant, le littérateur qui débute se demande invariablement sous quel nom il doit passer à la postérité, le sien propre lui paraît en général assez peu convenable ; il est malsonnant, point euphonique et rebute l’oreille et la mémoire ; il prête à la plaisanterie, et ses ennemis – car il compte bien en avoir – saisiront avec empressement cette fâcheuse coïncidence…… bref, il est trop ceci ou trop cela. Peut-être aussi a-t-il des homonymes qui pourraient profiter de sa gloire !… faire le bonheur d’un animal qui n’a absolument pour soi que le même nom que vous, quelle horreur ! et chose non moins amère et que l’on croit rencontrer plus fréquemment, porter une partie de son fardeau, être de moitié dans ses bévues, se voir méconnaître par de bons petits camarades enchantés d’établir une aimable confusion…, quel désespoir ! mort et passion !
Toutes ces causes – sans la vanité – sont au nombre des motifs plus ou moins pressants qui poussent un fils à renier le nom de ses pères ; je ne veux pas être plus tendre qu’il ne convient, celui qui ne signe pas de son vrai nom, a tort, mais celui qui l’altère, qui en prend un autre, a aussi quelquefois raison, et un esprit juste doit en rechercher la cause déterminante.
Tout le monde n’est pas, comme Victor Hugo, content de son nom ; Victor Hugo sonne comme une fanfare, mais Jacquot aussi ne manque pas de sonorité… et, cependant, qui pourrait en vouloir à Eugène de Mirecourt d’avoir préféré le nom de sa ville natale a celui de ses ancêtres. Quérard, le bibliographe rageur, eut peut-être pardonné – au fond ce n’était point un méchant homme – mais il y avait cette particule qu’il regardait comme une tentative d’anoblissement et qu’il ne pouvait supporter, car c’était un homme simple, bien que nourrissant à l’égard de la Légion d’honneur un vif désir d’en porter les insignes.
Pour deux hommes modestes comme Émile Laurent dit Colombey et Eugène Balleyguier dit Loudun, combien d’autres qui l’étaient moins : Latour dit de Saint-Ybars, Alfred Brézennec dit de Bréhat, Gustave le Bridoys dit Desnoiresterres (familièrement des sombres bords), Ducros de Sixt, Gaston Souillard de Saint-Valry, Girault de Saint-Fargeau, Boué de Villiers, Georges d’Heylli, etc.
D’autres ayant deux noms, suppriment carrément celui qui leur paraît désagréable : Caignart de Saulcy, Théodore Faullain de Banville, Michel Gaudichet Masson, Gaschon de Molènes… ce dernier poussait même la chose un peu loin, disant qu’il avait juré de tuer le premier qui l’appellerait du nom son père – honnête magistrat. Il ne tua personne, pas même Balzac qui l’appelait Gaschènes de Molon et Galon de Moschènes, ce qui, du reste, n’est pas autrement spirituel. Puis il y a ceux qui défendent leur noblesse, et ils ont raison ; il faut toujours défendre ce que l’on a, si peu qu’il vaille, mais tout dépend de l’esprit qu’on met à la chose et d’Audigier se rendit ridicule avec sa sortie indignée contre Monselet. Ce roturier avait fait dire à un jeune homme pauvre, avec une surprise ironique et s’adressant à Henri d’Audigier : – Ah çà, vous êtes donc noble, vous aussi ? et d’Audigier de lui répondre : – Cette question ! Mais certainement, Monsieur, nous sommes tous nobles !
– C’est une plaisanterie, s’écrie d’Audigier, je le veux bien (il ne le voudrait pas, que ce serait la même chose), mais déplacée, et je la relève. Et le voilà parti, flamberge au vent, sur le grand destrier qu’il montait pendant sa grotesque campagne d’Italie. Son nom n’est pas un nom d’emprunt, depuis 800 ans, ce nom est connu sur les rives du Rhône, et il est prêt à montrer ses parchemins à Monselet qui n’en peut mais ; il se contente pour le moment de ce que Arnaud d’Audigier, chevalier d’Avignon, disait en 1216 au comte Raymond de Toulouse : Noi a fachinem ! il n’y a point de mensonge !
Les Monselet de 1216, qui devaient avoir énormément d’esprit, à voir ce qu’il en restait au contemporain d’Henri d’Audigier, après tant de siècles de volatilisation, avaient probablement bien autre chose à faire que de collectionner leurs bons mots, pensant avec raison que les Monselet futurs en feraient à leur tour ; aussi notre Monselet se tient-il coi et ne souffle mot ; d’Audigier continue. Il est prêt à reconnaître qu’il n’a pas le caractère plus mal fait qu’un autre et il demande qu’on n’éveille plus sa susceptibilité à ce sujet, son nom étant à peu près la seule chose que ses ancêtres lui aient laissée, on comprendra qu’il tienne à garder ce débris du naufrage.
L’amertume et la résignation mélancolique de ces dernières lignes tendraient à faire croire que quelques ducatons eussent mieux fait son affaire…, ce qui, certainement, devait être loin de la pensée du gentilhomme en question. Encore, y avait-il une certaine naïveté amusante dans la réclamation de M. d’Audigier, que nous ne rencontrons plus dans la réclamation prétentieuse et sèche de l’auteur des Poèmes barbares :
Je lis dans un article du Temps, que je ne signe pas de mon vrai nom. – J’ai l’honneur de vous informer que je possède tous les papiers de famille qui me donnent le droit qui m’est contesté. Mon père, mon aïeul, mon bisaïeul, etc., se nommaient Leconte de Lisle, mais je ne me crois pas obligé de soumettre ces preuves incontestables à ceux qui en douteraient. Les archives du ministère de la marine et des colonies et de la grande chancellerie de la Légion d’honneur répondront pour moi à qui viendra les interroger. – Je suis d’ailleurs de ceux qui savent se faire un nom et qui ne le fabriquent pas.
LECONTE DE LISLE
On n’est pas plus modeste. Il est donc bien entendu, grâce à l’etc., que Molière n’avait en vue que Thomas Corneille, autre poète, lorsqu’il a dit :
Que serait-il arrivé à ce malheureux Monselet si, au lieu de prendre au hasard le nom de d’Audigier, il fut tombé sur celui de M. Leconte de Lisle ou de Privat d’Anglemont ?… car les gens des îles, à part Mallefille peu les anciens et Lacaussade et Cochinat pour les modernes, appartiennent presque tous à la noblesse et même à la noblesse religieuse, Charles Sainte-Claire Deville, Sainte-Suzanne Melvil-Bloncourt, etc., noblesse fort bien représentée, du reste, sur le continent par Saint-Marc Girardin, Saint-René Taillandier, Saint-Germain Leduc, Marco de Saint-Hilaire, le Roy de Sainte-Croix, Jules de Saint-Félix, Paul de Saint-Victor et plusieurs Saint-Albin, etc. Il y a même le très catholique M. Blanc Saint-Bonnet, auquel je tire le mien, puis…., comme disent les vieilles femmes, le bon Dieu reconnaîtra toujours bien les siens !
Nous ne parlerons pas de toutes les supercheries, savonnettes à vilain, dans lesquelles les vaniteux cherchaient à se décrasser de leur roture, Quérard en était malade ; il faut prendre la chose plus philosophiquement, pour ce qu’elle vaut. L’innocente manie d’Arsène Houssaye, qui préférait l’y à l’i, lui trouvant une tournure plus romantique et se plaisant à débaptiser et à baptiser ses collaborateurs, fait sourire, et mon ami Angelo de Sorr ne croyait certainement pas faire le moindre tort au public ni tant de peine à ce pauvre Quérard en signant ainsi romantiquement les Filles de Paris, les Cheveux de Mélanette, les Pinadas, etc. Si Quérard avait écrit le Vambire (quelle supposition saugrenue !) il ne l’eût pas signé Quérard, il eût cherché et n’eût trouvé que ce beau nom, Angelo de Sorr… parce que, pour ce roman, il n’y avait que ce nom-là, c’était fatal. Mais en revanche, il n’aurait certainement pas mis à le défendre l’aplomb qu’y déployait ce brave Angelo, et ce n’est pas sans stupéfaction que je l’entendis répondre à cette question : – Mlle Charlotte de Sor, la célèbre romancière bonapartiste, appartient-elle à votre famille ?
– Du tout, du tout ; d’abord cela ne s’écrit pas de la même façon, et il ajouta sèchement – tout en me jetant un coup d’œil : – Ce n’est, du reste, pas son nom, c’est un pseudonyme,… qui me fait assez de tort, elle eût bien fait d’en prendre un autre !
Or, Mlle Charlotte de Sor, qui, de son vrai nom s’appelait Elleaux, écrivait déjà sous ce pseudonyme à une époque où le jeune Ludovic Sclafer – plus tard Angelo de Sorr – était encore en nourrice.
S’il y avait des gaillards qui arrivaient à se faire facilement un beau nom comme l’abbé Genoud, fils d’un limonadier de Grenoble (on prononçait Genoud à la mode du midi) dont Louis XVIII fit de Genoude pour en finir et à qui il donna des titres de noblesse, il y avait aussi des êtres malchanceux qui toute leur vie travaillaient à cela sans pouvoir y parvenir. M. Latour Dumoulin, entre autres, qui joignait au titre d’homme de lettres ceux non moins glorieux de directeur de la presse et de créateur de la Commission de colportage… et dont les cartes de visite égayèrent un instant ses administrés : Latour du Moulin – La Tour Dumoulin – de la Tour du Moulin, etc. Pour une raison ou pour une autre, quelques rares particuliers ont fait de leur nom ce que le roi Dagobert faisait de sa culotte, l’ont mis à l’envers, tel que Charles Romey Selrahc Yémor, Delavigne, Engivaled, Cairon Noriac, etc. Quérard les appelait des boustrophédonistes d’après une classification de M. Pierquin de Gembloux, classification célèbre… dans le monde bizarre de la bibliographie.
Ne confondez pas l’anagramme avec le boustrophédonisme (ce nom me plaît) ; Chavette est l’anagramme de Vachette, Erdan d’André, Vorlac de Lacour et M. Léon Halévy qui, pour ses débuts a signé Nœl Hyéval, du coup s’est rangé moitié dans les boustro… et moitié dans les anagra…
J’ai tout à l’heure parlé de noms désagréables et je n’ai pas cité quelques courageux citoyens comme MM. Crétineau-Joly, habitué des coulisses de l’Opéra, bien qu’il ne fût ni crétineau, ni joli ; Cucheval Clarigny, à qui le valet chargé de l’annoncer à la porte d’un salon, répondait en rougissant : – Je n’oserai jamais, et même M. Cuvillier Fleury, qui, ayant reproché à Victor Hugo l’emploi de certain mot dans les Misérables (« il est des expressions condamnées à n’être jamais écrites par un homme qui se respecte »), se vit répondre par Victor Hugo (remarquez que je n’en crois pas un mot) qu’il trouvait sa critique fort juste et le lui prouvait en écrivant ainsi son adresse : M… Villier-Fleury. Oui, je les oubliais et j’avais tort, car ils gardèrent leur nom, ce qui ne les a pas empêchés d’arriver à la notoriété qui leur était due, alors qu’ils eussent été fort excusables d’y apporter quelque changement. Mais ce n’était encore que des noms plus ou moins choquants, il en est d’autres tout à fait désagréables et il est fâcheux pour un débutant d’être obligé de signer Pitre, Crétin ou Gille, – surtout quand il l’est et qu’il se livre à des calembredaines sur toutes choses… livres et beaux-arts mêlés.
Aussi est-il bizarre de voir des gens s’affubler de ces noms quand rien ne les y oblige ; tel l’excellent Pierre-Michel-François Chevalier qui préféra – probablement par souvenir d’enfance – laisser derrière lui le doux nom de Pitre-Chevalier, cause innocente de tant de petits vers satiriques. La pointe à pitre… la lui avons-nous assez faite ! Nous étions, ma foi, plus bêtes que lui, et ce n’est pas peu dire. Mais que penser de ce charmant homme « qui valait mieux que sa destinée et était supérieur à ses œuvres » ? Quelle idée fantasque avait traversé la tête de cet Espagnol qui, voulant franciser son nom, le traduisit simplement ; cela donna Louis Lurine et fit dire à un vieux polichinelle qui trouvait très drôle de signer Citrouillard : Monsieur, quand on a un nom comme le vôtre et qu’on se met à la fenêtre, on crie : gare la-dessous. L’écrivain caricaturiste Gosset de Guines (à ce que dit Vapereau), préféra s’appeler André Gill… pourquoi, je n’en sais rien, c’était son affaire ; mais comme il n’était pas bête il supprima l’e muet pour n’avoir pas l’air d’un bouffon de la comédie italienne, suppression qui, en même temps, donna au mot une allure anglaise. Peut-être a-t-il voulu prendre la moitié du nom du célèbre caricaturiste anglais Gillray, avec qui, du reste, il avait plus d’un point de commun, y compris les cinq dernières années de la fin… Mais je suis bon là, savait-il seulement qu’il y eut un caricaturiste anglais de ce nom ? À ce sujet, je ferai remarquer combien il est déshonorant, paraît-il, de faire de la caricature, car pour un qui signe de son vrai nom, il y en a dix qui se croient obligés de prendre un masque. Mais laissons les caricaturistes qui n’ont que faire ici ; certains hommes de lettres partagent, à l’égard de leur profession, l’opinion de ces Messieurs. Rochefort a fait jadis, de ces pudeurs étranges, justice amusante et spirituelle. Il s’agissait de l’Œillet blanc, pièce que l’affiche du Théâtre-Français donnait comme étant de MM. Alphonse Daudet et E. Manuel, pendant que les journaux annonçaient que le dit Manuel (plus tard Quatrelles) n’était autre qu’un secrétaire de M. de Morny, qui venait d’être nommé référendaire à la Cour des Comptes et croyait devoir à ses nouvelles fonctions de ne pas signer l’Œillet blanc. « Ainsi, voilà qui est convenu, dit Rochefort, quand un homme fait jouer une comédie au Théâtre-Français, il commet une action tellement honteuse qu’il est obligé de prendre un pseudonyme pour échapper au déshonneur… Je savais en général que nous étions assez mal vus, mais je ne croyais pas cependant qu’une pièce jouée au Théâtre-Français mit un auteur dans la nécessité de cacher son nom. Peut-être serait-il temps de s’expliquer une bonne fois sur l’opinion que les référendaires à la Cour des Comptes peuvent avoir de leur importance personnelle en même temps que de notre indignité ». Là-dessus, il se moque des référendaires et autres particuliers qu’il appelle les jocrisses du pouvoir qui pensent qu’un fonctionnaire s’encanaille dès qu’il franchit la barrière qui sépare l’administration de la littérature.
D’abord, ce n’était pas poli pour Daudet, puis il était si facile de ne point collaborer à l’Œillet blanc ? Référendaire est un gros mot sur lequel le populaire est peu renseigné et auquel il doit attribuer bien des vertus : un référendaire ! Avec quoi cela se fait-il ? La recette est souvent très simple. Je prends celle-ci dans un journal qui a toujours eu la confiance du référendaire en question et dont il s’était fait une tribune d’où il essayait de nous amener à regretter le temps heureux où il était référendaire – ce qui est tout naturel. Une vieille dame, qui lui voulait du bien, le présenta chez un diplomate en vue ; il y chanta des morceaux de sa composition et y fut applaudi ; alors, la vieille dame lui dit : – Vous avez chanté, eh bien, dansez maintenant. – Il dansa et révéla, dans la conduite d’un cotillon des qualités telles que le diplomate en fit immédiatement son secrétaire. Toutes les portes s’ouvrirent devant lui ; quo non ascendam ! devint sa devise, et on comprend de quels soins respectueux il dut entourer un emploi qui lui avait coûté tant de fatigues ; il voulait surtout le voir prendre au sérieux par des journalistes toujours prêts à se moquer de fonctions dont l’importance et la solennité échappent à la légèreté de leur tête folle.
La plupart des gens de lettres nous ont laissé quelques notes sur leurs débuts, notes qu’il ne faut accepter que sous bénéfice d’inventaire. Ils sont entrés dans les lettres pour ceci ou pour cela, prenez-en ce que vous voudrez et écoutez Jules Janin qui, sans tant de façon, dit simplement : « Il m’est arrivé ce qui arrive à tous les hommes de lettres des temps présents et des temps passés, je suis entré dans la vie littéraire sans le savoir et sans le vouloir. J’ai été écrivain à mon insu, par nécessite comme tout le monde. » Quant à la vocation pure, Victor Hugo, toujours étonnant, l’affirme dès le collège et il écrit sur son cahier d’écolier : – Je veux être Chateaubriand ou rien ; et comme Alexandre Soumet, troublé par la tête remarquable de cet enfant, tête qu’il appelle une véritable étude de Lavater, lui demande si son intention est de suivre uniquement la carrière des lettres, le jeune gaillard qui sait déjà joindre l’utile à l’agréable, répond tranquillement : – J’espère devenir un jour pair de France… et IL LE SERA, dit Soumet stupéfait.
Tout le monde a lu les racontars d’Alexandre Dumas, de George Sand, etc., mais il y a plus de sincérité touchante et émue dans les récits des écrivains qui leur ont succédé, et, sans parler des Souvenirs de jeunesse de Renan, de la Jeunesse de Michelet, d’Un normalien en 1833 de Jules Simon, de Thadeus et de Frère et sœur d’Auguste Luchet, des Mémoires de Claude Genoux, des Souvenirs de Sarcey déjà cités, de quelques pages de Monselet disséminées çà et là, d’une page de Sardou, des notes un peu sèches de Champfleury, de certaines sorties d’Alexandre Weill, de courts récits d’Albéric Second, de lettres de Flaubert, de Henri Heine, de l’arrivée à Paris d’Alphonse Daudet, des pages rageuses de Jules Vallès (le Testament d’un blagueur), etc., etc., je m’arrêterai un instant sur certaines lignes de Louis Ulbach. Il parle de sa vie d’enfant, d’écolier, des soirées de famille, pendant que le père, qui était tailleur, coupait du drap, et que la mère, fatiguée de dicter au commis les recettes et dépenses du jour, le priait de fermer le grand-livre, pour continuer à haute voix la lecture du roman entamé la veille, Histoires de Mme Cottin ou Indiana de George Sand, lecture que le père, avec ses gros ciseaux coupant sur le comptoir, rythmait d’un bruit régulier ; « Ah ! ces gros ciseaux paternels, qui ont tant taillé, tant découpé, tant rogné pour moi, et qui avaient donné aux mains de mon père ces durillons dont il était si fier ! j’entends toujours leur bruit : croc, croc, croc et au bout de la lisière plus dure à détacher, le son final, lent et plus sonore, crac ! – Un jour qu’avec mes ciseaux de journaliste je coupais sur mon bureau, et non en l’air, un article à emprunter pour mon journal, je tressaillis à leur chuchotement. Moi aussi, je leur faisais dire : croc, croc, croc, et au bout de la page, crac ! Je fus attendri, comme devant une évocation. Je pensai que mes ciseaux affilés, prétentieux, flandrins, étaient les enfants efféminés de ces robustes ciseaux de mon père. Je me reprochai de n’avoir pas gardé ceux-ci je les aurais suspendus au-dessus des miens. Avais-je à comparer les deux paires autrement que par tendresse paternelle ? Les miens m’avaient-ils servi à découper dans de meilleurs draps ? Je serais fier aujourd’hui des gros ciseaux du tailleur. En ai-je été fier suffisamment à vingt ans ? Comme il faut vieillir pour devenir juste ? pour trouver toute la vanité suffisante dans la reconnaissance et dans l’amour !… Ma vie intellectuelle date d’une soirée de famille, etc… voilà pourquoi j’aime ces chers ciseaux qui n’ont rien émondé de ma jeunesse et qui ne touchaient aux fleurs de la route que pour les faire pleuvoir sur moi. »
On peut s’être trouvé en désaccord avec Ulbach, avoir même bataillé avec lui, car il avait bec et ongles, mais on est obligé de reconnaître que celui qui a écrit ces lignes était un brave homme d’écrivain que nos jeunes fin de siècle me semblent avoir enterré un peu vite.
Parlons maintenant de la sympathie que les jeunes de lettres rencontrent à leurs débuts…, ce sera vite fait, ils n’en rencontrent pas, et la raison en est simple. Chacun se croit atteint dans sa vanité propre par l’outrecuidante vanité qui leur fait choisir une profession dont le principal objectif est de prouver qu’on est plus intelligent que son voisin. Personne ne vous le pardonne – et cela dans tous les mondes – depuis le camarade de collège qui, vingt ans plus tard, vous dira : – Est-ce que tu t’amuses toujours à écrire dans les journaux, jusqu’au confrère célèbre, prôné et renté, qui doucement vous a dit : Ne lâchez pas la proie pour l’ombre ; vous êtes venu à Paris pour faire votre droit ou votre médecine, continuez, et si vous avez des loisirs, écrivez puisque cela vous paraît amusant ; un jour, peut-être, vous verrez, vous pourrez choisir… Puis, il reconduit le jeune homme, en lui disant pour le consoler : « Il est inutile que vous cherchiez un éditeur, la poésie est morte ! la philosophie est livrée aux sacristains ! l’idée est proscrite et le journal cire les bottes des passants sur le Pont-Neuf ! même les Méditations poétiques ne trouveraient pas un éditeur. »
C’est Jules Janin qui disait cela ; quant à George Sand, elle écrit – parlant d’un poète qui sur la fin de l’Empire voulait venir à Paris : « Il m’a dit vouloir se lancer dans la vie littéraire. Qu’est-ce que c’est que cela. Où ça se trouve-t-il ? Qu’entend-il par la ? » Et que visait donc la bonne dame, si ce n’était à se lancer dans la vie littéraire, lorsqu’au lendemain de 1830, ayant laissé à son mari les 500 000 francs de dot qu’elle lui avait apportés, mais ayant sauvé sa personne, elle cherchait à introduire au Figaro de Delatouche « de fort mauvais articles et de pires calembours », et portait le manuscrit de son premier roman au vieux M. de Kératry qui la reçut légèrement, l’engageant à faire des enfants plutôt que des livres ; – ce que ne peut croire M. de Kératry fils. George Sand se rappelait néanmoins les grands airs du père « quand des poètes crottés viennent me demander conseil et protection ». Ce sont ces propres expressions.
Ceux qui avaient le toupet de porter leur première œuvre à la Revue des Deux-Mondes étaient généralement reçus avec les égards dus à leur notoriété, ce qui amenait des récriminations inouïes, et l’Année des Cosaques du jeune normalien Monin, fut, pour M. Buloz, une véritable année des cosaques. Un autre – poète de son état – se vengeait dans de petits vers acidulés qui n’étaient pas aussi violents que la prose de Monin, mais qui indiquaient un des côtés les plus reprochés à M. Buloz.
En général, les malins ne soufflent mot, et ils ont raison car ils n’apitoyent personne pour les motifs que nous avons donnés plus haut : – il lui était si simple de rester dans l’étude de son père ! – ou bien : ce serait vraiment trop commode s’il n’y avait qu’à se montrer pour réussir, etc. ; ils gardent le crapaud qu’ils ont avalé…, cela se retrouvera plus tard avec autre chose.
Ils sont rares, les pères qui, loin de décourager leurs fils de la profession littéraire, leur en facilitent rentrée, et le père de M. Catulle Mendès mérite d’être cité : – Tu veux absolument faire de la littérature, aurait-il dit à son fils, eh bien, voici de l’argent, fais une Revue, tu pourras y mettre tout ce qui te passera par la tête… si tu as du talent, on le verra bien, si tu n’en as pas, j’aurai mangé une vingtaine de mille francs et tout sera dit ; seulement, tu ne me parleras plus de littérature. M. Catulle Mendès, qui a du talent, eût fait son chemin sans cela, mais combien ce père intelligent et généreux n’a-t-il pas épargné à son enfant de démarches pénibles dans lesquelles se flétrissent et s’amoindrissent la fierté native et la sincérité d’impressions, doux et glorieux apanage de la jeunesse.
Ah ! Les promenades chez les éditeurs ! heureux ceux qui n’ont pas eu à les faire !…
Dans les Souvenirs d’un médecin de Paris, le docteur Mettais, qui avait voulu tâter de la profession littéraire, raconte ses tribulations de débutant ; une entre autres m’a frappé ; un éditeur lui dit : il faut un nom et sous ce couvert je vous prendrai votre nouvelle. Il va chez Frédéric Soulié qui, de sa chambre, lui crie : « Quand je vends mon nom à un éditeur pour servir de manteau, c’est excessivement cher. Combien le vôtre peut-il donner ? » Évidemment, Frédéric Soulié ne se souvenait plus de ses courses à la recherche d’un éditeur pour ses poésies les Amours françaises ; seulement, plus pratique, il avait accepté la direction d’une scierie mécanique, qu’il ne quitta qu’après le succès de son Roméo. Mais côté pratique à part, j’aime à penser pour l’honneur de Frédéric Soulié qu’il voulut simplement se débarrasser du jeune auteur, qui, en effet, prit immédiatement la porte ; cependant le docteur Mettais n’a pas l’air de croire a une plaisanterie.
Entrons chez Dentu, si vous voulez bien.
– Avez-vous lu La journée d’un grand éditeur ? et Dentu s’avança vers moi un journal à la main.
– Oui, je l’ai lue ; qu’est-ce que vous en dites ?
– Peuh ! j’aimerais autant qu’on me laissât tranquille ; j’ai toujours peur d’attraper quelques horions dans ces affaires-là.
– Voilà ce que c’est que d’avoir la conscience bourrelée de remords ; il me semble cependant que vous n’avez pas été trop maltraité ?
– Oh ! je ne me plains pas, l’article n’est point malveillant, mais il est plein d’inexactitudes.
– Oui, l’auteur pensait trop à l’éditeur futur, c’est un sycophante ! méfiez-vous. J’ai lu son article et je me suis même amusé à en faire un à mon tour, seulement j’ai mis les noms, c’est plus honnête et lorsque je dis du mal de M. Dentu, par exemple, je ne veux pas que Michel Lévy pense que je parle de lui. Je me suis dit : M. Dentu, tout en n’étant pas toujours très juste, aime assez qu’on le soit à son égard ; c’est un esprit net et précis qui a horreur des inexactitudes, il ne veut point passer pour ce qu’il n’est pas… eh bien ! je vais essayer de serrer la vérité d’aussi près que possible, je lui soumettrai la chose, car nous sommes trop bien actuellement pour que de gaîté de cœur je risque d’amener une ombre dans des relations devenues aussi charmantes ; et s’il ne trouve pas que j’aie été assez vrai… nous mettrons le tout au panier… et n’en parlerons plus.
Là-dessus, je tirai de ma poche quelques petits feuillets que je lui passai. Il était stupéfait et les prit assez mélancoliquement en murmurant : vous êtes tout de même un drôle de corps ; puis il se plongea dans la lecture de ce bout d’article intitulé :
Chez Dentu
De 5 à 7 heures du soir.
Le Palais-Royal : Galerie d’Orléans. – Une petite boutique sur laquelle sont venues se greffer successivement plusieurs autres. – Entassement de livres sur tous les points. – À droite, à gauche, se sont casés, comme ils l’ont pu, quelques auteurs, passés, présents, futurs. – Bien en vue, une dame d’un certain âge qu’au décousu de la toilette on peut reconnaître pour un bas-bleu dont les ouvrages ont cessé de plaire. – Comme figure principale, trône à son bureau, le premier commis de la maison, l’homme de confiance, le factotum, petit homme, sans âge, sans couleur et sans saveur, à physionomie parfaitement désagréable… au premier coup d’œil et au second aussi.
Un jeune auteur, le chapeau à la main, le manuscrit soigneusement dissimulé dans la poche du paletot : – M. Dentu est-il visible ?
Le commis sèchement : – Il n’y est pas.
Le jeune auteur : – Mais il va venir, je pense.
Le commis le toisant : – Non, il serait là s’il avait dû venir.
Le jeune auteur : – Il m’avait cependant donné rendez-vous pour aujourd’hui.
Le commis relevant ses sourcils et fermant à demi les yeux, fait une affreuse grimace qui signifie clairement : Je ne puis rien vous dire de plus, il n’y est pas et il ne viendra pas. Le jeune auteur qui est à sa troisième visite, a remarqué qu’il y a toujours là plusieurs particuliers qui semblent espérer quelqu’un ou quelque chose ; il se décide et dit courageusement : – Eh bien, si vous le permettez, je vais l’attendre. Peut-être va-t-il arriver. Le commis hausse légèrement les épaules et se plonge dans ses écritures tout en murmurant : – Je ne le crois pas, mais faites comme vous voudrez. Et le jeune auteur se glisse entre deux piles de livres d’où il suit avec anxiété le va et vient de la porte d’entrée.
La vieille dame bâille à bouche que veux-tu, tout en exhalant quelques plaintes : – Ah ! quel ennui, voilà cinq fois que je viens sans pouvoir le rencontrer ; je ne puis pas perdre ainsi mon temps. Et depuis chez moi, il y a loin ; justement j’ai mal au pied. Elle étend la jambe, et le commis qui est peut-être meilleur qu’il n’en a l’air, lui dit tout tranquillement : – Pourquoi ne prenez-vous pas une voiture ? Eh, mon Dieu, prendre une voiture et avec quoi ? ce n’est toujours pas avec l’argent que vous me donnez. La figure du commis semble s’être éclaircie, il est plus heureux qu’il ne l’était il y a quelques minutes, une jouissance intime, profonde se peint sur sa face quand il dit : Ah ! c’est un fichu métier que celui d’écrivain… À quoi la dame visiblement agacée répond : – Elle est bonne, celle-là, s’il n’y avait pas d’écrivain, il n’y aurait point d’éditeur… et pas de commis de librairie.
À cet instant, la porte s’ouvre et donne passage à un particulier de forte encolure ; il fait un signe au commis qui répond oui de la tête, et le particulier disparaît dans un petit escalier en colimaçon qui mène à l’entresol.
– Il a de la chance, celui-là, dit la vieille dame.
– Vous ne savez pas qui c’est ?… Adolphe Belot ! Et comme elle répond dans un bâillement par un ah ! qui n’a rien de bien flatteur pour ce romancier, le ah ! de quelqu’un qui s’aperçoit qu’il a un caillou dans sa chaussure, le commis croit devoir ajouter : – l’auteur de MlleGiraud ma femme qui est à sa 32e édition… et il conclut en ricanant : – En voilà un qui gagne de l’argent.
– Tout le monde ne peut pas faire des MlleGiraud… dit la vieille dame avec découragement, il a raison d’en faire puisque cela lui réussit.
Un peu plus tard, entre un petit homme tout frétillant ; il traverse la boutique tête baissée pour ne pas voir les personnes qui y sont, et se précipite dans le colimaçon ; mais un auteur grincheux, que la lecture du livre qu’il tient à la main n’absorbe pas au point de l’empêcher de voir ce qui se passe, se lève, et se tournant vers le commis, dit à haute voix : – C’est ici comme dans le royaume des cieux, les derniers sont les premiers ; que cela vous fasse sourire, c’est votre affaire, mais je ne comprends pas qu’un confrère se prête à cette comédie inconvenante.
Le petit homme qui est au milieu du colimaçon crie d’une voix flûtée : – Je vous demande bien pardon, mais je n’en ai que pour deux minutes, je redescends à l’instant.
Personne ne souffle mot, cela paraît avoir jeté un froid intense ; seule, la dame sourit en hochant la tête d’un air approbateur, et le commis ricane silencieusement sur son registre pour n’en pas perdre l’habitude. Quand une demi-heure après le petit homme reparaît, deux ou trois confrères vont lui serrer la main et le reconduisent à la porte en l’assurant probablement qu’ils ne sont pour rien dans ce qui vient de se passer. L’auteur grincheux remporte une jolie veste, il n’a eu pour lui que la vieille dame qui paraît plus gaie et le jeune auteur, pas plus bête qu’un autre, qui, comprenant enfin le mécanisme de la maison, se lève et sort en cherchant pour le lendemain un moyen, un traquenard quelconque afin de mettre la main sur ce Dentu, visible et invisible tout à la fois.
Cependant, le commis ne l’a trompé qu’à demi ; non, Dentu ne viendra pas, il est tout venu ; il est dans son vilain petit entresol où il bavarde avec les familiers de la maison.
– Eh bien, c’est entendu, je file car je suis pressé.
– Comment, comment, dit Dentu, asseyez-vous, causons un peu, j’ai encore tout un paquet d’épreuves dans ma poche… Ah ! mon Dieu, quel taudis n’est-ce pas ; où est donc la chaise, l’unique chaise que j’ai à offrir ?
– On a mis un tas de livres dessus.
– Oui, c’est la 33e édition de MlleGiraud ma femme qu’on vient d’apporter.
– Toujours donc !
– Ah ! vous êtes bien tous les mêmes ; au fond vous donneriez chacun deux doigts de votre blanche main pour l’avoir écrit, ce livre ! Ne les bousculez pas, ils sont tout frais ; asseyez-vous sur cette pile de volumes, là, à gauche, vous serez mieux que sur la chaise… Vous permettez (il ôte son paletot), ah ! quelle chaleur ! c’est épouvantable de passer sa vie dans ce trou… Oui, pourquoi je n’en change pas l’habitude, – que voulez-vous, j’ai commencé là mon métier, je continue… (s’essuyant le front) quel métier que celui d’éditeur, pas un moment à soi, la tête toujours prise, le corps aussi… Vous avez déjeuné ; vous ?
– Je l’espère bien, si à cinq heures je n’avais pas déjeuné…
– (Éclatant) Eh bien, moi je n’ai pas encore déjeuné, j’ai été dérangé, on est venu me prendre… j’ai mal à l’estomac, je vous demande bien pardon…, et il crie à son secrétaire : Envoyez-moi Auguste ?
Auguste est un petit commis à qui il dit : – Tu vas aller me chercher deux croissants, pas où tu es allé la dernière fois ; va à côté du Bœuf à la Mode, ils sont bien renflés et bien dorés… tiens voilà vingt centimes.
– Gourmand !…
– Oui, vous ricanez et vous avez raison ; mon grand-père et mon père étaient comme moi, mon grand-père venait de la Normandie où son père vendait du beurre, cela valait mieux que de vendre des livres. On a toujours besoin de beurre !…
Le commis reparaît et dit : – Gustave Aymard est là !
Dentu fronce le sourcil : – Est-ce qu’il n’est pas venu la semaine dernière ?
Si, deux fois, la première 50 fr., la seconde 25 fr. ; il demande 100 fr.
– Oh ! oh ! donnez-lui 50 fr… Toujours en avance, toujours pressé ce diable d’homme-là ! C’est inouï ce que j’ai d’argent de sorti, rien ne rentre ; on ne peut obtenir aucun compte des libraires de province… et avec ça, une semaine blanche… c’est sans précédent ; jamais je n’avais vu cela.
– Eh bien, MlleGiraud ?…
– Certainement MlleGiraud !… c’est encore heureux ; s’il n’y en avait pas deux ou trois comme cela, ce serait à renoncer au métier. Ah ! je vous envie vous autres, rien à faire, pas de responsabilité… À propos, il y a une phrase que je ne peux pas laisser passer, nous aurions un procès. Il tire de sa poche un tas d’épreuves chiffonnées, mélangées, mais s’y retrouve assez vite, car au milieu de ce désordre apparent, il a beaucoup d’ordre, s’occupe de tout, déploie une activité extraordinaire, ne laisse rien passer sans avoir examiné, pesé (il ne s’agit pas de romans bien entendu) ; et chose curieuse, au milieu de ses lamentations, à travers ce tohu-bohu d’auteurs et d’idées, ne perd jamais de vue l’écrivain qu’il a devant lui et le sujet qu’ils ont à traiter ensemble.
On discute la phrase en question ; pour en finir, Dentu insinue qu’on pourrait demander à son commis ce qu’il en pense : Ne souriez pas, dit-il, c’est un garçon de bon conseil, et je me suis toujours bien trouvé de l’avoir consulté quelquefois.
Le commis arrive, Dentu lui dit : – Écoutez bien ceci… mais avant qu’il ne commence à lire, l’auteur qui se méfie, prend l’épreuve et lit le paragraphe dans lequel est noyée la phrase malencontreuse.
– Qu’est-ce qui vous a frappé ?
Le commis, qui, pour obéir à sa nature, espère être désagréable à l’auteur, dit tranquillement : – Ma foi, rien du tout, mais Dentu lit la phrase en accentuant, et il ajoute : Comment, cela ne vous fait pas sauter, vous ne voyez pas là un procès à venir ?
– Ah ! oui, peut-être bien, dit le commis qui s’aperçoit enfin de ce que son maître attend de lui ; il a cependant la pudeur de ne pas virer de bord effrontément et se contente d’ajouter : Ce n’est pas très dangereux, je crois, mais en tout cas, dans le doute, il vaudrait mieux s’abstenir, et il se retire sur cette lumineuse intervention.
Puis, dit l’auteur, qu’est-ce encore ? voilà un mot que j’ai rétabli deux fois et que je retrouve toujours supprimé, on a même ajouté au crayon rouge : c’est faux ! qui est-ce qui se permet ?… Dentu prend l’épreuve et dit en riant : – Ne faites pas attention, c’est mon frère qui a écrit cela (il efface le c’est faux et rétablit le mot) ; votre livre le rend malade, que voulez-vous, ce n’est pas un communard, lui !
On bataille ; les croissants arrivent, Dentu se précipite sur eux. Il n’a pas fini le premier, qu’il étouffe et regarde autour de lui d’un air désolé : – Et rien à boire.
– Je vous offrirais bien un bock, dit l’auteur, mais vous êtes bloqué dans votre forteresse ; il y avait en bas quand je suis monté, cinq ou six assiégeants, ils doivent maintenant être au moins une douzaine. Il me semble les entendre rugir.
– Ah ! taisez-vous ; non, c’est horrible de n’être pas libre chez soi, de ne pouvoir pas même manger ou boire à sa fantaisie…
– Vous devriez avoir un petit placard et dedans quelques liqueurs que vous offririez à vos auteurs…
– Oui, transformer ceci en un estaminet, vous avez là une jolie idée, vous.
Le secrétaire (Émile Faure, un homme charmant qu’il ne faut pas confondre avec le commis) annonce : – M. Barbier est là.
Dentu se lève précipitamment tout en disant : – Ne vous en allez pas… c’est Auguste Barbier, l’auteur des Iambes ! vous ne le connaissez pas, non, eh bien, vous allez voir quel homme c’est ! En voilà un au moins qui console des autres, des ingrats… et tout en parlant, il a fait dégringoler MlleGiraud de la chaise qu’elle avait usurpée et sur laquelle vient s’asseoir l’auteur des Iambes, il n’est entré que pour serrer la main à son vieil ami Dentu, ne reste que cinq minutes, mais pendant lesquelles il trouve moyen de conter qu’un négociant à qui il vient de donner son adresse, lui a dit tout ému en écrivant sous sa dictée :
– M. Auguste Barbier… oh ! je connais… l’auteur de la Curée.
– Hein, quel homme ! s’écrie Dentu avec admiration… vous avez l’air tout stupéfait.
– Ma foi, je ne m’attendais pas à le trouver ainsi, mais êtes-vous bien sûr que ce petit homme à lunettes soit l’auteur des Iambes !… l’auteur des Sylves, je ne dis pas. Il doit y avoir erreur…
– Taisez-vous, vous êtes un misérable !
– Bon, je m’en vais là-dessus, car vrai, je ne sais comment oser traverser la ménagerie d’en bas ; je suis honteux, pour vous, de les avoir fait attendre aussi longtemps.
– Non, non, ne partez pas ; c’est fini pour aujourd’hui, tant pis, chacun son tour, je peux bien me donner un peu de bon temps une fois par hasard ; puis j’ai encore quelque chose à vous dire, quoi donc, mon Dieu… ah ! j’y suis. J’étais hier soir chez Montépin, – le chançard, c’est lui qui a fait une jolie trouvaille la semaine dernière !
– Sa soupière !
– Tiens, comment savez-vous cela ?
– J’étais là, quand il l’a achetée. J’ai même mis une enchère, mais M. de Montépin n’avait pas l’air de vouloir lâcher et j’ai laissé aller la soupière. Elle est charmante de forme…
– Et d’une conservation extraordinaire.
Mais vous ne la croyez pas ancienne, je suppose ; il l’a payée 70 ou 75 francs, ce qui est un peu cher. Elle a coûté au marchand de 40 à 45 francs dans le gros ; je ne dis pas que vous pourriez l’avoir à ce prix, mais il vous sera toujours facile de vous en procurer une au prix que l’a payée M. de Montépin.
– Tout à fait semblable ?
– À ne pas vous y reconnaître, si vous les mettiez l’une à côté de l’autre.
– Quel blagueur que ce Montépin, il m’a dit qu’elle lui coûtait tout près de 400 francs. Mais vous êtes bien sûr de ce que vous me dites là ?
– En voulez-vous une ? je connais un peu l’expert qui la lui a vendue, c’est un israélite qui a fait de la salle 6 de l’Hôtel des ventes son magasin ; c’est-à-dire que trois fois la semaine, il y vend des marchandises qu’il achète dans le gros ou qu’il se procure par ses relations commerciales. C’est plus intelligent que d’avoir à grands frais une boutique dans laquelle on peut rester huit jours sans voir entrer un acheteur ; comme cela, il est toujours sûr de vendre quelque chose. Il est très complaisant et très arrangeant ; quand vous serez décidé, vous n’aurez qu’un mot à dire, nous tomberons M. de Montépin. Elle est moderne, et il vous dit l’avoir payée 400 fr. pour vous faire croire qu’elle est ancienne ; s’il l’eût payée 400 fr. et qu’elle fut ancienne, il vous aurait dit l’avoir payée 75 fr. pour vous faire rager sur sa trouvaille. Il ne faut pas avoir pitié de ces amateurs là… Dites donc, je me sauve.
– À quelle heure dînez-vous ? Il n’est pas encore sept heures ; ah ! pendant que j’y pense, vous connaissez Challemel-Lacour, vous devez avoir des lettres de lui, oui, n’est-ce pas ? Si vous pouviez m’en donner une pour ma collection d’autographes, vous seriez bien le plus charmant garçon que je connaisse… et pour nos épreuves, que décidons-nous ?
– Voilà ce que c’est que d’avoir fait imprimer cela à Orléans… enfin, je vais écrire à Jacob…
– Il vaudrait mieux le voir ; est-ce que vous connaissez Orléans ? Non, c’est une très jolie ville, les environs sont délicieux… si vous alliez vous y promener, vous qui-n’avez rien à faire, cela serait préférable à une lettre ; Jacob est un homme charmant avec lequel vous vous entendrez très bien…
– Si vous voulez me payer le voyage, oui ; sinon, non.
– Merci, j’ai déjà bien assez de frais comme cela, et la couverture tirée en couleur va me coûter les yeux de la tête.
Le commis apparaît : – Il n’y a plus personne en bas.
– Filons, s’écrie Dentu qui a retrouvé toute sa vigueur et toute son énergie ; mais au coin de la Galerie d’Orléans il se rencontre nez à nez avec le jeune auteur qui, pas plus bête qu’un autre, a tenu bon et va reconduire jusque chez lui le malheureux éditeur.
FIRMIN MAILLARI.
Dentu avait lu ce petit factum sans souffler mot, sans rien manifester, et comme il gardait le silence : – Eh bien, lui dis-je, y a-t-il là-dedans quelque chose qui ne soit pas de la plus rigoureuse exactitude, un mot qui n’ait pas été dit, voyons, formulez…
– Je ne dis pas que ce soit inexact, mais il y a de l’exagération dans l’ensemble, et l’exagération est souvent le contraire de la vérité.
– Quand ce n’est pas de la vérité exaspérée… mais où voyez-vous de l’exagération ?
– D’abord, mon pauvre commis, comme vous le méconnaissez ; lui, le plus calme, le plus tranquille des hommes, l’employé le plus fidèle, le plus probe que je connaisse ; voilà vingt-quatre ans qu’il est à la maison et jamais je n’ai eu le moindre reproche à lui faire ; c’est un homme précieux et qui est loin d’être aussi malveillant que vous le donnez à entendre. Je vous souhaite de n’avoir jamais affaire à des gens plus désagréables que lui.
– Je vous remercie bien. Mais je n’ai rien dit qui fût contraire aux brillantes qualités que vous vous plaisez à lui reconnaître ; que voulez-vous, votre commis me fait penser à cet éditeur signalé, je ne sais où, par Asselineau – un esprit bienveillant, celui-là ! – et qui disait tout en secouant l’or dans son gousset : – De l’argent ! toujours de l’argent ! de l’argent au marchand de papier ! de l’argent au marchand d’encre !… eh bien, ce n’est pas l’argent que je donne à ces gens-là que je regrette le plus, c’est celui que je donne à ces gredins d’auteurs. Car enfin, pour mon argent, le marchand de papier me donne du papier, le marchand d’encre me donne de l’encre ; tandis qu’avec ces gredins d’auteurs, qu’est-ce qu’ils me donnent ? – Oui, votre employé me rappelle cet éditeur avec cet aggravement que l’argent qu’il distribue ne sort même pas de sa poche.
– Il n’y a pas d’éditeur qui ait pu dire cela.
– Bon, c’est Asselineau qui a menti. Et votre confrère Werdet, n’a-t-il pas émis cette opinion que les éditeurs devraient prendre le parti d’écrire eux-mêmes les ouvrages qu’ils publient, car avec la peine qu’ils se donnent pour créer une réputation à leurs auteurs, ils parviendraient probablement à s’en faire une à eux-mêmes, égale à beaucoup de celles qu’ils ont si péniblement édifiées.





























