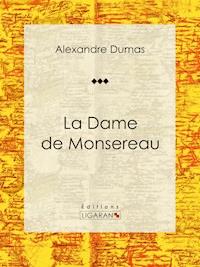
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "AURILLY, entrant : Cet appartement est-il prêt ? le feu dans les deux chambres ?... Bien ! A-t-on enlevé partout les verrous et les fermetures intérieures ?... Bien ! Maintenant, retenez ceci : Une personne va venir occuper cet appartement ; si quelqu'un de vous cherche à voir et à connaître cette personne, le cachot ! Il serait possible que vous entendissiez du bruit, des cris... Prenez garde ! car celui de vous qui répondrait soit à un signal, soit à un cri..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054736
©Ligaran 2015
CHICOT.
HENRI III.
BUSSY.
MONSOREAU.
LE DUC D’ANJOU.
SAINT-LUC.
LE BARON DE MÉRIDOR.
NICOLAS DAVID.
GORENFLOT.
LA HURIÈRE.
BONHOMET.
LE DUC DE MAYENNE.
LE DUC DE GUISE.
QUÉLUS.
DE NANCEY.
AURILLY.
MAUGIRON.
ANTRAGUET.
SCHOMBERG.
MONSIEUR DE LORRAINE.
LIVAROT.
D’ÉPERNON.
RIBÉRAC.
UN HUISSIER.
UN ÉCUYER.
DEUX VALETS.
DIANE.
LA DUCHESSEY.
MADAME DE SAINT-LUC.
GERTRUDE.
Une salle basse du château de Beaugé, en Anjou ; bois sculptés ; tentures de cuir d’Espagne ; lourdes tapisseries. Portes à gauche et à droite. À gauche, au fond, pan coupé avec portes donnant sur un vestibule éclairé par des cires rouges. Au fond, large fenêtre à trois vantaux vitrés, donnant sur l’étang de Beaugé. – Horizon d’arbres noirs. Fin d’hiver.
Aurilly, valets, à l’ouvrage.
Cet appartement est-il prêt ? le feu dans les deux chambres ?… Bien ! A-t-on enlevé partout les verrous et les fermetures intérieures ?… Bien ! Maintenant, retenez ceci : Une personne va venir occuper cet appartement ; si quelqu’un de vous cherche à voir et à connaître cette personne, le cachot ! Il serait possible que vous entendissiez du bruit, des cris… Prenez garde ! car celui de vous qui répondrait soit à un signal, soit à un cri venant de cet appartement, celui-là serait regardé comme traître, et, pour les traîtres, il y a mieux qu’un cachot dans la justice de monseigneur le duc d’Anjou !
(Les Valets s’inclinent.)
Les mêmes, un écuyer.
Maître Aurilly, on entend le pas des chevaux sur la chaussée.
C’est bien ! Vous m’avez tous compris ?… Qu’on n’entende plus un souffle, qu’on ne distingue plus une ombre dans le château, jusqu’à l’arrivée de monseigneur ! Allez !
(Les Valets se retirent.)
Maître Aurilly, la litière s’arrête devant le perron du château. J’en vois descendre…
C’est bon !… Retirez-vous, chez moi, et n’en sortez que si j’appelle.
(L’Écuyer sort ; Aurilly le suit et forme la porte.)
Diane, un homme masqué, puis Gertrude.
Je ne ferai plus un pas, si vous ne répondez à mes questions ! (L’Homme lui désigne la salle.) Où suis-je ?…
(L’Homme ne répond rien.)
Du calme, mademoiselle ! nous voici probablement arrivées où l’on voulait nous conduire, et nous allons trouver à qui parler.
(Pendant ce temps, l’Homme sort.)
Oh !…
Eh bien, il est parti ?… il ferme la porte ?… Ah ! par exemple !
Je meurs d’effroi !
Ah ! mais je vais me fâcher, à la fin ! Attendez !… (Elle va heurter à la porte, en criant.) Monsieur !… Holà !… Au secours ! au secours ! (À Diane.) Vous allez voir.
Gertrude, prends garde !
Bah ! mademoiselle, il faut en finir ! (Elle frappe avec fureur.) Au meurtre ! au feu !
On vient.
J’en étais bien sûre ! (Apercevant Aurilly.) Encore un homme masqué !
Les mêmes, Aurilly, masqué.
Monsieur, je suis la baronne Diane, l’unique enfant du baron de Méridor, le compagnon d’armes du roi François Ier, Sommes-nous si loin de chez mon père, qu’on me méconnaisse ou qu’on ose m’offenser ?… Je me rendais au château du Lude, chez une parente. Pourquoi vos gens ont-ils arrêté ma litière ? Pourquoi m’a-t-on détournée de mon chemin ? De quel droit les cavaliers qui m’ont amenée ici ont-ils maltraité et chassé mes serviteurs ? Qui sont ces misérables, et qu’êtes-vous, vous-même ?… Où suis-je, ici ? où suis-je ?
Chez vous, madame ?
Voilà une raillerie…
Daignez commander, madame. Il vous suffira de frapper avec le marteau de cette porte, pour faire accourir à vos ordres un serviteur qui ne quittera point ce vestibule.
On nous garde à vue !
Enfin, que veut-on faire de moi ?
Vous traiter comme une reine !
(Il salue et sort.)
Diane, Gertrude.
J’aimerais mieux des menaces !… Gertrude, tu ne dis plus rien !
Ah ! mademoiselle, nous sommes dans un piège !
Dont il n’est pas difficile de deviner l’auteur !
M. le comte de Monsoreau ?
Qui serait-ce, sinon lui ?… Depuis que je le connais, je connais le malheur !
Mais, mademoiselle, M. de Monsoreau n’avait pas besoin de vous enlever, puisqu’il peut vous voir librement à Méridor, puisqu’il vous a demandée à votre père, et que votre père ne vous a point refusée !
Oui ; mais j’ai refusé, moi !
Vous avez eu tort, peut-être.
Qu’en sais-tu ? Voudrais-tu nier l’inexplicable épouvante qui me saisit quand, pour la première fois, j’entendis prononcer à Méridor ce nom de Monsoreau ? Pressentiment sans doute, puisque je n’avais pas encore aperçu le comte. Et, depuis que je l’ai vu, sais-tu pourquoi tout mon cœur se glace quand il s’approche de moi, quand je sens s’attacher sur moi son regard avide et fourbe ?… Non, tu ne le sais pas, Gertrude ? Eh bien, tu vas le savoir. Te souviens-tu du jour ou nos bûcherons me rapportèrent au château, mourante, évanouie ?
Si je m’en souviens ! M. le baron faillit expirer de douleur en vous voyant si pâle, et pourtant vous n’étiez qu’un peu lasse. C’était le jour où M. de Monsoreau chassa pour la première fois dans la forêt de Beaugé.
Eh bien, oui ! M. le duc d’Anjou venait de l’envoyer dans cette province, qu’il administre en son nom. Jusque-là, j’avais vécu bien heureuse à Méridor, au milieu de mes fleurs, de mes brebis et de mes cygnes, idolâtrée de mon vieux père, et rendant cet amour à tout ce qui m’entourait, aux oiseaux du ciel, aux fauves des bois. Tout m’aimait aussi, et ma biche Daphné quittait ses halliers profonds pour venir manger dans ma main. Un matin, j’entends le cor et l’aboi des chiens dans les forêts voisines. C’était, comme tu l’as dit, la première chasse du nouveau gouverneur. Curieuse, je cours jusqu’à la grille du parc, et j’aperçois Daphné poursuivie, haletante ; derrière elle, toute la meute, et, au même instant, un cavalier, animant son cheval noir, rapide comme la tempête ; c’était M. de Monsoreau qui chassait la pauvre Daphné… Je criai : « Grâce !… » Il était passé sans m’entendre !
Ah !
Pour interrompre cette poursuite qui me déchirait le cœur, j’essayai de retrouver le comte ou l’un de ses veneurs. J’avançai à travers le bois, guidée par les bruits de la chasse. Parfois j’entrevoyais, toujours fuyant, la malheureuse Daphné déjà lasse. Une fois, elle passa près de moi en bramant tristement, comme pour me dire adieu. J’avançais oubliant ma fatigue, appelant, lorsque, enfin, je me trouvai dans l’allée de vieux chênes qui conduit au château de M. le duc d’Anjou, au bord du vaste étang de Beaugé. Je repris haleine, j’écoutai. Tout à coup gronda un tourbillon d’aboiements, de fanfares et de cris… La chasse revenait ; et, de l’autre côté de la nappe immense, la biche bondit hors du bois, et se lança dans l’eau comme pour venir à moi. Je la regardais, les larmes aux yeux, les bras tendus. Elle nageait de toutes ses forces, au milieu des chiens prêts à la saisir. M. de Monsoreau parut alors à la lisière du bois et sauta à bas de son cheval. Sans doute il m’avait vue, il m’avait entendue supplier, car il courut à un bateau dont il détacha rapidement l’amarre : il allait sauver ma pauvre Daphné. Déjà il la touchait, écartant ses ennemis féroces, quand soudain je vis briller un éclair : il avait tiré son couteau de chasse. L’éclair disparut avec, la lame, qui se plongea tout entière dans le cœur du pauvre animal. Daphné poussa un gémissement lugubre, et glissa morte dans l’eau, rougie de son sang ! Moi, je fis quelques pas pour fuir cet horrible spectacle, et j’allai tomber évanouie dans les bruyères, où je fus trouvée le soir par nos gens. Ah ! Gertrude depuis ce jour, chaque fois que j’ai revu le comte, – appelle-moi bizarre, injuste et folle, – il y avait, entre lui et moi, ce cri, ce sang, cette agonie !
Mais, mademoiselle, il ignorait que la pauvre Daphné fût votre favorite ; et ce qu’il a fait, tout chasseur le fait comme lui, sans crime.
Oui, peut-être.
Le comte vous aime trop, il vous respecte trop pour risquer de se faire mépriser et haïr. Une violence, vous ne la lui pardonneriez pas ; un enlèvement, à quoi bon ?… Ne suis-je pas là pour vous défendre ?
Bonne Gertrude !… Cependant cette violence, ce rapt, nous ne pouvons les contester, et ils ont un auteur.
Voulez-vous connaître mon idée, mademoiselle ?
Parle.
Vous avez été invitée, avec votre père, à Angers, il y a un mois, à cette fête que donna M. de Monsoreau à M. le duc d’Anjou, frère de notre roi Henri III.
Une bien splendide fête !
Où se trouvait réunie toute la noblesse de la province, où vous fûtes bien regardée, bien admirée !
Oui, je me souviens d’un regard opiniâtre qui pesa étrangement sur moi toute la soirée.
Quel regard ?
Continue.
M. de Monsoreau est un peu jaloux, c’est naturel, puisqu’il vous aime. M. de Monsoreau, dis-je, eut, le lendemain, avec M. de Méridor, votre père, un long entretien, d’où M. le baron sortit assez préoccupé.
C’est vrai.
À la suite de cet entretien, votre père décida précipitamment votre départ pour la terre du Lude.
Tu as raison.
Eh bien, mademoiselle, j’en conclus que vous aurez, à cette fête, produit une impression trop vive sur quelque seigneur du voisinage ; que M. le comte s’en sera aperçu, et que, craignant une rivalité dangereuse pour lui, dangereuse pour vous peut-être, il aura conseillé à votre père de vous éloigner de Méridor. Voilà pourquoi nous allions ce soir au Lude ; voilà pourquoi aussi des hommes masqués ont arrêté la litière, chassé vos gens, et pourquoi nous sommes ici.
Chez ce rival de M. de Monsoreau ! chez un homme capable d’un guet-apens si lâche ! Mais, en vérité, Gertrude, rien n’est effrayant comme ta supposition !… Où sommes-nous ?… Il faut le savoir
Patience ! ne perdons pas la tête ! Et d’abord, mademoiselle a-t-elle remarqué que, pour venir dans cette chambre, nous n’avons monté que cinq marches ?
Oui.
Donc, nous sommes au rez-de-chaussée, en sorte que, si ces fenêtres…
Si ces fenêtres ne sont pas grillées, veux-tu dire ?
Et si mademoiselle a du courage…
Si j’en ai ? Tu verras !
Chut !… Ah ! il y a une autre chambre là. Attendez ! (Elle y porte le flambeau, tandis que Diane cherche à ouvrir les volets de la fenêtre.) Laissez-moi faire.
(Diane a ouvert les volets ; on aperçoit le paysage sous un nuage d’abord, puis il s’éclaire, l’étang resplendit.)
Pas de grilles !
Oui, mais de l’eau qui baigne les murs.
De l’eau ! un étang immense !… Oh ! mais je me reconnais, c’est l’étang de Beaugé.
Nous sommes donc au château ?
Nous sommes chez M. le duc d’Anjou !
Eh bien, mademoiselle ?
Eh bien, Gertrude, l’homme dont le regard sinistre, dont l’attention dévorante m’ont torturée pendant toute la fête c’était le duc d’Anjou !
Oh !
Le tyran redouté de toute la province, le sombre débauché au pâle visage, le frère tout-puissant du roi, qui a peur de ses complots et de ses crimes !
Silence ! silence !…
Mais nous sommes dans sa maison, en son pouvoir ! c’est lui qui a tendu ce piège infâme ! Gertrude, il faut sortir d’ici.
C’est tout ce que je demande ; mais comment ?
Ici, une chambre sans issue… Ici, leurs espions, leurs gardes… Là…
(Elle montre la fenêtre.)
La mort !
La mort, c’est souvent le salut !… Il me semble à présent que les murs me menacent, que des yeux de flamme me surveillent ; je ne puis plus penser, je ne respire plus, j’ai peur ! Enfermons-nous ! enfermons-nous !
Rien ! pas un verrou ! pas une clef ! Ils ont tout prévu, mademoiselle !
Ô mon père ! mon bon père ! tu me défendrais !
Et dire qu’on est femme ! qu’on n’a pas la force, qu’on n’est rien !… Il y a là-bas, tenez, à cent toises, un bateau dans les saules, je le vois ; si j’étais un homme, je l’irais chercher à la nage !
Oh ! mon Dieu !
Qu’avez-vous ?
Je suis éblouie, je suis folle !
Mais quoi donc ?
Il me semble que je vois remuer ce bateau.
Oui, il marche !
Il avance !
Et ces ombres qui se meuvent sur la lisière du bois… des amis, peut-être !
Ou le prince !
Il ne se cacherait pas ainsi. Voyez comme cette barque cherche l’obscurité, voyez comme ces ombres glissent mystérieusement dans les roseaux, sous les saules.
Un cheval a henni.
Oh ! la lune se cache, je ne vois plus rien.
Moi, j’entends l’aviron !
Tout près !
Ferme cette fenêtre !
Gertrude !
Qu’y a-t-il ?
Mon nom !
Qui donc est là ?
Les mêmes, Monsoreau.
Un ami !
M. de Monsoreau !
Lui !
Ne m’attendiez-vous pas, mademoiselle, puisqu’il s’agit de votre honneur ?
Voyez-vous !
On vient de m’apprendre, à Méridor, la trahison dont vous êtes victime. Des ravisseurs masqués vous enlevaient : j’ai couru, je les ai poursuivis, j’ai retrouvé vos traces. Ne craignez plus rien, mademoiselle, me voici !
Je vous suis reconnaissante, monsieur.
Donnez-moi vos ordres, mademoiselle : j’ai en bas une barque ; dans le bois, j’ai de bons serviteurs avec mes meilleurs chevaux. Nul ne m’a vu, nul ne me soupçonne. Ne perdons pas de temps, partons !
Où me conduisez-vous ?
À Méridor !
Chez mon père ?
Vous pouvez l’embrasser dans trois heures !
Oh ! monsieur, si vous disiez vrai !
Êtes-vous prête ?
Monsieur !…
Les instants sont précieux… Le prince n’est pas au château ; mais demain, peut-être, il arrivera. Fuir au grand jour, impossible ! Et, le prince une fois arrivé, je ne pourrai plus rien pour vous, que risquer en vain ma vie, comme je la risque en ce moment avec l’espoir de vous sauver.
Vous risquez votre vie ?
Sans doute, puisque le prince m’appelle son ami, et que je le trahis pour vous ! S’il pouvait soupçonner que je suis ici, il me ferait assassiner demain !
Ah ! mademoiselle, croyez-le !
Le secours me fait autant peur que le danger !
Est-ce par faiblesse que vous hésitez ? est-ce par défiance ?… J’espérais mieux de mon dévouement.
Vous venez de Méridor, dites-vous, averti, envoyé par mon père… Comment n’est-il pas venu avec vous ?
Ici ! chez Son Altesse ! j’aurais souffert qu’il s’exposât ainsi ! Passe pour moi !… mais votre père…
Mais il pouvait m’écrire ; une ligne de lui m’eût persuadée, je VOUS suivais ! (Monsoreau tire par un mouvement rapide une lettre de son pourpoint.) Il a écrit, n’est-ce pas ?… Donnez !
(Elle tend la main.)
Non, mademoiselle, il n’a pas écrit !… Pouvait-il croire qu’un ami dévoué, un libérateur, vous fût à ce point suspect ?
Écoutez ! des pas !… on vient !
Monsieur le comte !…
(On frappe.)
Je suis perdu, et sans vous sauver !
(On frappe.)
Ici, monsieur, ici !
(Elle le cache dans la chambre voisine. On frappe toujours. Diane tombe assise.)
Les mêmes, Monsoreau, caché ; Aurilly, masqué
Quoi ?… qu’y a-t-il ?
Mademoiselle !…
De quelle part venez-vous ?
Prenez la peine de lire.
Je ne lirai pas cette lettre sans savoir de qui elle vient. Je la refuse.
(Aurilly pose la lettre sur le coussin devant Diane et sort.)
Les mêmes, Monsoreau.
« À la belle Diane de Méridor. »
Jette dehors ce papier.
Lisez-le, lisez-le, mademoiselle, au contraire !
(Gertrude le décachette précipitamment et le donne à Diane.)
« Un malheureux prince, éperdu d’amour, vous a offensée, et veut obtenir sa grâce. Ce soir même, à dix heures, il viendra la demander à vos pieds. »
Ce soir !…
À dix heures !…
(On entend sonner l’horloge de château.)
Neuf heures trois quarts sonnent à Beaugé, et le duc est très exact, mademoiselle, à ses rendez-vous d’amour !
Ah ! quelle torture !
Et pour Diane de Méridor, qui est si belle, il est capable de devancer l’heure. Tenez, voyez-vous ces lumières à travers le bois ?
C’est vrai !
Les flambeaux de son escorte !
Mademoiselle ! mademoiselle ! je vous en supplie…
Je voudrais fuir, impossible !
(On entend une rumeur, un son de cloches lointain.)
Le duc entre au château ; une minute encore, il sera trop tard !
(Il place un meuble devant la porte.)
À moi, Gertrude ! à moi !
Me voici ! me voici !
(Elle la soulève et l’entraîne vers le balcon.)
Son voile ! ils la croiront morte, cela vaut mieux ainsi !
(Il disparaît à son tour.)
Aurilly, puis le duc d’Anjou.
Ouvrez ! ouvrez ! ne craignez rien, c’est monseigneur. (La porte est ébranlée. Aurilly entre par l’autre porte, et, la trouvant sans lumière, va voir dans la chambre voisine, puis dérange le meuble Entrent des Écuyers avec des flambeaux, puis le Prince.) Personne, monseigneur ! (Il court à la fenêtre ouverte.) Disparue !
Son voile flottant sur l’eau ! morte ! morte !
(Il se détourne épouvanté.)
Un grand cabinet, attenant à la galerie de l’hôtel de Cossé-Brissac. Portes au fond, à gauche et à droite, Illumination splendide.
Maugiron, assis ; Schomberg, Saint-Luc, puis Quélus.
Ah ! mon cher Saint-Luc, tes noces sont magnifiques ! Mais, sais-tu, quand je vois un homme se marier, c’est plus fort que moi, j’étouffe !
Pauvre Schomberg ! dans ce cabinet tu vas pouvoir respirer… (Apercevant Maugiron.) Tiens ! tu es déjà ici, Maugiron ?
Oui ! je me suis sauvé… La mariée est trop belle ! et j’attends ici Quélus, qui est aux prises avec M. de Brissac, ton beau-père.
Ah ! messieurs, quel beau-père !… (Apercevant Saint-Luc.) Pardon, mon brave Saint-Luc, mais voilà sept fois que ce cher M. de Brissac me demande si le roi viendra honorer de sa présence… Est-ce qu’on sait jamais si le roi viendra ou si le roi ne viendra pas !
(Ils rient.)
Les mêmes, Jeanne.
Comment ! le roi ne viendra pas ? Mais, messieurs, on m’a promis le roi !
C’est vrai, mes amis ; rassurez madame de Saint-Luc.
Ai-je dit le roi, madame ?… La langue m’a fourché ; nous parlions de M. le duc d’Anjou, et je disais ; « J’espère qu’il ne viendra pas ! »
Mais on m’a promis aussi M. le duc d’Anjou.
Ma chère Jeanne !
Pourquoi ne le verrait-on pas ?
Parce que, madame, nous n’avons aperçu ici aucun angevin.
Dieu merci !
Dieu merci ?
Hum ! hum !
Madame de Saint-Luc, qui nous arrive de son couvent toute fraîche et toute charmante, ne connaît pas encore les habitudes de la cour angevine. Sachez, madame, que M. le duc d’Anjou ne fait jamais un pas sans éclaireurs, sans une petite avant-garde de sbires, de coupe-bourses et de coupe-jarrets !
Oh !…
Un Antraguet, un Ribérac, un Livarot ou un Bussy quelconque.
Louis de Clermont, seigneur de Bussy, un coupe-jarret !
Quélus veut rire.
Pas le moins du monde. Ainsi, madame, comme on n’aperçoit pas céans M. de Bussy, le tranche-montagne, il est certain qu’on n’y apercevra pas M. d’Anjou.
Il est encore temps !
Taisez-vous donc !
Hein ?
Plaît-il ?
Madame de Saint-Luc se plaint du temps.
La chaleur ici, la neige dehors !
Il ne fait jamais beau, les jours de noces.
Voilà mon beau-père qui-se dirige de ce côté.
Il veut peut-être savoir si le roi honorera…
Il cherche quelqu’un.





























