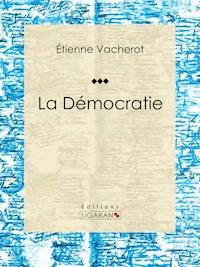
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est l'abus du mot démocratie qui m'a donné l'idée de ce livre. Le nom est dans toutes les bouches, tour à tour maudit et célébré pour les terreurs, les déceptions et les espérances qu'il fait naître. Toutes les écoles politiques, celles qui redoutent la démocratie, comme celles qui l'appellent de leurs vœux, s'accordent à reconnaître qu'elle est la grande promesse de la Révolution qui a clos le siècle dernier."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054095
©Ligaran 2015
C’est l’abus du mot démocratie qui m’a donné l’idée de ce livre. Le nom est dans toutes les bouches, tour à tour maudit et célébré pour les terreurs, les déceptions et les espérances qu’il fait naître. Toutes les écoles politiques, celles qui redoutent la démocratie, comme celles qui l’appellent de leurs vœux, s’accordent à reconnaître qu’elle est la grande promesse de la Révolution qui a clos le siècle dernier. Les uns trouvent que toutes les sociétés européennes où les privilèges de la noblesse et les institutions de la féodalité ont disparu, sont déjà en pleine démocratie. C’est le sens de la célèbre phrase de M. de Serre et du beau commentaire de M. Royer-Collard. Le premier s’effrayait, le second s’applaudissait de voir la démocratie couler à pleins bords. Tous deux étaient loin de comprendre le mot dans toute son extension. D’autres, plus exigeants, font de l’égalité politique le principe même de la démocratie. Mais cela leur suffit. Ils voient dans le suffrage universel le dernier mot de la démocratie, quelles que soient les conditions morales, sociales, économiques du peuple qui en jouit, et sans considérer que l’ignorance, la superstition, l’immoralité, la misère peuvent rendre vain ou dangereux l’exercice du droit populaire. D’autres enfin, peu soucieux de liberté et de dignité, vont jusqu’à prostituer le nom de démocratie à un régime politique qui confond toutes les classes de la société sous le niveau du despotisme, et fait du suffrage universel un jouet dérisoire, un instrument d’oppression.
J’ai voulu relever la démocratie de toutes ces définitions fausses, légères ou misérables, en montrant quel en est le véritable principe, quelles en sont les véritables conditions, morales, sociales, économiques, administratives, politiques ; en un mot, ce que c’est qu’une Société, un État, un Gouvernement démocratique. Le fond des idées de ce livre est peu nouveau, j’en fais l’aveu sans peine. Sur de pareilles matières, les prétentions à l’originalité et à l’invention ne sont pas seulement ridicules ; elles seraient suspectes à bon droit au public, si elles étaient justifiées. C’est en politique surtout qu’il n’est pas bon de penser seul, et de se complaire dans l’orgueil des méditations personnelles. Les idées n’y ont d’autorité et de vertu qu’autant qu’elles ont acquis un certain degré de généralité, au moins dans le monde des esprits plus ou moins familiers avec ce genre de questions. Je serais en grande défiance de celles que j’expose ici, si elles m’étaient entièrement propres. Mais comme ces idées sont plus ou moins celles de toutes les écoles politiques qui se rallient sous le drapeau de la démocratie, comme je ne fais guère autre chose que résumer le grand travail qui s’est produit autour de ce drapeau depuis trente ans, je prends confiance dans mon œuvre, et j’ai quelque espoir que ma voix ne restera pas sans échos.
La seule chose un peu nouvelle dans ce livre, c’est la méthode. On sait comment procède le géomètre. Il pose d’abord ses axiomes et ses définitions ; puis déduit de celles-ci, à l’aide de ceux-là, toutes les propositions dont l’enchaînement forme la science entière. Ses définitions ont pour objet des figures idéales dont le géomètre démontre les diverses propriétés, sans se soucier si la réalité répond exactement à la vérité géométrique établie par les définitions et les théorèmes, et surtout sans jamais s’aviser de vérifier par l’expérience des démonstrations fondées sur des principes abstraits et a priori. De même, dans l’ordre des vérités que je poursuis, c’est à l’idée, au principe, que je m’attache exclusivement. Étant donnée la définition de la démocratie, j’en déduis toutes les conséquences pour la Société, l’État et le Gouvernement. Que ces conséquences soient plus ou moins applicables, selon les temps, les lieux et les peuples, ceci est un problème de politique pratique qui n’entre point dans le programme de ce livre. Il ne s’agit ici que d’idéal, de théorie, de vérité pure. Je laisse la réalité pour ce qu’elle vaut, et je la renvoie au jugement des hommes d’État. Les imperfections et les misères des démocraties réelles, soit anciennes, soit modernes, n’infirment pas plus les définitions et les déductions de la théorie démocratique que les irrégularités et les défectuosités des figures concrètes n’infirment les définitions et les démonstrations de la géométrie pure. La philosophie ne saurait trop le répéter en face des grossiers préjugés de l’imagination : en politique, comme en morale, comme en littérature, la réalité n’est point la vérité. Elle n’en est qu’une imparfaite ébauche ; parfois même elle en est l’insolente négation. Quelle qu’elle soit, il n’y a rien à en conclure contre l’éternelle et immuable vérité. L’histoire ne peut jamais être un argument contre la logique et la raison. L’idéal sera toujours le refuge inviolable des esprits et des âmes d’élite qui ont le sens du beau, du juste, du vrai, de toutes les choses intelligibles , pour parler la langue de Platon.
On croira peut-être réfuter cette manière d’entendre la démocratie, en la qualifiant d’utopie. J’accepte le mot, en demandant la permission de l’expliquer. Utopie peut signifier deux choses bien différentes : un roman de l’imagination, ou un idéal de la logique et de la raison. Dans le premier cas, l’utopie n’a aucune espèce de valeur ni de portée, puisqu’elle n’est pas plus l’expression de la vérité que de la réalité. Elle peut charmer l’esprit, si elle a les mérites d’une œuvre littéraire ; mais elle ne compte pas dans l’ordre des conceptions politiques. Dans le second cas, l’utopie, étant l’expression de la vérité, est toujours une œuvre politique sérieuse, soit que cette vérité reste à la hauteur inaccessible de l’idéal et de l’absolu, soit qu’elle n’attende que certains progrès inévitables de la civilisation pour être pleinement réalisée. Ce genre d’utopie est le seul mérite auquel mon livre prétende. Je n’ai ni le goût ni la liberté d’aborder la politique actuelle. J’ai voulu seulement montrer à la société moderne l’idéal qui peut lui servir d’étoile dans la voie de la démocratie, où la Révolution l’a définitivement engagée. Cet idéal est proposé pour la vérité et la justice absolues en politique. C’est sur ce terrain que j’accepte et que j’appelle la discussion. Ce livre ne veut être jugé qu’au nom de la logique et de la raison. S’il a pour lui la vérité, peu importe que la réalité proteste contre ses principes et ses conclusions. Toute la question est là, et j’aurai toujours le droit d’y ramener la critique. C’est assez dire qu’un pareil travail sur la démocratie n’a rien de commun avec les ouvrages publiés sur le même sujet. L’admirable étude de M. de Tocqueville sur la démocratie en Amérique est un livre d’histoire. L’éloquente dissertation de M. Guizot sur la démocratie en France est un livre de politique contemporaine. Ici, l’histoire et la politique actuelle font place à la définition des principes et à la déduction des conséquences de la démocratie, abstraction faite des temps, des lieux et des peuples ; rien de moins, rien de plus. L’auteur regrettrait vivement qu’on y cherchât ce qu’il n’a point voulu y mettre.
Quant à décider si l’idéal démocratique tracé dans ce livre peut être réalisé dans un avenir prochain, c’est un problème tout historique, aussi complexe qu’intéressant, qui ne pourrait être positivement résolu que par un examen approfondi des sociétés modernes les mieux préparées à cet état politique. Toutefois, un simple coup d’œil jeté sur l’Europe suffirait, ce semble, pour faire concevoir de légitimes espérances aux amis de la démocratie. Il serait assurément téméraire d’affirmer que les provinces encore un peu barbares de la Russie et de l’Autriche seront en pleine démocratie au début du siècle suivant. Avant d’en venir à la démocratie pure, il faut que ces nations, qui ne sont encore que des sociétés naturelles, soient devenues de vraies sociétés politiques. L’Italie et la Péninsule ibérique en sont moins éloignées. Et pourtant que de préjugés, de superstitions, de mauvaises passions, de fatales habitudes, d’obstacles de toute espèce à vaincre ! Que de progrès à faire dans les voies de la civilisation, matérielle et morale, pour arriver à une organisation démocratique ! Les États scandinaves y aspirent instinctivement, et en sont dignes à beaucoup d’égards ; c’est leur destinée infaillible, quand ils auront accompli les progrès matériels indispensables à l’établissement de la démocratie moderne. Les sociétés qui marchent à la tête de l’Europe, comme la France, l’Angleterre, la Belgique, la Hollande et l’Allemagne, gravitent visiblement vers cet état de choses. Les traditions monarchiques, aristocratiques, théocratiques qui en retiennent l’essor, perdent de plus en plus, quoi qu’on fasse, de leur force et de leur prestige. En France, l’œuvre révolutionnaire, commencée par la philosophie, précipitée par la Révolution, se continue, malgré les apparences, avec une puissance irrésistible, et descend de plus en plus dans les profondeurs de la société, de manière à faire la place nette à la démocratie pure, à un moment donné qui ne peut guère dépasser le XIXe siècle. En Angleterre et en Allemagne, ce travail est moins avancé. L’œuvre démocratique y rencontre des traditions plus tenaces et des obstacles plus puissants. Mais si le progrès y est plus lent, il est plus sûr. Moins prompte aux révolutions, la race anglo-germanique se prête mieux aux évolutions naturelles qui font atteindre le but, sans rompre brusquement avec la tradition. D’ailleurs, grâce à l’action universelle de la civilisation moderne, le progrès se généralise et s’harmonise dans tout le système des nations civilisées, de façon à les faire arriver toutes au but à peu près en même temps. Les amis de la liberté et de la démocratie peuvent donc se consoler du présent par la perspective de l’avenir. Le règne de la justice est plus proche que les apparences ne le font croire aux politiques à courte vue. Il est possible que le XIXe siècle tout entier se consume en essais, en tâtonnements, en révolutions, en restaurations, en toutes sortes d’institutions provisoires, avant d’aboutir à un véritable établissement politique. Autant qu’il est permis d’en juger jusqu’ici par son histoire, son œuvre est de transition et de préparation plutôt que d’organisation définitive. Mais l’état actuel de la civilisation moderne, et la loi du progrès accéléré qui la régit ne permettent guère de douter que le siècle suivant ne voie, à son début, les États-Unis de la Démocratie européenne.
Comment s’opérera cette grande métamorphose ? Nul ne le sait. Dans le développement progressif de la civilisation humaine, les moyens sont aussi obscurs que le but est visible. C’est que le but est nécessaire, tandis que les moyens sont plus ou moins contingents. La loi du progrès s’arrange de tout, des mérites et des fautes, des vertus et des vices, des bons et des mauvais gouvernements. Le bien suprême sort de l’excès du mal ; le sublime effort jaillit tout à coup, comme l’éclair, de la plus dégradante abjection. Tel despotisme, qui semblait avoir courbé toutes les têtes, provoque un certain jour un magnifique élan de liberté. Sans les misères accumulées de l’ancien régime, la Révolution de 89 n’aurait eu ni sa force irrésistible ni son héroïque vertu. Les réactions n’arrêtent un moment le progrès des sociétés que pour le précipiter ensuite vers le but. Entre toutes les routes qui conduisent au port, il serait difficile de dire a priori laquelle abrège le temps et les peines de l’Humanité. Les sociétés modernes vont à la démocratie par toutes les voies, par les révolutions, par les restaurations, par la liberté, par le despotisme, par l’anarchie. Chaque peuple y procède à sa manière, et selon son génie propre ; celui-ci par la révolution violente, celui-là par l’évolution pacifique. Tel y porte un bon sens qui prévient les excès, et une solidité de caractère qui ne permet pas les défaillances. Tel autre s’y jette avec une furie héroïque que n’arrête aucun obstacle, mais aussi avec une légèreté qui le fait reculer bien au-delà du point de départ. À tout prendre, il serait difficile de découvrir l’élu de la Providence parmi les grands peuples qu’elle a doués de facultés aussi admirables que diverses pour l’œuvre commune de la civilisation. Et parmi les histoires nationales de ces peuples, il ne serait pas plus facile de dire laquelle fait la meilleure page de l’Histoire universelle.
Est-ce à dire qu’il n’y ait qu’à se croiser les bras devant l’irrésistible fatalité du progrès, dans une superbe indifférence du bien et du mal, et dans une absolue confiance à l’avènement de la démocratie, au jour marqué par le doigt de la Providence ? Loin de là. La politique n’est pas la philosophie de l’histoire. Si l’une contemple surtout l’action des causes générales qui dominent la volonté humaine, l’autre ne compte que sur l’homme pour l’exécution de ses plans. À chacun son œuvre. Par son travail latent, profond et général, la force des choses provoque les révolutions et entasse les ruines. Par son perfectionnement moral et son action personnelle, l’homme seul crée, fonde et organise les sociétés qui en sortent. Sans cette dernière condition, les révolutions les plus légitimes, les plus nécessaires sont infécondes. Puissantes pour la destruction, elles ne peuvent rien pour l’organisation. En ce sens, il est bien vrai de dire que le mal ne peut engendrer le bien, que le despotisme n’enfante jamais la liberté. Il n’y a que les peuples déjà libres auxquels il soit donné de faire des révolutions libérales. Pourquoi la Révolution française, d’ailleurs si féconde, a-t-elle trompé les espérances de ses plus nobles amis ? C’est qu’elle est sortie du despotisme. Toute révolution se ressent inévitablement de son origine : brutale, violente, sanglante, si le régime intérieur a comprimé tout essor, éteint toute lumière chez le peuple qui la fait ; douce, pacifique, constitutionnelle, si le régime antérieur a favorisé ou permis du moins l’éducation libérale de ce même peuple.
Voilà pourquoi ceux qui espèrent en la démocratie ne sauraient être indifférents aux régimes politiques qui en doivent précéder l’avènement. Le despotisme peut hâter cet avènement plus que tel gouvernement libéral ; mais à la liberté seule il appartient de le préparer et d’en assurer la durée. Par les habitudes qu’il laisse chez le peuple brusquement émancipé, le despotisme est la pire école pour la démocratie. On l’a bien vu en France après 89. Si la volonté de l’homme était toujours maîtresse des évènements, il faudrait désirer que le progrès démocratique, comme tout autre, se fit par évolution plutôt que par révolution. Mais c’est le cas de dire ici : L’homme propose et Dieu dispose. L’action décisive des causes générales, jointe à l’action imprévue des causes accidentelles, ne laisse pas le plus souvent à la volonté et à la sagesse de l’homme le choix des moyens pour les grandes transformations sociales qui doivent s’opérer. Alors la politique pratique, sommée par les évènements de saisir l’occasion par les cheveux, en est réduite aux hasards, aux aventures, aux expédients révolutionnaires, toujours plus ou moins en contradiction avec les principes de liberté et de justice dont le triomphe est le but même de la révolution.
Quoi qu’il en soit, la démocratie n’est pas seulement l’idéal des sociétés modernes ; elle en est l’avenir plus ou moins prochain. Simple vérité aujourd’hui, elle sera tôt ou tard la réalité ; c’est une de ces utopies qui n’attendent que l’heure et l’occasion pour prendre place dans la politique pratique. Telle est du moins la foi profonde de tous les démocrates sérieux, en face des changements politiques, sociaux, économiques qui se succèdent en Europe, depuis la Révolution de 89. Nous savons que certaines gens en rient, et que d’autres s’en irritent : les premiers, parce que le succès les aveugle au point de ne rien voir au-delà ; les seconds, parce que le spectre de la démocratie future vient mal à propos troubler leur sécurité actuelle. Mais ni ces railleries, ni ces colères ne détourneront un instant nos regards des splendides perspectives de l’avenir. À vrai dire, nous craignons que les rieurs n’aient pas toujours sujet de rire. Quant aux conservateurs accroupis sous l’égide de la force, nous leur conseillons de se familiariser avec les idées qui feront leur salut plus tard, s’ils s’y associent à temps, qui feront leur ruine, si par leur résistance obstinée ils en provoquaient l’explosion violente.
Quelle que soit notre passion de l’idéal, nous sommes de ceux qui n’ont jamais eu un moment d’illusion sur l’état actuel de la société européenne, et de la société française en particulier. Nous comprenons tout ce qu’il faut de temps et de peines pour y préparer l’avènement de la démocratie. Nous savons que la politique pratique doit regarder à ses pieds, et laisser à la philosophie la contemplation de l’idéal. Mais, parce que le progrès est difficile, faut-il se résigner aux misères et aux souffrances du statu quo ? Bien des gens qui prennent l’esprit de routine pour le sens pratique, croient nous fermer la bouche d’un mot : « Votre démocratie est une chose belle et juste, mais impossible. » Si les flatteurs de la vanité nationale ont pu dire qu’impossible n’est pas français, nous soutenons, nous, que c’est un mot à rayer du dictionnaire de la politique. Tout ce qui est juste est possible tôt ou tard ; ce n’est plus qu’une question de temps et d’occasion. Sans doute, quoique la nature humaine ne soit point radicalement mauvaise, le mal lui est plus facile que le bien ; l’expérience ne nous l’enseigne que trop. Qu’en veut-on conclure ? On nous parle des difficultés de la démocratie. Mais où est l’œuvre facile, quand il s’agit de vertu, de liberté, de vérité, de science, de justice ? Ce qui est simple et commode, c’est la servitude, c’est l’ignorance, c’est la superstition. Tout le monde s’en arrange, les classes qui en pâtissent comme celles qui en profitent. S’agit-il d’abaisser, d’abrutir l’homme, rien de plus facile. S’agit-il de l’élever, de le civiliser, rien de plus laborieux. Le despotisme, pour prendre un exemple dans l’ordre politique, est le plus élémentaire des gouvernements ; il n’a pas plus besoin de génie que de vertu : la force y suffit, sous la forme du premier gendarme venu. Une œuvre vraiment difficile, autant que glorieuse, c’est le gouvernement libre ; car là tout devient difficulté pour ceux qui gouvernent, le bien comme le mal, les mérites comme les fautes, parce que tout y subit l’épreuve du contrôle et de la critique.
Notre démocratie, nous en convenons volontiers, veut bien des choses nouvelles et d’une pratique difficile. Dans l’ordre moral, elle ne veut d’autre foi que la conscience, d’autre autorité que la raison. Dans l’ordre politique, elle ne veut d’autre Souverain que la loi, d’autre loi que la volonté générale. Dans l’ordre social, elle ne conserve que les conditions qui se concilient avec l’indépendance du citoyen, et supprime ou transforme toutes les autres. Dans l’ordre économique, elle remplace, partout où cela est possible, le salariat et le patronage par l’association libre. En un mot, elle veut la liberté sous toutes les formes, pour toutes les conditions de la société.
Rien de tout cela n’est aisé. Il est bien plus simple de s’endormir sur l’oreiller de la foi que de poursuivre la vérité à la sueur de son front. Il est bien plus simple de se laisser gouverner que de se gouverner soi-même, peuples ou individus. Il est bien plus simple de vivre dans une domesticité qui délivre le serviteur de tout souci de l’avenir que dans une liberté qui l’oblige sans cesse à prévoir. Il est bien plus simple de travailler pour un salaire toujours assuré que de courir les risques de l’association. Ici les praticiens vulgaires triomphent sans peine. Il est vrai qu’ils pouvaient triompher tout aussi bien, quand la philosophie et le Christianisme s’efforçaient d’arracher l’Humanité à l’esclavage, quand la philosophie et la Révolution faisaient tomber les chaînes des dernières victimes de la féodalité. Alors aussi l’Humanité entrait dans l’inconnu, c’est-à-dire dans l’impossible, selon le langage des conservateurs de tous les temps. Que ne pouvait-on pas dire contre une liberté si féconde en difficultés et en désordres pour des hommes habitués à la vie de l’esclavage et du serf ? N’entendons-nous pas encore aujourd’hui vanter par les colons américains les douceurs de l’esclavage ? Tout grand progrès de l’Humanité a toujours été un enfantement laborieux. Donc, entre les conservateurs et nous, il ne s’agit point de pratique plus ou moins facile ; il s’agit de justice et de vérité. Le régime de la raison, de la science, de la loi, de l’association, de la liberté en tout et partout, vaut-il mieux pour la moralité, la dignité, le vrai bonheur de l’homme, que le régime de l’autorité, de la consigne, du patriciat, de la servitude ? Si cela est, et c’est le cri de toute conscience humaine, la cause de la démocratie est gagnée, au moins en principe. Nous n’en demandons pas davantage aux conservateurs honnêtes et intelligents.
Si les déclamations et les injures des ennemis de la liberté nous touchent peu, il en est tout autrement des objections et des critiques de ses amis. Dans l’école démocratique libérale à laquelle nous tenons à honneur d’appartenir, des voix s’élèveront peut-être pour protester en faveur du droit individuel compromis, en apparence, par notre théorie du droit social et de l’État qui en est l’organe. Rien ne serait plus propre à éveiller nos doutes sur la justice de nos principes que les scrupules des consciences libérales, s’ils étaient fondés. Notre démocratie repousse absolument toute espèce de despotisme, quelle qu’en soit l’origine, le caprice d’un prince ou la volonté d’un peuple tout entier. Elle tient avant tout pour les droits de l’homme, pour ces droits inviolables, imprescriptibles, antérieurs et supérieurs aux lois positives, qui peuvent bien les reconnaître et les formuler, mais ne les créent point. Elle considère la déclaration de ces droits comme le palladium de toute vraie démocratie, et ne saurait trop applaudir à la haute inspiration des assemblées qui l’ont mise en tête de leurs Constitutions. Le droit individuel est le principe de toute politique avouable. La Société n’a d’autre but que d’en assurer le développement ; l’État ne peut pas avoir d’autre mission que d’en protéger et d’en favoriser l’exercice. Nous sommes de ceux qui proclament bien haut que la volonté d’un Peuple ne peut contre ce droit rien de plus que la volonté d’un individu. Ainsi, le vote le plus régulier, le plus libre, fût-il unanime, ne peut priver un seul citoyen d’un de ses droits, si bien nommés droits naturels, parce qu’il les tient de sa nature d’homme, et nullement d’une institution sociale quelconque. S’il est vrai que les grands révolutionnaires qui, en 93, ont fait un si terrible abus de la souveraineté populaire, aient obéi en cela à un principe plutôt qu’à une nécessité, nous répudions énergiquement cette dangereuse tradition, et nous nous séparons sans retour de cette fraction de l’école démocratique qui, tout en flétrissant les excès et les crimes de la Révolution, accepte la théorie de l’omnipotence de l’autorité populaire.
Mais, ces réserves faites, nous sera-t-il permis de répéter que le droit individuel, si positif qu’il soit, ne peut être absolu, qu’il est nécessairement limité par le droit social, et réglé par l’État qui représente ce droit ? Nous avons pris pour exemple le droit de propriété qui fait partie de ces droits de l’homme stipulés en tête de toutes les Constitutions modernes, et nous avons fait voir que, malgré le respect parfois superstitieux d’un droit individuel qui touche si profondément à la famille, jamais le droit social d’expropriation légale n’avait été contesté. Nous avons montré, de même, comment le droit de parler, le droit d’agir, le droit de réunion, le droit d’association, toute espèce de droit individuel a pour limite le droit d’autrui, et pour règle la justice sociale qui intervient par l’organe de l’État. Nous aurions pu citer un exemple plus décisif encore de cette subordination du droit individuel au droit social. Qu’y a-t-il de plus intime, de plus personnel, de plus individuel que le mariage ? Quelle liberté est plus vitale, plus sainte que celle-là ? Il semble que le mariage consiste tout entier dans l’union des cœurs, qu’il soit un acte libre de conscience, avec lequel l’État n’ait rien à voir. Et pourtant le droit social intervient pour légitimer le mariage, ou pour le maintenir comme un devoir, alors même qu’il a cessé d’être un sentiment. Les amis de la liberté ont pu protester contre l’excès du droit social poussé jusqu’à l’odieux et à l’absurde ; ils ont pu arracher le droit du divorce à l’autorité civile, dans les pays où le sentiment du droit individuel a définitivement prévalu contre le préjugé religieux. Un jour viendra où l’on ne pourra comprendre un pareil abus du droit social. Mais, parmi les partisans les plus décidés du divorce, qui s’aviserait de contester à la Société le droit de décider s’il y a lieu ou non à rompre des liens contractés sous les auspices de la loi, et en face de l’État ? Et pourquoi cela ? Parce que le mariage, de même que la propriété, est un acte social, en même temps qu’un acte individuel. C’est le principe de la famille, sans laquelle il n’y a pas de société. S’il n’y avait dans le mariage que l’union des cœurs et l’accord des volontés, tout serait dit, le divorce serait légitime et forcé, du moment que cette union et cet accord auraient cessé. Mais le mariage laisse des enfants, dont l’entretien et l’éducation sont pour les parents un devoir aussi bien qu’un droit. Qui se chargera de cette tâche ? Qui est apte à la remplir, sinon la famille ? Voilà le droit social en face du droit individuel ; voilà la justice en présence de la liberté. Le droit des époux est limité par leur devoir ; et s’ils ne peuvent dignement remplir ce devoir qu’en restant unis, la Société a le droit de maintenir la justice méconnue par le sentiment. Qui osera voir ici une usurpation du droit social sur le droit individuel ? Qui persistera à maintenir ce dernier comme droit absolu ? C’est en ce sens que nous affirmons le droit social, et que nous l’affirmons comme droit absolu, en face de tous les droits individuels qui doivent y chercher leur mesure et leur règle définitive. Le droit social est absolu, comme la justice dont il est l’expression ; et l’autorité de l’État est absolue, en tant qu’elle est l’organe de cette justice.
Autre objection. D’excellents démocrates pourront trouver que nous faisons la part trop large à l’État, dans l’organisation de la démocratie future. Nous comprenons ce sentiment de défiance envers l’État personnifié dans un homme, une famille ou une caste. Mais quand il est uniquement l’organe de la justice sociale, ce qui est le fait de la démocratie, et que d’ailleurs il se renferme dans les attributions et les œuvres qui lui sont propres, de quoi peut se plaindre la liberté individuelle ? On dit que c’est réduire d’autant l’initiative des individus et des communes. Autant vaudrait se plaindre des limites dans lesquelles la loi enferme la liberté des citoyens. Cette objection va tout droit à la suppression de l’État. Telle est, du reste, la conclusion formelle d’une certaine école ultra-libérale qui ne veut de l’autorité publique sous aucune forme, ni dans aucune mesure. Nos amis ne vont pas si loin. Ils veulent bien de l’intervention de l’État pour la justice, la défense nationale et la perception de l’impôt ; mais c’est tout.
Pour nous, nous trouvons que ce n’est pointasses . Nous craignons que l’abus de la centralisation, dans tel pays et à tel moment donné, n’ait quelque peu exagéré la défiance de nos amis. Il est des temps où la faveur publique est à l’État, où les meilleurs amis de la liberté ne se sentent point assez gouvernés. Après des excès de pouvoir, il arrive, par une réaction naturelle, que les plus fervents amis de l’ordre en viennent à trouver qu’on les gouverne beaucoup trop. C’est alors que l’État tombe en suspicion, et que sa cause devient impopulaire. Nous comprenons que la politique pratique tienne compte de ces mouvements de l’opinion en sens contraire, ainsi que du tempérament plus ou moins libéral des sociétés qu’elle dirige. Mais, en nous plaçant au point de vue des principes, nous nous demandons ce que la justice et la vraie liberté ont à gagner à l’amoindrissement de l’État. Selon nous, il s’agit d’en régler, non d’en réduire l’action. Le domaine de l’État ne peut être à la merci des courants d’opinion qui tendent tantôt à en restreindre, tantôt à en reculer les limites. L’État, comme l’individu, comme la commune, a sa sphère d’action déterminée, dans toute société bien organisée, et particulièrement dans la démocratie. Le vrai problème est d’en fixer les limites. Et pour en trouver la solution, nous croyons qu’il y a autre chose à faire qu’à regarder l’Angleterre ou l’Amérique. La première est une vieille aristocratie où les traditions féodales n’ont pas encore permis l’organisation normale de l’État ; la seconde est une démocratie encore trop jeune et trop novice pour cette organisation. Admirables exemples de liberté politique, ces deux sociétés ne peuvent être proposées pour l’idéal de la société moderne.
Mais où trouver la vraie ligne de démarcation qui sépare le domaine de l’État de celui de l’initiative individuelle ou communale ? C’est la question que nous avons essayé de résoudre par la distinction précise de l’intérêt privé et de l’intérêt public. Les publicistes, généralement d’accord sur le principe, varient beaucoup sur l’application. Certaines attributions, telles que les fonctions de la justice, de la police générale, de l’administration financière, de la défense nationale, de la politique extérieure, sont acquises à l’État sans contestations sérieuses. D’autres, comme l’instruction publique, les travaux d’utilité générale, la construction des monuments publics, l’entretien et la direction des théâtres, sont renvoyées par la plupart des publicistes libéraux à l’initiative des individus, des compagnies, ou des communes. En maintenant ces dernières attributions à l’État, nous ne croyons pas exagérer la centralisation. Si nous avons en horreur tout régime auquel puisse s’appliquer le mot de Louis XIV : L’État c’est moi, nous n’avons aucune défiance d’un État vraiment démocratique, où aucun intérêt personnel et dynastique ne vient se mêler à l’intérêt social dont cette institution est l’organe propre. On nous dira qu’à défaut d’un homme ou d’une famille, il faudra toujours que l’État se personnifie dans un parti, sous le régime démocratique. Nous en convenons, en faisant observer toutefois que les partis qui se disputent le gouvernement et l’administration, dans une démocratie, sont toujours sous le coup d’un vote populaire qui les punit d’un abus de pouvoir, comme il les récompense d’une bonne et libérale gestion. D’ailleurs, les abus de pouvoir de la part de l’État ne sont à craindre qu’autant qu’il se confond avec le gouvernement. Or, la distinction de ces deux institutions, et leur séparation dans une certaine mesure, si elle est possible, nous paraît une garantie suffisante de la liberté des citoyens, ainsi que de l’indépendance des fonctionnaires. Il ne s’agit donc que de trouver le moyen d’opérer cette séparation, sans troubler l’harmonie des pouvoirs exécutif et administratif. Le lecteur jugera si nous avons réussi à le faire.
Donc, nous tenons pour la centralisation bien entendue, non seulement comme principe d’ordre, mais surtout comme principe de justice. La liberté individuelle est une sainte chose et d’un prix absolu, mais seulement quand elle a pour règle la justice. Autrement la liberté des uns sera la servitude des autres. Or, qui répondra de la justice, dans toute société oh l’État n’aura pas partout l’œil ouvert et la main prête ? Les pouvoirs locaux auront-ils l’œil assez impartial et la main assez forte ? La loi suffit, dira-t-on. Mais d’abord la loi n’agit pas toute seule ; il lui faut une force publique pour se faire respecter. Et puis la loi, même parfaitement respectée, laisse en dehors de son action bien des œuvres d’intérêt public et national, pour lesquelles l’initiative individuelle ou communale n’aurait ni la puissance ni l’équité nécessaire. Tout ce que les amis de la liberté peuvent raisonnablement demander, c’est que l’État fasse son œuvre, sans se mêler du reste. Le champ ouvert à l’initiative des citoyens est bien assez vaste pour suffire à leur activité.
Quant à craindre que la centralisation ne devienne une machine d’oppression entre les mains des pouvoirs despotiques, nous pourrions demander quelle est l’institution que ces pouvoirs ne fassent servir à leur despotisme. La décentralisation administrative est une excellente institution pour la démocratie ; mais il ne faut pas en exagérer la portée, comme garantie des libertés publiques. C’est le caractère seul qui répond sûrement de la liberté des peuples, comme de la dignité des individus. Les garanties politiques et administratives, telles que la division des pouvoirs, la substitution de l’élection à l’hérédité pour les magistratures suprêmes, la suppression des armées permanentes, l’extension du jury, la décentralisation communale et provinciale, etc., etc., sont loin d’être des institutions indifférentes à la conservation de la liberté. Mais il en est d’une société libre comme d’une place de guerre : il ne suffit pas d’en fermer toutes les issues à l’agression de l’ennemi ; le despotisme trouve toujours moyen d’y pénétrer, du moment qu’elle n’est pas gardée par les vertus libérales de ses citoyens. Au contraire, avec une société qui possède cette garde invincible, il n’y a pas de machine d’oppression sérieusement à craindre. En tout cas, ce n’est pas l’État qui pourra être cette machine, dans une véritable démocratie. Très puissant pour le bien, l’État démocratique ne peut sortir de son rôle sans rencontrer d’insurmontables obstacles dans sa propre organisation, ainsi que dans la constitution de la Société qu’il administre.
Ce livre n’attaque aucun pouvoir, puisqu’il ne touche à aucune réalité. Il laisse au temps le soin de faire justice du mal et de l’erreur ; il renvoie à l’histoire et à la morale le jugement sur les choses et les hommes du présent. Quant aux sentiments personnels de l’auteur, ce serait lui faire injure de croire que la préoccupation de l’idéal et de l’avenir puisse le rendre indifférent à la politique de son temps et de son pays. Absolu sur les principes, il comprend, il accepte, dans une certaine mesure, toutes les nécessités pratiques qui en modifient ou en restreignent l’application. Parmi les amis de la démocratie, il est de ceux qui, au sein des plus tristes épreuves, n’ont rien perdu de leur foi à la doctrine, ni de leur confiance en l’avenir. Mais à ceux-là mêmes l’expérience a enseigné la modération, en leur révélant par les faits les moins équivoques la distance qui sépare la réalité de la vérité. Sans en venir jamais à croire que le mieux est l’ennemi du bien, ils se résignent à attendre le règne absolu de la justice, sous tous les régimes transitoires qui respectent la morale, conservent la liberté, et favorisent ou permettent les progrès de la démocratie. Tout en persistant à croire que la liberté, telle que l’entend l’école libérale proprement dite, n’est pas la justice, ils n’oublient pas que cette grande école a fait la Révolution qui doit aboutir au triomphe de leur cause. Bien convaincus que toute guerre à la liberté est une guerre à la vraie démocratie, ils ont appris à ne plus confondre des alliés naturels et nécessaires avec leurs éternels ennemis. Les vrais démocrates et les vrais libéraux sont toujours amis ; et rien n’est plus légitime que leur alliance, puisqu’au fond leur principe est le même, et qu’il n’y a entre eux d’autre question que l’opportunité. Les libéraux prévoyants acceptent la démocratie pour l’avenir ; les démocrates sensés acceptent, comme transition, tout régime libéral qui est de nature à y préparer. Il faut lire l’excellent livre de M. Jules Simon sur la liberté pour voir jusqu’à quel point les deux écoles se touchent . Combien il serait à désirer que toutes les publications de l’école démocratique fussent faites dans le même esprit ! Entre les libéraux et les démocrates, la liberté n’est pas un mot d’ordre inventé par la tactique des partis ; c’est le vrai drapeau de tous les fils de la Révolution.
Il est d’autres amis que nous regretterions également de blesser ; ce sont les croyants restés fidèles à la cause de la liberté et de la démocratie. Nous l’avons dit dans le cours de l’ouvrage, et nulle exception, si admirable qu’elle puisse être, ne nous fera revenir sur une vérité fondée sur la logique et confirmée par l’histoire. Toutes les servitudes se tiennent, aussi bien que toutes les libertés. Il est impossible que la cité soit libre là où la conscience est esclave. Le catholicisme et le despotisme sont frères. Il y a mieux entre eux qu’une alliance officielle cimentée par la politique ; il y a affinité de nature. L’Église catholique a toujours eu l’instinct de cette parenté, et sa politique n’a jamais abandonné ou attaqué que les despotismes assez malavisés pour ne pas comprendre la nécessité de s’unir à elle devant l’ennemi commun, c’est-à-dire l’esprit de liberté. L’Église catholique a raison. Tous les despotes sont ses amis et ses auxiliaires naturels, quels que soient d’ailleurs leur origine, leur moralité personnelle, leur mode de gouvernement. Elle peut bien avoir ses préférences secrètes pour les anciens pouvoirs qui lui ont donné des gages nombreux et décisifs de fidélité. Mais, en attendant, elle s’accommode parfaitement de tout gouvernement qui peut imposer silence à la voix de la raison publique ou privée ; car elle sait que sa liberté à elle, la liberté du bien, comme dit l’un de ses évêques, ne court aucun risque sous un pareil régime.
Il n’en est pas moins vrai que la liberté, et même la démocratie, comptent des adeptes sincères, soit dans la Religion, soit dans l’Église catholique. Comme il y a des libéraux qui vont tout droit à la démocratie par instinct de cœur, sinon par conclusion logique, de même il se rencontre des croyants, sérieux amis de la liberté de conscience, qui se montrent plus indignés que les philosophes des abus et des violences de l’autorité catholique dans le passé, et qui, de la meilleure foi du monde, essayent de réconcilier le catholicisme, soit avec la liberté, soit avec la démocratie. Comment ne pas respecter ces esprits généreux que nulle autorité n’a pu asservir, ces âmes fortes que nulle discipline n’a pu briser ? Comment ne pas aimer ces natures douces et sympathiques, chez lesquelles l’esprit d’intolérance et d’exclusion n’a jamais pu germer ? Enfin, qui peut nier les aspirations démocratiques du beau livre dont ils s’inspirent ? Pour moi, je n’ai jamais lu le Sermon sur la montagne sans avoir peine à me défendre de l’illusion des démocrates qui voient dans le Christianisme la religion de la démocratie. Je ne partage point cette opinion, parce que je pense que la science et la philosophie doivent suffire un jour à l’Humanité. Mais si j’avais la conviction que la démocratie eût essentiellement besoin d’une religion, je ne verrais pas quelle autre pourrait lui mieux convenir que la loi du Christ, écrite dans l’Évangile, enseignée par un Fénelon ou un Channing, pratiquée par un Las Casas ou un Vincent de Paule.
J’en fais l’aveu d’autant plus volontiers que je ne suis pas plus un fils de Voltaire qu’un fils des croisés. Quelle que soit l’intolérance ou la violence de nos adversaires, je veux rester fidèle à mon temps. L’esprit du XIXe siècle est de comprendre et de juger les choses du passé ; son œuvre est d’expliquer ce que le XVIIIe siècle avait mission de nier, et ce que la Révolution achève de détruire, en dépit des réactions et des restaurations éphémères. Il peut être bon, pour en finir plus vite, de faire sentir encore la griffe de Voltaire aux insolents ennemis de la raison et de la liberté. Mais j’ai beau trouver les représailles de nos amis justes et nécessaires ; le sentiment invincible de la vérité me rend rebelle aux exigences de la tactique. Je ne puis reprendre ni les lieux communs du bon sens superficiel, ni les sarcasmes de l’esprit voltairien contre des doctrines dont la profondeur métaphysique et la beauté morale ne sont aujourd’hui un secret que pour la foi aveugle ou l’incrédulité vulgaire. Avant que la philosophie de mes maîtres ne me donnât la chef des hautes vérités que le Christianisme cache sous ses symboles, je le prenais à la lettre. Tant que je suis resté croyant, je n’y ai vu qu’un mystère, respectable pour la foi du chrétien. Quand j’ai cessé de croire, je n’y ai vu qu’une superstition indigne de la raison moderne. Je n’ai senti la beauté et la vérité du Christianisme que le jour où j’ai écarté la lettre pour en saisir l’esprit ; et c’est la philosophie qui m’a valu cette révélation. Ce jour là, ce que j’avais cru naïvement tout d’abord, je l’ai compris, fidèle en cela à la méthode de Malebranche, qui veut qu’on débute par la foi et qu’on finisse par l’intelligence . La philosophie m’a montré dans la métaphysique chrétienne des vérités que la critique du dernier siècle ne m’avait pas même laissé soupçonner. L’histoire m’a fait voir dans l’établissement du Christianisme la plus grande révolution sociale qui ait été accomplie dans le monde. Voilà ce que les déclamations ou les injures des ennemis de la raison ne me feront jamais oublier .
Quant à la démocratie, si elle n’attend son avenir que de la raison et de la science, elle n’en fait pas moins son profit de tous les bons et généreux instincts, quelle qu’en soit la source. Elle accepte pour auxiliaires toutes les doctrines qui élèvent et purifient les âmes ; elle compte tant d’ennemis parmi les mauvaises passions de la nature humaine, et tant d’obstacles parmi les intérêts de la société actuelle, qu’elle est trop heureuse de trou ver le concours de toutes les forces morales de cette société pour l’œuvre laborieuse qui porte son nom. La vertu est trop rare, surtout la difficile vertu de l’abnégation personnelle et du sacrifice, en ce temps d’égoïsme universel, pour que la démocratie lui demande compte de son origine. Sympathique à tout ce qui est bon, juste et vrai, elle aussi peut dire avec le sage de Térence, mais dans un sens plus profond :
Nihil humani a me allenum puto.
Si donc quelques-unes de mes paroles devaient blesser les âmes évangéliques auxquelles une certaine confraternité libérale et démocratique inspirerait le désir de lire ce livre, je m’affligerais d’avoir pu leur donner le change sur la nature de mes sentiments. Je leur suis et je leur resterai uni de cœur, sinon d’esprit, tout en regrettant que les traditions du passé nous séparent encore. Les démocrates catholiques ont fait la triste et récente expérience de l’incompatibilité radicale du catholicisme et de la démocratie. L’épreuve continue ; tout fait espérer qu’elle sera assez décisive pour dissiper ce qui leur reste d’illusions à cet égard. Alors, tous les enfants de la démocratie auront la même foi, le même symbole, les mêmes sympathies et les mêmes espérances.
6 septembre 1859.
E. VACHEROT.
Il en est de la politique comme de l’art, de la morale et de la géométrie : la vérité doit y être sévèrement distinguée de la réalité. La célèbre définition qui réduit la littérature à n’être que l’expression de la société est d’une parfaite justesse, si l’on s’en tient à l’expérience et à l’histoire ; mais, pour être vraie, elle a besoin qu’on ajoute le mot d’expression idéale. La réalité peut bien être la matière de l’art ; c’est l’idéal seul qui en fait la forme ou l’essence. L’art est toujours et partout l’expression du beau, quelque soit le fond d’idées, de sentiments, de passions qui en fasse la substance. De même, quand on dit que le meilleur gouvernement est celui qui est l’expression de la société qu’il régit, la définition est juste, mais empirique. La bonté absolue d’un gouvernement tient à des principes plus élevés que ceux que peut donner l’expérience. Le meilleur gouvernement est celui qui est l’expression la plus complète de la justice. La justice ! voilà la seule vérité en politique, comme le beau est la seule vérité dans l’art, comme l’honnête est la seule vérité en morale. En dehors de cette vérité, il n’y a que la réalité avec ses imperfections, ses misères, ses nécessités, que la politique doit subir, sans jamais les ériger en principe et en droit. La réalité peut bien faire que telle forme imparfaite et même vicieuse de gouvernement convienne mieux ou convienne seule à telle société donnée. Mais placer la perfection et la vérité dans cette simple convenance, c’est rabaisser la science à l’empirisme. La politique, non moins que l’art et la morale, répugne à cette grossière méthode.
Il y a donc une vérité en politique comme dans tout le reste ; il y a un type idéal de perfection, une société, un État, un gouvernement modèle, à la mesure desquels toute société, tout État, tout gouvernement doit être jugé et apprécié. À qui pose cette question : Où est la vérité politique ? on peut hardiment répondre : Dans la démocratie, et la démocratie seule. La démocratie est la seule forme vraie de la politique. Toutes les autres, monarchie pure, monarchie tempérée, aristocratie, n’en sont que des formes réelles, transitoires, comme les nécessités auxquelles elles répondent. Mais la démocratie est un grand mot qui a besoin d’être défini. C’est la vérité politique, vient-on de dire. Mais qu’est-ce que la vérité politique ? On ne risquera guère d’être contredit en répondant que c’est la justice. Définition aussi vague qu’elle est évidente. Qu’est-ce donc que la justice ? Le respect du droit, répondra-t-on d’une voix unanime. Encore une définition qui a besoin d’être définie. Qu’est-ce que le droit ? Ici il n’est plus possible de se payer de mots ; on touche au fond et à la substance même du droit ; on ne peut le définir sans y entrer.
Le droit est chose si simple, si usuelle dans la pratique, que toute définition semble impossible ou inutile. On définit telle espèce de droit, le droit de sûreté personnelle, le droit de parler ou d’écrire, le droit de s’associer, le droit de posséder, le droit de travailler. Quant au droit en soi, n’est-ce pas une pure abstraction, c’est-à-dire un terme commun exprimant la collection de tous les droits spéciaux ? Et en cherchant à le définir, ne s’expose-t-on pas à poursuivre une entité métaphysique analogue aux universaux de la scolastique ? L’école empirique le pense et supprime la question, sans voir qu’elle supprime en même temps le principe du droit. Comme ce principe est supérieur à la politique, il échappe nécessairement à toute méthode qui s’enferme dans la politique. Ici l’erreur est de croire que la politique est une science indépendante et qui se suffise. La politique ne prend pas son principe en elle-même ; elle le reçoit de la morale et de la psychologie. En lui livrant le secret de la nature, de la fin et de la loi de l’homme, ces sciences lui donnent le principe du droit. Et qu’on ne dise pas que la question se complique en passant d’une science spéciale, comme la politique, à une science générale, comme la morale ou la psychologie. En fait de principes, c’est le général, l’abstrait, qui est la source de toute lumière. En traitant de l’homme, abstraction faite de toute complication historique et sociale, la psychologie et la morale simplifient les problèmes de la nature, de la fin et de la loi de l’humanité, exactement de la même façon que la physiologie simplifie la question des organes et des lois de la vie physique, en la dégageant de tous les incidents d’âge, de maladie, de tempérament, de climat. Quand la politique veut remonter jusqu’aux principes, il lui faut recourir aux analyses de la psychologie et aux théories de la morale. C’est là seulement que la définition de la justice trouve sa base et sa formule première.
Or, que dit la morale ? Que l’homme est le seul être capable de devoirs et de droits. Et pourquoi ? Parce qu’il est, au témoignage certain de la conscience, un être doué de raison et de volonté qui a le libre arbitre, une personne, dans le sens strict du mot. Les choses n’ont pas de droits, quelle qu’en soit l’utilité ou la bienfaisante vertu. L’animal lui-même, être sensible et actif, n’a ni devoirs ni droits, parce qu’il n’a ni raison ni libre arbitre. L’homme peut avoir des devoirs, non pas à l’égard, mais à propos des choses et des animaux ; mais ceux-ci n’ont aucun droit vis-à-vis de l’homme. Être raisonnable, l’homme seul comprend le bien ; être libre, il a seul conscience du devoir. Et c’est parce qu’il se sent des devoirs qu’il se sent des droits. Aux uns et aux autres s’attache la même obligation, la même autorité, la même nécessité morale. Par la raison, par la liberté, par le devoir, l’homme est un être sacré pour tout être qui se sent raisonnable, libre et moral. C’est qu’en effet pour l’homme, cesser d’être libre, c’est cesser d’être. Si par la tyrannie, la corruption, l’ignorance, la misère, il était possible d’enlever à l’homme jusqu’au sentiment de sa liberté, que resterait-il de lui, sinon l’animal ? Il aurait donc perdu son être véritable, son humanité. Le plus grand mal qu’on puisse lui faire, c’est de le traiter comme une chose, une machine, un instrument. Cela est contraire à sa nature, à sa dignité, à sa loi alors même que cela est fait dans un but de perfectionnement ou de conservation. L’homme (l’homme moral s’entend) se perfectionne et se sauve lui-même, par la seule vertu du libre arbitre. Individu ou société, tout progrès de l’homme qui n’a pas son principe dans l’énergie personnelle est sans racine et sans prix. C’est le perfectionnement de la machine et de l’animal. L’homme peut accepter, dans cette œuvre, des auxiliaires, mais non des agents qui viennent substituer leur initiative à la sienne. Être libre par essence, c’est sa loi, sa dignité, sa vraie perfection de tout faire librement. Sa nature d’être libre ne le dispense sans doute ni d’éducation, ni de gouvernement ; mais elle ne comporte pas une éducation dont une cause étrangère ferait tous les frais. Il est dans son essence de se gouverner lui-même, sans direction extérieure ; et la meilleure éducation pour lui est celle qu’il opère lui-même avec les lumières d’autrui.
La liberté est donc le vrai, l’unique principe du droit. Tout droit se rapporte à la liberté. Toute justice s’explique et se définit par la liberté. Qu’est-ce que le droit de penser ? La liberté dans son acte le plus intime et le plus profond. Ce droit-là est à l’abri de la force ; mais il peut être atteint par l’ignorance et la superstition. Droit de l’homme, s’il en fût, bien qu’il ne soit inscrit ni dans le code civil, ni dans le code politique, il crée aux familles et à l’État l’impérieux devoir de l’enseignement et de l’éducation. Qu’est-ce que le droit de parler et d’écrire ? La liberté dans sa plus haute manifestation, la liberté de l’esprit, pour lequel toute faculté corporelle, toute propriété matérielle n’est qu’un instrument. On voit déjà combien ce droit est saint, et que le pouvoir qui le viole commet un crime de lèse-humanité plus grave que s’il portait la main sur la propriété. Cela semble un paradoxe dans les idées politiques actuelles, parce que bien peu d’esprits sont habitués à remonter aux principes du droit, et qu’on est généralement enclin à juger de la gravité d’un abus de pouvoir sur la gravité des conséquences matérielles. Et pourtant rien de plus simple, au point de vue de la morale et de la psychologie. Si la sainteté d’un droit se mesure sur la dignité de la faculté à laquelle il correspond, que peut-il y avoir de plus saint que la liberté de la pensée ? Le droit de vivre, le droit d’agir extérieurement, le droit de posséder, également inviolables, bien qu’inférieurs en dignité, n’ont de prix qu’autant qu’ils sont des moyens nécessaires à l’exercice des autres droits. La religion nous dit que, si la vie de l’homme est si précieuse, c’est qu’il a une âme à sauver. Profonde vérité qui devient manifeste sous une forme plus rationnelle. Ce qui fait le prix de la vie, de l’activité, de la propriété humaine, c’est que l’homme est une personne. Tout cela dès lors participe, comme moyen, de la sainteté de l’être libre, de l’esprit qui en est la fin. Si l’homme n’était qu’une force de la Nature, à l’instar des autres êtres, toute force supérieure aurait prise sur sa vie, ses actes, sa propriété, sans qu’aucun droit pût l’arrêter.
Tous les droits de l’homme, droits civils et politiques, peuvent donc se résumer dans un seul mot : liberté. Ce mot est la formule la plus simple et la plus complète tout à la fois de la démocratie. Plus on la creuse, plus on la trouve riche et profonde. Justice, égalité, fraternité, progrès, civilisation, socialisme bien entendu, il n’est rien qu’elle ne comprenne. Tous ces principes et tous ces sentiments reçoivent de la liberté leur vraie signification et leur véritable autorité. Une courte analyse suffira pour le démontrer.
Justice est un terme plus général et plus complexe que liberté, et qui semble plus propre à définir la démocratie. Il comprend toute espèce de droits, ceux qui naissent de l’égalité comme ceux qui naissent de la liberté. Mais c’est un mot vague qui n’apprend rien à l’esprit sur l’objet et le principe du droit. Rien de plus exact que de définir la démocratie le règne de la justice. Mais qu’est-ce que la justice ? Est-ce une loi extérieure ou intérieure de l’humanité ? A-t-elle sa racine dans la nature humaine, dont elle ne serait que l’expression ? Ou bien est-ce une autorité qui s’impose d’en haut à la conscience ? C’est ce que le mot ne dit point. Il exprime le caractère obligatoire de la loi morale, sans en révéler l’objet ; pour parler le langage de Kant, il en donne la forme, et non la matière. C’est donc une définition stérile de la démocratie.
Égalité est un terme plus précis que justice, et qui au premier abord semble mieux convenir que le mot de liberté à la définition même de la démocratie. Il ne paraît pas que toute société libre soit nécessairement démocratique. La liberté ne s’accommode-t-elle pas fort bien de l’aristocratie ? Et l’histoire ne montre-t-elle pas qu’égalité et servitude vont parfaitement ensemble ? Mais en réfléchissant, on voit combien il est dangereux de définir la démocratie par l’égalité. C’est qu’en effet la liberté lui devient alors étrangère, à ce point que l’égalité sous la servitude ne serait pas moins la démocratie que l’égalité sous la liberté ! Honteuse définition, et très commode pour les amis du despotisme ! Si elle était vraie, il faudrait avouer que jamais plus beau nom n’a couvert plus misérable chose. Quelle école politique, ayant le sentiment de la dignité humaine, accepterait la démocratie à ce prix ? La seule étymologie du mot proteste contre une pareille interprétation. Démocratie, en bon langage, a toujours signifié le peuple se gouvernant lui-même ; c’est l’égalité dans la liberté. L’égalité dans la servitude s’est toujours appelée tyrannie. Le mot égalité est donc une triste formule démocratique, du moment qu’on le sépare du mot liberté. Toute institution de ce nom où la liberté individuelle ne conserve pas tous ses droits doit être renvoyée à l’école du césarisme.
Il y a plus. Que l’égalité soit une condition essentielle de la démocratie, nul n’en doute ; mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elle n’est qu’une conséquence rigoureuse de la liberté. Qu’est-ce en effet que l’égalité, sinon la liberté égale pour tous ? L’égalité, comme telle, n’est ni la justice ni la démocratie. Le mot n’a de sens positif que par la chose à laquelle on l’applique. Rien de plus injuste et de plus antidémocratique que l’égalité dans la servitude. L’égalité ne devient la formule de la justice et de la démocratie qu’autant qu’elle est l’attribut de la liberté. C’est donc par la liberté elle-même que se définit l’égalité. La vraie démocratie est le régime politique où la liberté complète, liberté civile et politique, est le droit commun. En ce sens, il est vrai de dire que c’est le seul gouvernement libre, dans le sens absolu du mot. Si l’histoire semble démentir cet axiome, la contradiction n’est qu’apparente. L’Angleterre est considérée à juste titre comme le pays classique de la liberté. Rien de plus vrai, si l’on compare cette société à d’autres dont la prétendue démocratie n’est que l’égalité dans la servitude, et surtout si l’on n’envisage que certaines libertés, mieux assurées dans cette société aristocratique que partout ailleurs. Mais le droit n’y est pas égal pour tous. Dans le droit politique, dans le droit civil, le privilège est partout, privilège de fortune, privilège de naissance, privilège de localité. Une minorité a le monopole de l’élection des pouvoirs politiques ; une minorité plus restreinte a la bénéfice exclusif des emplois. Or ces privilèges qui, dans un état social donné, peuvent servir de garanties à certaines libertés, n’en sont pas moins en eux-mêmes contraires au principe général de la liberté, dont ils restreignent l’application. Un droit de moins, n’est-ce pas une liberté de moins ? Si fier qu’il soit de sa liberté, le peuple anglais n’est donc pas encore un peuple libre dans le sens complet du mot, et il ne le sera pas tant que les privilèges aristocratiques subsisteront. Il n’y a de société parfaitement libre que dans la justice et l’égalité. C’est dire qu’il n’y a de liberté complète que dans la démocratie, et qu’à la rigueur ces deux mots peuvent être pris l’un pour l’autre. Donc le vrai principe de la démocratie est la liberté. Ce principe donné, l’égalité en sort comme tout le reste. Or, en bonne logique, c’est le principe et non la conséquence qui doit être la formule de définition.
La fraternité pourrait-elle être cette formule ? Moins encore. La liberté et l’égalité sont des principes, tandis que la fraternité n’est qu’un sentiment. Or tout sentiment, si puissant, si profond, si général qu’il soit, n’est pas un droit ; et il est impossible d’en faire la base de la justice. Les politiques qui essaient de l’ériger en principe commettent la même erreur que les moralistes qui fondent la loi morale sur l’amour. Que la politique et la morale aient besoin de ces sentiments ; que l’amour et la fraternité soient d’admirables auxiliaires du devoir et de la justice, nul ne songe à le nier. Les principes ne sont que la lumière de la politique et de la morale. Ces sentiments en sont comme les forces vives. Mais il ne faut pas leur demander la règle des mœurs et de la justice. Où conduit la morale de l’amour ? À une charité aveugle qui foule aux pieds la justice. Où peut mener la politique de la fraternité ? Au mépris de la liberté et de la dignité humaines. Un écrivain de la démocratie a signalé avec sa violente énergie le vice d’une pareille doctrine, en représentant les membres de la société communiste attachés, côte à côte, sur le rocherde la fraternité . Assurément l’association est un principe vrai et fécond. En elle est le salut de la démocratie ; in hoc signo vincet. Mais à quelle condition ? C’est que si la fraternité est l’âme de l’association, la justice en soit la loi. Autrement c’en serait fait de la liberté. La fraternité aboutirait au régime du couvent, comme la paternité, en fait de gouvernement, aboutit au despotisme patriarcal. Ne s’est-il pas rencontré une école, fort généreuse dans ses intentions, et véritablement enflammée de l’amour de l’humanité, qui a été ainsi conduite à la négation de la liberté et même de la loi morale ? Elle a tristement fini en une contrefaçon de théocratie ; et après sa chute, elle a préparé des auxiliaires et des complaisants au pouvoir absolu. Tout socialisme, s’il n’était relevé par le sentiment de la liberté, et épuré par la notion du droit, tomberait infailliblement dans cette espèce de démocratie qui fait bon marché de la personne humaine. La fraternité toute seule est donc une dangereuse formule pour la démocratie.





























