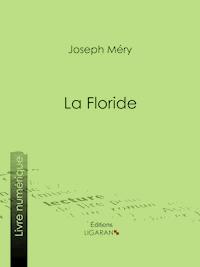
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les plus tragiques scènes de notre monde se passent sur l'Océan ; mais elles n'ont d'autres témoins que le soleil, ou les astres de la nuit, ou les oiseaux voyageurs. Quand le Malabar, vaisseau de la Compagnie hollandaise, s'abîma dans le gouffre de la mer Indienne, nul regard humain ne vit cette scène de désolation ; les passagers et l'équipage s'étaient jetés à la mer ; le capitaine seul ne voulut pas quitter son pavillon..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les meilleurs cours de littérature sont aujourd’hui professés dans les chambres des paquebots à vapeur.
Aussi les voyages sont-ils aujourd’hui plus instructifs que jamais.
Ce genre d’éducation manquait à nos pères : on apprend tout ce qu’on ignore en voyageant sur la Saône, sur le Rhône, sur le Rhin, ou sur la mer.
Je venais de quitter Paris, selon mon usage, et je courais en vapeur vers la Méditerranée. Nous étions cinquante, assis, couchés ou debout dans l’entre-pont d’un paquebot. Un monsieur grave prenait du café, en lisant un journal, et il souriait beaucoup.
« Il lit le roman de… dit un jeune homme en blouse ; je suis en arrière de deux feuilletons.
– Moi, je suis abonné, dit un ami : je recevrai ma collection poste restante à Valence.
– Je lis ce roman avec beaucoup d’intérêt, dit une dame voilée de vert, parce qu’il est écrit dans le genre que j’aime.
– Vous êtes tout à fait dans mes opinions, dit un voyageur maigre et chauve ; moi, madame, je n’aime que les romans d’intérieur domestique, ceux qui peignent avec vérité la vie réelle, qui nous offrent un miroir fidèle, et nous corrigent de nos vices et de nos défauts en nous les représentant d’après nature. Je suis fâché que la Bruyère n’ait pas fait un roman. »
Un jeune homme, coiffé à la Grioto, et qui allait en Chine un bâton à la main, prit la parole d’un ton leste et dit :
« Moi, je ne comprends pas trop le plaisir que vous trouvez à lire dans des livres ce que vous faites chez vous. Les Chinois ont bien plus de bon sens dans leur folie. Ils ne peignent, ne gravent, ne sculptent, n’écrivent que leurs rêves, leurs fantaisies, leurs caprices d’imagination. Tout ce qui se passe bourgeoisement autour d’eux leur paraît vulgaire et indigne d’être présenté à l’œil. Vous autres Français, vous voulez voir sur vos livres de boudoir, sur vos paravents d’alcôve, sur vos écrans de cheminée les mêmes choses que vous faites avec votre ridicule costume européen. Vous demandez à vos faiseurs de tapisseries une scène de nourrice, une noce de village, un départ de conscrits pour l’armée, un ménage de nouveaux mariés, un père maudissant un fils, une demoiselle qui touche du piano devant ses parents, un propriétaire qui met son locataire insolvable à la porte de sa maison. De cette manière, vous avez l’agrément de pouvoir répéter dans le salon vos histoires de tapisseries. Quant à moi, en passant à Lyon, où je m’arrête cinq jours, je vais commander à un fabricant quatre panneaux de papiers représentant quatre scènes qui se passent dans la planète de Saturne. Eugène Delacroix m’en a fait les dessins à Paris. À Péking, je vendrai cela un prix fou.
– Mais, monsieur, observa un voyageur sérieux et enrhumé, savez-vous ce qui se passe dans la planète de Saturne ?
– Si je le savais, je ne le ferais pas peindre, répondit le Chinois : cela rentrerait alors dans la vie bourgeoise et réelle des gens de Saturne.
– Ah ! dit le voyageur sérieux ; et il toussa beaucoup.
– Les jeunes gens ont des idées de jeunes gens, remarqua un monsieur presque endormi sur la pomme d’un jonc ; moi, ce que je cherche dans un roman, c’est un fait, un grand fait historique, une chose enfin qui m’instruise en m’amusant, comme dit Boileau ; car, soyons de bonne foi, quel fruit retirez-vous de la lecture d’une œuvre de pure imagination, d’un long mensonge, tranchons le mot ?
– Parbleu ! cela nous amuse ; voilà le fruit, dit le Chinois.
– Oui, dit le monsieur somnolent ; mais cela ne vous instruit pas. Moi, monsieur, j’ai appris l’histoire d’Écosse dans Walter Scott.
– Moi aussi, dit la dame voilée de vert.
– Moi aussi, dit son mari.
– Vous voyez, ajouta l’autre, que tout le monde ici est de mon avis, monsieur.
– Ah ! vous croyez aux histoires d’Écosse de Walter Scott ? dit un Parisien qui entrait en éteignant son cigare. Vous saurez, mesdames, qu’il pleut sur le pont… les histoires d’Écosse sont des fables en brouillards comme toutes les autres histoires d’ailleurs ; à qui dites-vous cela ? Moi, monsieur, j’ai vu à Paris trois histoires et deux révolutions passer sous mes croisées, et je les ai rencontrées dans la rue, comme je vous rencontre ici. Depuis, j’ai lu vingt ouvrages sur ces évènements. Chaque ouvrage contredit les dix-neuf autres, et tous contredisent ce que j’ai vu de mes propres yeux ; et vous voulez, après cela, que j’ajoute foi aux choses qui se sont passées dans les brouillards, les cavernes et les neiges d’Écosse il y a trois cents ans ! Allons donc ! »
Le monsieur sérieux agita le bras droit, mais la parole lui fut supprimée par une quinte de toux.
Une dame d’un âge mur, qui donnait à boire dans son verre à un épagneul, prit la parole et dit : « Moi, je n’aime que les romans par lettres, comme ceux de M. Montjoie.
– Nous ne connaissons pas M. Montjoie, remarquèrent en trio trois jeunes gens.
– Mais quel âge ont ces messieurs ? demanda la dame de l’épagneul.
– Trente ans, comme tout le monde, répondit un des trois.
– M. de Montjoie, poursuivit la dame, écrivait en mille… mille… huit cent… et quelque chose… Il a fait les Quatre Espagnols, le Manuscrit du mont Pausilippe, etc., etc., toujours sous la forme épistolaire. J’ai lu cela au sortir du couvent.
– Il me faut à moi les grosses plaisanteries, dit un énorme voyageur qui s’ennuyait de se taire ; les farces, quoi ! un tas de gaudrioles à mourir de rire le dimanche quand il pleut. Tenez, voulez-vous savoir mon roman que j’aime, moi ? c’est celui de… aidez-moi un peu… j’ai le nom au bout de la langue… un farceur… Ce livre, où il y a un homme bête comme une oie, qui a une femme gentillette et il y a un autre jeune cadet, nommé… chose je suis brouillé avec les noms !… J’ai acheté ce livre en arrivant de l’armée, et puis je l’ai donné à mon cousin, qui est veuf et qui n’a pas d’enfants.
– D’où vient que l’on ne fait plus aujourd’hui des romans avec des chevaliers ? demanda naïvement une dame qui allait joindre son mari à Alger.
– Des chevaliers de quoi ? répliqua un jeune évaporé, qui jouait avec ses cheveux.
– Des chevaliers qui se battaient dans les tournois et qui allaient en Palestine.
– Bah ! ce sont des romans de servantes de curés, ça ! dit le même.
– J’ai un cousin qui fait des romans, dit une dame mystérieuse ; vous devez le connaître, messieurs, mais je ne dis pas son nom. Il rédige beaucoup dans les gazettes. C’est plus fort que lui, il ne peut écrire que des choses tristes comme une robe de deuil ; je lui dis quelquefois : Alfred, mon ami (je l’ai vu enfant), il ne faut pas toujours broyer du noir comme cela ; on dirait que tu es employé aux pompes funèbres… Ça le fait rire aux larmes… Eh bien ! c’est son naturel. Il est gai avec ses camarades, et dès qu’il prend la plume, il vous oblige à pleurer.
– Voilà un genre que je déteste, moi, dit un jeune farceur qui voyageait pour les garances. Nous, par exemple, dans notre état, nous avons toujours la gaudriole à la bouche. Il faut causer beaucoup avec les correspondants. On est invité à dîner : on trouve des dames, des demoiselles qui vous demandent : Avez-vous lu le roman de M. tel ? Que diable ! si ce roman est noir comme un four, on ne peut pas rire au dessert. Nous voulons des historiettes galantes, des amourettes, des bêtises. L’autre jour, à Lyon, j’ai fait une affaire de vingt-sept mille francs, escompte deux, en disant cette drôle d’aventure de ce monsieur qui était dans les journaux avec la femme d’un autre ; et lorsque le mari entra, il sauta dans le jardin, et resta pendu par son habit à la grille en fer.
– Ce n’est pourtant pas ce que veut l’époque, dit un professeur de philosophie en vacances : l’époque est sérieuse. On accepte le roman comme distraction, comme amusement, comme on écoute l’air d’un orgue de Savoyard dans la rue. Il y a beaucoup de gens frivoles qui cherchent, disent-ils, à tuer le temps. Mais pour la majorité des travailleurs, des penseurs, des moralistes, des industriels, le temps n’est pas une chose qu’on tue ; c’est une chose qu’on emploie. Quant à moi, je donnerais tous les romans du monde pour une page de Banks, de Slouds, de Kramm ou de Strauss.
– Ce monsieur parle très bien, dit un large visage coloré couvert d’un bonnet de soie noire.
– Qu’est-ce qu’un roman ? poursuivit le professeur. (On fit cercle autour de lui.) Un roman est un long mensonge. Quel effet moral produit le mensonge ? Il déprave : voilà le roman jugé en deux mots. Vous lisez une aventure romanesque ; vous vous intéressez à des malheurs imaginaires ; vous dépensez un trésor de sensibilité, au profit de qui ? au profit de qui, je vous le demande ?… au profit de l’insensibilité ; c’est-à-dire que lorsque vous rencontrerez à côté de vous, le lendemain, des malheurs réels, des infortunes véritables, vous ne leur donnerez ni larmes, ni intérêt, ni assistance, ni secours : votre fonds sera épuisé.
– Il a raison, dit la dame mystérieuse.
– Certainement, dit le voyageur chinois ; si monsieur parle toujours, il aura raison.
– Permis à vous, monsieur, de me réfuter, dit le professeur avec un regard oblique et un sourire sacerdotal.
– Allons donc, monsieur, dit le Chinois, est-ce que l’on réfute quelque chose aujourd’hui ! Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Il y a des modes ou des goûts qui existent, et que rien au monde ne peut empêcher d’exister.
– Tant pis ! dit le professeur.
– Vous dites tant pis ! autour de vous un million d’hommes et de femmes dit : tant mieux.
– Oui, monsieur ; mais en morale, les opinions ne se comptent pas, elles se pèsent. Vous avez beau dire, vous ne changerez pas la nature de l’époque : notre siècle est sérieux.
– Oui, il est sérieux ! s’écria le Chinois en s’échauffant ; il est sérieux le siècle, parce qu’il n’a pas voulu rire à la lecture de Clara ou l’Héroïne de Bougival. »
Le professeur pâlit.
« C’est un roman de monsieur, continua le Chinois. Voilà mon ami Clémenson, voyageur en librairie, qui vient de me souffler cela à l’oreille.
– Alors, dit le professeur, si notre discussion dégénère en personnalités, je me retire
– Il n’y a pas de personnalités, monsieur. Êtes-vous ou n’êtes-vous pas l’auteur de l’Héroïne de Bougival ?
– Et quand cela serait, monsieur ?
– Cela est.
– Chacun de nous n’a-t-il pas quelques petites erreurs de jeunesse à expier ? dit le professeur d’un air contrit. À vingt ans, on s’essaye, on s’interroge, on se tâte, avant de choisir irrévocablement sa vocation.
– Vous avez fait Clara ou l’Héroïne de Bougival… Ah !
– Mon Dieu ! comme vous faites sonner haut cette vétille !
– L’époque était sérieuse quand vous avez publié l’Héroïne de Bougival. C’est en 1841. Vous aviez trente ans ; vous aviez lu Banks, Kramm et Strauss.
– C’est possible, c’est possible, monsieur.
– Voici l’analyse de Clara ou l’Héroïne de Bougival.
– La plaisanterie traîne un peu en longueur, ce me semble, dit le professeur avec un rire d’écolier.
– Clara, poursuivit le voyageur, est une jeune, leste et fringante villageoise qui désole Bougival de ses coquetteries. Clara met Bougival en état de siège. Le maire, le juge de paix, le capitaine de la garde nationale ont échappé seuls à l’ascendant de Clara, et ils tendent des pièges à l’héroïne pour la forcer à déserter Bougival. Clara tient bon : elle a deux cents amoureux qui ont juré de s’ensevelir sous les ruines de Bougival avant de perdre leur trésor. De là une foule d’aventures plus ou moins scabreuses. Clara est couronnée comme rosière au dénouement, et elle ne se marie pas. Ma pudeur m’empêche d’entrer dans les détails de ce roman, destiné au plus sérieux de tous les siècles. Voilà, messieurs. »
Au milieu de cette analyse, le professeur était monté sur le pont du paquebot.
La question des romans ayant été épuisée, on mit l’entretien sur la hausse des actions du chemin de fer d’Orléans.
Les dames s’endormirent, et je me plongeai dans de sérieuses réflexions.
En quittant Paris, j’avais promis à mon ami Dujarrier de lui faire un roman.
Quel roman écrirai-je ? Telle était la question que je m’adressais sur le paquebot dans mes entretiens avec moi-même. Vous figurez-vous l’intérêt que je dus porter à la discussion de cette société voyageuse ? J’écoutais chaque interlocuteur avec une avidité bien naturelle. C’était pour moi comme un public en miniature, m’éclairant de ses conseils.
Je trouvai cinq plans en germe et plusieurs sujets.
Je penchais, tantôt pour le roman avec des chevaliers, avec une action en Palestine ou en Bretagne, que j’aurais appelée Armorique ; tantôt pour le roman par lettres, comme ceux de Montjoie ; tantôt pour le roman individuel avec un héros lamentable, accusant le destin, et se plaignant de l’ingratitude de tous les hommes et d’une femme ; tantôt pour le roman bourgeois avec des messieurs habillés comme nous, parlant, agissant et se mariant comme tout le monde, entre Chaillot et Bercy.
J’étais fort perplexe ; je n’arrêtais rien ; je ne décidais rien ; un instant je fus sur le point de conclure quelque chose avec les chevaliers ; mais la gloire de Mme Cottin m’épouvanta.
Comment surpasser ou égaler les trente-cinq éditions de Malek-Adhel ?
Je m’adressai au jeune voyageur qui allait en Chine, et je lui dis :
« Pardon, monsieur ; si un ami vous priait de lui faire un roman, quel roman lui feriez-vous ? Excusez-moi si je vous interroge ainsi sans préface ; mais vous me paraissez un homme de goût, et je suivrais volontiers un de vos conseils.
– Monsieur, me dit-il, je vais en Chine tout exprès pour faire un roman chinois. La vie réelle que nous menons en Europe n’est pas amusante, il faut en convenir, et je ne vois pas ce qui peut m’obliger d’écrire pour les autres ce qui ne m’amuse pas moi-même. Il me serait impossible, d’ailleurs, de faire la peinture des cœurs humains qui barbotent dans la boue de nos villes du Nord, avec des socques et des parapluies. Ces cœurs-là se feront peindre par d’autres si bon leur semble, je ne m’en mêlerai pas. Monsieur, ces réflexions peuvent vous servir de conseil.
– Je vous remercie, monsieur. Vos idées sont à peu près les miennes : on se sent bien fort quand on est deux à penser la même chose. Pourtant, je dois vous avouer que mon goût de lecteur s’attache quelquefois avec fureur à des romans de vie intime ou à des actions contemporaines, dont nos cités les plus brumeuses sont le théâtre, et qui sont racontées avec un charme, inouï jusqu’à nos jours, par les puissants esprits de notre siècle. Depuis quinze ans, nous avons vingt admirables livres de ce genre, signés de noms divers ; et il ne manque à ces livres que d’être allemands ou anglais, pour être proclamés chefs-d’œuvre à la face de l’univers.
– Cela est vrai, monsieur, et je comprends que votre goût comme lecteur ne s’accorde pas avec votre goût d’écrivain.
– Vous le comprendrez encore mieux, lui dis-je, lorsque je vous aurai donné une petite explication. Entre autres défauts dont la nature m’a doué, je suis très paresseux, et je crains beaucoup le froid. Lorsqu’on me fait l’honneur de me demander un roman, ma première idée est de choisir un pays chaud, pour y établir ma famille et y vivre au soleil ou à l’ombre tiède, avec mes femmes et mes enfants, imaginaires, bien entendu.
Après mon premier chapitre écrit, je suis dupe de mon illusion, et mon domicile est bien clairement établi pour moi entre les deux tropiques ou sous l’équateur, au point que j’oublie souvent de faire du feu en janvier, lorsque j’écris à chaque page les mots de bananiers, d’acacias, de cactus, de nopals, d’aloès, de tigres, d’éléphants, de lions.
C’est aussi une économie de flanelle et de bois. Un travail de ce genre triomphe encore de ma paresse constitutionnelle, parce qu’il m’amuse. J’écris en égoïste. Je mets en jeu mes héros de prédilection ; les grands animaux surtout, mêlés aux grands paysages. En Europe, nous avons pour auxiliaires de romans, parmi les quadrupèdes, les chevaux et les chiens ; ils ont leur mérite, cela est incontestable ; mais ils sont un peu usés. Les bêtes fauves de l’Afrique et de l’Asie me semblent nées d’hier.
L’histoire naturelle, avec sa gravité scientifique, ne les fait pas vivre, elle les empaille. J’ai donc essayé de leur donner un rôle actif et intelligent, par l’observation exacte de leurs instincts et de leurs facultés. Ceux qui, à force d’étudier les hommes, ont négligé les animaux, m’accuseront peut-être d’exagérer l’intelligence des bêtes, si je prête à des éléphants, par exemple, des combinaisons de vengeance opérées dans leur vaste cerveau avec toute la subtilité du raisonnement humain.
En m’adressant un pareil reproche, on oublierait la plus populaire des histoires, une histoire racontée dans tous les livres, et qui est vraie, quoiqu’elle soit une histoire.
Il s’agit d’un éléphant que son cornac conduisait à l’abreuvoir chaque matin.
Dans la rue où passait l’animal, il y avait un savetier qui trouvait plaisant de le piquer avec son aiguille de travail ; l’éléphant supporta quelque temps avec patience cette méchanceté indigne, mais enfin, poussé à bout, il garda un jour dans l’immense réservoir de sa bouche un immense volume d’eau, et il noya le savetier.
Personne n’a jamais révoqué en doute ce trait d’intelligence fourni par un éléphant domestique, c’est-à-dire dégradé : que ne doit-on pas attendre d’un éléphant au désert, lorsqu’il n’a rien perdu des merveilleuses facultés de sa nature ! Ainsi, monsieur, en associant à des héros de roman les grands quadrupèdes de la création, en les encadrant de puissante verdure et d’horizons lumineux, je me sens la force de pouvoir conduire deux volumes jusqu’au bout, même en hiver, et l’année, hélas ! n’est qu’un hiver déguisé en quatre saisons ! Voilà pourquoi, monsieur, il me sera facile de suivre votre conseil.
– C’est ce qui peut m’arriver de plus heureux, monsieur, me dit le voyageur en souriant ; j’aime toujours à donner à mes amis les conseils qu’ils se sont toujours donnés eux-mêmes : ceux-là sont toujours suivis. »
Je demandai une plume et du papier au garçon de chambre du paquebot, et j’écrivis ces pages, qui devaient un jour servir de préface à la Floride, roman que j’allais composer au centre de l’Afrique, département des Bouches-du-Rhône, sur le bord de la mer où s’élève le château d’If.
Les plus tragiques scènes de notre monde se passent sur l’Océan ; mais elles n’ont d’autres témoins que le soleil, ou les astres de la nuit, ou les oiseaux voyageurs.
Quand le Malabar, vaisseau de la Compagnie hollandaise, s’abîma dans le gouffre de la mer Indienne, nul regard humain ne vit cette scène de désolation ; les passagers et l’équipage s’étaient jetés à la mer ; le capitaine seul ne voulut pas quitter son pavillon ; il fut dévoré par l’incendie, et la mort le trouva courbé sur la carte marine, le doigt fixé sur le dixième degré de latitude, vers l’île de Socotora.
La mer était fort agitée, le vent soufflait avec violence ; aussi, les passagers et les hommes de l’équipage, qui avaient confié leur salut à la chaloupe ou à de petits radeaux improvisés, furent presque tous submergés à peu de distance du navire incendié.
Un seul radeau, défendu par sa solidité, ou, pour mieux dire, par la Providence, résista aux vagues jusqu’au coucher du soleil : après un terrible et dernier coup de vent, l’air reprit sa sérénité ; l’ouragan parut s’ensevelir dans les nuages pourpres de l’horizon, comme un ouvrier qui a fini son travail et s’endort.
Trois êtres vivants, les seuls échappés à l’incendie et au naufrage, sentirent renaître en eux quelque espoir, quand les derniers rayons du soleil s’allongèrent sur une mer calme. Leur radeau, favorisé dans ce désastre, pouvait alors suivre une direction à l’aide de quelques pièces de bois posées en manière de rames et de gouvernail.
Des trois passagers réfugiés sur cette planche, deux pouvaient la conduire au hasard, avec la boussole de la Providence, car aucune ombre de terre ne se montrait à l’horizon : le troisième était une jeune femme qui paraissait abattue par la souffrance plutôt que par l’effroi. La figure des deux hommes exprimait cette calme énergie qui sait se résigner à la mort en luttant contre elle ; ils étaient dans une de ces crises où l’action remplace la parole, où les coups de rame sont plus éloquents que les meilleurs discours. Ainsi la révolte désespérée de ces malheureux contre la mer s’accomplissait avec un morne silence. Autour d’eux s’étendait la plus désolante des solitudes, celle de l’Océan, cercle infini dont leur radeau était le centre. Le dernier rayon de soleil embrassa la mer, puis la surface de ce désert prit subitement une teinte opale, qu’elle ne garda pas ; le rapide crépuscule des régions équinoxiales permit aux passagers de jeter un coup d’œil circulaire vers des rivages invisibles ; et la nuit tomba lourdement avec ses embûches et ses terreurs.
Les deux hommes continuèrent leurs fonctions de rameurs avec une adresse de métier qui annonçait chez eux l’expérience de la mer.
Leurs regards interrogeaient fréquemment la boussole céleste de la croix du Sud ; et l’éclair de l’espérance ranima leurs forces épuisées, lorsqu’ils s’aperçurent qu’un favorable courant, bien plus rapide que l’action des rames, les emportait vers les côtes d’Afrique. La jeune femme, étendue sur un lit de toiles goudronnées, dormait de ce lourd sommeil que donnent la fatigue, la douleur et le désespoir.
Si quelque observateur intelligent avait vu le maintien des deux naufragés dans cette crise, et surtout s’il avait entendu les premières paroles qui s’échappèrent de leur bouche après dix heures de silence, il aurait reconnu dans ces deux êtres des caractères peu communs et bien faits pour s’associer dans les hasards d’une vie pleine de périls.
Des deux acteurs de cette scène maritime, dont l’un était un jeune homme de vingt-six ans, et l’autre un homme de trente-sept, ce fut le dernier qui rompit le silence.
« Nous faisons là un rude métier, mon cher Lorédan, dit-il en laissant tomber la poignée d’une rame sur le bord du radeau ; je ne sais pas si la vie vaut la peine qu’on la défende à ce prix.
– Nous avons à défendre la vie de cette jeune femme, sir Edward.
– Oui, c’est justement ce que je pensais aussi.
– Sir Edward, vous êtes trop généreux pour ne faire que la moitié d’une bonne action. Vous avez déjà retiré cette belle enfant du fond de la mer ; vous achèverez votre ouvrage maintenant.
– Certes, je ne demande pas mieux : en la sauvant, nous nous sauvons ; il y a souvent beaucoup d’égoïsme dans les bonnes actions des hommes. Ne me faites pas plus vertueux que je ne suis.
– Parlons bien bas pour ne pas la réveiller…
– Elle dort avec une confiance en nous qui mérite d’être justifiée… Lorédan, vous avez l’œil et l’odorat subtils ; ne flairez-vous pas l’Afrique à l’ouest ? Je vois que vos narines interrogent le vent.
– Oui, oui il y a des parfums de terre dans l’air… Bon courage, sir Edward ; la côte n’est pas loin.
– Et quelle côte, mon jeune ami ?
– Que nous importe ! pourvu que ce soit une côte.
– Vous avez raison ; au moins, nous ne ramerons plus. C’est que je ne connais pas du tout le pays ; si nous étions au Bengale, je ne ferais pas erreur d’un demi-degré ; mais ce quartier du globe m’est complètement inconnu.
– Ou je me trompe fort, sir Edward, ou nous ne sommes pas loin des atterrages d’Agoa.
– D’Agoa ! d’Agoa !… un nom nouveau pour moi… je suis vraiment honteux d’habiter depuis trente-sept ans une ville aussi petite que la terre, et de ne pas connaître la rue d’Agoa et vous êtes, sans doute, en pays de connaissance à Agoa, vous, Lorédan ?
– Moi, je n’y connais pas un brin d’herbe, pas une goutte d’eau ! C’est un nom que j’ai remarqué sur la carte, hier, quand je suivais le doigt de notre pauvre capitaine, et les pointes de son compas.
– Ah ! voilà tout ce que vous savez sur ce pays ? »
Sir Edward regarda les étoiles, et continua de ramer. Rien en lui ne trahissait la moindre émotion ; si à son prénom nous ajoutons son nom de famille, Klerbs, nous aurons désigné un voyageur intrépide connu déjà de quelques-uns de nos lecteurs, et qui a laissé dans l’Inde de fort honorables souvenirs.
Le passage subit de la nuit au jour, phénomène des régions équinoxiales, découvrit aux yeux de nos deux naufragés une terre très voisine ; c’était en effet la vaste baie d’Agoa.
Nos deux voyageurs, en voyant cet abri secourable, ne manifestèrent leur joie par aucune exclamation frénétique usitée en pareille circonstance. On aurait dit qu’ils regardaient leur salut comme chose inévitable, ou comme une dette que la Providence acquittait envers eux. Il est vrai que les âmes fortement trempées gardent leurs secrets de joie ou de tristesse, et n’en laissent rien jaillir sur le front.
Le courant poussait le radeau vers la baie, comme une main providentielle et invisible. À mesure que la côte s’élevait sur la mer, elle se parait d’une verdure charmante, et réjouissait les yeux des naufragés, en leur promettant tous les trésors que les ombrages donnent, les eaux douces et les fruits doux.
La baie d’Agoa, tranquille comme un lac indien, semblait ouvrir ses bras circulaires pour accueillir les naufragés, comme une mère assise au rivage, qui appelle ses enfants.
L’éclat du matin était si doux sur les eaux calmes de la baie, les grands palmiers s’inclinaient avec tant de grâce sur les deux rives, les oiseaux chantaient si joyeusement sous les feuilles, que les deux naufragés ne conçurent aucun souci en voyant se dérouler devant eux une terre déserte. Il était impossible que cette charmante nature les accueillit si bien pour les étouffer ; un mauvais soupçon eût été une offense contre le golfe de fleurs qui les sauvait des eaux. Nos deux voyageurs s’abandonnèrent donc à tous leurs élans de joie intérieure et le radeau s’arrêta devant un quai naturel pavé de velours et ombragé de palmiers.
La jeune femme dormait toujours sur son lit de naufrage, et ses compagnons n’osèrent pas la réveiller, afin de la laisser savourer jusqu’à la dernière goutte ce suprême remède que la nature a infusé dans le sommeil, et qui guérit les maux du corps et de l’âme. Ils lièrent le radeau à la racine saillante d’un arbre, et lui donnèrent une alcôve charmante avec ses rideaux mobiles chargés d’oiseaux vivants et de fleurs. Les deux gardiens de ce sommeil, debout sur la rive, tenaient leurs yeux fixés sur la plus ravissante jeune fille qui se soit jamais endormie dans un bois de palmiers, au chant des oiseaux et des fontaines. Ce tableau appartenait à une nature primitive ; il rappelait une scène des anciens jours de la création, lorsque les familles errantes n’habitaient que les eaux ou les bois, à la clarté des étoiles et du soleil.
Rien dans le costume des trois naufragés n’annonçait des habitants de notre monde d’aujourd’hui ; la mer avait dévasté les vêtements de ces voyageurs, comme aurait fait un pirate. La chevelure noire de la jeune fille, pétrie par les vagues, s’élargissait sous sa tête comme un chevet d’ébène, et faisait ressortir la blancheur du front et l’incarnat des joues ; le corps était comme enseveli sous un amas de toiles hideuses, et les deux hommes, qui contemplaient ce visage divin, semblaient attendre une résurrection et non un réveil.
Sir Edward avait une de ces organisations singulières qui mettent de la pudeur dans la sensibilité ; il y a des individus qui rougissent d’une vertu comme d’autres d’un crime, et qui prennent un soin extrême à cacher les plus honorables sentiments. La parole de ces hommes est faite d’une raillerie perpétuelle qui déconcerte l’observateur assez hardi pour vouloir surprendre le trésor de bonté enfoui au fond de leur cœur. Mais il y a dans la vie des heures solennelles où la sensibilité la plus contrainte dans son expansion se trahit par une larme, par un geste, par un regard.
« Cette pauvre jeune fille, dit sir Edward en couvrant ses yeux avec sa main ; cette pauvre enfant, qui est attendue là-bas, au bout de l’Afrique, par la famille de son futur époux ! Quel chemin de noces ! Ne vaudrait-il pas mieux qu’elle dormit ainsi toujours ! »
Après cette phrase, dite à voix basse et pleine de mélancolie, sir Edward se ravisa et se repentit.
« C’est que, mon cher Lorédan, poursuivit-il, on ne va pas en radeau à la ville du Cap, où Mlle Rita est attendue ; j’ai beau chercher autour de moi une maison solide de pierre, ou une maison de bois flottante, je ne vois rien… C’est un désert un désert charmant, mais qui a le tort de ne pas être habité… Lorédan, vous qui étudiez les cartes, avez-vous aperçu autour de la baie d’Agoa quelque trace d’habitation humaine ou sauvage ?
– Sur la carte, pas une ombre noire autour d’Agoa ; un blanc uni et désespérant.
– Oh ! si nous n’étions que vous et moi, je ne m’inquiéterais guère de ce blanc ! j’en ai vu bien d’autres dans ma vie. J’ai failli fonder une ville, avec un de mes amis, dans un désert indien peuplé de tigres… Mais nous avons cette pauvre orpheline sur les bras ! un fardeau charmant dans une ville, bien lourd ici !
– C’est pourtant cette jeune fille qui me rattache à la vie, sir Edward, » dit Lorédan de Gessin, avec une expression de voix mystérieuse.
Sir Edward le regarda fixement, et après une pause :
« Ah ! voilà qui est clair, dit-il… En effet, j’avais cru découvrir un certain penchant du jeune passager pour la jolie passagère à bord du Malabar… Je vous demande pardon d’avoir sauvé la vie à Mlle Rita ; je vous ai volé cette bonne action ; mais ne craignez rien, je ne réclamerai aucune récompense ; bien plus, je mettrai ce service sur votre compte : c’est généreux, n’est-ce pas ? »
À son tour, Lorédan regarda fixement sir Edward, mais avec cette expression de tristesse amicale, plainte muette de l’homme malheureux qui n’est pas compris :
« Ces diables de Français ! poursuivit sir Edward, ils se ressemblent tous. Sur l’Océan, à la ration, avec le mal de mer, ils deviennent amoureux des jeunes filles qui vont se marier ! Au reste, je conviens que, cette fois, le hasard vous a merveilleusement servi, Lorédan. Ce pauvre oncle, M. Thomas Clinton, qui conduisait Rita, sa nièce, à la ville du Cap, périt dans notre naufrage. La jeune et belle orpheline est sauvée des eaux par votre dévouement ; il n’y a pas, dans la baie d’Agoa, le moindre brick en partance pour Cape-Town ; nous sommes dans un désert, et par conséquent, obligés de fonder une ville à nous trois : tout cela justifie très bien l’amoureux penchant né à bord du Malabar. Vous aviez tort hier ; aujourd’hui vous avez raison. On n’est pas plus heureux dans un malheur. Mlle Rita n’avait jamais vu son futur époux de Cape-Town, elle n’aura donc pas de peine à l’oublier. »
Lorédan secoua la tête mélancoliquement, et garda ce silence mystérieux qui provoque une interrogation.
Sir Edward prit un biscuit de mer, le rompit, et en offrant la moitié à Lorédan :
« Je comprends, dit-il, vous regrettez votre riche cargaison d’écailles et de moka, incendiée, sans garantie d’assurances, avec le Malabar. C’était toute votre fortune, n’est-ce pas ? »
Lorédan fit un signe affirmatif.
« Quelle imprudence ! continua sir Edward ; mettre sa fortune sur une coquille de noix !… Mais, tout bien réfléchi, Lorédan, vous avez vingt-six ans ; c’est encore une belle fortune que vingt-six ans ; vous avez l’intelligence du commerce ; il vous sera facile de regagner ce que vous avez perdu. J’ai sur moi une ceinture de piastres fortes qui ne me quitte jamais ; c’est mon cilice ; je vous offre ces graines d’or pour les semer dans la première terre féconde que vous labourerez. »
Lorédan serra les mains de sir Edward.
« Ah ! dit-il après une pause ; ah ! cher compagnon d’infortune, vous ne connaissez pas le fond de mes misères ! Oui, si je n’eusse regardé comme un devoir sacré de m’associer avec vous pour sauver cette jeune fille, croyez, bien que j’aurais suivi ma cargaison au fond de la mer.
– Maintenant, je ne vous comprends pas, dit sir Edward d’un air qui sollicite une explication. Quoi ! à vingt-six ans, estimer assez quelques morceaux d’écailles et quelques grains de moka pour se noyer avec eux ! Cela confond mon intelligence, passée au crible de l’univers.
– Sir Edward ! sir Edward ! ne vous étonnez pas. En deux mots, voici mon histoire :
Mon père avait un nom vénéré dans le commerce, un nom sans tache ; c’était sa noblesse, c’était son orgueil. En 1828, une crise commerciale éclata dans notre ville du midi de la France ; à son réveil, un matin, mon père se trouva ruiné, mais ruiné sans ressources… Son désespoir fut effrayant parce qu’il fut silencieux. Je devinai sa pensée ; elle était au suicide. Je pris donc la détermination de garder à vue mon père, et de ne le quitter ni jour ni nuit ; je trouvai même un prétexte pour dormir dans sa chambre et dormir éveillé, s’il était possible. Un soir, mon père m’embrassa avec une tendresse alarmante. Je le regardai fixement, il avait des larmes dans les yeux. Je redoublai de surveillance, et je me promis bien de garder son sommeil ou son insomnie. Avant le jour, je le vis se lever avec précaution et marcher vers un meuble de sa chambre, et je vis luire dans sa main deux armes, à la clarté d’une lumière extérieure. Au moment où il franchissait le seuil de sa porte, je me précipitai sur lui, je le repoussai vivement dans l’appartement. Là, tenant mon père étroitement pressé sur mon sein, j’épuisai tout ce que l’éloquence du désespoir peut inspirer au cœur d’un fils. Que vous dirai-je de plus ! il vous suffira de savoir que mon père, vaincu par mes larmes, consentit à vivre, ou du moins qu’il ajourna son suicide. Il fut convenu entre nous que le lendemain il convoquerait ses inexorables créanciers, et qu’il leur promettrait, sous serment, de s’acquitter envers eux au bout de trois ans ; ce qui fut proposé, débattu, et enfin accepté. Maintenant un devoir terrible et rigoureux commençait pour moi. Mon père, vieillard sédentaire, ne pouvait reconstruire une fortune pour la donner ; ce soin m’était confié. J’avais à remplir une mission de dévouement filial, et je me sentais au cœur le courage de l’accomplir. Devant moi, sur le port de notre ville, on m’avait souvent montré des jeunes gens qui avaient fait leur fortune dans les Indes, sans autres éléments que l’intelligence et la probité. Je fis mes préparatifs de départ ; je me ménageai de longs entretiens avec ceux qui connaissent le commerce de l’Inde, dans ses grandes et modestes opérations ; et prenant mon passage à bord de l’Indus, j’embrassai mon père et je partis en lui disant : "Vous m’avez donné la vie, je vous la rendrai. Sir Edward, vous savez le reste. Deux ans m’ont suffi pour gagner une fortune et la vie de mon père. Une nuit a suffi pour tout perdre. Voilà ma position, jugez-la. "
Pendant ce récit, la noble figure de sir Edward avait laissé entrevoir de vives émotions sous l’épiderme de bronze tissu aux rayons du soleil indien.
Il n’osait encore parler, de peur de trahir sa sensibilité par une parole tremblante, et il affectait de s’occuper de quelques détails de sa toilette de naufragé, comme si la confidence de Lorédan n’avait fait que traverser son oreille, sans arriver à son cœur.
Dès qu’il sentit qu’il pouvait donner à sa voix la froide assurance de l’égoïsme, il dit, en peignant avec ses doigts ses boucles de cheveux noirs collés sur son front :
« Mon cher Lorédan, votre position est triste, j’en conviens. Un malheur personnel, à votre âge, est un amusement ; mais vous portez le malheur d’un autre, et cet autre est un père ; voilà ce qui est intolérable. C’est le cas où le désespoir serait permis. Je crois pourtant qu’il y a une récompense providentielle pour le courage qui ne désespère pas dans le délire de l’infortune consommée. La vôtre a toutes les conditions qui semblent légitimer une révolte contre le ciel. Oui, il y a des fatalités si brutalement injustes, qu’elles peuvent ébranler la foi du plus sage. Eh bien ! dans ma vie vagabonde, quand j’ai passé devant un grand désespoir, j’ai arrêté ses mains violentes ; je lui ai ordonné de vivre, et il a vécu ; quand j’ai repassé devant lui, longtemps après, il était calme et joyeux, comme cet océan après la tempête d’hier. Vous avez fait votre devoir, Lorédan, attendez demain.
– Mais mon père attend aussi ; il attend, sir Edward ! il attend ce qui n’arrivera pas ; il attend la vie, et il recevra la mort. Mes dernières lettres de Bombay lui annoncent mon prochain départ. Quel coup pour lui ! mon père est triomphant d’espoir ; une nouvelle tombe sur son front comme la foudre : il n’a plus de fortune, il n’a plus de fils !… Oui, si je n’eusse regardé comme le devoir sacré du moment celui de sauver, avec vous, cette jeune fille à travers les flammes de l’incendie et les vagues de l’Océan, à cette heure je serais mort. Vous avez sauvé Rita, sir Edward, et Rita m’a sauvé.
– Eh bien ! mon cher compagnon, dit sir Edward avec un de ces sourires tristes qui essayent d’égayer une horrible situation, eh bien ! mon pauvre Lorédan, je rétracte alors toutes les mauvaises plaisanteries qui ont provoqué cette explication. Excusez-moi ; je me suis trompé ; je vous ai cru amoureux de Mlle Rita.
– Amoureux ! non, dit Lorédan en copiant, comme un miroir, le sourire de son compagnon, je ne suis pas amoureux ; mais j’ai reconnu comme vous, et comme tous nos pauvres morts, que notre jeune passagère est une merveille de grâce et de vivacité créole…
– Oui, c’est un ange lutin.
– Voilà le mot !… Certes, je conviens, sir Edward, qu’il est dangereux de naviguer en golfe Arabique avec elle. Fort heureusement, son oncle, Thomas Clinton, m’a soufflé en confidence que le mariage attendait la belle enfant à la ville du Cap.
– Lorédan, dites-moi, quand vous a-t-il fait cette confidence, Thomas Clinton ?
– Avant-hier, sir Edward.
– C’est-à-dire après trente jours de traversée ; il était peut-être un peu tard, n’est-ce pas ? Et je présume même que l’oncle voulait plutôt vous donner un avis charitable que vous honorer d’une confidence.
– Ah ! vous êtes méchant !
– Non, je connais les oncles : j’en ai eu quatre… Quatre héritages que le feu des tropiques a dévorés !… Excusez cet aparté – cher compagnon, point d’hypocrisie entre nous… Dans un désert et devant la mort, entre les lions et l’Océan, nous ne sommes que deux, et nous chercherions à nous tromper ! Oh ! pour le coup, l’humanité serait déshonorée sans rémission !… Lorédan, soyez sincère ; vous êtes amoureux de notre divine créole, amoureux comme un écolier ; je suis si fin, Lorédan, que je puis me vanter de ma finesse ; ainsi toute dissimulation ne vous servirait pas.
– Eh bien ! dit Lorédan avec un mélancolique mouvement de tête, eh bien ! supposons que je suis amoureux de Mlle Rita Clinton, n’entrevoyez-vous pas pour moi, dans l’avenir, un motif de désespoir de plus ? Cette fois, il y aurait du luxe pour excuser un suicide…
– Comment donc jugez-vous cet avenir, Lorédan ? Tout peut s’arranger, la fortune et l’amour. Les vies orageuses sont faites de miracles. Je ne compte que sur l’impossible, moi, je n’ai foi qu’en lui. L’invraisemblable est le mot du vulgaire, c’est l’exclamation du bourgeois. Les hommes comme nous sont les prédestinés de la Providence, le soleil ne luit que pour eux. Nous vivons toujours aux antipodes de la vie réelle. Si j’avais le malheur d’écrire dans une revue anglaise que nous sommes ici, vous et moi, après un incendie et un naufrage, occupés à déjeuner avec du biscuit, en causant gaiement devant une jeune fille endormie, tout Londres me lancerait un démenti, parce que Londres n’a jamais fait ce que nous faisons. Voyez ce pauvre Levaillant, l’intrépide voyageur, il a eu le malheur de dire qu’un jour il s’était rencontré, nez à trompe, avec un éléphant, cette histoire l’a perdu ; on a mis son voyage dans la mythologie africaine. L’an dernier, j’étais à Londres, où j’étouffais faute d’espace ; on ne respire pas dans cette bicoque, quand on s’est domicilié en Asie. Une famille me pria de lui raconter un chapitre de mes voyages. Je commençai de cette façon : Un jour, mes bons amis, j’étais à Tranquebar ; il était deux heures après midi. Je pris une tasse de chocolat et je partis. À ces mots, un sourire d’incrédulité courut sur tous les visages auditeurs. Personne de cette famille n’avait jamais pris du chocolat à deux heures après midi. Je bornai là mon récit. On me pria de continuer. Je répondis que mon chapitre était terminé. Cher Lorédan, ces digressions, assez habituelles dans mes discours, m’amènent toujours à mon but. Nous sommes réservés aux choses extraordinaires ; nous ne devons prévoir que l’imprévu. Vous êtes ruiné, c’est bien ; vous êtes amoureux, c’est à merveille. Voyez comme la Providence veille sur vous ; étudiez sa marche, et vous devinerez ses desseins. Croyez-vous que c’est pour vous perdre qu’elle vous a sauvé ? Cette jeune fille est votre ange gardien visible. Votre amour vous a épargné un crime, le suicide. Ce concours d’heureuses circonstances n’est pas l’œuvre du hasard : c’est l’intelligente préface d’une histoire écrite pour vous dans le ciel. Lorédan, vous avez fait une noble action filiale, eh bien ! vous aurez votre récompense ; et moi qui n’ai jamais fait que des folies, je me sauverai à la faveur de votre bonne action. »
Lorédan donna un long et triste regard au ciel, à la terre, à l’Océan, ces trois déserts pleins de mystères et de silence, et il n’exprima sa pensée que par la pantomime du doute et de la résignation.
En ce moment, une douce et légère ondulation se fit remarquer sur l’amas de toiles goudronnées qui couvraient le sommeil de la jeune fille. Une main enfantine écarta quelques boucles de cheveux égarées sur le plus doux des visages ; les yeux de Rita étincelèrent alors sous un front pur, comme deux étoiles sorties d’un nuage noir, et la nature sauvage de ce désert sembla se réveiller avec la belle créole. Toutes les choses d’alentour, mortes ou animées, prirent un aspect enivrant ; où aurait dit que les oiseaux, les feuilles, les fontaines, les petites vagues du golfe attendaient le regard d’une jeune fille pour donner un charme inouï à leur concert de chaque jour.
Ce fut la voluptueuse réalité du rêve de l’Éden du poète Bloomsfield, dont les vers peuvent imparfaitement se traduire ainsi :
Il est inutile de reproduire ici toutes les phrases qu’amenait la situation, et qui furent échangées au réveil de Rita entre les trois naufragés.
L’intimité, si prompte à s’établir dans la communauté du malheur, vint adoucir bientôt une position en apparence désespérée. La jeune fille, qui trouvait déjà un remède à son infortune dans sa vive gaieté de créole, ne put modérer son premier transport de joie lorsqu’elle se vit ainsi renaître au bord d’une mer calme, sous les arbres et parmi les fleurs ; un sourire même, qui se contint pour ne pas arriver à l’éclat, illumina sa figure, lorsque sir Edward, fièrement drapé d’un lambeau de voile, s’excusa de se présenter ainsi à elle dans son négligé du matin.
Pendant que sir Edward prodiguait à Rita les phrases consolantes de sa philosophie pour rendre la jeune fille à sa sérénité habituelle, Lorédan faisait de courtes et rapides incursions dans le voisinage, afin de découvrir un asile et des vestiges humains.
Ces rapides explorations ne servirent qu’à montrer aux naufragés leur isolement et le plus affreux abandon. À la dernière de ces courses, le dernier espoir s’était évanoui. Sir Edward s’occupait tranquillement à composer pour la jeune femme une coiffure de feuilles de bananier.
« Voilà, dit-il, ce qu’on ne trouverait pas chez la meilleure lingère de la rue Vivienne ou du Quadrant. Que pensez-vous de mon talent de modiste, Lorédan ?
– Je pense, dit Lorédan pâle et consterné, que nous sommes tombés dans un horrible pays.
– Cela vous sied à ravir, mademoiselle Rita, dit sir Edward avec le plus grand calme ; je fonderai ma réputation de coiffeur en Afrique. Vos beaux cheveux noirs s’harmonisent très bien avec ce vert ardent. Corrége a coiffé une nymphe de cette façon. Elle est à la galerie Pitti… Vous disiez donc, Lorédan, que ce pays…
– Est horrible, sir Edward.
– Ah ! ne calomniez pas la création. Je ne connais que deux horribles pays, moi, la Cité à Paris, et la Cité à Londres. Mais ce qui se présente ici est superbe, mon cher naufragé. Avez-vous jamais vu de plus beaux arbres, de plus doux gazons, de plus belles eaux ?
– Et pas un vestige de pied humain.
– Tant mieux, Lorédan. Savez-vous que ce vestige serait effrayant ici ? Consultez Robinson Crusoé ; il en découvrit un de ces vestiges, et il mourut de peur.
– J’espère bien pourtant, sir Edward, que nous ne passerons pas notre journée ici à faire des chapeaux de bananier et des sandales de nénufar.
– Rassurez-vous, Lorédan ; notre toilette est terminée ; notre repas frugal du matin est fini ; nous allons maintenant nous mettre à la recherche de quelques vestiges humains. J’ai l’habitude de ces choses, vous verrez : il y a des procédés pour découvrir un pays, comme on trouve un domicile inconnu dans l’éternelle rue d’Oxfort. Voilà une rivière charmante, une terre féconde, un site délicieux. Eh bien ! il y a des hommes domiciliés ici ; il ne s’agit que de connaître leur rue et leur numéro. Bien plus, j’ajoute que ces habitants sont des hommes bons et hospitaliers, parce que le paysage est doux, la colline arrondie, la rivière transparente, l’air embaumé ; parce que, chose rare en Afrique, il n’y a point de ces insectes sanguinaires qui aigrissent de bonne heure les meilleurs naturels, et les obligent à se faire sanguinaires à leur tour – Vous voyez, Lorédan, que j’ai étudié mon globe natal dans ses plus intimes secrets. Un avenir très prochain me donnera raison. Vous verrez, mon ami.
– Oui, sir Edward, j’ai foi en votre expérience ; mais si nous persistons à faire une idylle au bord de la mer, sans nous mettre en quête d’un abri, nous ne rencontrerons jamais ces habitants hospitaliers et bons qui doivent nous accueillir et nous sauver. Je vous avouerai même, qu’à chaque bruit du vent dans les arbres, il me semble que notre groupe va s’augmenter de quelque lion inhospitalier.
– Voilà une erreur encore et qui vous vient des récits de ces voyageurs qui ne voyagent pas. Vous vous imaginez donc que les lions viennent ainsi rêver en plein soleil, au bord de la mer, comme des poètes lakistes. Je connais mes lions ; ils craignent la mer comme le feu. L’Océan est pour eux un monstre qui les tient à distance et qui rugit plus fort que tout un concert africain. Cependant, je conviens avec vous, Lorédan, qu’il est temps de chercher un abri, et de suivre l’indication du doigt de la Providence. Cette jolie rivière chante avec une voix humaine ; elle nous fait un signe providentiel ; elle nous dit de remonter sa rive, en nous promettant d’étancher notre soif dans nos haltes ; levons-nous et allons où elle nous dit d’aller. »
À quelque distance de la mer, la rivière se voilait de la longue et flottante chevelure que secouait sur elle une double allée de tamarins.
Un sentier naturel, bordé d’iris, serpentait sur la rive comme une écharpe verte, et adoucissait la fatigue sous les pieds nus des voyageurs ; par intervalle, les arbres sauvages qui calment la faim et la soif perçaient les rideaux des tamarins comme des mains secourables, et laissaient pleuvoir leurs fruits sur le gazon ou les eaux.
Les trois naufragés suivaient avec espoir cette route merveilleuse.
« Il faut être patient et riche comme Dieu, disait sir Edward, pour dépenser depuis six mille ans tant d’eaux vives, de fruits et de fleurs, au bénéfice de trois pauvres naufragés ! »
La jeune femme, absorbée par un deuil trop récent, et marchant avec une résignation muette, n’exprimait sa reconnaissance envers ses libérateurs que par des regards remplis d’une douceur ineffable.





























