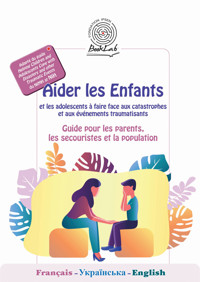Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EME éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Notre Europe semble être condamnée à se trouver constamment dépassée par l’existence et la rapidité même de son propre mouvement : l’Europe comme « formule historique » est, dès lors, inlassablement - et nécessairement - débordée par sa réalité pratique. Il convient, en quelque sorte, de penser l’intégration européenne comme constitutive d’une frontière qui, privée d’essence, doit être régulièrement déplacée, retravaillée et finalement toujours repensée. L’Europe, malgré ce statut ontologique étrange, interfère, néanmoins, à tous les niveaux dans notre existence et transforme - souvent en profondeur - aussi bien nos ordres juridiques que notre vie quotidienne. Les effets de l’intégration européenne sont, dès lors, nombreux et puissants et bouleversent la structure classique de nos instances étatiques. La norme fondamentale sur laquelle repose nos régimes politiques, la Constitution, est, elle-même, profondément concernée par cette construction internationale. De forts et itératifs courants de constitutionnalisation se développent à la fois selon des inclinaisons ascendante et descendante impliquant non seulement l’intégration des conséquences des traités constitutifs au coeur des chartes fondamentales des États membres ; mais, également, une irrigation du droit de l’Union par les principes fondamentaux présents dans ces mêmes textes fondamentaux des États membres. Enfin, ces mouvements sont, eux-mêmes, consolidés par la mise en oeuvre de ce que la doctrine présente comme une « constitutionnalisation transversale » qui se forme à partir de l’établissement d’un véritable dialogue juridictionnel entre les divers organes juridictionnels nationaux et européens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Directeurs de la collection De Lege Feranda
Laurence VANIN-VERNA(Docteur en philosophie politique et épistémologie - Membre du CERC, Faculté de droit,Toulon. Membre associé du C.F.D.C.M. Université de Perpignan Via Domitia),
David REMY(Licencié en droit notarial, Université de Bruxelles).
Comité de concertation scientifique :
J. BASSO (prof. Emérite, droit public et sc. politique, Université de Nice/Science Po, Paris),
J. BOMBIN (Dr., Cons. Général du Var, Commission Enseignement supérieur Europe),
P. BRUNET (prof. droit public, dir. Centre de théorie et analyse du droit, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Paris),
T. FREIXES (prof. de Droit Constitutionnel, Université Autonome de Barcelone, Chaire Jean Monnet ad personam Senoir Expert de l’Agence des Droits Fondamentaux de l’UE et de l’Institut),
C. JUHEL (MCF, Historien du Droit, Faculté de droit de l’USTV),
S. LEADER (School of Law, University of Essex, GB),
D. MARRANI (Senior Lecturer, School of Law, University of Essex, GB),
A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS (pro. Law & Theory, Co-dir. The Westminster international law & theory centre, University of Westminster, GB),
J.-C. REMOTTI CARBONEL (prof. droit public, UAB, Barcelone, Spain),
D. REMY (Licencié en droit notarial, Université de Bruxelles),
P. RICHARD (MCF, Faculté de droit, Toulon),
G. TUSSEAU (prof. droit public, Sciences Po, Paris),
L. VANIN-VERNA (Dr. en philosophie politique, Membre du CERC, PRCE Faculté de Droit de l’USTV, Membre associé du C.F.D.C.M. Université de Perpignan Via Domitia).
Avant-Propos
La collection De Lege Feranda participe à la mise en œuvre d’un espace de confluences intellectuelles qui n’est rendu possible que par la rencontre des idées et de l’interdisciplinarité, par le prisme de la philosophie, du politique et du droit. Cette collection invite à dépasser les réductions simplistes afin d’appréhender de manière pertinente l’évolution du droit, son développement, son champ d’application dont la combinatoire se complexifie à mesure de son extension et de la nécessité de son intégration au droit de l’Union Européenne. Elle a donc pour objet de penser, dans sa contemporanéité, l’évolution philosophique, politique et juridique du droit et des droits.
Au regard de ce qui se manifeste, il importe d’aller voir au-delà du phénomène, afin de saisir une ontologie du droit et susciter par la multiplication des perspectives - y compris comparatiste - une analyse à partir de laquelle pourront s’échanger ou se refléter les différents points de vue.
Afin de défier les mirages des apparences sociales, politiques, historiques, il sera nécessaire, à partir de cette diversité des correspondances et des contributions de quérir, l’essence de ce qui se réalise.
Cette superposition des axes de réflexions - générée par la diversité des disciplines à l’œuvre dans la compréhension des phénomènes philosophico juridiques - toutes ces strates de pensées amplifieront la densité et la substantialité de cette narration ontologique et sans cesse renouvelée du droit. De cette profondeur, l’analyse fera surgir, intrinsèquement, ce qui est nécessaire à normaliser les pensées afin d’envisager les liens entre un ensemble normatif complexe et l’introduction progressive du politique. D’autant que, le droit est, en permanence, habité par ses propres limites, assujetti à ses règles mais aussi à son interprétation. Ce qui alors requiert de s’attarder sur la signification du droit, son lexique spécifique lié à son énonciation, son champ sémantique et implique de réfléchir sur son mode d’attribution de sens consécutif à l’interprétation. À partir de ce qui est révélé, il importe donc d’envisager le dépassement du phénomène par un travail herméneutique – ou d’interprétation – afin, dans une orientation commune, de déterminer le sens de cette justice manifestée.
Cette entreprise critique exige aussi de penser les contraires et d’opérer une dialectique permettant de faire voler en éclats les a priori ou les craintes engendrés par les changements politiques, juridiques et sociaux économiques qui ouvrent à l’éphémère comme transition historique, intermédiaire dynamique entre des possibles.
Cette démarche ne pourra ensuite que rejaillir sur l’espace européen – en terme géographique cette fois-ci, de l’horizontalité - dont l’horizon reste évanescent car non totalement défini, en proposant un fil à plomb régulateur, c’est-à-dire une éthique de la pensée comme référent normatif ou vertical des actes à produire, dans cet être collectif auquel chacun participe.
Cette collection propose donc de méditer la logique du vivre ensemble à partir d’une multiplicité d’analyses complémentaires et comparatistes. Elle invite à dépasser les réductions simplistes ou les réactions parfois épidermiques entre les États et les citoyens afin de fonder une onto éthique et faciliter l’être en commun de cet espace mutant qu’est l’espace européen.
D’où la nécessité de produire une collection multidisciplinaire à caractère juridique et philosophique facilitant de nouveau la compréhension : De Lege Feranda.
Laurence Vanin-Verna David Remy
Préface
Avec quelques amis universitaires, nous avons souhaité créer le Cercle d’Études et d’Échanges Euro-méditerranéen. Le CEEEM a pour ambition de faciliter, de promouvoir, d’analyser et de proposer des actions dans le cadre défini par le Processus de Barcelone et de l’Union Pour la Méditerranée. Plus largement, il a aussi - et surtout - pour objet la mise en place d’une véritable plate-forme : une bourse d’échanges entre tous les partenaires de la Région, sur le mode de « Coopération Décentralisée ». C’est pourquoi nous sommes heureux que la collection De Lege Feranda, co dirigée par Laurence Vanin-Verna et David Rémy, nous accorde le privilège de figurer dans un de ses volumes.
À l’heure où le « printemps des peuples » semble capable de relancer le mouvement de l’histoire, nous souhaitons ainsi, avec d’autres - et en accord avec eux - participer à la construction, à partir du lieu que forme l’Union Européenne et conformément à ce qui se présente comme son particularisme, d’un espace de communication euro-méditerranéen.
En effet, l’Union nous apparaît initialement comme traversée par la communication et l’échange des expériences : cette organisation communautaire se développe dans un espace neutre d’intégration. Certes, ce milieu supprime les antagonismes pour créer, du seul fait de sa présence, les conditions du dialogue. Facteur d’identité interne, l’intégration européenne repousse la frontière politique et la logique agonistique aux frontières de l’Europe. Au total, le développement de l’Union Européenne implique, en ce sens, deux questions : la construction de l’espace de communication propre à l’intégration et la question plus sensible et dérangeante de la communication sur cet espace.
C’est à l’égard de ces deux questions que le CEEEM cherchera à apporter sa pierre à l’édifice conceptuel : comment se manifeste et s’actualise la communication entre les instances politiques (au sens large) au sein de l’Union et comment cette construction communautaire élabore un espace de communication à l’égard de son environnement ?
Nous essayerons donc de susciter la mise en place d’un espace de réflexion qui n’a pas vocation à se substituer à ce que d’autres réalisent avec davantage de pertinence et de talent que nous ; nous nous contenterons, au sein de cette nouvelle structure, de créer une instance de partage et d’expertise en profitant des synergies que permettent les institutions universitaires françaises et étrangères et les structures locales nationales ou internationales qui déjà réfléchissent et œuvrent au développement de la coopération décentralisée. Simple espace d’échanges de partage et de communication : le CEEEM aura pour objet de relayer les bonnes pratiques, de mettre en relation les partenaires et de porter la voix de certains spécialistes…
Outil, offert au bénéfice d’une cause qui nous semble plus que jamais essentielle et que certaines institutions, comme l’Arc latin, portent déjà au plus haut de l’efficience, nous souhaitons partager, communiquer et penser avec nos partenaires.
Nous sommes, dans cette perspective, particulièrement heureux d’intégrer cette collection De Lege Feranda en permettant la reproduction du colloque de Barcelone sur la gouvernancemulti-niveau. Ce colloque a été initié et réalisé par les efforts de Mme le professeur Teresa Freixes de l’Universitat Autonoma de Barcelona et de M. le professeur David Marrani de l’Université d’Essex. Ils ont également associé à la mise en œuvre de cette réflexion les Universités de Paris Ouest Nanterre la Défense et de Toulon ainsi que, naturellement, le CEEEM.
Cette thématique émergente offre un levier puissant permettant de penser la casuistique des relations précitées qui nous semble déterminante afin de comprendre le fonctionnement en réseau du droit de l’Union Européenne et le nécessaire développement, par exemple, des coopérations décentralisées.
Nous pensons, avec G. Ganguilheim, qu’être en vie c’est être pleinement normatif. En ce sens, il s’agit d’être capable de générer, à l’égard de la vie, des intensités spécifiques - des « horizons de sens - qui favorisent l’émergence d’une certaine signification au profit et au bénéfice de la vie elle-même. Cette possibilité de « penser » de nouveaux agencements – et ceci à partir de la vie et du plan d’immanence qui synthétise ainsi des intensités vitales – se révèle capable d’engendrer une ontologie de la construction européenne et de son particularisme.
Il s’agit, en quelque sorte, de récuser les principes traditionnels d’organisation des modèles politiques comme la hiérarchie ou le fédéralisme… au bénéfice d’une construction qui jusqu’à présent semble davantage existentielle que pleinement conceptualisée. Cette analyse nous apparaît, non seulement scientifiquement légitime, mais également pleinement nécessaire à l’émergence d’une authentique démocratie européenne.
Élaborée à partir de l’archétype provenant de la construction étatique et de ses différentes déclinaisons, la construction européenne a été pensée comme devant être calquée à terme sur le modèle traditionnel qu’offrait la référence hiérarchique ainsi que sur ses attributs classiques... Les transferts de souveraineté ne pouvaient être appréhendés que dans le cadre d’une recomposition du pouvoir ou l’ancien était remplacé par un « pseudo-nouveau » et ceci conformément à une ingénierie qui bloque la pensée européenne entre un constitutionnalisme nécessairement immature et une réflexion internationale teintée d’anamorphose car projetée sur un terrain différent de celui de la société internationale classique…
La démarche fonctionnaliste instituait, dès lors, le dépérissement de l’État membre, par le biais des transferts progressifs de compétences, comme étant la base de la nouvelle logique identitaire de la construction européenne.
Pourtant ce modèle ne semble pas convenir à la réflexion qui porte sur le développement de l’Europe.
De fait, une telle réflexion heurte, en premier lieu, le principe d’identité. Prendre l’Union européenne, comme phénomène singulier d’intégration, au sérieux, c’est considérer qu’elle est ce qu’elle est et non autre chose. En ce sens, la pensée classique sur l’intégration européenne et son droit se présente paradoxalement comme extérieure à sa propre expérience.
Notre Europe semble être condamnée à se trouver constamment dépassée par l’existence et la rapidité même de son propre mouvement : l’Europe comme « formule historique » est, dès lors, inlassablement - et nécessairement [sic.]- débordée par sa réalité pratique. Il convient, en quelque sorte, de penser l’intégration européenne comme constitutive d’une frontière qui, privée d’essence, doit être régulièrement déplacée, retravaillée et finalement toujours repensée.
L’Europe, malgré ce statut ontologique étrange, interfère, néanmoins, à tous les niveaux dans notre existence et transforme - souvent en profondeur - aussi bien nos ordres juridiques que notre vie quotidienne. Les effets, de l’intégration européenne sont, dès lors, nombreux et puissants et bouleversent la structure classique de nos instances étatiques. La norme fondamentale sur laquelle repose nos régimes politiques, la Constitution, est, elle-même, profondément concernée par cette construction internationale. De forts et itératifs courants de constitutionnalisation se développent à la fois selon des inclinaisons ascendante et descendante impliquant non seulement l’intégration des conséquences des traités constitutifs au cœur des chartes fondamentales des États membres ; mais, également, une irrigation du droit de l’Union par les principes fondamentaux présents dans ces mêmes textes fondamentaux des États membres. Enfin, ces mouvements sont eux-mêmes consolidés par la mise en œuvre de ce que la doctrine présente comme une « constitutionnalisation transversale » qui se forme à partir de l’établissement d’un véritable dialogue juridictionnel entre les divers organes juridictionnels nationaux et européens.
Se manifeste ainsi la présence de divers processus d’inclusion… Pour permettre la mise en œuvre d’une véritable démarche analytique à l’égard de ce qu’est l’Union européenne et de son principe d’action.
Cette réflexion sur les processus d’inclusion exprime non pas une « inclusion de cohésion » qui serait, en quelque sorte, proche de « l’enveloppe postale » mais une « inclusion par inhérence » renvoyant à la présence d’une même substance s’agissant de l’enveloppe et de son contenu. L’ordonnancement juridique complexe de l’Union européenne n’existe pas ainsi par superposition mais par intrication inhérente : ce qui offre une clé de lecture essentielle à sa compréhension et au concept de gouvernance telle qu’elle est appréhendée dans le colloque de Barcelone.
C’est, en réalité, un pouvoir d’une nature autre qui se met en place avec la construction européenne ; c’est ainsi moins l’étage supérieur d’une construction qui se présente comme inachevée qu’un espace remodelé qui bouleverse régulièrement le plan de la totalité de son édifice. La réflexion sur la construction européenne est ainsi pour partie encombrée par un questionnement maladroit qui porte sur l’être politique et institutionnel de l’Europe. Manteau d’Arlequin, l’Union européenne doit maintenant être pensée à partir d’une véritable et puissante casuistique des relations.
En ce sens, ce passage vers une structure institutionnelle qui partage son pouvoir avec des acteurs décentralisés doit être explicité et ses effets élucidés. De fait, c’est sur cette base véritablement ontologique que doit être située notre analyse portant sur la coopération décentralisée et la gouvernance.
Dans cet esprit, on passe ainsi bien souvent avec le droit communautaire : de la réglementation à laquelle nous sommes habitués à la régulation. L’ensemble permet d’intégrer dans le processus de production de la norme non seulement les instances centrales de l’État mais également les éléments qui forment l’État « au sens large ». Nos voisins italiens, distinguent, par exemple, dans le cadre de la réflexion constitutionnelle : l’État ordonnancement, l’État appareils et l’État comme République… Les diverses composantes de l’État de même que certains éléments de la société sont dans le cadre de ce droit moderne qu’est le droit communautaire associés à l’élaboration de la norme.
Conformément à cette logique les entités territoriales infra-étatiques apparaissent nécessairement comme des acteurs privilégiés des développements des politiques publiques nationales ou européennes. Elles se présentent, en effet, comme le point « extime » de l’Europe permettant à cette dernière de penser son environnement1 à partir d’elle-même et de la logique propre à sa construction.
Ces travaux publiés dans le cadre de la collection de Lege Feranda sur le thème de la gouvernance multi-niveau tentent ainsi d’offrir aux lecteurs une sorte de « boite à outils conceptuels » au bénéfice de l’ensemble des partenaires qui déjà travaillent avec vigueur et réfléchissent avec acuité aux problématiques qui s’attachent à la coopération décentralisée dans l’espace euro-méditerranéen.
Docteur Jean Bombin,
président du CEEEM,
conseiller général du Var,
président de la Commission
Enseignement supérieur
Europ, Vice président et
représentant de l’Arc Latin
auprès de l’Union
Pascal Richard,
Maître de conférences
en droit public à
l’USTV, membre du CERC.
Les connexions entre les différents ordres juridiques en Europe: l’égalité et la non-discrimination dans le système juridique multiniveau
par Mercè Sales2
La croissance, toujours plus forte, des interactions entre le droit communautaire et celui des États membres (droit régional compris) engendre de nouveaux paradoxes. Ces bizarreries sont provoquées par le «multiniveau» juridique, lui-même dérivé des connexions qui existent entre les différents niveaux normatifs. Les identités nationales traditionnelles se trouvent menacées par le supranational et l’approfondissement de la décentralisation générant ainsi des crises organisationnelles. Dès lors, l’harmonisation législative en Europe, beaucoup plus profonde qu’on ne le pense, n’arrive pas à être conçue sans entraves par tous les États membres. En outre, ces nouveaux paradigmes confrontent la dogmatique traditionnelle avec les concepts autonomes créés par le processus d’intégration européenne. La dogmatique juridique est ainsi en crise.
Dans cette perspective et comme première approximation, le multiniveau peut se configurer comme un paradigme « autonome » tendant à expliquer cette complexité juridique. Il est discuté au sein même de la dogmatique classique ; néanmoins, il est dans ce contexte appréhendé comme étant lié avec l’interprétation systématique et le fédéralisme. Il peut être ainsi applicable aux systèmes intégrés par des sous-systèmes (compétences, sources du droit…) et, surtout, il est ancré dans la suprématie du droit de l’Union européenne et l’intégration du droit international dans le droit interne… En ce sens, il faut donc tenir compte de la distribution des compétences entre les institutions de l’État, des régions et des communautés locales. Il apparaît ainsi que le multiniveau est partout, il s’introduit dans les relations juridiques verticales (hiérarchie), horizontales (compétence) et réticulaires (collaboration et subsidiarité).
1. Le « multilevel constitutionalism » : une réalité dans les états membres de l’Union Européenne
Le concept du « multilevel constitucionalism » est entré dans le débat juridique avec Ingolf Pernice, Dieter Grimm et Jürgen Habermas, à l’occasion des travaux de la Convention pour l’avenir de l’Europe. Leur discussion portait sur l’éventualité de la nécessité pour l’Europe d’avoir une Constitution. Pour Pernice, la Constitution n’était pas nécessaire, dès lors que, dans l’Europe existait déjà une « constitution multilevel », formée par les constitutions des États membres et par le corpus constitutionnel intégré par les Traités européens.
Le Traité d’Amsterdam contenait déjà un Protocole sur le principe de subsidiarité et de proportionnalité. À ce titre, il intégrait le multiniveau en s’attachant aux relations entre l’Union européenne, les États membres, les régions (Länder, Communautés Autonomes…) et les collectivités locales. En outre, des analyses liminaires sur le « multilevel constitutionalism » avaient été réalisées3 au regard de la pratique des États fédéraux, régionaux ou, dans le cas de l’Espagne4, l’État des Autonomies parce que dans ces cas, l’ordre juridique des pays contenait aussi les normes institutionnelles basiques de l’ordre juridique régional (Constitutions des länder, Statuts d’autonomie, etc.).
Par ailleurs, pour mieux présenter le cadre du débat sur le multiniveau, le Livre blanc sur la Gouvernance Européenne commençait par ces mots : « Les dirigeants politiques de toute l’Europe sont confrontés aujourd’hui à un véritable paradoxe. D’un côté les citoyens européens attendent qu’ils leur offrent des solutions aux grands problèmes de la société. D’un autre côté, ces mêmes citoyens confient moins chaque fois dans les institutions et la politique, ou bien tout simplement se sont désintéressés de tout cela5 ». En conséquence, ce Livre blanc établissait des propositions concernant l’Europe, telles que la réalisation de meilleures politiques et de meilleures réglementations (parce que plus claires) et, aussi, l’instauration d’instruments de participation politique pour les territoires avec des caractéristiques spécifiques concernant les collectivités locales. Le « multilevel constitutionalism » entrait ainsi au cœur même du débat juridique européen et le traité de Lisbonne a accueilli cette configuration de l’ordre juridique et des institutions politiques à différents niveaux.
Le traité de Lisbonne : approfondissement du rôle des Parlements nationaux et le renforcement du contrôle du principe de subsidiarité
Le rôle des Parlements nationaux dans le contexte européen, notamment avec l’établissement de rapports, de la Commission et du Parlement Européen, s’est développé à partir des années 1990. Le Traité de Maastricht comptait deux déclarations relatives aux Parlements nationaux qui prévoyaient que ces derniers devaient être informés par leurs gouvernements des propositions législatives de l’UE (en temps utile) et participer à des conférences communes. Le Traité d’Amsterdam consacrait, à son tour, un protocole concernant le « Rôle des Parlements nationaux dans l’UE » dans lequel on envisageait une transmission plus rapide des documents et des propositions législatives à la Commission et au renforcement du rôle du COSAC6. Le Traité de Nice, dans la Déclaration relative à l’avenir de l’UE, considérait également qu’il était nécessaire d’approfondir le rôle des instances parlementaires nationales dans l’architecture européenne. Ceci a été fait par la déclaration du Conseil européen de Laeken ainsi qu’à l’occasion des débats de la Convention sur l’avenir de l’Europe (le rôle des Parlements nationaux a été ainsi abordé par l’un des 11 groupes de travail, le Groupe de Travail IV : Parlements nationaux). Cette Convention s’achevant par la rédaction d’un Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’UE, a été jointe au traité instituant une Constitution pour l’Europe, et fut par la suite intégrée au Traité de Lisbonne. Néanmoins, le Traité de Lisbonne va plus loin et, au-delà même du Protocole nº 1 sur le rôle des Parlements nationaux, il consacre, pour la première fois dans le Traité européen, un article sur le rôle des Parlements nationaux7 qui mentionne explicitement la contribution des Parlements nationaux au « bon fonctionnement » de l’Union.
Enfin, s’agissant du Principe de subsidiarité, celui-ci a été reconnu par le droit de l’UE, en témoigne son intégration au Traité de Maastricht et sa reprise dans le Traité d’Amsterdam – qui, en outre, comporte en annexe un Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Traité de Nice a maintenu ce Protocole, qui a été repris par le Traité de Lisbonne, qui a inscrit le principe de subsidiarité à l’art. 5.3 TUE, avec l’ajout une référence explicite à la dimension régionale et locale de ce principe en octroyant une valeur contraignante au dit Protocole.
Dans ce contexte, différents systèmes établissant des relations entre l’Union Européenne et les parlements nationaux sont prévus :
En premier lieu, il faut remarquer la présence d’une consultation des États avant la proposition d’un acte législatif européen - et ceci en tenant compte, si nécessaire, de la dimension régionale et locale (encore qu’en cas d’urgence il est possible de passer outre cette obligation par une décision motivée). Ces projets d’actes législatifs doivent, selon l’art. 5 du Protocole, être motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ainsi, tout projet d’acte législatif doit comporter une fiche contenant des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres - y compris, le cas échéant, la législation régionale. Il est à noter que les raisons qui permettent de conclure qu’un objectif de l’Union peut être atteint plus avantageusement au niveau régional s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Il faut souligner ce que l’on comprend par « acte législatif », en incluant ainsi les propositions de la Commission, les initiatives d’un groupe d’États membres, celles du Parlement européen, les demandes de la Cour de Justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d’investissement, visant à l’adoption d’un acte législatif.En deuxième lieu, est prévue la mise en place d’un système d’alerte rapide avec la participation des Parlements nationaux et régionaux - et ceci en tenant compte de l’information des Parlements nationaux à l’égard du développement de la procédure législative. Dans un délai de huit semaines depuis la transmission d’un projet d’acte législatif, une chambre d’un Parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que le texte ne respecte pas le principe de subsidiarité et deux voix. Il appartient ainsi à chaque Parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux qui possèdent des pouvoirs législatifs. Lorsque 1/3 des votes émis par les Parlements nationaux sont contraires au texte du projet, celui-ci doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est cependant abaissé à 1/4). Dans l’application de cette règle, chaque Parlement national dispose de deux voix en tenant compte que dans un système bicaméral, chaque chambre dispose d’une voix. Il faut remarquer que, lorsque le projet d’acte législatif qui relève de « la procédure législative ordinaire » si un projet est contesté à la majorité simple des voix la Commission peut maintenir le projet, le modifier ou le retirer en motivant sa décision. Par ailleurs, si la Commission décide de le maintenir, elle devra cependant rédiger un avis motivé qui justifie la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l’Union afin d’être pris en compte dans le cadre de la procédure.En outre, une nouvelle procédure de contrôle sur la subsidiarité a été ajoutée. Même s’il n’y a pas de veto, le Conseil et le Parlement étudieront la compatibilité de la proposition avec le principe de subsidiarité, en tenant compte des allégations des Parlements nationaux et de la Commission ; et si 55% des membres du Conseil ou une majorité des votes émis par le Parlement européen, considèrent que la proposition n’est pas compatible avec la subsidiarité, la proposition législative sera rejetée.
Enfin, après l’adoption d’un texte, on peut présenter un recours devant la Cour de Justice afin de contrôler le respect du principe de subsidiarité. La Cour est, en effet, compétente pour se prononcer sur le recours pour violation du principe de subsidiarité, par un acte législatif, constitué par un État membre ou par le Comité des régions (quand le processus a requis la consultation de ce dernier).
2. Un exemple de « multilevel constitutionalism » : les systèmes juridiques complexes et le fondement juridique du multiniveau de l’égalité
Afin de constater l’effectivité de ce « multilevel constitutionalism » - dont nous venons préalablement d’indiquer les principaux éléments - nous pouvons à présent étudier cette réalité juridique dans un cas concret et particulier : le multiniveau concernant l’égalité.
Certes, les fondements juridiques du multiniveau de l’égalité dans les systèmes juridiques complexes se structurent de manière compliquée. En droit international, il faut signaler les Pactes et les Conventions des Nations Unies et ceux de la Convention Européenne des Droits Humains et celles provenant du Conseil de l’Europe. En droit de l’Union européenne il faut distinguer entre les normes de Hard law (Traités, règlements, directives, décisions, jurisprudences…) et celles de Soft law (Chartes, recommandations, programmes). Et, en droit interne, il faut différencier les systèmes unitaires et les systèmes composés ou complexes en tenant compte du fait que, dans ces derniers, coexistent : la Constitution ; la jurisprudence constitutionnelle ; les lois de développement du pouvoir central ; les statuts d’autonomie ou les Constitutions régionales ainsi que les lois de développement régional.
2.1. Le multiniveau de l’égalité en droit international
L’égalité est appréhendée, en droit international, dans les Pactes et les Conventions des Nations Unies, comme dans les normes du Conseil de l’Europe et ceci de manière générale ou plus spécifiquement dans le cadre de la mise en œuvre d’un domaine particulier. Dès lors, nous allons succinctement étudier, en un premier moment, les principales normes qui traitent l’égalité dans des domaines singuliers (politique, civil, du travail, de la famille et des femmes) ; pour ensuite analyser les normes qui ont un caractère général et qui impliquent une application de ce principe de respect de l’égalité dans tous les domaines - intégrant ainsi une perspective transversale de l’égalité (« mainstreaming »).
S’agissant, tout d’abord, du domaine politique… Dès 1952, la Convention sur les Droits Politiques de la femme énonce, dans son article 2, que les femmes doivent être éligibles dans des conditions d’égalité avec les hommes, sans distinction aucune dans les postes électifs ; selon l’article 3, ce même texte énonce que les femmes ont droit à occuper des postes publics et à exercer toutes les fonctions publiques dans des conditions d’égalité avec les hommes, sans aucune sorte de discrimination. Ces « conditions d’égalité » ne présupposent pas une égalité formelle de traitement : elles impliquent une « égalité contextuelle » dans l’exercice du droit d’accès aux postes et aux fonctions publiques, visant à établir in fine une « égalité réelle ».
Dans le domaine civil et politique… Le Pacte International des Droits Civils et Politiques de 1966 établit l’égalité entre les femmes et les hommes dans le mariage et pendant sa durée ainsi que dans les cas de séparation ou de divorce. Ce texte énonce également le droit de participer à la direction des affaires publiques, (moyennant le suffrage actif et passif) et le droit d’accéder aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité8.
Dans le domaine du travail et de la famille… Le Pacte International des Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1966, rassemble dans son article 7 plusieurs manifestations de l’égalité, parmi lesquelles : l’obligation d’assurer aux femmes des conditions de travail non inférieures à celles dont bénéficient les hommes ; l’égalité d’opportunités pour ce qui concerne le droit à la formation professionnelle ; l’obligation des états signataires d’octroyer une protection spéciale aux mères.
En outre, dans tous les domaines qui peuvent concerner les femmes, il faut également signaler la présence de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme. Ce texte offre la définition suivante du concept de discrimination : il s’agit de toutes les distinctions, exclusions ou restrictions qui fondées sur le sexe ont pour objet - ou pour résultat - de porter atteinte à la reconnaissance, à la jouissance ou à l’exercice par la femme d’un droit ou d’une liberté fondamentale9. Cette Convention oblige ainsi les états signataires à prendre des mesures appropriées, même à caractère législatif, afin d’assurer le plein développement et le progrès des droits de la femme dans tous les domaines10. Elle considère comme non discriminatoires les actions positives, accordant un traitement différent ou plus favorable aux femmes, dès lors que ces mesures sont adoptées temporairement jusqu’à l’établissement de l’égalité réelle - ou de traitement11. Cette convention institue un Comité de Garantie auquel les victimes peuvent plaider directement, et ce dès l’adoption du Protocole Additionnel.
Cependant, il faudra attendre 1995 pour que la Déclaration et la Plateforme de Beijing parlent de l’égalité dans tous les domaines de la vie et introduisent ainsi une perspective véritablement transversale de l’égalité (« mainstreaming »). En ce sens, cette perspective renforce l’introduction des actions positives afin de promouvoir l’accès et le maintien des femmes dans la vie politique ; l’examen de l’impact différentiel des systèmes électoraux sur la représentation féminine ; la conciliation entre la vie professionnelle et familiale et les mesures contre la violence liée aux genres.
En ce qui concerne la Convention Européenne des Droits humains de 1950 (CEDH) il faut signaler que le principe d’égalité des sexes est protégé par l’article 1412. Ce texte empêche toutes les discriminations et établit que les droits de la Convention doivent être garantis « sans distinction aucune » en tenant compte de leur version française et « without discrimination » selon leur version anglaise - les deux versions faisant foi. Dès ses premiers arrêts la Cour Européenne des droits humains a opté rapidement pour la version anglaise en établissant un test ou scrutin (construction prétorienne de la Cour) pour l’interpréter13.
Enfin, le Protocole 12 de la CEDH élargit la protection de l’égalité dans tous les domaines en particulier ceux qui ne sont pas réglés d’une façon explicite par les articles de la Convention14.
2.2. Le multiniveau de l’égalité en droit communautaire
Le droit communautaire a organisé, à l’égard de l’égalité, une vaste construction interprétative générale ainsi que, ponctuellement, des régulations de ces manifestations spécifiques - en accord avec son esprit de création d’un ordre juridique intégré et la mise en place d’une réglementation des politiques à l’égard des citoyens des États membres.
En tenant compte de sa dimension générale, l’égalité de traitement entre hommes et femmes, constitue un principe fondamental de l’Union européenne qui contient un véritable droit fondamental. Dans ce domaine, les objectifs de l’Union européenne sont doubles et visent, à la fois, l’intégration de la « dimension du genre » dans toutes les politiques et actions communautaires (gender mainstreaming) et la réalisation d’actions spécifiques en faveur des femmes dans le but d’éliminer les inégalités structurelles persistantes. Dans ce sens, comme l’a noté la Commission européenne, il ne suffit pas seulement de favoriser les efforts de promotion de l’égalité, s’agissant de la mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes. Il importe également « de mobiliser explicitement en vue de l’égalité, l’ensemble des actions et politiques générales, en introduisant dans leur conception de façon active et visible l’attention à leurs effets possibles sur les situations respectives des femmes et des hommes »15. Il est à noter que quinze ans plus tard, à l’occasion du 15ème anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes organisée par les Nations unies à Pékin, la Commission continue à affirmer que : « nous accentuerons la dimension de genre dans toutes nos politiques au cours de notre mandat et nous proposerons des mesures spécifiques en faveur de l’égalité entre les sexes »16.
Ainsi, dès le début, dans l’ordre juridique communautaire, les principes « d’égalité de traitement » et « d’égalité des chances » ont été appliqués de façon générale. Ils forment maintenant la base d’un large « acquis communautaire » dans de nombreux domaines. Le Traité d’Amsterdam a sensiblement renforcé le fondement juridique de l’action communautaire dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes en introduisant dans le droit communautaire les recommandations de la Déclaration de Pékin et de la Plate-forme d’action de la 4ème Conférence mondiale sur les femmes de 1995. Le principe du gender mainstreaming, ou le principe de l’égalité transversale, implique donc de prendre systématiquement en compte les différences entre les conditions, les situations et les besoins des femmes et des hommes dans l’élaboration, l’interprétation et l’application de toutes les normes et de toutes les politiques communautaires, y compris en matière de droits fondamentaux. Par ailleurs, dès lors que le principe d’égalité entre hommes et femmes constitue une des missions de la Communauté, celle-ci peut également prendre des mesures sur base de l’article 13 CE pour lutter contre les discriminations dans ce domaine17.
Le Traité de Lisbonne renforce, quant à lui, le principe d’égalité hommes-femmes en l’intégrant dans les valeurs et objectifs de l’Union (article 2 TUE et 3.3 TUE)18 et en incluant la question du genre dans toutes les politiques de l’UE (art. 8 TFUE)19.
Plus précisément, la Charte de Droits fondamentaux de l’Union Européenne établit, dans son article 23, que « l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération ». Elle autorise des dérogations au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes par des mesures dites positives en faveur du sexe sous-représenté. Cet article doit se lire de manière systémique avec les articles 20 et 21 de la Charte qui consacrent respectivement les principes d’égalité en droit et de non-discrimination. La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes constitue donc clairement un objectif général de l’Union Européenne et un droit fondamental.
La Cour de justice de l’Union Européenne (CJCE), comme garante de cet objectif général et des droits découlant de l’ordre juridique communautaire, souligne que le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe s’applique également aux discriminations indirectes (discriminations non visibles en apparence, mais qui se montrent par le résultat). Il faut noter, que le « test » de la Cour Européenne des Droits Humains, vu précédemment, est également appliqué en matière de non-discrimination par la Cour de Justice. En outre, la Cour de Justice élabore également une analyse tenant à l’inversion de la charge de la preuve pour les demandes qui concernent les discriminations en raison du sexe. Cette construction prétorienne a été recueillie par la Directive du Conseil 97/80/CE, de 15 décembre 199720.
En plus de cette dimension générale, l’égalité est aussi réglée, dans le droit communautaire, dans des domaines plus spécifiques, parmi lesquels : L’égalité des rémunérations, l’égalité de traitement au travail, l’égalité de traitement relative à la sécurité sociale et à l’aide sociale, l’égalité de traitement pour les travailleurs/es indépendants, l’égalité des droits dans le mariage, la protection de la grossesse, les congés maternité, les congés parentaux, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, le travail à temps partiel, la dignité dans le travail et l’interdiction du harcèlement sexuel au travail, les actions positives dans le domaine professionnel, la participation équitable dans la prise de décision politique économique et sociale, le traitement de l’image de chacun des deux sexes dans les moyens de communication et la publicité, la coopération au développement, la science et l’éducation et la formation au long de la vie, les violences à l’encontre des femmes et des enfants et la dimension de genre dans les fonds structuraux et les prévisions budgétaires et financières.
2.3 Le multiniveau constitutionnel de l’égalité en droit interne
Dans les Constitutions nationales des États membres plusieurs scénarios peuvent se présenter au regard de cette régulation de l’égalité. Parfois il n’existe aucune reconnaissance spécifique provenant des normes constitutionnelles. Toutefois une simple couverture constitutionnelle provenant de l’interprétation de principes généraux est possible ; parfois nous pouvons même être en présence d’une clause juridique générale de l’égalité et de non-discrimination ou encore face à une reconnaissance spécifique de l’égalité des femmes et des hommes. Enfin, généralement dans des Constitutions « récentes » on y trouve la reconnaissance de l’égalité entre les femmes et les hommes, la non discrimination et le principe de la mise en œuvre d’actions positives.
Certains États membres ont reformé leur Charte constitutionnelle dans cette perspective de promotion de l’égalité. La France, par exemple, a modifié l’article 3 de sa Constitution afin d’énoncer que « la loi favorisera l’égalité entre femmes et hommes dans l’accès aux mandats électoraux et les postes électifs »; en conséquence, la Loi 493/2000 du 6 juin va régler l’organisation des listes paritaires et les sanctions économiques aux partis qui n’accomplissent pas ce mandat. De même, l’Italie à l’occasion d’une reforme constitutionnelle de 2003, dispose dorénavant dans l’article 51 de la Constitution que « tous les citoyens d’un ou autre sexe pourront développer des postes publics et des postes électifs en conditions d’égalité conformément à la loi. Avec cette finalité la République favorise avec des actions positives l’égalité d’opportunités entre les femmes et les hommes». La Belgique a inclus dans son texte constitutionnel un article 11 bis en disposant que « la loi, le décret ou les normes régionales garantissent aux femmes et aux hommes l’égalité dans l’exercice des droits et libertés, et favorisent spécialement l’égalité dans l’accès aux postes électifs et publics ». Cet article a été développé par la Loi du 3 mai 2003.
3. L’intégration du multiniveau de l’égalité dans l’ordre juridique espagnol
3.1. L’intégration du multiniveau de l’égalité par le développement législatif de l’égalité et non discrimination
Les sources de droit des différents systèmes juridiques, qui se conforment au multiniveau, constituent le fondement même du développement législatif interne. Cependant, il faut constater que dans les États décentralisés comprennent des régions avec des compétences législatives : celles-ci peuvent parfois être le moteur de législations innovantes, ayant comme référence le système juridique national, mais aussi peuvent s’inspirer directement des sources juridiques internationales ou européennes. C’est le cas de l’Espagne où, en matière d’égalité, coexistent la législation nationale et celle des Communautés autonomes.
S’agissant de la Constitution espagnole, l’égalité est considérée, à la fois, comme un principe à valeur constitutionnelle et un droit fondamental. À ce titre, elle est proclamée comme une valeur supérieure à l’ordre juridique et ceci avec la liberté, la justice et le pluralisme politique (article 1.1). Elle est également considérée comme un « droit public subjectif » en tant qu’égalité devant la loi (article 14.1) et comme un « droit subjectif » en tant que prohibition de toute discrimination pour raison de sexe (article 14.2). En outre, il est possible de trouver dans la Constitution plusieurs manifestations concrètes des droits concernant l’égalité : le droit d’accès aux postes et à la fonction publique en conditions d’égalité (art. 23.2), l’égalité dans les obligations fiscales (art. 31.1), le droit à se marier en pleine égalité juridique entre homme et femme (art. 32.1), la prohibition de toute discrimination pour raison de sexe dans le travail et la rémunération (art. 35.1), l’égalité des enfants devant la loi indépendante de sa filiation (art. 39.2). Enfin, l’égalité est configurée comme une obligation des pouvoirs publics qui doivent promouvoir l’égalité et surmonter les entraves qui empêchent ou rendent difficile sa plénitude (art. 9.2).
S’agissant de la législation générale sur le thème de l’égalité, il faut noter la présence de la LO 3/2007 sur l’égalité effective des femmes et des hommes, dans le domaine national, ainsi que les lois de diverses Communautés autonomes (Andalucía, Canarias, Castilla-la-Mancha, Castilla-Léon, Extremadura, Galicia, Iles Baléares, Murcia, Navarra, País Vasco et Valencia). Dans des domaines spécifiques, par exemple, différentes Communautés Autonomes (Baléares, Castilla-La-Mancha et País Vasco) ont également établi par la loi la parité électorale. La Loi 3/2007 sur l’égalité effective des femmes et hommes a même développé ce droit dans le domaine national ; elle a également introduit l’inversion de la charge de la preuve dans l’art. 96 du Statut des travailleurs dans le domaine de la lutte contre les discriminations, cette démarche ayant été généralisée dans le domaine pénal par la Loi 3/2007. En 2003, la Loi de conciliation entre la vie familiale et professionnelle a été adoptée (aussi dans quelques Communautés Autonomes); on a également incorporé l’évaluation de l’impact de genre dans l’adoption des projets législatifs en 2003 (à Catalunya depuis 2001; enfin en Andalucía, País Vasco et Navarra) et au niveau national fut approuvée la Loi Organique 1/2004, de mesures de protection intégrale contre la violence fondée sur le genre.