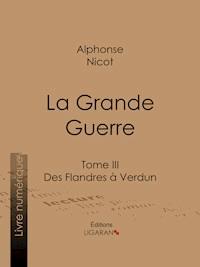
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "La bataille de l'Yser, où les Germains subirent des pertes sanglantes que l'on peut évaluer sans crainte à plus de trois cent mille hommes, avait ruiné à jamais, chez nos ennemis, tout espoir de « faire un coup », soit sur Paris, soit sur Calais, pour terroriser la France ou l'Angleterre."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous publions aujourd’hui le tome III de la Grande Guerre. Ce tome comprend, les récits des événements survenus sur le front anglo-français depuis février 1915 jusqu’à l’été de 1916, qui marque le point culminant de la résistance héroïque de Verdun.
Nous avons réservé pour un autre volume l’exposé des opérations de la Guerre hors de France : opérations-d’Italie, de Serbie, de Pologne, de Bukovine, du Caucase, d’Asie Mineure et de Macédoine. Nous exposerons alors l’effort simultané fait par les Alliés pour encercler d’un réseau infranchissable le repaire des vautours de l’Europe centrale.
Alphonse NICOT.
Après l’Yser. – L’artillerie lourde. – La guerre de tranchées. – Les oscillations du front. – La guerre de mines. – Fourneaux et « camouflets ». – Héroïsme de nos sapeurs. – Le rôle des places fortes. – La défense mobile.
Nous avons, à la fin du dernier volume, laissé l’armée française victorieuse dans les Flandres.
La bataille de l’Yser, où les Germains subirent des pertes sanglantes que l’on peut évaluer sans crainte à plus de trois cent mille hommes, avait ruiné à jamais, chez nos ennemis, tout espoir de « faire un coup », soit sur Paris, soit sur Calais, pour terroriser la France ou l’Angleterre.
Aussi, après les terribles hécatombes qui avaient marqué leurs insuccès sur la Marne et sur l’Yser, semblèrent-ils renoncer, au moins d’une manière provisoire, au système des grandes attaques, à effectifs nombreux et massifs, et se cantonnèrent-ils de plus en plus dans cette forme de la guerre, forme renouvelée du siège de Sébastopol, qui constitue ce que l’on nomme la « lutte de tranchées », et que l’on pourrait appeler plus justement encore la « lutte souterraine ».
Une nouvelle forme de la bataille gigantesque allait naître : à la guerre de « mouvements » allait succéder la guerre de « positions ».
Chacun des deux adversaires, retranché aussi solidement que possible derrière ses lignes redoutablement fortifiées, cherche à bouleverser celles de l’ennemi d’en face, et, à l’aide de sa grosse artillerie à longue portée, à détruire, loin à l’arrière, les approvisionnements et les réserves.
Le rôle du canon de campagne, de notre célèbre « 75 », devient donc moindre. La pièce merveilleuse, qui triompha sur la Marne, s’efface devant la fameuse « artillerie lourde ».
À ce dernier point de vue, il faut reconnaître que les Allemands s’étaient supérieurement organisés et avaient réalisé, à longue échéance, une préparation remarquable. Leurs gros canons de 155 millimètres, de 305 et même de 420, étaient très nombreux ; leurs approvisionnements en obus étaient formidables, et leur permettaient de faire subir à nos ouvrages et à nos abris, à un moment donné, un véritable « arrosage » de projectiles d’une grande puissance dévastatrice.
De notre côté, il faut constater également qu’au point de vue de l’artillerie lourde, notre préparation était absolument insuffisante.
En vain, plusieurs années avant la guerre, des soldats éminents, des patriotes éclairés, avaient signalé aux Chambres l’importance de cette grande question.
Et cependant, quelques mois avant l’ouverture du terrible conflit, le sénateur d’un de nos départements-frontières, Charles Humbert, avait, en séance publique, jeté le cri d’alarme : tout fut inutile.
La guerre éclata, et sa déclaration nous trouva à peu près dépourvus d’artillerie lourde. Nous n’avions guère que quelques batteries de 120 et quelques « Rimailho » ; mais qu’était cela en face du formidable armement de l’Allemagne ?
Heureusement que, si nos ennemis ont le génie de l’organisation patiente, nous avons, nous, le génie de l’improvisation, et ce sont de véritables tours de force que la France a réalisés pour la fabrication rapide et intensive du matériel de guerre.
Donnons maintenant quelques détails sur la guerre de tranchées, qui est la première phase de la « guerre souterraine ».
Évidemment, les grandes lois générales qui régissent l’art de la guerre subsistent toujours et demeurent intactes. La « stratégie », c’est-à-dire la science de combiner, dans une conception d’ensemble, les mouvements des troupes qui constituent une ou plusieurs armées, reste la forme la plus haute de l’art militaire : c’est celle que Napoléon avait poussée à son plus fort degré de perfection, celle qu’il a si admirablement appliquée sur les champs de bataille d’Austerlitz, de Wagram et d’Iéna, où furent défaites les armées prussiennes il y a un siècle.
Mais quand la lutte s’immobilise dans des fortifications, quand à la guerre de mouvement succède la guerre de siège, le temps n’est plus où, à la veille d’une grande bataille, le chef suprême, réalisant par le mouvement de ses armées sa conception stratégique, avait toute liberté de fixer, par des manœuvres savantes et de large envergure, le lieu qu’il avait choisi pour y livrer la bataille, de contraindre l’adversaire à y venir combattre et de pouvoir, grâce à la valeur militaire de ses officiers et au courage de ses soldats, avoir raison de la résistance de l’ennemi en forçant le centre de ses lignes et en débordant ses deux ailes.
Toutes ces méthodes « classiques » de la grande guerre deviennent inutilisables quand on se trouve en face d’un adversaire qui s’est « terré », comme l’ont fait les Allemands, sur l’Aisne d’abord, puis sur tout leur front, après leur défaite de la Marne.
Il n’y a alors d’autre ressource que d’agir de même et de se « terrer » également, en usant du maximum des ressources de la « fortification de campagne ».
Déjà, au cours de la guerre russo-japonaise, si féconde en enseignements de toutes sortes, on avait reconnu l’importance que prend la fortification de campagne sur le champ de bataille même, et le rôle capital qu’elle y joue.
Elle permet d’économiser le « matériel humain » en laissant, pour la manœuvre proprement dite, un plus grand nombre d’hommes disponible ; elle fournit aux combattants qui l’utilisent une protection contre les effets des projectiles ennemis, protection d’autant plus précieuse que les effets de ceux-ci deviennent plus meurtriers à mesure que progresse la puissance des bouches à feu de l’artillerie lourde actuelle.
Aussi l’entrée en jeu de la fortification de campagne a-t-elle modifié du tout au tout les conditions mêmes de la guerre. Il a fallu entraîner les hommes à devenir des terrassiers, et les munir de pelles et de pioches, outils devenus, pour eux, aussi utiles et même aussi nécessaires que la baïonnette et le fusil.
La lutte actuelle, depuis la bataille de la Marne, est donc une nouvelle guerre de tranchées. C’est le retour aux traditions de Sébastopol ; c’est la guerre de siège, étendue à un front de huit cents kilomètres, avec cette différence, comme l’a judicieusement fait observer le général de Lacroix, que « dans ce siège il n’y a pas de places fortes ».
La notion élémentaire que l’on se fait d’un siège implique, en effet, l’idée d’une forteresse que l’assaillant doit d’abord cerner de tous côtés, dont il doit démolir les défenses et qu’il doit, finalement, enlever à l’assaut de ses troupes, lancées en trombe sur les ruines des fortifications détruites par l’artillerie.
La guerre d’aujourd’hui présente ce même caractère ; mais, au lieu d’une place forte, c’est un pays entier qui se trouve assiégé. Les deux armées en présence sont fortifiées de façon égale, et, suivant les vicissitudes de la fortune des armes, l’une ou l’autre peut, selon les circonstances, être envisagée comme l’armée assiégée ou comme l’armée assiégeante.
Il suffit, pour se pénétrer de cette vérité, de regarder une carte du front.
Ce front est à peu près le même, du côté des alliés et du côté allemand. Ce n’est pas, à proprement parler, une ligne de défense dans le sens rigoureux du mot « ligne ». C’est bien plutôt une zone de défense, dans l’étendue de laquelle la résistance est organisée, non seulement suivant la direction du front, mais encore en profondeur. Cette résistance est réalisée par une série de tranchées dont chacune est pourvue de ses organes propres et de ses moyens individuels de défense : parapets, meurtrières, réseaux de fils de fer barbelés, trous-de-loup, etc.
Ce qu’on entend couramment sous le nom de ligne de tranchées est, en réalité, une suite de retranchements successifs qui constituent respectivement : les tranchées avancées, les tranchées de première ligne, les tranchées de soutien, les tranchées intermédiaires et un réduit.
Suivant les mêmes principes qui ont servi à l’établissement de cette zone fortifiée, d’autres zones sont établies en arrière de la première, constituant ainsi une véritable « cascade » de positions fortifiées.
Les tranchées avancées et les tranchées de première ligne doivent permettre à l’armée de défense d’utiliser le maximum de ses forces de résistance et, par les obstacles qu’elles présentent, d’affaiblir, d’épuiser l’ennemi suffisamment pour qu’il ne puisse préparer avec fruit la contre-attaque.
Le tracé de ces tranchées, quel l’on se figurerait volontiers former une ligne droite de grande longueur, est, au contraire, loin d’être rectiligne.
Il est déterminé par toutes sortes de considérations, par la proximité plus ou moins grande de l’ennemi, par les effectifs qui doivent occuper les tranchées, et surtout par les formes du terrain. L’officier, ou, pour mieux dire, « l’ingénieur » qui trace les tranchées doit être, tout d’abord, un topographe dans toute l’acception du mot. Il doit savoir, d’un coup d’œil, reconnaître la capacité défensive du terrain qu’il va remuer ; il doit embrasser d’un seul regard les positions que commanderont les ouvrages qu’il va édifier, et, inversement, éviter que la position qu’il a choisie ne soit « commandée » par des positions occupées par l’ennemi.
La topographie du terrain impose donc le tracé des tranchées, qui est formé avec des brisures dont l’alternance constitue des « saillants » et des « rentrants ».
Les « saillants » s’avancent en cornes, en éperons, en avant du front principal : ils y constituent, par leur saillie même, des centres de résistance. Par leurs deux côtés, ils peuvent battre facilement, et de la meilleure manière, le terrain situé en avant du front, et ils possèdent en outre, ce qui est le point capital de leur établissement, des feux de flanquement, feux de mousqueterie et feux de mitrailleuses.
Par contre, en vertu même de leur position avancée, les saillants seront les objectifs naturels vers lesquels tendront les principales attaques de l’adversaire. Les saillants sont donc des points tout spécialement exposés aux assauts de l’ennemi et doivent avoir, de ce fait, des défenses particulièrement renforcées. On n’a pas oublié l’attaque dont fut l’objet le « saillant d’Ypres » au cours de la campagne des Flandres, saillant qui fut si héroïquement défendu par l’armée anglaise.
Comment installe-t-on ces « saillants » ?
Ils sont, d’abord, fournis par des unités géographiques existantes, en particulier par les bouquets de bois ou par les villages. Ce n’est que lorsque ces unités font défaut que les saillants sont construits de toutes pièces par le génie, en utilisant toutes les ressources que peut fournir la fortification de campagne dans ce but.
Au cours des événements qui se sont déroulés depuis février 1915 jusqu’à ce moment, les villages ont joué et continuent à jouer un rôle capital : les « communiqués » de chaque jour en apportent la preuve quotidienne. Ce rôle varie, d’ailleurs, suivant les conditions où ils se trouvent, selon leur position dans la topographie de la région environnante.
Quand ils sont construits au sommet des collines, quand ils occupent des positions élevées qui « commandent » les environs, leur situation les désigne impérieusement pour faire partie de la ligne des tranchées et pour constituer des centres de résistance.
Ces villages « de hauteur » sont, il est vrai, appelés par leur importance même à servir de but à l’artillerie ennemie ; ils sont destinés à être inondés de projectiles, d’obus, et à ne plus former, au bout de quelques jours et souvent de quelques heures, que des monceaux de ruines ou des amas de pierres et de plâtras.
Mais, malgré cette démolition à laquelle leur situation dominante les expose fatalement, ils n’en gardent pas moins une grande valeur défensive.
Cette valeur, ils la doivent aux abris qu’ils continuent à fournir, alors même qu’ils sont en ruines ; mais ils ont aussi une valeur offensive importante, grâce aux emplacements, où le défenseur a pu organiser, à l’épreuve des projectiles ennemis, les postes de ses mitrailleuses et de ses engins spéciaux, « crapouillots » ou obusiers de tranchées. Ainsi les villages ont, dans cette guerre, un rôle de premier ordre. Leurs défenseurs doivent y tenir jusqu’au bout et y épuiser tous les moyens de résistance.
À l’inverse des villages situés sur des hauteurs, on en rencontre d’autres situés dans des creux, dans des fonds de vallées, ou au bas des pentes sur lesquelles est installée la défense de première ligne. Alors ces villages sont utilisés, au point de vue de la défense, d’une façon toute différente. Ils forment ce que l’on pourrait appeler des « ouvrages avancés », comparables aux anciens ouvrages extérieurs des fortifications classiques de Vauban.
C’est ce rôle d’ouvrages avancés qui détermine l’occupation de ces villages. Cette occupation est indispensable pour arrêter l’ennemi, pour l’empêcher le plus longtemps possible de déboucher par les routes qui aboutissent à ces localités. On arrive ainsi à le retarder, à paralyser les efforts qu’il fait pour aborder la position principale qui se trouve en arrière, sur les hauteurs : le cas s’est présenté d’une façon caractéristique au cours des attaques contre le fort de Douaumont, devant Verdun, fort qui domine une butte au pied de laquelle se trouve le village du même nom.
Toutefois, la défense ne doit pas oublier que ces villages « de bas-fond » ne forment que des ouvrages avancés et non la défense principale, située plus haut et en arrière. Il ne faudra donc pas s’entêter à y résister « à tout prix », comme on le ferait dans l’ouvrage dominant. Le devoir du commandant de la défense sera de « savoir les évacuer en temps voulu ». C’est là que gît le secret d’une défense habile. Souvent, en lisant les « communiqués », en voyant que nos troupes ont évacué un village, on a le sentiment d’un échec : rien n’est plus inexact. Ce village ainsi évacué était un simple « organe de défense ». Quand il n’avait plus à intervenir, il devait donc, légitimement, cesser d’exister.
Comment se fait la défense de l’ensemble de la ligne de tranchées ?
Cette défense dépend, avant tout, du travail effectif de ses organes de « flanquement », organes qui sont placés dans les « saillants », comme nous l’avons dit tout à l’heure. Il en résulte que, si le bombardement de l’artillerie ennemie est arrivé à détruire ces organes, la défense ne peut plus se tenir dans les intervalles de la première ligne. Elle est dès lors contrainte de se replier en arrière, sur une autre ligne, encadrée elle-même par des saillants défensifs préparés dans ce but et que le premier bombardement aura laissés intacts.
On comprend donc aisément une chose qu’il est essentiel de se rappeler quand on lit les communiqués relatifs aux opérations du front.
Dans une suite ininterrompue d’opérations, comme celles qui se font journellement sur toute l’étendue de la ligne de bataille, il peut et il doit se produire forcément des incidents qui rendent naturel et même nécessaire un mouvement de repli en arrière, une rectification (pour employer le mot technique) du front de défense, sans que, de ce fait, la force résistante de l’ensemble se trouve le moins du monde diminuée.
Dans la guerre de positions, l’art du commandement consiste surtout à préparer d’avance le champ de bataille de façon que la défense puisse être assurée de trouver partout l’abri, le « couvert » nécessaire, l’obstacle qu’elle a besoin de pouvoir opposer à l’assaillant pour l’arrêter ou du moins pour ralentir son attaque.
Or, une propriété essentielle de la fortification de campagne est de pouvoir se prêter, à chaque moment, aux exigences commandées par les péripéties du combat, et de s’y prêter avec une facilité que ne peut pas présenter un ouvrage de fortification élevé d’une façon permanente.
Dans cette guerre de positions, qui s’éloigne tant de l’ancienne guerre de mouvements, il y a cependant des règles, tout comme dans la guerre classique. Il faut savoir substituer à une fortification abandonnée une fortification nouvelle dont on improvise la construction, et le « terrassement de campagne » est, pour le soldat, une œuvre véritable dont il trouve, sur le lieu de la bataille, les matériaux, et qu’il peut réaliser lui-même avec sa pelle et sa pioche.
Il faut, quand c’est nécessaire, savoir abandonner un terrain pour en occuper un autre plus avantageux, et pour pouvoir attirer l’ennemi dans une position qui lui soit nettement défavorable. Ainsi la guerre de positions, comme l’autre guerre, a aussi sa manœuvre : manœuvre lente, il est vrai, mais cependant très réelle. C’est, dans toute l’acception du mot, une « guerre d’usure » ; mais c’est aussi une guerre d’action offensive.
Ces choses étaient à dire pour l’intelligence des faits dont nous allons, plus loin, faire le récit, et pour expliquer les inévitables « fluctuations » de la ligne de bataille.
La victoire définitive reviendra donc à celui des deux adversaires qui parviendra à briser, à détruire les éléments essentiels de la ligne de résistance de l’autre. Comment se fera cette destruction ? Par des assauts d’infanterie ? Non pas. Quelle que soit la valeur des soldats, elle serait impuissante contre les tirs de barrage lancés par la ligne de défense. Les hécatombes d’Allemands devant l’Yser en sont la preuve.
On n’arrivera à rompre la ligne ennemie que par la mise en action d’une artillerie lourde nombreuse et puissante, approvisionnée d’obus jusqu’à en permettre, en quelque sorte, le gaspillage. Avec le tir de ces grosses pièces, on pourra démolir les ouvrages de l’adversaire, ravager ses tranchées, faire effondrer ses abris à quelque profondeur qu’ils se trouvent, atteindre ses réserves de l’arrière et faire exploser ses dépôts de munitions, enfin bouleverser et démonter son artillerie.
Mais, pour cela, il faut des canons, des munitions ! Jusqu’à la guerre, on ne l’avait pas compris dans les milieux législatifs. La situation est admirablement résumée par ce couplet d’un chansonnier de Montmartre :
Oui, il faut des canons et encore des canons. C’est là le moderne cri de guerre : « Des canons, des munitions ! » C’est l’entrée en ligne, nécessaire, de l’armée industrielle, qui doit fournir sans discontinuer à l’armée combattante les moyens de lutter avec succès, et par conséquent de vaincre.
La supériorité individuelle de nos soldats sur les soldats allemands est un fait qui n’est plus discutable ; mais il faut qu’ils puissent les combattre à armes égales. La bravoure exaltée jusqu’à l’héroïsme ne peut rien contre l’artillerie lourde : il faut qu’elle soit soutenue, elle aussi, par une artillerie lourde au moins équivalente.
Dans ces conditions seulement, elle peut faire éclater sa supériorité.
Mais la guerre de tranchées n’est pas le seul aspect de la lutte de positions : il en est un autre, encore plus « souterrain », si l’on peut ainsi s’exprimer : c’est la « guerre de mines ».
La guerre de mines est un des plus anciens moyens mis en œuvre par l’art militaire.
Dès que la guerre cessa d’être une suite de corps à corps, dès que sa pratique devint une doctrine entre les mains de généraux éminents, la guerre souterraine montra son importance. Dans les siècles passés, au moyen âge notamment, elle fournissait à l’assiégeant le moyen de s’avancer sans être vu jusque sous les murs, jusqu’au cœur même de la place investie, dans laquelle, en débordant brusquement des galeries qu’il avait creusées, il pouvait ainsi faire irruption.
De son côté, l’assiégé cherchait, par des moyens analogues, agissant en sens contraire, à s’opposer aux progrès de l’assaillant, et pour cela il l’attaquait par des « contre-mines ». Quand il pouvait atteindre l’extrémité des galeries de l’attaque, il s’efforçait de les rendre intenables en les enfumant, en y lançant à profusion des matières incendiaires qui en brûlaient les supports de bois et en amenaient ainsi l’effondrement.
Quand la poudre à canon fut inventée, les galeries creusées par l’assaillant autant que par l’assiégé furent utilisées, non seulement pour faire progresser des soldats, mais encore pour accumuler, sous des points déterminés, des charges considérables de poudre dont l’explosion devait ruiner, en les faisant sauter, les obstacles construits par la défense ou par l’attaque.
À partir de ce moment, la guerre souterraine devint une branche très spéciale de l’art militaire ; son étude théorique, sa mise en application dans les conditions des opérations d’un siège, furent des opérations qui passionnèrent les officiers du génie.
Dans quelques sièges historiques, la guerre de mines a même pris une importance prépondérante. On peut citer, entre autres, le siège de Bologne au xve siècle, le siège d’Arras au xviie, le siège de Turin au xviiie ; sous les guerres de Napoléon, le siège de Saragosse, et enfin, plus récemment, sous le second empire, le siège mémorable de Sébastopol.
En 1870, la guerre de mines joua un rôle tout à fait effacé.
À cette époque venait d’éclore une nouvelle forme de la guerre, consistant à mettre en ligne des effectifs formidables, à faire appel, par des réserves, à la « nation armée ». De plus, les armements étaient devenus plus puissants ; le tir des canons et des fusils avait augmenté de rapidité autant que de portée. Aussi, en présence de cette guerre de mouvements où la rapidité semblait être la condition essentielle du succès, les lenteurs forcées de la guerre de mines la firent-elles reléguer au second plan, la firent-elles considérer comme un moyen archaïque de combat, bon à remiser sur les rayons de l’histoire passée.
Mais la guerre russo-japonaise vint redonner de l’activité à la guerre souterraine, principalement avec le siège de Port-Arthur ; cette actualité est devenue plus grande encore au cours de la lutte actuelle.
Dès que la grande rencontre des nations eut pris la forme de la guerre de tranchées, les opérations de mines furent commencées. Ce furent d’abord des débuts timides, limités à quelques points du front. Mais, petit à petit, leur usage fut étendu à tous les endroits où la proximité des lignes ennemies en rendit l’usage efficacement possible.
Et dès lors ce fut la renaissance de cet « art des mineurs », art qui se développe sous la double forme de la science de nos officiers du génie, et du courage indomptable de nos sapeurs.
Une galerie de mine ou « cheminement » se compose d’un conduit souterrain dont le point de départ est toujours dans un abri : tranchée ou réduit couvert. Les sapeurs travaillent dans les positions les plus pénibles à cause de l’étroitesse du boyau creusé, qu’il faut étayer à l’aide de madriers à mesure qu’il avance vers l’ennemi. De plus, l’atmosphère de ce boyau est vite irrespirable, et il faut prendre des mesures spéciales pour la renouveler par une ventilation énergique.
À l’extrémité des galeries, sous les ouvrages ennemis, on creuse un fourneau, cavité où l’on accumule la charge d’explosifs destinée à opérer son œuvre de destruction. On appelle entonnoirs les cavités que ces explosions font naître à la surface du sol.
Les charges mises dans les fourneaux peuvent être calculées de manière à produire des entonnoirs dont le rayon soit égal à la profondeur de la charge au-dessous de la surface. On dit que ce sont des fourneaux « ordinaires ». Les fourneaux sont appelés fourneaux « surchargés » quand la charge d’explosifs qu’ils renferment a été calculée pour produire un entonnoir de rayon plus grand que la profondeur de la charge. Ce rayon doit-il, au contraire, être plus petit que cette profondeur ? le fourneau est dit fourneau « sous-chargé ».
Une variété de mines est constituée par les « camouflets ». On appelle ainsi des fourneaux sous-chargés, dont la charge a été calculée de telle sorte que leur effet demeure interne et ne produise pas d’entonnoir à l’extérieur : le camouflet a donc pour effet d’ébranler la solidité du terrain où il fait explosion.
La technique de la guerre souterraine est empruntée à celle de la guerre ordinaire.
Ainsi elle a, comme la guerre de surface, ses services de reconnaissance. Ces services sont réalisés par les écouteurs, mettant à profit, par le téléphone et le microphone, toutes les ressources de la science moderne, toutes les conquêtes de l’électricité, afin de pouvoir déceler à distance les travaux opposés de l’ennemi.
Elle dirige ses attaques, soit de front, soit par une manœuvre enveloppante qui déborde les ailes de la contre-mine de l’adversaire. Des rameaux auxiliaires sont branchés sur les boyaux d’attaque directs : sur ces rameaux sont installés les « flanc-gardes ». Enfin, elle connaît les contre-attaques, comme dans les tranchées ; elle pratique les retours offensifs et construit des lignes successives de défenses, tout comme on le fait dans la guerre à ciel ouvert. Seulement, toutes ces opérations se font avec une lenteur que l’on s’expliquera facilement.
La forme la plus courante de l’attaque par mines est celle qui consiste à détruire un organe important du front de l’ennemi : par exemple, un abri blindé, un poste de mitrailleuses, un dépôt de munitions. L’ennemi, comme il faut s’y attendre, ne demeure pas inactif et opère sa défense par l’établissement de contre-mines. La lutte des deux partis se poursuit donc sous terre, chacun des deux adversaires cherchant à paralyser l’avance de l’autre en détruisant ses travaux.
D’autre part, l’expérience a montré que les effets explosifs des fourneaux de mines sont plus redoutables dans le sens de la hauteur que dans celui de la profondeur. Chacun des deux partis s’efforcera donc de « prendre le dessous », afin de faire sauter, par l’explosion d’un camouflet, les travaux du parti adverse.
C’est en se basant sur les renseignements qui lui sont fournis par ses postes d’écouteurs que l’ingénieur-officier peut diriger efficacement ses travaux. C’est ainsi qu’il peut voir et décider ce qu’il est possible de faire dans une circonstance déterminée, sur un terrain et dans un temps donnés, pour tâcher de surprendre l’adversaire tout en évitant de se laisser surprendre soi-même.
Souvent, des boyaux du système de contre-mines viennent s’infiltrer à travers les galeries creusées par l’assaillant ; souvent, au cours de la guerre actuelle, on a vu nos sapeurs rencontrer ainsi des galeries creusées par les Allemands. Alors ils se sont emparés des poudres de l’ennemi, pour en faire plus tard, contre lui, le meilleur usage possible.
Il est à peine besoin d’insister sur le courage, l’abnégation de soi-même, le sang-froid à toute épreuve qui sont nécessaires à nos héroïques sapeurs pour conduire à bien leurs périlleuses opérations. Il faut un moral solidement trempé à ces hommes, qui, méprisant le danger, sans souci de la mort qui peut les guetter à chaque instant, et quelle mort ! la mort par ensevelissement vivant, sous la terre éboulée ! travaillent dans un air vicié, accroupis ou courbés, à plusieurs dizaines de mètres de l’entrée de leurs galeries, à quinze ou vingt mètres de profondeur, et parfois à quelques pieds de distance du mineur ennemi qui guette leur approche pour les faire sauter et les étouffer sous les éboulements du terrain miné.
Ces qualités, nos sapeurs du génie les possèdent à un degré exceptionnel. Nous admirons, et c’est justice, l’audace de nos aviateurs qui s’en vont, en plein ciel, livrer aux avions boches des combats dont l’issue est toujours mortelle pour l’un des combattants. Mais gardons une admiration égale pour ces courageux pionniers qui font la guerre dans les entrailles de la terre, comme il nous en faut garder pour les marins au cœur d’acier qui composent les équipages de nos sous-marins. Nos sapeurs, devant Verdun en particulier, se sont montrés les dignes successeurs de leurs ancêtres de Sébastopol ; ils les ont même dépassés par la grandeur et la durée de leurs généreux efforts.
La Patrie leur en est reconnaissante : ils ont bien mérité de la France.
Ces quelques lignes nous ont paru nécessaires pour préciser les caractères essentiels de la guerre de positions actuelle.
Elles expliquent, en particulier, la lenteur des opérations sur nos fronts de bataille. On peut s’irriter de cette lenteur quand on en ignore les motifs ; mais on la comprend aussitôt qu’on descend un peu au fond des choses.
Cette lenteur fait partie du plan de notre commandement. Elle laisse l’ennemi s’user en attaques qui lui coûtent des pertes énormes. Les statistiques des dix-huit premiers mois de la guerre ont établi que, pour un allié mort sur le front occidental, de la mer du Nord aux Vosges, il y avait à peu près trois Allemands tués.
On voit donc que cette guerre d’usure nous est favorable : nos forces augmentent sans cesse, tandis que celles de l’ennemi diminuent, et en même temps nos moyens matériels de combat, constamment améliorés, deviennent égaux à ceux des Allemands.
Bientôt ils leur seront supérieurs.
Et alors ce sera la victoire définitive.
Avant de terminer cet aperçu général sur les nouvelles conditions de la guerre moderne, il est un dernier point sur lequel il n’est peut-être pas inutile d’insister.
Ce point, c’est la valeur militaire des villes fortifiées et des forts.
La courte résistance qu’ont offerte aux assiégeants des places très défendues, comme Liège, Namur, Maubeuge, surtout comme Anvers, réputée inexpugnable, a provoqué à l’adresse des fortifications permanentes de nombreuses critiques, et l’on a été jusqu’à parler de la « faillite des forteresses ».
Il est certain que sous la pluie de projectiles énormes et d’une puissance exceptionnelle, comme ceux que les canons de 305 et les mortiers de 420 ont fait pleuvoir sur leurs forteresses, ces villes ne pouvaient résister. Aucun bétonnage, aucune coupole cuirassée ne peut survivre à l’effet brisant de pareils obus, surtout tirés avec une précision extraordinaire, réglée par les observations des aviateurs.
Aussi semble-t-il bien que la guerre actuelle ait donné une leçon pratique à la fortification : la seule manière possible de tirer parti des forteresses est d’adopter pour celles-ci, comme on le fait aujourd’hui pour les troupes en campagne, l’ordre dispersé.
L’effort de la défense d’une place de guerre doit consister à empêcher à tout prix l’artillerie ennemie de mettre en batterie ses gros canons : on peut arriver à cela par l’organisation d’une ou plusieurs lignes de défense avancées. Il faut disposer, à cet effet, non plus d’une simple « garnison », mais bien d’une véritable « armée ».
Il faut que cette armée possède à son tour des points d’appui pour les différentes armes qu’elle comprend, en particulier pour l’artillerie mobile, dont elle doit user abondamment. Et ainsi, la seule différence qu’il y aura entre un siège et une bataille, c’est que, dans le cas du siège, le lieu de la lutte est imposé par la situation même de la place assiégée, centre forcé de lignes de chemin de fer et de routes de toutes sortes.
Il sera donc nécessaire, si l’on veut soustraire le centre fortifié proprement dit à l’action du bombardement, de reporter au moins à vingt-cinq ou trente kilomètres en avant toutes les défenses mobiles qui doivent l’abriter. Et dès lors c’est, comme nous le disions plus haut, une véritable armée qui est nécessaire pour la défense de la forteresse, et non plus, comme dans les sièges d’autrefois, une simple garnison.
Cela se vérifie d’une façon remarquable dans les opérations tentées par les Allemands pour emporter la place de Verdun, défendue par une armée constituant une merveilleuse défense mobile sous la direction d’un chef remarquable : la place a résisté victorieusement pendant plus de dix mois à des assauts qui, dans l’idée de l’ennemi, devaient l’emporter en quatre jours.
La ligne de front. – Les forces allemandes opposées à nos armées. – Les succès des Anglais : la bataille de Neuve-Chapelle. – L’éperon de Notre-Dame-de-Lorette. – Les exploits du 158e. – La prise de Carency. – Les succès de Neuville-Saint-Waast et d’Ablain-Saint-Nazaire.
Au début de février 1915, les forces allemandes qui attaquaient le front des troupes franco-britanniques, comprenaient le chiffre énorme de quarante-sept corps d’armée ! Nos ennemis avaient donc encore augmenté de quelques régiments les effectifs qu’ils avaient en janvier.
C’est cette formidable armée contre laquelle nous, avons à lutter. Elle représente, en chiffres ronds, 2 400 000 hommes pour un front de 800 kilomètres au maximum, ce qui fait une moyenne de trois hommes par mètre de terrain !
L’armée anglaise, avec l’armée belge, occupe toute la gauche du front, dans les Flandres et en Artois ; puis notre armée se raccorde avec elle pour former une ligne ininterrompue jusqu’aux Vosges.
C’est sur la partie gauche du front, comprise entre la mer du Nord et Reims, que se déroulèrent les événements que nous allons retracer en premier lieu.
Après de nombreuses escarmouches qui avaient marqué la fin du mois de janvier et le début de février 1915, les Allemands manifestèrent tout à coup une certaine activité dans le secteur d’Arras. L’ennemi pensait trouver un point faible à l’endroit où nos troupes se soudaient aux troupes britanniques.





























