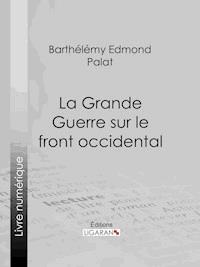
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Pendant de longues années, deux corps d'armée seulement sur dix-neuf, les 6e et 7e tenaient garnison sur la partie de nos frontières située entre le grand-duché de Luxembourg et la Suisse. Il en résultait pour nos troupes de couverture une réelle infériorité, car, à la même époque, quatre corps d'armée allemands au moins, les VIIIe, XVIe, XVe et XIVe, bordaient cette frontière ou en étaient à proximité immédiate."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335014938
©Ligaran 2015
Le présent volume est consacré à la mobilisation, à la couverture et à la concentration sur le front occidental, ainsi qu’aux premiers évènements militaires en Belgique, en Alsace et en Lorraine. Malgré toutes nos recherches, il présente des lacunes concernant les opérations de nos Ire et 2e armées, en raison de l’insuffisance et du vague extrême de beaucoup des documents communiqués jusqu’ici au public. Peut-être nous sera-t-il permis de regretter la discrétion dont a fait preuve le haut commandement français en cette matière. La confiance réciproque des troupes et du pays n’aurait pu que gagner, semble-t-il, à ce qu’on imitât chez nous la franchise du commandement anglais dans ses Naval and Military Despatches relating to the War. Nous ne possédons rien de semblable. Au contraire, on s’est attaché à conserver pour nos troupes un anonymat qui ne paraît pas de nature à rehausser leur moral. C’était rompre avec toutes nos traditions militaires et oublier que, dans les armées françaises, le désir de se distinguer, la soif de gloire, pour employer un mot quelque peu désuet, a, de tout temps, exercé l’action la plus puissante sur les individus comme sur les collectivités.
S’il est un enseignement qui ressorte des faits dont on va lire le récit, c’est assurément notre défaut de préparation matérielle et morale au début des hostilités. Non seulement nous n’avions pas suffisamment prévu une grande guerre contre l’ennemi héréditaire, l’invasion de la Belgique à laquelle il procéderait selon toutes les probabilités, l’effroyable consommation de matériel et de munitions qu’exigeraient nos opérations, mais nous avions paru laisser dans l’ombre la question des effectifs de combat. Nous avions négligé le rôle capital de l’artillerie lourde, de la fortification de campagne, de l’aviation dans cette guerre que si peu de gens croyaient imminente. La mobilisation proprement dite était préparée avec grand soin, du moins pour ce qui concerne l’armée active et sa réserve, mais nous n’avions rien prévu pour la mobilisation civile, pour l’organisation du Parlement en temps de guerre. La délicate question des finances avait été-à peine envisagée. Trop souvent, nous allions en être réduits à des solutions de fortune, dont beaucoup devaient se révéler inapplicables à bref délai. En face d’un adversaire qui avait préparé la guerre dans les plus petits détails, avec la collaboration effective du Parlement, de la presse, de la finance, de toutes les corporations, à commencer par les Universités, nous semblions croire qu’une grande guerre constituait une éventualité très peu vraisemblable et que, si elle survenait jamais, ce serait presque uniquement affaire des organes spéciaux, autrement dit des ministères de la Guerre et de la Marine.
Sous une forme légère, M. Anatole France a finement analysé certains des sentiments qui contribuèrent à cette situation. Voici les réflexions qu’il met dans la bouche de M. Bergeret : « Elle [ la République ] est volontiers militaire, mais point du tout belliqueuse. En considérant les chances d’une guerre, les autres gouvernements n’ont à redouter que la défaite. La nôtre craint également, avec juste raison, la victoire et la défaite. Cette crainte salutaire nous assure la paix, qui est le plus grand des biens ». Certes oui ; encore faut-il être d’accord sur la valeur des mots. Il y a bien, des manières de comprendre celui-là. M. von Bethmann-Hollweg ne l’entend assurément pas comme M. Ribot, ni même comme M. Bergeret.
Saint-Lien, Nantes-Doulon, le 24 août 1917.
La couverture française. – Résultats de la loi de 1913. – Transports de couverture. – Dispositions prises. – La couverture allemande.
Pendant de longues années, deux corps d’armée seulement sur dix-neuf, les 6e et 7e, tenaient garnison sur la partie de nos frontières située entre le grand-duché de Luxembourg et la Suisse. Il en résultait pour nos troupes de couverture une réelle infériorité, car, à la même époque, quatre corps d’armée allemands au moins, les VIIIe, XVIe, XVe et XIVe, bordaient cette frontière ou en étaient à proximité immédiate.
Cette situation s’améliora sensiblement dans la suite. On créa deux corps d’armée nouveaux, les 20e et 21e, qui s’intercalèrent entre les 6e et 7e ; on remania les régions de façon à étendre la 2e au nord-est. En 1914, cinq corps d’armée étaient destinés à former la couverture, les 7e, 21e, 20e, 6e et 2e, soit près du quart de nos forces actives.
Sous un autre rapport, la situation s’était également améliorée. Jusqu’en 1913, chaque année, après la libération du contingent et pendant plusieurs mois, soit du 25 septembre au 1er mars, l’armée active ne comportant qu’une classe exercée et une classe de recrues, les unités de couverture étaient réduites à 70 combattants par compagnie, 80 par escadron, 50 par batterie de campagne. On pouvait donc les considérer comme matériellement incapables de remplir leur rôle de protection avant d’avoir incorporé des réservistes. Une attaque brusquée de l’Allemagne, du genre de celle que nous allons décrire sur la Belgique, aurait eu contre nous les plus grandes chances de succès.
En portant la durée du service à trois ans, la loi du 7 août 1913 améliora grandement cette situation. Quand la guerre éclata, nous avions trois classes sous les drapeaux, celles de 1911,1912,1913. Les unités de couverture atteignaient un effectif qu’elles n’avaient pas encore atteint. Nous verrons en traitant de la mobilisation pour quelles raisons le résultat final ne fut pas aussi bon qu’il eût pu l’être. Mais il n’en reste pas moins un fait hors de conteste, c’est que la loi si péniblement arrachée aux Chambres rendait notre situation beaucoup moins précaire vis-à-vis de l’Allemagne. Au 1er janvier 1914, l’effectif réel est de 738 000 hommes de l’armée active, déduction faite des indigènes algériens, des régiments étrangers et des hommes du service auxiliaire. Au 1er janvier 1913, cet effectif n’était que de 517 000 hommes, d’où un accroissement de 221 000 hommes pour nos troupes de premier choc.
C’est le 31 juillet, après la proclamation de l’état de danger de guerre en Allemagne, que le gouvernement français décida la mise en place de la couverture. Commencés le même soir, à 21 heures, les transports nécessaires par voies ferrées furent terminés le 3 août, à 12 heures, sans que, jusqu’au 2 août à minuit, il y eût eu aucune modification du service commercial. Ces mouvements s’accomplirent avec une extrême régularité, sans retard appréciable, soit à l’arrivée, soit au départ, et bien que, sur le seul réseau de l’Est, ils eussent exigé un grand nombre de trains. En outre, près de 250 trains assuraient l’approvisionnement de siège des places fortes.
Le rôle de nos troupes de couverture allait être d’autant plus délicat que des considérations politiques limitaient singulièrement leur liberté d’action. Dès le 30 juillet, le gouvernement leur donnait l’ordre de se maintenir à dix kilomètres au moins de la frontière, de façon à éviter tout incident qui servirait infailliblement de prétexte aux Allemands.
Le 2 août, nouvelle instruction prescrivant de laisser à nos adversaires l’entière responsabilité des hostilités éventuelles et de se borner à repousser toute attaque d’une troupe entrée sur notre territoire. En même temps, le ministre de la Guerre adressait au commandant de la 1re région (Lille) des recommandations spéciales : « Il est absolument nécessaire en l’état actuel de n’avoir aucun incident sur la frontière franco-belge et par suite de ne pas s’en approcher pour les troupes (sic) à moins de deux kilomètres environ.
Il sera recommandé aux douaniers et forestiers d’éviter tout incident. »
Le 3 août, les troupes de couverture recevaient de nouveaux ordres confirmant et précisant ceux du 2 : il s’agissait encore de laisser aux Allemands l’entière responsabilité des hostilités et de se borner à repousser leurs attaques. Il semble que, dans ce cas, le gouvernement français ait exagéré les scrupules. À ce moment, il ne pouvait plus y avoir doute sur les intentions de l’Allemagne.
Enfin, le 4 août, c’est-à-dire le jour même où nos adversaires pénétraient en Belgique, on adressait aux troupes de la frontière les recommandations suivantes : « L’Allemagne va tenter par de fausses nouvelles de nous amener à violer la neutralité belge.
« Il est interdit rigoureusement et d’une manière formelle, jusqu’à ce qu’un ordre contraire soit donné, de pénétrer, même par des patrouilles ou de simples cavaliers, sur le territoire belge, ainsi qu’aux aviateurs de survoler ce territoire ».
C’est le 5 août, seulement, sur la demande du gouvernement belge, que cette défense était levée pour les avions et dirigeables comme pour les reconnaissances. Ces faits irrécusables ne devaient pas empêcher le gouvernement allemand de justifier son attentat contre la Belgique en alléguant de prétendues violations de ce territoire neutre par nos aviateurs ou même par nos troupes. Le 3 août, à 1 heure 30 du matin, le ministre d’Allemagne à Bruxelles demandait à voir le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il était chargé par son gouvernement de faire connaître que des dirigeables français avaient jeté des bombes et qu’une patrouille de cavalerie était entrée, le tout en territoire allemand. Ces actes faisaient supposer que d’autres, contraires au droit des gens, seraient commis par la France.
Un peu plus tard, le mensonge prit une forme plus accentuée. La Norddeutsche Allgemeine Zeitung allégua que, dès le 24 juillet, des troupes françaises en armes avaient pénétré en territoire belge. Il se trouvait même des témoins allemands pour affirmer ce fait ou d’autres analogues sous la foi du serment. Il a été facile de prouver que ces allégations étaient simplement mensongères ou basées sur une confusion des uniformes français ou beiges. De ces accusations il ne reste qu’un fait : après avoir ruiné de toute façon la Belgique, les Allemands ont tenté de la déshonorer, mais des entreprises de ce genre déshonorent sûrement leurs auteurs.
Immédiatement en face des cinq corps d’armée français que nous avons énumérés, figurent six corps d’armée allemands. Quatre sont au contact de notre frontière les XIVe (Carlsruhe ; 28e division, Carlsruhe ; 29e, Fribourg-en-Brisgau) ; XVe (Strasbourg ; 30e division, Strasbourg ; 39e, Colmar) ; XXIe (Sarrebruck ; 31e division, Sarrebruck ; 42e, Sarrebourg) ; XVIe, Metz (33e et 34e divisions, Metz).
Deux autres corps d’armée sont dans un voisinage assez rapproché de la frontière pour qu’une partie de leurs éléments, au moins, puissent participer à la couverture : IIe corps bavarois (Wurtzbourg ; 3e division, Landau ; 4e division, Wurtzbourg) ; VIIIe corps (Coblentz ; 15e division, Cologne ; 16e division, Trèves).
La couverture est d’autant mieux assurée que près de moitié des 651 bataillons d’infanterie allemands sont à effectif renforcé : soit 297 à effectif fort de 722 hommes de troupe ou employés et 354 à effectif faible de 644. Tous les régiments de cavalerie ont le même effectif : 740 hommes de troupe et 726 chevaux. Quant aux 609 batteries de campagne, 264 sont à effectif fort (143 hommes de troupe, 100 chevaux) et 345 à effectif faible (124 hommes de troupe, 75 Chevaux.
Cette proportion se retrouve à peu près la même dans l’artillerie à pied.
Nous avons dit, dans une autre étude, que les premières mesures allemandes en vue d’une mobilisation paraissent avoir été prises le matin du 25 juillet, sinon à une date antérieure. Les troupes de couverture auraient été mises en place le 27 ; les éléments éloignés de la frontière en auraient été rapprochés le 28. Les effectifs des troupes de couverture étaient complétés les 28,29,30 par l’appel individuel de réservistes. On évaluait leur nombre à un minimum de 125 000. Le 30 juillet, M. Viviani écrivait que, non seulement les troupes en garnison à Metz avaient été poussées jusqu’à la frontière, mais qu’elles avaient été renforcées d’éléments venus par voies ferrées de l’intérieur, de Trèves ou de Cologne par exemple. L’armement des places menacées avait commencé le 25. Les troupes de couverture avaient leurs avant-postes « sur nos bornes-frontière ». Dès le 29 juillet, on signalait l’entrée de patrouilles allemandes en territoire français, ce qui n’empêchait pas leur gouvernement de formuler contre nos préparatifs des plaintes au moins singulières. Ainsi se trahissait l’un des procédés qui allaient être le plus familiers à nos adversaires : nier résolument tous leurs torts, même contre l’évidence, et se plaindre amèrement de la moindre infraction au droit des gens, quand les circonstances faisaient de ces plaintes une amère dérision. Nouvelle application de ce principe qui veut que l’Allemagne ait tous les droits, y compris celui d’altérer impudemment la vérité. La présente guerre n’a-t-elle pas été déclenchée par nos adversaires sur un télégramme absolument faux :
« Berlin, 2 août, 3 h. 15 après-midi.
« Un aviateur français bombarde Nuremberg.
« Une nouvelle de source militaire annonce que, dimanche matin, un aviateur français a jeté des bombes à Nuremberg et dans les environs… ».
Mobilisation française. – L’esprit de la nation. – Les mobilisés, – Résultats de la loi de 1913. – Transports de mobilisation. – Mobilisation belge. – Mobilisation anglaise. – Mobilisation allemande.
On ne saurait dire combien le sentiment de l’injuste provocation allemande contribuait à faciliter notre mobilisation, à en rendre le poids moins lourd pour un peuple qui, pourtant, la veille encore, ne songeait nullement aux aventures guerrières. N’est-ce pas un sénateur, M. Debierre, vice-président du parti radical-socialiste, qui s’exprimait ainsi, dans le Rappel, à l’automne de 1913 : Le Congrès de Pau « dira, nous dirons : guerre à la guerre. La République, c’est la paix et l’empire du travail créateur. La réaction, c’est la guerre avec ses désastres et ses ruines… ». Toute cette phraséologie s’envolait au souffle des évènements. M. Clémenceau écrivait dans l’Homme libre (31 juillet) : « C’est une force de savoir qu’on lutte pour l’existence même de sa patrie. Nous sommes dans ce cas, précisément, et ceux qui ont triomphé de nous avec tant de peine, quand nos armées étaient anéanties et que tous les moyens d’action nous manquaient à la fois, vont apprendre ce que nous pouvons faire, quand il n’y a plus d’autre moyen que la victoire pour sauver notre pays ».
En temps normal, la presse française est extrêmement divisée dans ses opinions, de même que le pays dont elle émane. L’agression allemande la faisait unanime. Dans La Guerre sociale, M. Gustave Hervé assure, le 31 juillet, aux « soldats et officiers » qui constituent nos troupes de couverture, qu’ils peuvent veiller sans arrière-pensée sur nos frontières. « Personne ne leur tirera dans le dos.
« Ici, tous, nous avons rayé de notre Internationale le couplet des généraux.
« Et notre Internationale, ainsi expurgée, qu’est-ce qu’elle dit au fond, sinon ce que disait la Marseillaise que nos pères chantaient il y a cent vingt ans ! »
Nous n’avions pas souhaité la guerre, « mais nous la voyions approcher sans faiblesse. La certitude rendit notre résolution plus arrêtée et notre confiance plus entière. « Dans ces jours d’angoisse poignante, mais aussi de fière énergie, écrivait le Figaro du 2 août,… aucune nation n’aura donné un plus bel exemple de sang-froid et de bravoure que la nôtre. Notre première victoire, nous l’avons remportée sur nous-mêmes, en faisant trêve à toutes les divergences d’opinions et d’intérêts….
« Rien n’était plus réconfortant que de parcourir les boulevards, hier soir. On y respirait je ne sais quelle atmosphère vibrante d’émotion et d’allégresse. C’est que ce peuple est fort, non seulement de son enthousiasme, mais aussi de son droit.
« Cette guerre, la France ne l’a pas voulue. Elle a fait tous ses efforts loyaux et sincères pour en écarter la redoutable éventualité….
« La France n’engage pas la lutte à cause du conflit austro-serbe. Elle met ses armées en campagne, d’abord pour respecter la parole qu’elle a donnée à sa grande alliée la Russie, mais aussi parce qu’elle est directement visée par l’ennemi orgueilleux, patient et sournois qui, depuis quarante ans, ne lui a pardonné ni sa défaite matérielle, ni sa victoire morale…. »
La veille au soir, 1er août, à 16 h. 20, l’ordre de mobilisation avait été lancé aux quatre coins de la France :
« Armée de terre et armée de mer.
ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE
Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées.
Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914.
Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d’être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation (pages coloriées placées dans son livret).
Sont visés par le présent ordre : tous les hommes non présents sous les drapeaux, appartenant :
1° À l’année de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires.
2° À l’armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine, ».
Partout la mobilisation s’accomplit dans le plus grand ordre, affirmant la magnifique confiance de la nation. Dans beaucoup d’endroits, les maisons étaient pavoisées aux couleurs nationales, comme s’il se fût agi d’une fête solennelle. On couvrait de fleurs les partants, on les accompagnait au chant de la Marseillaise. Le mois d’août était magnifique, sans que la chaleur fut accablante, et le beau temps rendait plus joyeux ces décors de fête. Les plus pacifiques se laissaient gagner par l’enthousiasme guerrier, irrités qu’ils étaient d’une odieuse et louche agression. L’union sacrée de M. Poincaré n’était pas encore un vain mot. Tout respirait le sang-froid et la dignité d’une grande nation.
Ce n’était pas que la masse fût exempte d’illusions. Confiante dans la justice de sa cause, elle admettait volontiers la possibilité d’une victoire facile. Déjà elle voyait nos régiments sur les routes de Metz et de Strasbourg. Elle croyait à une guerre rapide et beaucoup parmi les mieux informés partageaient son erreur.
Dans toute la France, le spectacle est le même, avec les différences que comportent le caractère et les occupations habituelles de la population. Un neutre, qui se rend de Genève à Lyon pendant cette période, a donné de ses impressions un tableau qui paraît fidèle. Dans la journée du 1er août, il passe en chemin de fer aux pieds du fort de l’Écluse. À partir de là, partout, le tocsin sonne, des tambours roulent ; à toutes les stations, des réservistes envahissent les wagons, les uns équipés déjà, les autres en vêtements civils. On se serre, on se tasse ; les couloirs sont pleins à craquer. Néanmoins la bonne humeur reste générale. Nul n’est ravi de partir, mais c’est l’Allemand qui l’a Voulu. Et il le paiera, car le monde entier sait où est le bon droit. La partie sera chaude, mais on est sûr de la gagner. Il y a trop d’années qu’on nous marche sur les pieds. Il est grand temps de mettre à la raison ces voisins si encombrants. Aussi l’ordre est parfait dans ce train bondé de jeunes gens. Il reste tel à Lyon pendant toute la mobilisation. C’est avec transport qu’on y accueille la nouvelle de la participation anglaise. L’impression d’ensemble du neutre se résume ainsi : « Tout se passe le mieux du monde au point de vue français ».
Dans cette vaste opération qui met en mouvement des millions d’hommes, de cheveux, de voitures, il est fatal que des erreurs se produisent, mais elles sont sans importance réelle. C’est ainsi qu’on voit convoquer dans certaines régions, dès les premiers jours, un nombre de médecins et de pharmaciens qui dépasse de beaucoup les besoins immédiats, au risque de priver complètement des populations entières de secours indispensables. Ailleurs certaines catégories de réservistes sont prématurément appelés sans que leur logement, leur équipement et même leur armement aient été prévus. Enfin, dans certaines grandes gares, où affluent plusieurs courants de réservistes, les dispositions indispensables n’ont pas été prévues pour éviter toute fausse direction.
Nous avons dit en quoi la loi du 7 août 1913 avait amélioré la couverture. Ses résultats n’étaient pas moindres pour ce qui concerne la mobilisation. On sait comment ce projet, présenté par M. Briand, président du Conseil, et par M. Étienne, alors ministre de la Guerre, fut violemment combattu par les socialistes et par un grand nombre de radicaux. Ces opposants exagéraient les inconvénients de la mesure projetée, tout en refusant obstinément d’en admettre les avantages. Ils taisaient d’ordinaire leur principale raison, à savoir que l’intérêt électoral se conciliait mal avec la prolongation du service militaire. Après de très longs débats, le projet finit par être adopté, grâce aux efforts de M. Barthou, successeur de M. Briand, et des généraux Joffre et Pau, commissaires du gouvernement. Jaurès en avait été le principal et le plus prolixe sinon le plus éloquent adversaire. Dans l’Humanité, il prétendait imposer à tous les élus-du parti radical-socialiste l’obligation « de répudier, de briser, de flétrir la loi de trois ans, la loi de réaction et d’abaissement, la loi de ruine et de défaite, la loi qui a compromis tout ensemble la défense nationale et l’action républicaine, et qui a ouvert la voie à tous les désastres extérieurs et à toutes les complications intérieures ». Ces mots creux, ces phrases toutes faites qui dissimulent mal le vide de la pensée, évoquent les épithètes dont Junius gratifiait l’orateur socialiste en août 1913. Il le qualifiait de minus habens sonore, et tous ceux qui ont pu se rendre compte du rôle néfaste de cet homme dans la préparation de la Défense nationale souscriront à ce jugement.
La principale raison d’être de la nouvelle loi résidait dans notre faible natalité. Comment, avec des contingents décroissants, assurer à nos unités l’effectif indispensable, sans diminuer le nombre de ces unités ou prolonger la durée du service ? Or, diminuer le nombre de nos bataillons, de nos escadrons et de nos batteries au moment précis où l’Allemagne ne cessait d’augmenter celui des siens eût été la pire des folies. Il ne restait donc qu’à prolonger la durée du service » actif. L’article 2 établit même la fixité des effectifs minima par unité, en spécifiant qu’ils ne pourraient être modifiés que par une loi spéciale, indépendante des lois annuelles de finances, trop souvent votées sans examen suffisant.
Toutefois des dispositions parasites, introduites au cours de la discussion, comme il arrive fréquemment, affaiblirent les résultats immédiats à obtenir de la nouvelle loi. On abandonna le principe de la deuxième portion, dont devaient faire partie, au bout d’un certain temps de service, les jeunes gens appartenant à des familles nombreuses. La totalité du contingent fut astreinte à un service de durée identique, ce qui enlevait à la loi toute élasticité et accroissait sans profit correspondant les charges du budget. La seule compensation, et elle était maigre, résidait dans l’égalité des charges militaires, ce dogme auquel on a fait tant de sacrifices chez nous et qui, malgré tout, a été si souvent outragé au cours de la présente guerre. En outre, on abaissait à vingt ans l’âge d’incorporation jusqu’alors fixé à vingt et un ans. On avait d’abord admis que la prolongation du service s’appliquerait aux deux classes sous les drapeaux, celles de 1910 et de 1911. L’appel du contingent à vingt ans avait pour conséquence l’incorporation simultanée des classes de 1912 et de 1913. Nous aurions donc eu quatre contingents sous les drapeaux, ce qui devait conduire à de complètes impossibilités. On préféra libérer la classe de 1910 au bout de quelques semaines et l’année active ne comprit que trois classes (1911,1912,1913), dont deux de recrues. Pendant l’hiver de 1913-14, il fallut instruire ces deux contingents, avec des cadres inférieurs affaiblis par le renvoi de la classe 1910. Cette instruction exigea de grands efforts et donna de médiocres résultats dans certaines unités. Au mois d’août, la moitié au moins de l’armée allemande, le tiers environ de l’armée française étaient depuis vingt et un mois sous les drapeaux. Il résulta de cet ensemble de circonstances, pour quelques-unes de nos troupes, une insuffisance tactique appréciable. Elle a été signalée parmi les causes de nos échecs en août, et M. Joseph Reinach insiste avec raison sur ces conséquences d’une loi improvisée.
Parmi les avantages résultant de la loi de 1913 figurait la diminution des effectifs à transporter lors de la mobilisation. Trois contingents étant déjà sous les drapeaux, il en résultait que le nombre des réservistes destinés à l’armée active était réduit d’une classe, c’est-à-dire d’un effectif très appréciable. En outre, les unités, atteignant un effectif de paix sensiblement plus élevé, étaient plus rapidement mises sur le pied de guerre. C’est ainsi que la compagnie d’infanterie avait été portée de 90 à 140 hommes à l’intérieur et de 150 à 200 hommes pour les troupes de couverture. Il est d’ailleurs évident qu’une unité contenant sur 250 hommes une proportion de 140 ou 200 hommes de l’armée active, bien connus de leurs cadres et les connaissant bien, dûment entraînés, possède beaucoup plus de solidité intrinsèque que la même unité portée de 90 ou même de 150 hommes à 250 par l’incorporation brusque de 160 ou de 100 nouveaux venus. La trop grande proportion de réservistes est un danger évident au début des opérations et nous en eûmes la preuve au mois d’août. Certaines divisions de réserve laissèrent grandement à désirer comme consistance jusqu’à ce que se fût produit, sous l’influence de la vie commune et du commandement, cette sorte d’amalgame qui fait un tout homogène d’éléments juxtaposés. Les guerres balkaniques l’avaient déjà démontré : pour que des troupes comportant une très forte proportion ou une totalité de réservistes acquièrent une solidité suffisante, il faut qu’elles soient soumises à une période d’entraînement, de préférence dans un camp.
Dès le 26 juillet, le sentiment d’une crise aiguë s’était répandu en France et dans les pays voisins, accentuant le mouvement de rentrée de l’étranger, de la mer, de la montagne, habituel à la fin de chaque mois. Du 25 juillet au 1er août, 500 000 voyageurs revinrent à Paris ou le traversèrent ; 200 000 étrangers quittèrent Paris.
Le 30 juillet, les officiers de complément de certaines formations furent appelés par télégrammes individuels. Jusqu’alors, du 25 au 30, une moyenne de 175 000 télégrammes passaient chaque jour au Central télégraphique de Paris, soit pour le service privé, soit pour le service officiel. Le 31 juillet, ce nombre fut porté à 212 000. On prévint les réservistes de l’armée territoriale, les R.A.T. comme on devait bientôt les nommer partout, destinés à la garde des voies de communication, c’est-à-dire les futurs G.V.C., d’être à leur poste le soir du 1er août. Le trafic privé fut suspendu à dater du 2 août, à 18 heures. Seuls, les voyageurs partis avant cette heure purent continuer leur route. L’horaire militaire fut substitué à l’autre le deuxième jour, c’est-à-dire le 3 août, à minuit 01. Pendant vingt longs jours, les trains allaient circuler sur les lignes importantes à raison de 140 à 160 par vingt-quatre heures. Il ne se produisit aucun accident et les retards furent insignifiants, bien que les transports de mobilisation eussent lieu concurremment avec ceux de couverture jusqu’au 3 août, à midi. Les 3 et 4 août, le réseau de l’Est, seul, mit en mouvement, de ce fait, près de 600 trains.
Ces transports se firent dans les meilleures conditions, non sans gaieté. Parmi les réflexions que l’on entendait, il y en avait beaucoup d’amusantes, empreintes de ce libre esprit, volontiers frondeur et toujours primesautier, que l’on est accoutumé à voir fleurir en France. Quelques-unes avaient un sens profond. Un réserviste venant des Pyrénées traverse la vallée de la Loire : « Tout de même, ça vaut la peine de se battre pour ce pays-là ! » Et le reste du compartiment de faire chorus. De ceux qui allaient tomber sur les champs d’Alsace, de Lorraine, de Champagne ou de Picardie, combien avaient la même pensée, sans pouvoir toujours l’exprimer aussi nettement ?
Le 29 juillet, le gouvernement belge avait décidé de mettre l’armée sur le pied de paix renforcé, en rappelant trois classes de milice. Ses effectifs atteindraient ainsi des chiffres analogues à ceux « entretenus en permanence dans les zones frontières des Puissances voisines ». Cette mesure, était inattaquable. En effet, l’armée belge, comprenant en temps normal une seule classe de milice, l’infanterie d’une brigade mixte ne comptait que 1 500 hommes, soit environ 60 hommes par compagnie. Dès le 31 juillet, à 19 heures, la mobilisation partielle était suivie de la mobilisation générale. Elle aurait dû porter l’armée belge à 350 000 hommes, dont 175 000 destinés à l’armée de campagne. Mais ce résultat, dû à la loi de 1913, ne pouvait être atteint qu’en 1918. À ce moment, six classes de milice entreraient dans la composition normale des troupes de campagne, le reste étant affecté aux troupes de forteresse et aux dépôts, etc.
En attendant, le gouvernement jugeait nécessaires des mesures provisoires permettant de mobiliser l’armée à toute époque de sa période de transformation. Dès le 15 décembre 1913, les troupes de campagne furent constituées sur le pied de paix comme elles devaient l’être suivant les conceptions nouvelles. Les effectifs de guerre étaient évidemment incomplets, aussi bien que le matériel, mais on n’en pouvait pas moins mobiliser en quelques jours 110 000 hommes d’armée de campagne avec sept classes de milice au lieu de six. Malgré l’adjonction d’une classe, le déficit était encore supérieur à 60 000 hommes, soit plus du tiers de l’effectif espéré en 1918.
En dépit des circonstances, la mobilisation belge s’accomplit dans des conditions de rapidité très satisfaisantes.
L’attaché militaire allemand à Bruxelles en félicitait même, le 1er août, la veille de la remise de l’ultimatum, le chef du cabinet du ministre de la Guerre. Était-ce ignorance de la situation réelle, de la part d’un comparse ? Était-ce plutôt fourberie native ? Tout donne à croire que la dernière supposition est la vraie.
En Angleterre, la mobilisation de la flotte, déjà rassemblée pour les manœuvres, n’avait donné lieu à aucun retard. Il n’en fut pas de même pour l’armée, dont l’envoi sur le continent fut retardé par de fâcheuses hésitations, dont le contrecoup devait être très nuisible à l’intérêt commun. Le rejet de l’ultimatum anglais par l’Allemagne aurait dû automatiquement déclencher la mobilisation dès le soir du 4 août. Mais, à cette date, le cabinet britannique n’avait pas encore arrêté ses décisions, quant à la nature de sa coopération. M. Paul Cambon s’efforçait encore d’obtenir une prompte résolution au sujet de l’envoi sur le continent du corps expéditionnaire anglais. On calculait qu’il faudrait à ce dernier de douze à quinze jours pour qu’il fût à même de prendre part aux opérations, ce qui reportait déjà son intervention au 17 ou au 20 août, à supposer que les ordres fussent donnés le jour même.
Dans un entretien qu’il avait eu le 4 août avec sir E. Grey, M. Paul Cambon lui faisait remarquer que, la neutralité belge étant violée, la guerre était inévitable entre l’Angleterre et l’Allemagne. Mais comment attaquer la flotte allemande, si elle restait dans la Baltique ou à l’abri de ses ports ? Il fallait donc transporter immédiatement le corps expéditionnaire sur le continent.
À ce raisonnement, sir E. Grey n’objectait rien, sans doute parce qu’il ne se croyait pas encore assuré d’être suivi par l’ensemble du cabinet et par le Parlement.
Le 6 août avait lieu une importante séance des Communes. Le premier ministre, M. Asquith, analysait les évènements survenus depuis l’ultimatum à la Serbie et flétrissait les propositions louches faites à la Grande-Bretagne pour obtenir sa neutralité. Il concluait ainsi : « Nous allons faire la guerre, d’abord pour remplir nos obligations internationales, ensuite pour défendre les nations faibles. Le pays comprendra que notre cause est juste et je demande à la Chambre de voter un crédit de 100 millions de livres et de porter l’armée à 500 000 hommes ».
La Chambre vota séance tenante les crédite et les hommes.





























