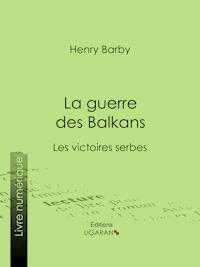
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je me souviens qu'un jour de cet hiver, vers les six heures du soir, sous les arcades de l'Odéon, je causais de la guerre des Balkans avec un membre de l'Institut, un de ceux qui connaissent le mieux l'Europe : Oui, je sais bien, me disait-il ; vous êtes serbophile, vous voyez en beau l'armée serbe. Mais l'armée bulgare vaut mieux, et l'armée turque encore mieux. Le Turc, c'est le premier soldat du monde !"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je me souviens qu’un jour de cet hiver, vers les six heures du soir, sous les arcades de l’Odéon, je causais de la guerre des Balkans avec un membre de l’Institut, un de ceux qui connaissent le mieux l’Europe : « Oui, je sais bien, me disait-il ; vous êtes serbophile, vous voyez en beau l’armée serbe. Mais l’armée bulgare vaut mieux, et l’armée turque encore mieux. Le Turc, c’est le premier soldat du monde ! » Et, du doigt, l’académicien me montrait, aux dernières nouvelles du Journal des Débats, une dépêche officielle de Constantinople : « Nos troupes de Macédoine ont bousculé quatre divisions serbes à Koumanovo ! »
Certes, je n’y pouvais croire, à cette dépêche !Pour admettre qu’on les eût « bousculés », j’avais connu trop d’officiers et de soldats serbes, trop souvent vu défiler, sous les plis lourds des étendards tricolores, leurs alertes et solides régiments ! Mais le proverbe dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu, et les heures parurent longues à tous les amis des Slaves jusqu’au moment où, dans le Journal, les dépêches de M. Barby leur apprirent que la « bousculade » des Serbes, c’était leur victoire décisive à Koumanovo !
Je paye donc une dette en écrivant la préface que M. Barby m’a fait l’honneur de me demander, et j’ose ajouter que slavophiles ou non, nous lui devons tous de la reconnaissance. Son livre, en effet, nous montre les Serbes tels qu’ils sont, tels que, pendant des siècles, l’Europe n’a pas su les voir. Une malchance singulière les a poursuivis longtemps. Effacés de la carte d’Europe au moment où la vague de la Renaissance les atteignait, ils ont continué à se battre contre l’oppresseur, mais oubliés, inconnus, à l’avant-garde des Allemands ou des Vénitiens. Plus tard, quand ils se sont affranchis par leur seul effort, sans guerre européenne, le nom de Karageorges a bien retenti en Europe, mais celui deNapoléon y retentissait aussi, et très vite, l’ère des batailles passée, on s’est occupé des pesmé, des vieux poèmes épiques, plutôt que des réalités auxquelles on n’est revenu, du temps du roi Milan, que pour les constater peu favorables à la Serbie. Et cependant, de Pétersbourg à Paris, en passant par Vienne et Berlin, l’opinion s’éprenait des Bulgares, qu’elle dotait de toutes les vertus, et qui, certes, en avaient beaucoup, pas assez pourtant pour qu’on traitât en « repoussoirs » les devanciers qui, sur la route de la liberté, avaient rencontré plus d’obstacles et moins d’amis.
Le livre de M. Barby met les choses au point. Dans ses pages véridiques, nous retrouvons la bravoure des héros des pesmé, cette bravoure slave faite avant tout de mélancolie stoïque, mais qui a, chez le Serbe, quelque chose de plus vif et qui évoque, moins ces hommes du Nord, dont les Latins notaient déjà la résolution froide,
que les fils plus ardents d’un autre pays,
Cette bravoure, M. Barby en donne d’innombrables exemples, et qu’elle soit du Nord ou du Midi, nous nous inclinons devant elle, nous quipouvons aussi nous connaître en héroïsme. Elle n’est pourtant pas ce qui m’a frappé le plus dans ce livre. La bravoure, elle est partout, dans les Balkans ; plus rare y est la générosité chevaleresque, dont M. Barby nous cite non moins d’exemples. D’où vient-elle aux Serbes ? On les a appelés quelquefois des Slavo-Latins ou des Celto-Slaves ; on a parlé aussi de l’action sur eux de la culture française. Il serait plus simple, et de notre part plus modeste, de penser à leur tradition féodale, que les Turcs n’ont pu étouffer tout à fait, et surtout à leur tradition chrétienne. Je relisais hier l’histoire d’un de leurs rois du Xesiècle, saint Vladimir, qui, mandé à la cour du Tsar bulgare, son allié ou son suzerain, et quasi sûr que la mort l’y attend, y va pourtant pour que son peuple ne souffre pas. Il y a encore de l’âme de saint Vladimir dans l’âme serbe.
Disons-le pourtant, ce n’est pas la résignation ; dans les négociations qui se poursuivent pour le partage des territoires qu’ils ont conquis, les Serbes n’entendent pas se sacrifier comme l’a fait, pour eux, leur premier saint. Qui s’en étonnera ? Et pourtant, tous les amis des Slaves, et avec eux quiconque désire simplement un peu de progrès en notre Europe, souhaite que cette lutte fratricide n’ait pas lieu. Puisse l’unanimité du monde civilisé agir sur qui se refuserait à la conciliation ! puissent rester blanches les pages par lesquelles il faudrait continuer ce livre en cas d’une guerre nouvelle ! Aucune victoire n’y ferait revivre au vainqueur les heures inoubliables d’après Koumanovo !
Émile HAUMANT.
Paris, 18 juin 1913.
Le 16 octobre 1912, je rentrais à Paris après une longue absence nécessitée par les services du Journal. À midi, je venais rendre compte de ma mission à mon rédacteur en chef, M. Lauze.
– Voulez-vous aller faire un tour dans les Balkans ? me proposa-t-il.
– Très volontiers, répondis-je.
Le lendemain soir, 17 octobre, rapidement équipé, je quittais Paris, et le 18, vers 11 heures du soir, l’Express-Orient s’arrêtait à Buda-Pest ; la guerre avait fait de cette gare le point terminus du train.
Force était de passer la nuit dans la capitale hongroise, où m’arrivaient déjà les échos de la lutte qui s’engageait dans la péninsule.
– Vous êtes journaliste ?… vous allez en Serbie ? vous serez expulsé, m’avait-on affirmé à mon passage à Vienne.
À Buda-Pest ce fut pis :
– Hier, m’assura-t-on, deux correspondants de journaux qui voulaient traverser le Danube pour télégraphier sur notre territoire ont été arrêtés et jetés en prison… Un appareil photographique !… mais on va vous prendre pour un espion !…
« Bigre ! pensai-je, le métier ne va pas être gai ! »
Pourtant, à l’hôtel où j’étais descendu, je m’endormis paisiblement, et à 7 heures du matin, le 19, je prenais un train pour Semlin.
Depuis Buda-Pest, je me croyais déjà dans l’un des pays belligérants. Les gares étaient occupées militairement. Partout des cliquetis d’armes, des mouvements de troupes, une surveillance étroite.
À Semlin, me voici aux prises avec un gendarme et un douanier hongrois ; ni l’un ni l’autre n’ont la moindre notion du français ; quant aux quelques mots allemands que je baragouine, ils ne les comprennent pas ou ne veulent pas les comprendre.
La nuit vient, il pleut, d’une pluie fine et continue. Heureusement la Providence des reporters m’apparaît sous les traits d’une dame serbe, « gouvernante, me dit-elle, dans une grande famille ». Avec une bonne grâce dont elle trouvera ici le remerciement, si jamais elle connaît ce livre, elle s’ingénie à me tirer d’affaire et y réussit, non sans peine.
Enfin je traverse le Danube et débarque en Serbie, à Belgrade, devant la vieille forteresse.
Un officier s’enquiert de mon identité ; je présente mon passeport : « Paris… journaliste… » constate-t-il. Aussitôt, en pur français : « Vous venez suivre les opérations de la guerre ?… Soyez le bienvenu. »
Poignées de mains. Me voilà réconforté. N’empêche que ma première impression sur le pays est franchement détestable.
Par des rues défoncées, auprès desquelles la rue Ravignan, à Montmartre, peut passer pour dépourvue de pente, sur des blocs de pierre, vestiges des siècles passés, aussi énormes qu’irréguliers, la guimbarde préhistorique qui me véhicule m’amène au centre de la ville.
Là, après quelques bonds désordonnés, au beau milieu d’une rue, mon cocher, stoppant brusquement, descend de son siège et par gestes m’indique qu’il ne peut nous conduire plus avant, moi et mes bagages.
Il est impossible, en effet, d’avancer davantage.
La mobilisation, en enrôlant toute la population mâle du pays, a arrêté net les travaux de la société de pavage – française – qui travaille à remplacer dans les rues les grosses dalles difformes par un pavage en bois.
Je suis à 150 mètres de l’hôtel en pleine boue. Et quelle boue !
C’est à me croire aux plus mauvais jours des travaux du Métro !
À peine installé à l’hôtel, je cours toute la soirée, parmi les fondrières, de ministère en ministère. Partout, dans les rues, dans les antichambres, dans les bureaux, le monde est en tenue de guerre, voire en armes. On se dirait non dans une grande ville, mais dans une vaste caserne.
Le départ des correspondants de guerre pour Nisch, siège du quartier général, est fixé au lendemain matin. Il s’agit d’être en règle pour prendre ce train. Ah ! les fonctionnaires ne traînent pas dans les bureaux serbes ! En deux heures, tout ce qui me concerne est réglé.
Il ne me reste plus avant le départ qu’à entendre les recommandations du capitaine d’artillerie Milan Georgevitch, qui doit nous piloter, et du chef du bureau de la presse, M. Dragomir Stéfanovitch :
« Nous ne vous demandons aucune bienveillance. Nous exigerons seulement que vous disiez la vérité… Sous cette condition, vous serez libre d’écrire tout ce que vous verrez. »
De fait, la censure n’a jamais fonctionné aux dépens de mes dépêches que dans deux cas : lorsque j’indiquais les mouvements et opérations futures des armées et quand je parlais de l’aide que la Serbie, sa tâche accomplie, donnait à ses alliés bulgares, grecs et monténégrins.
Dans le premier cas, force m’était de m’incliner, car la publication de mes dépêches pouvait donner des indications à l’armée turque et contrecarrer ou même faire échouer les plans de l’état-major serbe.
Dans le second : « Ne parlez pas, me disait-on, des renforts que nous envoyons à nos alliés, cela froisserait peut-être leur amour-propre. » « Ce que nous faisons est tout naturel, ajoutait dame Censure pour calmer la mauvaise humeur que me causaient alors ses ciseaux, nos alliés en feraient certainement autant pour nous si nous avions besoin d’eux. »
Si la censure se montra débonnaire, combien souvent pestâmes-nous contre la lenteur du télégraphe et contre les difficultés que nous avions à soutirer des détails sur les victoires et sur la marche des armées qui opéraient loin de nous !
Quatre armées serbes, en effet, envahissaient l’empire ottoman ; nous ne pouvions les suivre simultanément et l’état-major avait, je le reconnais, autre chose à faire qu’à nous renseigner ; peut-être eût-il pu – ceci soit dit sans la moindre mauvaise humeur – se placer à un point de vue un peu moins strict et tenir compte, dans une plus large mesure, du rôle moderne de la presse.
– Nous n’avons pas besoin de réclame ! répondait le général en chef Poutnik à ceux qui lui portaient nos doléances.
La mobilisation serbe, décrétée le 30 septembre, s’était accomplie avec une facilité prodigieuse.
Ceux qui en avaient été témoins m’en firent le récit, pendant que le train m’emportait vers Nisch.
Dans la nuit même qui suivit la publication du décret appelant la nation aux armes, le pays tout entier, jusque dans les endroits les plus reculés où n’arrive pas le télégraphe, avait connu l’ukase.
Dans les villages, les cloches sonnèrent le tocsin, des bombes furent tirées, et pour prévenir la population des campagnes plus éloignées, de grands feux préparés à l’avance brûlèrent toute la nuit sur les hauteurs.
À l’aube, les soldats convoqués gagnèrent, à cheval ou à pied, les points de concentration.
Tous les hommes valides, même les dispensés, se présentèrent, amenant avec eux et sans qu’il eut été besoin de réquisition, tout ce qui pouvait être utilisé par l’armée : chevaux, bœufs, chariots, etc…, chacun donnant ce qu’il avait, ce qu’il pouvait, sans même songer à une indemnité, dans l’idée seule d’aider à la victoire.
Pas de manifestation, pas de cris, pas d’exaltation. Le pays, conscient des difficultés qu’il allait rencontrer, montrait simplement sa décision d’obtenir coûte que coûte le succès.
Nulle part l’autorité n’eut à intervenir, chacun se présentant volontairement pour accomplir son devoir…
En quittant Paris, je croyais très sincèrement à la victoire des Turcs. Mais ma conviction s’ébranla vite quand je me fus rendu compte du patriotisme des Serbes, de leur esprit de sacrifice et de leur volonté de vaincre. Et leur enthousiasme me gagna.
En quarante-huit heures, toutes les forces militaires serbes étaient réunies. L’effectif prévu était même dépassé de près de 100 000 hommes, et ce furent les fusils à tir rapide qui manquèrent.
Le troisième ban (territorial) ne reçut que de vieux fusils. Il devait être employé aux services de garnison et de protection dans le pays même ; plus tard, au besoin, dans les territoires conquis. Un fait sans précédent dans les armées européennes se produisit et mérite d’être signalé : ces territoriaux voulaient aller au feu avec les troupes de l’active et de la réserve.
En trois jours, 95 % des réservistes furent incorporés et au bout de la semaine le chiffre des incorporations atteignait 98 % des inscrits.
Les 2 % non incorporés se composaient de malades qui, pour la plupart, se présentèrent quand même, sollicitant leur admission dans les rangs.
– Nous guérirons en route, affirmaient-ils.
Les cavaliers de la réserve fournirent leurs chevaux. Les armes, l’équipement et le matériel de guerre, le train, les vivres, les munitions étaient en quantité suffisante et en bon état ; le trésor de guerre s’élevait à 100 millions de francs.
On imagine difficilement comment une telle organisation, si parfaite qu’elle permit à la Serbie, dès la mobilisation, non seulement d’accomplir sa tâche, mais de fournir assistance à ses alliés, put être en quatre ans mise à point.
Comment ne pas s’étonner d’un effort si rapide, quand on se rappelle qu’au moment de l’annexion de la Bosnie par l’Autriche (1898) la Serbie était hors d’état de faire entendre utilement une protestation quelconque. À Belgrade et dans les villes, la mobilisation avait été accueillie avec une profonde joie. Le jour de sa proclamation avait été comme un jour de fête ; dans les rues les gens s’abordaient la joie au visage et s’étreignaient. On s’embrassait sans se connaître. Partout, ce fut une véritable explosion de patriotisme.
Voici la formidable armée que ce petit pays de 2 900 000 habitants – ce n’est même pas la population de Paris – avait mise sur pied en une quinzaine de jours :
En outre,
Dans les postes frontières se trouvaient :
Les troupes de protection se composaient de :
Ce qui donne pour l’armée d’opération :
Enfin, il resta dans le pays :
En résumé, la Serbie eut 402 000 hommes sous les armes, presque 14 % de sa population totale.
Avec cette armée, j’ai parcouru la Macédoine jusqu’à la signature de l’armistice ; plus tard, lors de la reprise des hostilités, j’ai vécu avec elle, comme volontaire serbe, devant Andrinople ; après l’avoir vue à l’œuvre, je puis le proclamer : cette armée-là peut être comparée aux meilleures armées européennes.
Sa valeur fut une révélation non seulement pour l’Europe, mais pour la Serbie elle-même, qui ne se doutait pas avant la guerre de ce dont elle était capable.
Or un mois lui suffit pour balayer de la vieille Serbie, de la Macédoine et de l’Albanie les Turcs qui depuis plus de cinq siècles maintenaient ces contrées sous leur domination.
Dans ces régions, terriblement accidentées, où les routes ne sont guère tracées que sur la carte, par la pluie et le froid dans la neige et dans la boue, certaines de ces troupes progressèrent en moyenne de vingt-deux kilomètres par jour, illustrant leur marche, à elle seule surprenante, de combats presque quotidiens et de victoires désormais célèbres.
Un exemple suffira pour donner une idée de l’entrain et de la résistance des armées serbes. La division de la Morava (deuxième ban), par conséquent composée d’hommes âgés de trente à trente-huit ans, entra à Monastir un mois, jour pour jour, après avoir franchi l’ancienne frontière à Merdari. En trente jours, elle avait livré 27 combats, 21 de jour et 6 de nuit !
À la fin de la campagne, je rencontrai à Uskub le général Herr, commandant l’artillerie de notre 6e corps d’armée à Châlons-sur-Marne.
Profitant de son congé annuel, il était venu, simple touriste, attiré vers cette armée serbe, dont les successives prouesses emplissaient les colonnes des journaux du monde entier. C’était le 30 novembre, après un mois et demi d’une campagne terriblement pénible. Le calme, la discipline, le bon aspect des troupes faisaient l’admiration du général.
– On dirait qu’elles sortent de leurs quartiers ! s’écriait-il.
Et le général Herr éprouvait une satisfaction profonde en constatant que l’artillerie serbe, la nôtre, avait donné toute satisfaction.
– Officiers et canonniers ont su en tirer tout le parti possible, et s’ils font de nos canons du Creusot des éloges, que n’en doit-on pas, me déclara-t-il, à ceux qui s’en servent si bien !
Et me parlant de l’armée serbe en général, il concluait :
– Je ne puis faire la moindre restriction à mes éloges : ce n’est plus une jeune armée, c’est une grande armée !
Un autre officier supérieur français, le lieutenant-colonel Fournier, notre attaché militaire en Serbie, fut enthousiasmé comme l’avaient été le général Herr et tous ceux qui suivirent cette guerre mémorable. Dans les lignes suivantes il m’a confié le résultat de ses observations :
« Je suis revenu de la campagne de Macédoine, rempli d’admiration pour le soldat serbe : brave, discipliné, remarquablement résistant, supportant avec bonne humeur toutes les fatigues et les privations d’une guerre où les conditions matérielles ont été particulièrement rudes et difficiles, il a fait son devoir avec la plus grande abnégation, animé par le souffle du patriotisme le plus pur.
Ses officiers, dans lesquels il a une confiance absolue et dont l’autorité s’exerce avec autant de bienveillance que de fermeté, se sont montrés largement à hauteur de la tâche difficile qui leur incombait.
Leur esprit d’initiative, le vigoureux exemple qu’ils ont toujours donné personnellement en entraînant leurs hommes au combat et en supportant les mêmes fatigues et les mêmes privations que leurs troupes, ont été parmi les facteurs les plus importants des succès rapides remportés par les armées serbes.
L’instruction des officiers d’artillerie, que j’ai eu l’occasion d’apprécier plus particulièrement, et l’habileté avec laquelle ils ont su employer leur excellent matériel de campagne expliquent la part très importante que cette arme a jouée dans les divers combats et surtout à Koumanovo.
J’ai été également très frappé de l’organisation excellente et de l’efficacité du service des convois.
Grâce aux attelages des bœufs serbes et au dévouement de leurs conducteurs, ces convois ont pu assurer le ravitaillement en vivres et en munitions des armées serbes d’une façon très satisfaisante, dans des conditions que rendirent très difficiles les mauvais chemins de la Macédoine. »
Les appréciations du général Herr et du lieutenant-colonel Fournier sont concluantes.
Ajoutons encore que le soldat serbe est aussi sobre que solide, et que la répression n’eut pour ainsi dire pas à s’exercer.
D’ailleurs la discipline de l’armée serbe, à rencontre de la discipline allemande, toute de raideur et de rigueur, est, comme dans l’armée française, paternelle et bienveillante. Elle a pour base non la violence ni la crainte, mais une autorité amicale et attentive d’où naissent un dévouement sans bornes et une confiance absolue à tous les degrés de la hiérarchie.
Avant d’aller plus loin, je crois nécessaire d’indiquer brièvement quels ont été les organismes de l’armée serbe.
Son chef suprême est le roi Pierre Karageorgevith.
Le commandement effectif était assuré par le quartier général, ayant à sa tête le chef d’état-major général, généralissime Radomir Poutnick, assisté du général Michitch.
Le quartier général comprenait 8 sections :
1° La section opérative (dirigeant toutes les opérations, comprenait en outre le bureau de la presse, le service d’espionnage, le service historique) ;
2° La section d’artillerie (s’occupant également des services de munitions en général) ;
3° La section du génie (sapeurs, pontonniers, mineurs, télégraphistes, T.S.F., etc.) ;
4° La section du personnel (permutations, promotions, avancements, décorations, etc.) ;
5° La section sanitaire (hôpitaux, ambulances, trains sanitaires, missions étrangères de la Croix-Rouge, etc.) ;
6° La section de l’intendance (ravitaillement des troupes, fourrages des chevaux et des bœufs) ;
7° La section des transports et communications (très importante surtout avant et pendant la mobilisation et la concentration des troupes) ;
8° La section de justice militaire.
Il existait en outre un quartier maître du quartier général.
L’armée serbe se compose :
De troupes du premier ban, hommes de 21 à 30 ans ; du deuxième ban, hommes de 31 à 38 ans ; du troisième ban, hommes de 39 à 45 ans.
Le recrutement est régional.
La nation est divisée, au point de vue militaire, en quinze circonscriptions qui, groupées trois par trois, forment cinq régions de recrutement fournissant chacune une division de premier ban et une division de deuxième ban ; ce sont les divisions de la Morava, de la Drina, du Danube, de la Choumadia et du Timoc.
Chacune des cinq divisions du premier ban, d’un effectif moyen de 26 000 hommes, comprenait :
4 régiments d’infanterie de 4 bataillons de 4 compagnies fortes de 250 à 270 hommes.
Chaque régiment avait en outre une section de mitrailleuses ;
Un régiment de cavalerie de 2 à 5 escadrons (suivant la plus ou moins grande richesse en chevaux de la région où avait été recrutée la division) :
Un régiment d’artillerie à tir rapide (canons Schneider de 75) composé de 3 groupes de batteries de 4 pièces ;
Un demi-bataillon de pionniers ;
Une section de télégraphistes ;
Un train de pontonniers ;
Un train de matériel du génie ;
Une compagnie d’infirmiers avec 4 hôpitaux de campagne (correspondant aux 4 régiments d’infanterie) ;
Un train sanitaire ;
Un hôpital vétérinaire ;
5 sections de train de munitions (une pour chacun des 4 régiments d’infanterie et une pour le régiment d’artillerie) ;
Un matériel mobile de réparation et de ferrage ;
Plusieurs sections administratives (boulangers, bouchers, dépôt vétérinaire, train de ravitaillement, poste militaire, etc.).
Un pope, aumônier militaire, était attaché à chaque régiment.
Outre les 5 divisions du premier ban existait une division de cavalerie indépendante sous les ordres directs de l’état-major général et commandée par le prince Arsène Karageorgevitch, avec 2 batteries d’artillerie montées à tir rapide, des sapeurs, des télégraphistes, etc. ; au total, 12 000 hommes environ.
Chacune des 5 divisions du deuxième ban, d’un effectif moyen de 18 à 20 000 hommes, comprenait :
Trois régiments d’infanterie (même composition que dans les divisions de premier ban) ;
Un régiment de cavalerie à 3 escadrons ;
Un groupe de 3 batteries d’artillerie de 4 pièces à tir rapide (canons Schneider de 75).
(Par exception, la division du Danube, deuxième ban (armée du général Stépanovitch, autour d’Andrinople), avait été renforcée et comprenait 2 groupes de 3 batteries et un quatrième régiment d’infanterie.)
Les autres armes, proportionnellement à la force de ces divisions de deuxième ban, avaient la même organisation que dans les divisions de premier ban.
Le troisième ban comprenait 15 régiments d’infanterie, un par circonscription, avec les mêmes effectifs que les régiments du premier et du deuxième ban ; les cadres étaient composés d’officiers d’active et de réserve.
Pour augmenter les effectifs, 6 régiments d’infanterie surnuméraires du premier ban avaient été créés en grand secret.
Le premier et le deuxième de ces régiments formèrent la brigade indépendante de la Morava, chargée d’établir la liaison entre la première et la deuxième armée.
Le troisième fut incorporé dans la brigade de Javor.
Le quatrième renforça la division du Danube, deuxième ban, autour d’Andrinople.
Le cinquième opéra avec l’armée de l’Ibar.
Le sixième forma la garde spéciale du quartier général.
Enfin, en plus de ces 41 régiments d’infanterie (20 de premier ban, 15 du deuxième ban et 6 surnuméraires), 41 bataillons complémentaires (un par régiment) avaient été formés avec des hommes du premier et du deuxième ban.
Ils servirent, au cours de la campagne, à combler les vides (tués, blessés ou malades) de façon à maintenir, autant que possible, dans chaque régiment une force numérique constante.
L’artillerie lourde de siège, ses cadres et ses servants ne sont pas indiqués dans ce bref exposé des forces de l’armée serbe, qui utilisa 80 pièces de siège au cours de la campagne.
En Serbie, le service, obligatoire pour tous, est d’une durée de deux ans pour l’artillerie et la cavalerie, et d’un an et demi pour l’infanterie et les autres armes. Les étudiants diplômés et les soutiens de famille profitent de certaines dispenses qui abrègent le temps de leur présence sous les drapeaux.
Les sous-officiers sont recrutés de deux façons : ceux qui sortent du rang et ceux qui passent par des écoles spéciales pour chaque arme.
Les officiers sortent également du rang, de l’académie militaire serbe ou des écoles militaire de l’étranger (de France, de Russie et, en faible proportion, d’Autriche).
La mobilisation, décrétée par ukase du roi signé le 30 septembre 1912, commença le 3 octobre.
Le 30 septembre, un deuxième ukase décrétait la formation et la composition des armées serbes :
La première armée, commandant en chef Son Altesse Royale le prince héritier Alexandre, était forte de six divisions.
Les divisions de premier ban de la Morava, de la Drina et du Danube, les divisions de deuxième ban du Danube et du Timoc et la division indépendante de cavalerie.
En plus de l’artillerie de corps, elle avait à sa disposition de l’artillerie de montagne, des obusiers et des mortiers.
La deuxième armée, commandant en chef le général Stépan Stépanovitch, était formée par la division du Timoc, premier ban, une division bulgare et, en plus de l’artillerie de corps, de 2 batteries de montagne et de 2 batteries d’obusiers.
La troisième armée, commandant en chef le général Boja Yankovitch, comprenait la division de la Choumadia, premier ban, les divisions de la Drina et de la Morava, deuxième ban, et la brigade indépendante de la Morava (premier et deuxième régiments d’infanterie surnuméraires), premier ban. En plus de l’artillerie de corps, elle avait 2 divisions d’artillerie de montagne, 2 batteries d’obusiers et 2 batteries de canons de 12 centimètres, modèle 1897.
La quatrième armée, qui se subdivisait en deux colonnes :
1° L’armée de l’Ibar, du général Michel Jivkovitch, composée de la division de la Choumadia, deuxième ban, et du cinquième régiment d’infanterie surnuméraire, avec une division d’artillerie de montagne, 5 batteries d’obusiers et 1 batterie de canons de 12 centimètres, modèle 1897 ;
2° La brigade indépendante de Javor, du colonel Milivoï Andjelkovitch, composée du 4e régiment d’infanterie du deuxième ban, du 3e régiment d’infanterie surnuméraire, du 5e





























