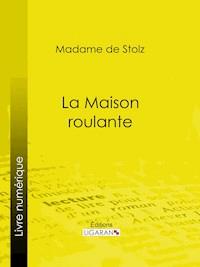
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Rien de plus joli que la demeure où s'écoulait l'enfance du petit Adalbert ; c'était la campagne de la Normandie avec ses haies, ses buissons, ses grands prés, ses champs dorés, tous ses parfums, toutes ses fleurs. Ces trésors, Adalbert les partageait avec les enfants du canton, car Dieu a mis pour tous du bonheur dans la plaine..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rien de plus joli que la demeure où s’écoulait l’enfance du petit Adalbert ; c’était la campagne de la Normandie avec ses haies, ses buissons, ses grands prés, ses champs dorés, tous ses parfums, toutes ses fleurs.
Ces trésors, Adalbert les partageait avec les enfants du canton, car Dieu a mis pour tous du bonheur dans la plaine ; mais ce dont le petit garçon jouissait seulement avec ses frères et sa sœur, c’était une grande et belle maison dont les fenêtres donnaient sur une jolie pelouse, où l’on admirait deux corbeilles de roses, les plus délicieuses qu’on pût voir. Il y avait de tous côtés des arbres verts, des peupliers, des hêtres, des chênes, des ormes, entre lesquels couraient tantôt des allées capricieuses, tantôt de l’eau bien claire où se plaisaient de beaux poissons.
Au fond du parc était un labyrinthe formé de lilas et de clématite, où l’on se perdait pour de bon, tant il y avait de détours. Ce labyrinthe semblait avoir été fait tout exprès pour jouer à cache-cache, et Adalbert s’y amusait de tout son cœur à chercher ses frères, Eugène et Frédéric, ou sa sœur Camille.
À cinquante pas du château, on voyait sur une pièce d’eau une barque coquette peinte des plus riantes couleurs. Cette barque était le point de mire de tout ce petit monde. Une promenade sur l’eau, au clair de lune, voilà quel était le plus désiré des divertissements à Valneige. Cela venait sans doute de ce que les enfants n’obtenaient cette faveur qu’après l’avoir gagnée par des bons points, des très bien, et des parfaitement bien à n’en plus finir. Il n’y a pas de meilleur plaisir que celui dont l’accomplissement du devoir est la cause.
Tout près de la pièce d’eau, il y avait une grande et belle ferme appartenant aux parents d’Adalbert : une douzaine de vaches dans une longue étable, plus un taureau qui faisait peur, tout en vous regardant avec des yeux bien doux.
Plus loin une grande écurie occupée car sept ou huit chevaux de labour, hauts et robustes. En face, quatre cents moutons se serrant les uns contre les autres, vivant heureux, tranquilles comme des moutons ! Dans la cour, dans l’écurie, dans les étables, sur le fumier, sous les hangars, partout, des poules, des poulets, des coqs, des oies, des canards, tout un peuple de petits êtres voltigeant, pondant, se baignant, se battant, et se moquant du monde avec un sans-façon incroyable.
La mère Barru était la reine de ce paisible empire, autrement dit la fermière ; elle avait bonne tête, et sa belle humeur ne cessait qu’en deux occasions : quand un garçon de ferme se grisait, et quand une poule perdait ses œufs au loin. Dans ces deux cas, jugés pendables, le garçon et la poule étaient grondés pendant toute la saison ; s’il y avait récidive, on mettait à la porte le garçon, et dans la marmite la poule.
On peut se figurer combien douces étaient les premières années d’Adalbert, s’écoulant entre les jeux et de faciles travaux, sous les yeux d’un bon père et d’une bonne mère. Eugène et Frédéric, tous deux plus âgés que lui, allaient partir pour le collège au grand désespoir d’Adalbert qui les aimait beaucoup, tout en se disputant avec eux le plus souvent possible. Les grands, comme on disait à Valneige savaient qu’on ne doit jamais abuser de sa force, et comme ils eussent certainement terrassé Adalbert, si petit et si mince, ces bons enfants consentaient, suivant le conseil de leur excellente mère, à céder dans ces rencontres journalières où l’on se cherche querelle, à propos d’une bille ou d’une toupie.
Quant à la bonne Camille, c’était la douceur même, et, quoiqu’elle eût près de quatorze ans, elle voulait bien jouer souvent aux dames avec son petit frère qui, sans doute à cause de ses huit ans, confondait plus d’une fois ses pions avec ceux de son adversaire. Camille avait l’extrême patience de sa mère, et le caractère sérieux de son père. M. et Mme de Valneige, lui donnant un très grand témoignage de confiance, avaient permis qu’elle s’occupât de la première éducation d’Adalbert, qui l’appelait volontiers petite maman. La chère enfant, à la faveur des verbes et des dictées, l’appelait quelquefois, elle, mon fils, en prenant un air très grave qui faisait rire aux larmes M. de Valneige.
Tout était réglé à la campagne, les heures des repas, celles de l’étude, et celles des récréations. Comme la régularité en tout est une excellente chose, il y avait au château deux horloges : une sonnante et une vivante. La première était suspendue au fond du vestibule ; la seconde montait et descendait l’escalier trente ou quarante fois par jour ; elle entrait dans les chambres, allait, venait, trottait, grondait, elle savait tout, et voyait tout. Ah ! quelle horloge ! On l’appelait Rosette. Ce joli petit nom lui avait été donné sans doute par une marraine qui pensait que sa filleule ne vieillirait pas ; néanmoins, comme il y avait de cela soixante-dix ans, la filleule avait des rides, les mains maigres et les joues creuses. C’était une toute petite bonne femme bien leste, un peu roide, mais très bonne et toute dévouée à la famille et à la maison. Il y avait si longtemps qu’elle était là, que personne ne se figurait Valneige sans Rosette, ou Rosette hors de Valneige. La vieille bonne avait gardé ses cotillons courts d’autrefois, ses bonnets plats par devant et plissés par derrière, son grand fichu blanc à fleurs rouges ; enfin ce qu’elle appelait le costume de chez nous.
Rosette avait un esprit exact jusqu’à la minutie ; elle reconnaissait l’heure au chant du coq, à l’ombre des arbres, au cri des oiseaux, à des tiraillements d’estomac qu’elle avait à certains moments, et à des inquiétudes dans les jambes qui lui prenaient un peu plus tard. De là, une incroyable sévérité dans l’observance de toute règle établie. Si Rosette eût mené le monde, on aurait fini par se plaindre tant il eût marché droit, tout comme on se plaint tant il marche de travers.
À cause de cet esprit rigide, on avait surnommé la vieille Rosette l’horloge vivante de Valneige, et vraiment on aurait pu à la rigueur se passer de l’autre horloge qui ne savait que sonner comme une vraie machine qu’elle était. Un coup d’œil de Rosette envoyait au travail tous les petits paresseux qui flânaient dans l’escalier à l’heure des leçons ; un geste faisait accourir les plus mutins du fond du parc ; enfin, dans les circonstances qui en valaient la peine, sa voix impérative forçait chacun à rentrer dans le devoir, quel que pût être l’entraînement présent. Au lieu de dire : l’horloge va sonner ; on disait : Rosette va passer ; et le régiment défilait l’arme au bras, sans souffler mot.
M. et Mme de Valneige trouvaient fort bonne cette surveillance qui rendait la leur plus facile, et les enfants eux-mêmes, tout en craignant un peu les airs fâchés que la vieille savait prendre, l’aimaient néanmoins parce qu’elle était juste, parce qu’elle faisait les confitures, et parce que c’était encore elle qui se prêtait le mieux à leurs innocents caprices, pourvu que ces caprices ne s’avisassent pas de naître avant telle heure, ou après telle autre. Le cadran avant tout.
Adalbert était un bon enfant aux yeux vifs, au sourire fin, bien pris dans sa petite taille, souple comme une gazelle, adroit, léger à la course, et capable de toutes les gentillesses possibles. Sa figure était heureuse, c’est-à-dire qu’elle avait, quand il était sage, cette aimable et fraîche expression qui prévient les étrangers en faveur d’un enfant.
On était bon pour lui, on se faisait une joie de lui procurer du plaisir, et pourtant, quand on le connaissait bien, on voyait qu’il avait un défaut, un très grand défaut… Il était désobéissant !
Au lieu de se rappeler que toutes les personnes qui l’entouraient savaient beaucoup plus que lui, il se posait en connaisseur, et prétendait qu’il pouvait sans inconvénient faire telle ou telle chose défendue.
Évidemment il se trompait, car lors même qu’il n’en résulte aucun dommage apparent, le mal de la désobéissance est réel, et vaut la peine d’être redouté à cause des grands malheurs qui le suivent ordinairement.
Avez-vous jamais vu un petit garçon qui fuit les regards de ses parents ? qui va dans tel endroit précisément parce qu’il ne faut pas y aller ? qui touche à ceci, à cela, uniquement parce qu’on le lui défend ? qui semble ne pouvoir bien s’amuser qu’aux heures destinées au travail ? qui parle pour le plaisir de bavarder au beau milieu du silence ? qui ne sait qu’inventer pour se soustraire au règlement ? Si vous connaissez un petit garçon qui ressemble à ce portrait, vous pouvez vous dire : – Voilà comme était Adalbert. – Pauvre. Adalbert ! je vais vous apprendre ses terribles aventures ; oui terribles, car mes cheveux se dressent sur ma tête quand je pense aux dangers qu’a courus cet enfant pour avoir pris l’habitude de la désobéissance.
Il y avait pourtant, dira-t-on, beaucoup de plaisirs à Valneige ? Oui, il y en avait beaucoup sans chercher à s’en procurer par la désobéissance. On pouvait courir en liberté tout autour de la maison et dans les allées adjacentes, et dans le petit bois. Les enfants, quand ils s’y mettaient, avaient bientôt fait une lieue. Il y avait un gymnase où le corps s’exerçait à devenir souple et adroit ; on grimpait à l’échelle de corde, on se balançait, on s’amusait enfin, et Adalbert avait un goût particulier pour ce genre de plaisir.
Mais c’était surtout quand de petits amis se joignaient à eux que les enfants se divertissaient. Tout le monde connaît ces parties-là : on met en commun sa bonne humeur, ses inventions, son espièglerie, cela fait un gros tas, et chacun y puise sans nuire à personne. On arrive par ce moyen à de nouveaux résultats.
À Valneige, on aimait ces réunions d’enfants, et comme le voisinage le permettait, on voyait accourir le jeudi dans l’après-midi, trois ou quatre lutins qui ne demandaient pas mieux que de s’amuser. On faisait alors mille et une gambades, un bruit à assourdir la commune, et toutes sortes de choses très innocentes, mais fort ennuyeuses pour le public. Le jeudi, Rosette regrettait son pays, son village, et jusqu’à son berceau, car elle passait ses dernières années à gémir sur le malheur de s’être attachée du fond de l’âme à ces vilains enfants, disait-elle, qui la faisaient tant enrager, et qu’elle n’aurait pas voulu quitter pour un empire.
Rosette éprouvait, comme cela nous arrive souvent, deux sensations opposées. D’une part, le besoin de se dévouer ; de l’autre, le besoin de déplorer son dévouement du matin au soir. Quand un de ses petits chéris avait du chagrin, s’il tombait, par exemple, et se cassait un peu le nez, la vieille pleurait tout en le raccommodant de son mieux, puis elle en voulait à ce nez de ce qu’il était tombé, et de ce qu’il s’était fait mal, parce que c’était lui faire mal aussi, à elle.
« Ah ! répétait-elle souvent, quel malheur d’avoir connu ces enfants-là ! J’avais bien besoin vraiment, quand mon maître est mort, de rester avec son fils pour faire du mauvais sang ! J’aurais pu, avec ce que j’avais, m’en aller tranquillement chez nous, avoir ma petite maison, mon petit jardin, mes poules, mon chat et mes aises. Au lieu de ça, il a fallu rester là ! Pourquoi faire, je vous le demande ? Ah ! c’est bien fini, il est temps que je me repose ; j’ai des parents là-bas, ils voudraient bien m’avoir. Mon parti est pris, je l’ai dit à monsieur, et sitôt la fonte des neiges, je prends la voiture et je m’en vas. »
Elle disait cela en hiver, mais quand la neige était fondue, si quelque malin lui demandait :
« Eh bien ! Rosette, quand partez-vous ? »
Elle répondait, selon la circonstance :
« Ah ! comment voulez-vous ? Frédéric a trop mal aux dents ! Faut que je lui mette tous les soirs du coton dans l’oreille avec de l’huile d’amandes douces que je lui fais chauffer, ce pauvre petit !… ou bien : – Soyez tranquille, je ne me ferais pas prier pour m’en aller si seulement mes deux grands étaient au collège, mais tant qu’ils seront là… ou bien : – Ah ! dès que je verrai mamselle Camille se tenir bien droite, je ferai mes paquets, mais j’ai trop peur que sa taille tourne… ou bien : – Sitôt que ce petit coquin d’Adalbert ne sera plus désobéissant, je m’en irai, mais d’ici là, faut que je le veille comme du lait sur le feu. »
Elle disait ainsi, la pauvre vieille, et la neige fondait, les feuilles poussaient, jaunissaient, tombaient, et Rosette était toujours là, attachée par le lien le plus fort qu’il y ait au monde : une ancienne et véritable affection.
Le jeudi, cela arrivait cinquante-deux fois par an, le jeudi Rosette croyait qu’elle n’aimait plus du tout Valneige, mais du tout, du tout ! Pourquoi ? Parce que les heures n’étaient pas distribuées comme à l’ordinaire, et qu’il était bien convenu qu’on jouait depuis midi jusqu’au dîner. Or, le jeu est une occasion excellente pour déchirer son pantalon et le reste, briser toutes sortes de choses, et se casser le cou. Voilà pourquoi la brave femme passait tout le mercredi à se dire :
« Quel dommage que ce soit demain jeudi ! »
Pour nous, qui ne gardons pas les enfants nous pouvons convenir que ces parties étaient fort amusantes. Mme de Valneige mettait à la disposition de la jeunesse tout ce qu’elle avait de raquettes, de volants, de toupies, de ballons, de quilles, de cerceaux, plus un jeu de tonneau, et je ne sais quoi encore. On commençait à midi ces joyeux ébats, et la bonne mère apparaissait de temps en temps, comme une puissance protectrice qui cause tout le bien possible, et garde de tout mal. Elle disait d’un air grave et doux :
« Allons, amusez-vous, faites tout ce qui vous plaira, je ne vous demande qu’une chose, obéissez, mes bons enfants.
– N’ayez pas peur, chère maman, disait avec un gros éclat de rire le bon Eugène, à la mine éveillée, aux joues rouges, au franc sourire, voyez-vous, nous nous amusons si bien que nous n’aurions même pas le temps de penser à désobéir. »
Sur ce, Eugène prenait le mors aux dents quand il était cheval, et faisait claquer son fouet quand il était cocher. Son heureuse mère avait à peine jeté sur lui un regard confiant qu’il était déjà loin. Quant à Frédéric, l’espèce de gravité qui lui était naturelle, même en jouant, rassurait Mme de Valneige. Mais il y avait un petit monsieur, blondin et fort gentil qui ne répondait jamais au doux avertissement de sa mère ; il se nommait bien entendu Adalbert, et on le surnommait le désobéissant !
Quand on attaquait par un mot son défaut capital, il prenait un air distrait, cherchait à attraper une mouche, s’arrangeant de manière à entendre le moins possible ce qu’on disait, et pourtant le comprenant fort bien.
Obéissez, mes enfants. Cela voulait dire : N’allez point jouer au bord de l’eau et surtout, gardez-vous de jamais toucher à la barque ! Je veux qu’on n’entre dans l’écurie qu’accompagné de Philippe, qu’on ne se mette jamais derrière les chevaux parce qu’ils pourraient lancer un coup de pied, qu’on ne s’avise point de monter sur un cheval, à moins que Philippe n’ait le temps et la complaisance de se prêter à ce jeu. Qu’on n’imagine pas de se pencher sur le bord d’un puits, ni de franchir la grille qui sépare la cour de la route, ni de courir au loin pendant la promenade, ni de s’aventurer trop près d’un moulin à vent, etc., etc., etc.
Adalbert savait par cœur ces défenses, et bien d’autres. Dès qu’il entendait sa mère résumer le tout par ces simples mots. Obéissez, mes enfants, il aurait voulu boucher ses oreilles de peur de comprendre une fois de plus tout ce qu’il ne fallait pas faire, car c’était justement ce dont il avait le plus envie, et nous verrons bientôt ce qu’il en arriva.
Quels que soient les charmes de la vie quotidienne, c’est pour nous une grande jouissance de rompre la monotonie, même dans nos plaisirs. Qu’on juge des transports de bonheur qui éclatèrent en famille lorsque M. de Valneige déclara un beau matin, pendant le déjeuner, qu’il allait mettre à exécution un charmant projet formé depuis longtemps, et tour à tour accepté, combattu, retardé. Ce projet réunissait toutes les conditions qui flattent le désir, car non seulement il était charmant, mais il se faisait attendre, et depuis un an notre petit monde en parlait tout haut et tout bas, disant : Quand donc ferons-nous le grand voyage ? quand verrons-nous Paris, Strasbourg, Vienne, Prague ? des lacs, des montagnes ?… À cette seule pensée, on sautait sur sa chaise, même en achevant sa page d’écriture, ce qui ne manquait pas d’y faire un très regrettable pâté.
Eh bien oui, c’était décidé, on partait pour l’Allemagne ; on allait voyager lentement, sans fatigue, n’ayant d’autre but que de s’instruire sans livres et de s’amuser. Il est vrai que Mme de Valneige, qui désirait particulièrement ce voyage, avait un but secret ; elle était inquiète de la santé de son mari, et les médecins jugeaient que le remède le plus actif était le changement de lieu et d’habitudes ; on espérait combattre ainsi une sorte de mélancolie nerveuse qui tourmentait M. de Valneige, et qui de temps en temps était accompagnée de quelques accès de fièvre. Son excellente femme cachait soigneusement son inquiétude pour ne pas augmenter le mal. Quant aux enfants, comme leur père n’était pas couché, et s’habillait comme tout le monde, ils trouvaient qu’il se portait à merveille.
Lorsque la décision fut connue, on battit des mains aux paroles du bon père de famille, et quand il eut dit : – Nous partons dans huit jours ; – on lui sauta au cou.
Huit jours après, toute la famille était en route ; le fidèle Gervais, domestique de confiance, suivait les voyageurs et tout le monde était enchanté, excepté la vieille Rosette qui avait versé beaucoup de larmes en voyant partir ses quatre enfants, comme elle les appelait. Dès qu’ils n’étaient plus sous ses yeux, elle les croyait perdus… pauvre vieille ! si elle avait pu prévoir… mais non, ne disons rien.
On demeura dix jours à Paris. Les enfants admirèrent surtout les promenades. La différence des âges et des connaissances acquises se faisait sentir dans la diversité de leurs appréciations. Par exemple, en face du palais des Tuileries, Adalbert ne donnait qu’un coup d’œil au monument historique, et cent coups d’œil aux petits poissons rouges qui nagent dans les bassins, et aux cygnes majestueux dont la race a vu se passer tant d’évènements, sans savoir pour cela son histoire de France. Il fut aussi très frappé de la longueur des Champs-Élysées, de la foule, des voitures ; mais ce qui le frappait davantage, et d’une façon désagréable, c’était l’obligation qu’on lui imposait de donner la main. Ceci lui parut insupportable, et nuisit considérablement dans son esprit aux splendeurs de la capitale. Lui, si libre à Valneige, n’était-il donc venu à Paris que pour y être traité comme une petite fille ? Fi donc ! un homme ! Hélas ! le pauvre enfant, s’il avait pu se douter… mais non, il n’est pas encore temps.
Après avoir vu de Paris ce qui peut surtout plaire à des enfants, M. de Valneige prit le chemin de fer de l’Est, et, tout en s’arrêtant aux stations intéressantes, on finit par arriver à Strasbourg où l’on vit avec admiration la cathédrale, ce chef-d’œuvre qui atteste le développement successif de l’architecture gothique, depuis son origine dérivée du plein cintre, jusqu’au fini qui se remarque dans la nef principale.
La grande horloge astronomique, dont les heures sont marquées par des statues qui vont et viennent, étonna et charma nos jeunes voyageurs, bien plus que le transept et la façade. Quant au petit Adalbert, en dépit des savants architectes, en dépit même de Vauban et de sa citadelle pentagone, il ne vit dans Strasbourg qu’une chose : le coq qui chante sur la tourelle latérale au moment où midi sonne à l’horloge merveilleuse, et où tous les apôtres apparaissent ensemble.
Dire que c’est un coq pour rire et qu’il chante tout de même ! c’est un peu fort !
Le petit garçon fut donc ravi, non précisément de Strasbourg, mais du coq qui pour lui remplissait Strasbourg. Cependant, cette belle et majestueuse ville avait, elle aussi, un très grand inconvénient… il fallait donner la main !
On partit pour Vienne, et l’on s’arrêta le long de la route, comme on avait fait de Paris à Strasbourg. M. de Valneige ayant résolu de séjourner au moins huit jours dans la capitale de l’Autriche, on eut le temps de voir beaucoup de choses, et de se promener à loisir dans la grande allée du Prater et ailleurs. Les enfants ne se lassaient point d’admirer ce qu’on appelle le Prater sauvage, et qui n’est en partie qu’une forêt antique où paissent des cerfs et des chevreuils. Ces beaux animaux, joignant les avantages de la vie domestique aux charmes de la liberté, entendent chaque soir le son du cor, et se rendent près de la maison de plaisance, où les attend une distribution de fourrage. Eugène et Frédéric trouvaient l’idée parfaite, et ils avaient raison.
Le père de famille mena ses fils à l’arsenal, et leur fit visiter les différents ateliers où se fabriquent les armes. Ils y passèrent trois heures et décidèrent en sortant qu’ils se prépareraient pour Saint-Cyr.
Mme de Valneige ayant témoigné le désir de parcourir les environs de Vienne, en longeant par le chemin de fer la rive droite du Danube, toute la colonie s’ébranla. On vit d’abord Schonbrunn, château de plaisance impérial, achevé sous Marie-Thérèse. Dans ce château, on remarqua la chambre où Napoléon signa le traité de Schonbrunn en 1809, et où mourut vingt-trois ans plus tard, par l’instabilité des choses humaines, son fils le duc de Reichstadt. Adalbert, vu sa grande jeunesse, fut moins frappé de ce contraste historique que des trente-deux statues de marbre qui ornent le parterre des palmiers, de l’obélisque, de la belle fontaine qui a donné son nom au château, et surtout du lion, du tigre, et autres animaux qu’on voit dans la ménagerie.
Le château de Luxembourg fut aussi visité. Ce qu’Adalbert remarqua le plus, en fait de souvenirs autrichiens, ce fut les vieilles carpes dorées qu’il aperçut dans l’étang lorsqu’on revint du château à la gare ; il leur donna du pain qu’elles daignèrent accepter comme l’avaient fait les petits poissons rouges des Tuileries. On voit qu’Adalbert avait des succès, non seulement en France, mais en Autriche.
Les huit jours passés à Vienne s’étant écoulés rapidement, on s’achemina vers Prague, toujours en s’arrêtant aux grandes stations. Adalbert quitta Vienne sans chagrin, il trouvait qu’il y avait dans la capitale de l’Autriche quelque chose de fort ennuyeux, un véritable et très grand inconvénient… il fallait donner la main ! On ne peut se figurer quel était l’esprit d’indépendance de ce petit bonhomme. Obéir était pour lui un supplice. Pauvre, pauvre Adalbert !…
On se réjouissait fort d’entrer en Bohême. Ce nom, disait Camille, avait quelque chose de bien étranger, d’intéressant, et même d’un peu effrayant ; il lui semblait qu’il ne devait y avoir dans ce pays que ce qu’on appelle des diseuses de bonne aventure.
M. de Valneige, qui ne perdait pas une occasion d’instruire ses enfants, leur fit en quelques mots l’historique de ce plateau élevé, qui est comme enfermé dans une ceinture de montagnes, et sillonné lui-même par des rameaux de ces montagnes.
Il leur apprit à ne pas confondre les Bohèmes et les Bohémiens.
Les Bohèmes sont les habitants du pays, qui mènent notre vie à tous. Les Bohémiens forment un peuple à part qui a conservé les traits caractéristiques d’une peuplade vagabonde qu’on vit au quinzième siècle se répandre en Europe, et particulièrement en Bohême, en Hongrie, en Italie, en France et en Espagne ; il y a de ces tribus nomades dans tous ces pays ; le nom change, mais les mœurs ne changent pas. En France on les appelle Bohémiens ; en Espagne Gitanos ; en Italie Zingari, en Angleterre Gypsies.
Ce peuple offre un très singulier spectacle au milieu de notre vieux monde. Méprisé, pourchassé, pendant trois cents ans, et néanmoins toujours debout, toujours errant, dérobant sur son passage, et disant la bonne aventure. On conçoit que, précisément à cause de leurs habitudes étranges, ils se marient entre eux. Ainsi se perpétue cette race indépendante, redoutée non sans raison, et vivant au milieu de la foule sans se mêler à elle, si ce n’est pour lui débiter des folies et des mensonges, l’amuser un moment, et en tirer le peu qu’il faut pour subvenir à des besoins très restreints.
En certains endroits néanmoins, les Bohémiens ne sont pas errants ; ceux qu’en Espagne on nomme Gitanos habitent des quartiers séparés dans Cordoue et dans Séville ; mais partout ils parlent la même langue ; cette langue est douce, harmonieuse, et dérive du slave.
Ce qu’il y a de remarquable, c’est le respect profond que ces hommes indépendants ont pour leur propre chef. Leur entêtement, leur obstination tombe devant l’autorité de celui d’entre eux qui les commande, et il faut convenir qu’en cela du moins, ils font mieux que nous. On fait remonter leur origine aux anciens Perses qui vinrent s’établir en Égypte lorsque Cambyse, l’indigne fils de Cyrus, s’empara de cette belle contrée ; on sait que ce fut au moyen des chiens et des chats qu’il mit en tête de son armée, et sur lesquels les Égyptiens n’osèrent lancer leurs flèches parce que, à leurs yeux, ces animaux étaient sacrés. À l’appui de cette opinion sur l’origine de ce peuple singulier, la physionomie belle et expressive de la plupart des Bohémiens rappelle le type persan. Certains chants anciens, qui se sont perpétués dans cette race, donnent aussi à penser que l’Égypte les a vus jadis, entre autres une sorte de complainte dans laquelle ils célèbrent les beautés du Nil, et lui envoient de plaintifs regrets.
Les Bohémiens ont en général les membres nerveux et bien faits, et sont doués d’une grande souplesse de corps. Leurs femmes ont la taille mince, flexible, les mouvements gracieux, et, il faut le dire à leur louange, chez elles a persisté, à travers leur demi-sauvagerie, un respect admirable pour leur honneur : elles sont remarquables surtout en Espagne, par la sévérité de leurs mœurs.
Voilà donc nos voyageurs en Bohême. Prague les enchanta par ses maisons disposées en terrasse, soit dans la plaine, soit sur les collines, par son palais royal, ses tours, ses tourelles, ses clochetons, et par les hauteurs qui dominent les deux rives de la Moldau. Cet aspect est en effet très frappant, et quand on est en face de ces beautés, on se sent réellement bien loin de la Seine, ce qui charme toujours les Français en voyage, bien qu’ils reviennent au pays avec une joie sans pareille.
Adalbert était particulièrement ravi de ne rien comprendre en passant auprès des promeneurs qui faisaient entre eux la conversation. Plus de la moitié parlaient bohème, et les autres allemand.
« Je suis content, disait le petit homme, moitié riant, moitié sérieux, je suis content parce que je voyage à l’étranger !
– Raison de plus pour donner la main, » répondait Camille qui, par instinct féminin, partageait la perpétuelle inquiétude de sa mère au sujet du petit désobéissant. Elle avait beau dire, il ne l’écoutait guère, et il fallait un ordre bien positif de son père ou de sa mère pour le forcer à donner la main ; encore s’échappait-il très souvent pour voir ceci ou cela, et ces méfaits causaient une sorte de petite guerre dans laquelle les armes n’étaient pas toujours courtoises.
La vue du pont à seize arches jeté sur la Moldau excita l’attention de nos voyageurs. En effet, avec ses tours antiques, ses statues en pierre, et ses sanglants souvenirs, il ressemble à un vieux guerrier qui a bien défendu son drapeau. Comment ne pas rendre hommage en passant à la statue en bronze de ce noble patron de la Bohême, généreux martyr du secret inviolable de la confession ? On a pris soin d’indiquer à tous les siècles l’endroit précis où le prêtre, pour ne pas perdre son âme, consentit à perdre son corps plutôt que de manquer au profond secret du sacrement. Il fut noyé dans la Moldau, par l’ordre barbare de l’empereur Wenceslas. Les chrétiens de son temps l’admirèrent, et ceux d’aujourd’hui s’en vont encore chaque année par milliers, au jour anniversaire de son supplice, regarder en ce lieu la Moldau qui parle et parlera toujours de saint Jean Népomucène.
On remarqua le quartier occupé par la noblesse bohème, et toute cette partie de la ville que borne au nord le palais archiépiscopal. Puis on alla voir la cathédrale. M. de Valneige, qui avait visité quelques années plus tôt celle de Cologne, trouva une grande analogie entre ces deux monuments qui remontent d’ailleurs l’un et l’autre au quatorzième siècle. La cathédrale de Prague est beaucoup plus vaste ; aussi M. de Valneige disait-il en riant que les deux temples lui faisaient l’effet de deux jumeaux, dont l’un a grandi plus que l’autre.
La pieuse mère de famille ne manqua pas de faire agenouiller son dernier enfant devant les reliques de saint Adalbert qui se trouvent dans la petite chapelle octogone de l’avant-cour. Pauvre femme ! pendant que l’enfant distrait, comme on l’est à cet âge, regardait à droite et à gauche, elle, inclinée sur sa tête blonde, priait avec une ferveur émue, comme si elle eût pressenti le malheur qui allait la frapper…
Dans la nef de la cathédrale, on admira le mausolée royal, en marbre et albâtre, qui date de la fin du seizième siècle, et sous lequel sont venus se coucher tour à tour les grands de la terre.





























