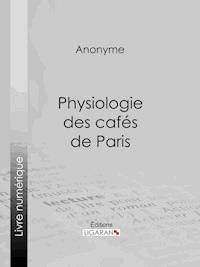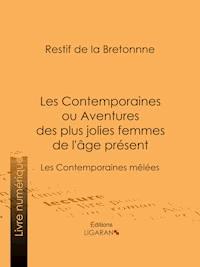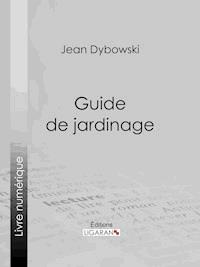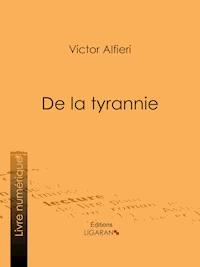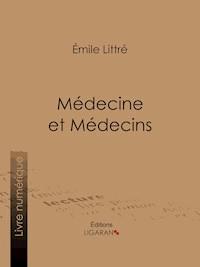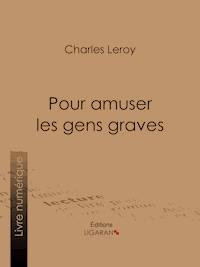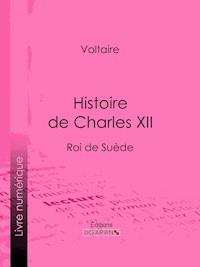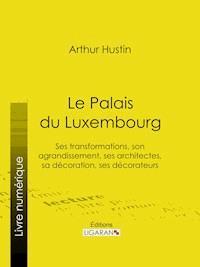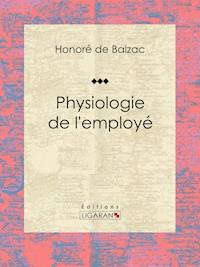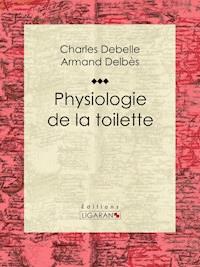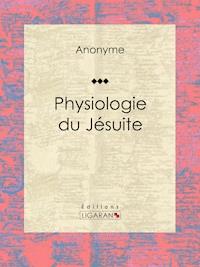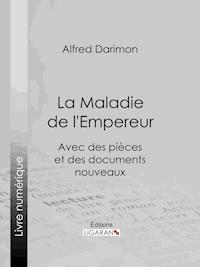
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "L'état de santé de l'empereur Napoléon III a pesé d'un poids très lourd sur les événements qui ont marqué pendant les dernières années du règne. On a eu là une démonstration éclatante de cette grande vérité, si éloquemment formulée par Pascal : À quoi tient le sort des peuples ? À un petit grain de sable qui se met dans la vessie."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J’ai réuni, dans ce volume, les articles que j’ai publiés sur la maladie de l’Empereur Napoléon III. Je donne, sous forme d’appendices, des extraits de mes carnets de notes journalières, destinés à éclairer certains points de cet épisode de notre histoire contemporaine. J’ai ajouté des pièces justificatives qui forment le complément naturel de mon travail.
La publication de ces recherches a produit une profonde émotion dans le public. C’était la première fois qu’on mettait en pleine lumière un ensemble de faits sur lesquels on s’était plu jusqu’ici à répandre une obscurité complaisante.
Bien des questions ont été soulevées à ce propos. Mais la principale a été celle-ci :
Comment se fait-il qu’au moment où allait s’engager une guerre terrible, le secret ait été gardé, en quelque sorte systématiquement, sur l’état de santé de Napoléon III ?
D’après les faits et les documents que je place sous les yeux du lecteur, une dizaine de personnes au moins savaient que l’Empereur était dans l’impossibilité absolue de faire campagne. C’était un devoir patriotique pour elles de révéler la situation à tous ceux qui avaient un intérêt immédiat à la connaître.
Toutes se sont renfermées dans le silence, même celles qui avaient reçu pour mission de parler.
Les médecins qui ont pris part à la consultation du 1er juillet 1870 étaient-ils admis à invoquer le secret professionnel pour se disculper du mutisme dans lequel ils se sont renfermés ?
J’ai entendu soulever à cet égard bien des doutes.
On conçoit qu’un médecin se renferme dans le secret professionnel quand il s’agit de l’intérêt d’un particulier ou d’une famille, lorsque certaines révélations jetées en pâture à la curiosité publique peuvent porter le trouble dans la vie privée et atteindre l’honneur et la considération d’un homme.
Mais quand c’est l’intérêt de l’État qui est en jeu, on ne voit pas bien en quoi le secret professionnel peut servir d’excuse à un silence qui met en péril l’existence de la patrie.
Il y a des cas où une opération chirurgicale devient une véritable affaire d’État.
Ce n’est point-là de la politique pathologique, c’est la pure expression d’un fait de sens commun.
Ce n’est pas seulement à l’Impératrice que la consultation du 1er juillet aurait dû être communiquée ; on aurait dû appeler à délibérer, sur ses conclusions, le conseil des ministres et le conseil privé.
On aurait ainsi constate l’impossibilité de confier le commandement de l’armée au Chef de l’État, et sans aucun doute les résolutions qui ont été prises et qui nous ont conduits à la défaite et au désastre auraient subi des modifications profondes. Peut-être la guerre elle-même eût-elle été définitivement écartée.
L’histoire sera sévère pour ces praticiens qui, d’un mot, pouvaient conjurer le danger, et qui, pour ne pas avoir à prononcer le mot sauveur, ont trouvé plus simple de se renfermer dans le privilège professionnel que la loi leur confère.
L’état de santé de l’empereur Napoléon III a pesé d’un poids très lourd sur les évènements qui ont marqué pendant les dernières années du règne. On a eu là une démonstration éclatante de cette grande vérité, si éloquemment formulée par Pascal : À quoi tient le sort des peuples ? À un petit grain de sable qui se met dans la vessie.
C’est, en effet, le calcul qui s’était formé dans la vessie de l’Empereur, qui a été, dans la plupart des cas, la raison déterminante des actes accomplis et des résolutions prises. C’est, on outre, le secret gardé sur cette affection grave, dénoncée par toutes nos sommités médicales, qui a été la cause principale de la défaite et de la chute.
Le 1er juillet 1870, Napoléon III se trouvant plus souffrant que d’habitude, une grande consultation eut lieu aux Tuileries. Les médecins consultants étaient : MM. Nélaton, Ricord, Fauvel, G. Sée et Corvisart.
À la suite de la délibération qui eut lieu entre ces éminents docteurs, M. G. Sée fut chargé de la rédaction de la consultation ; M. Conneau fut invité à la faire signer par tous les médecins consultants et à la communiquer ensuite à l’Impératrice.
Comment et pourquoi M. Conneau ne remplit-il pas la mission dont il était chargé ? C’est ce que nous rechercherons tout à l’heure. En ce moment, la seule chose que nous voulons constater, c’est que la consultation rédigée par M. G. Sée n’a pas seulement une haute valeur scientifique ; mais que c’est aussi un document historique d’une importance capitale. Il suffit de suivre les faits qu’il relate et les constatations médicales qu’il renferme, pour établir un parallélisme rigoureux entre le déclin de la santé de l’Empereur et les affaissements de sa politique.
Napoléon III était essentiellement anémique. Cet état général était dû à plusieurs causes : parmi les principales, il faut ranger les six années de captivité qu’il avait passées au château de Ham dans des conditions d’aération complètement insuffisantes, et sous le coup de graves préoccupations morales. Ajoutez à cela un flux hémorroïdal considérable qui avait persisté pendant plusieurs années.
Quand l’Empereur était souffrant et qu’il était impossible de dissimuler sa position au public, on répandait généralement le bruit qu’il était affligé de douleurs rhumatismales, ou bien on mettait en avant des accidents goutteux. Or, des observations faites par les médecins, il résulte que, si Napoléon III a éprouvé parfois des douleurs aux cuisses et aux articulations des pieds, ces douleurs n’ont jamais eu un caractère rhumatique ou goutteux. C’étaient des affections superficielles qui se manifestaient surtout sous l’influence du froid. Elles dataient de plus de vingt ans. Elles n’avaient jamais amené de rhumatisme articulaire.
En 1865, les symptômes avaient changé de nature. L’anémie subsistait ; mais on remarquait une certaine altération des voies urinaires. L’auguste malade était sujet à des hématuries, ce qui indiquait un commencement de lésion de la vessie. Néanmoins, comme aucun accident grave n’était signalé, on ne jugea pas nécessaire de se livrer à une exploration de l’organe affecté ; on se borna à ordonner quelques précautions ayant un caractère plus hygiénique que médical.
C’est l’état de santé de Napoléon III qui a été, en 1865, le motif déterminant de la longue excursion qu’il fit en Algérie. Une brochure, qui fut tirée à un petit nombre d’exemplaires et distribuée aux hauts fonctionnaires et à certaines personnalités politiques, donna une sorte de raison d’être à cette promenade du souverain à travers nos possessions africaines. En réalité, la politique ne fut pour rien dans ce voyage ; on voulait seulement soumettre pendant quelques mois l’Empereur aux influences d’un ciel plus clément et d’un climat plus chaud.
Avant de partir pour l’Algérie, l’Empereur consentit à deux actes qui agrandirent singulièrement la place que l’Impératrice occupait dans l’État ; il fit son testament et il confia à l’Impératrice la régence pendant tout le temps que devait durer son absence.
Ces deux actes ont entre eux une connexité qui n’a pas encore été signalée. Il suffisait cependant d’un examen superficiel du testament de Napoléon III, pour voir qu’ils ont été dictés sous le coup d’une seule et unique préoccupation, celle d’assurer à l’Impératrice la prépondérance, dans le cas où une catastrophe serait survenue.
Rien n’obligeait l’Empereur à constituer une Régence : en allant en Algérie, il ne quittait pas le sol français ; la distance qui sépare la France de sa colonie africaine n’est pas tellement grande que le chef de l’État ne pût continuer à suivre les affaires ; il suffisait, pour le tenir au courant et pour avoir sa signature, d’un simple service d’avisos faisant la navette entre Marseille et Alger. Cette abdication momentanée du pouvoir entre les mains de l’Impératrice avait eu surtout pour objet de mettre en relief la mère du Prince Impérial et de montrer qu’elle saurait, à un moment donné, tenir d’une main ferme les rênes du gouvernement.
Le testament de Napoléon III porte la date du 24 avril 1865 ; il a donc été écrit à la veille du départ pour l’Algérie. Les premières phrases révèlent la pensée qui l’a inspiré :
Je recommande mon fils aux grands corps de l’État, au peuple et à l’armée. L’impératrice Eugénie a toutes les qualités nécessaires pour bien conduire la Régence.
Cette Régence de 1865 a contribué à accroître l’importance politique de l’Impératrice. Jusque-là, elle s’était contentée de remplir son rôle de jolie femme, et l’on sait avec quel succès éclatant elle s’était tirée de cette tâche difficile et délicate ; à partir de ce moment, elle aspira à devenir la souveraine.
Il était bien difficile désormais de refuser à l’Impératrice, sinon l’entrée dans les conseils, du moins la connaissance des affaires de l’État, après qu’on lui en avait confié pendant des mois la direction presque absolue. Les ministres prirent l’habitude d’aller chez elle et de la mettre au courant des questions pendantes. C’était de leur part un simple acte de déférence ; mais elle faisait son profit des confidences et bien souvent l’Empereur eut à lutter contre les préjugés et contre les partis pris que ces confidences faisaient naître dans l’esprit de sa compagne.
Pendant sa régence, l’Impératrice avait suivi une politique de conciliation qui avait porté ses fruits. Elle avait réussi à rapprocher du gouvernement impérial des hommes qui s’étaient toujours tenus à l’écart. C’est ainsi qu’elle avait fini par intéresser à la cause de l’Empire Émile Ollivier, qui a toujours gardé, malgré les apparences, une complète réserve. C’était là une conduite véritablement intelligente. Les personnages que l’Impératrice avait ainsi gagnés tombaient naturellement sous son influence immédiate. Elle s’était formé de cette façon une clientèle importante qui lui constituait dans le gouvernement une sorte de lieutenance honoraire de l’Empire.
L’année 1866 a été l’année climatérique de l’Empire. Il s’agissait pour Napoléon III de savoir quel parti il prendrait dans la lutte qui mettait aux prises l’Autriche et la Prusse. La France ne pouvait rester indifférente : sa politique traditionnelle lui commandait de ne pas laisser l’équilibre européen se déplacer au profit de la Prusse. Entre une grande Allemagne et une Italie unifiée, la France est prise entre les deux mâchoires d’un étau ; elle est paralysée dans tous ses mouvements.
À ce moment critique de son histoire, la France aurait eu besoin d’un homme à l’esprit résolu et d’une fermeté à toute épreuve. Malheureusement, l’affection dont l’Empereur était atteint avait pris un plus grand développement et était arrivée à l’état aigu. L’intelligence du souverain n’était pas atteinte ; tout prouve qu’il se rendait parfaitement compte des difficultés de la position dans laquelle la France allait se trouver, au milieu des complications d’une guerre qui pouvait porter atteinte à son importance politique ; seulement, chez lui la volonté avait subi une dépression. Il ne savait à quelle décision il devait s’arrêter. Qui ne se souvient des tergiversations qui impatientaient si fort M. de Bismarck et le général la Marmora, au cours des négociations qui ont précédé ou suivi la guerre de 1866, et qui ont abouti à l’inaction de la France.