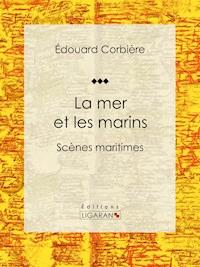
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lorsque le vent s'est élevé avec trop de violence et que la mer a grossi de manière à empêcher le navire de continuer sa route au milieu des lames dont le choc pourrait l'endommager, on met à la cape, sous une voile que l'on présente obliquement au vent. Dans cette position, le bâtiment, conservant très peu de vitesse, dérive en cédant plutôt à l'impression de chaque vague, qu'en y résistant..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335068658
©Ligaran 2015
De tous les actes produits par la raison humaine, la navigation est, sans contredit, le plus difficile, et celui qui a exigé le plus d’audace. La nature a mis chaque être au milieu de ses rapports nécessaires ; elle lui a affecté une place qu’il ne peut changer, elle lui a donné des organes propres aux éléments qu’il habite, et dont la disposition sert à l’exercice de certaines inclinations innées ; aussi, ne voit-on jamais les animaux contrarier ses vues. Chez eux, l’individu respecte toute sa vie les lois qui gouvernent l’espèce entière. L’homme seul, qui fonde toute sa prééminence sur une faculté pour ainsi dire artificielle, l’homme, qui a tout tiré de son industrie pour assurer son empire sur la terre, a eu besoin d’une industrie plus puissante encore quand il a voulu établir sa domination sur un élément auquel la nature ne l’avait point destiné. Sur la terre, en effet, son industrie a pu le mettre aux prises avec quelques dangers ; mais, sur la mer, il a eu à lutter contre tous. La terre était son domaine, et il n’a eu, pour l’assujettir, qu’à obéir à une inclination naturelle ; ici, au contraire, il a fallu que celle inclination cédât à une volonté qui la contrariait.
Sans doute, le caractère de la raison est non seulement de tirer parti de tout, mais encore d’abuser de tout. L’art de la navigation mérite les mêmes blâmes que tous les autres. En étendant l’empire de l’homme sur un élément qui ne lui avait pas été donné, il a fait servir cet élément de théâtre à nos fureurs, et il n’est pas aujourd’hui un rivage si ignoré qu’il fut jadis, qui n’ait été souillé du sang des hommes. Ainsi, si ce n’est pas, rigoureusement parlant, le plus utile des arts, c’est toujours le plus sublime de tous.
Mais ce n’est ni par ses brillants accessoires, ni par ses résultats plus brillants encore, et qui ont été cent fois examinés, que la navigation présente à nos regards un spectacle si différent des autres sciences, c’est par les sensations mêmes dont elle remplit l’âme de celui qui lui a consacré sa vie. Quelles sensations que celles de l’homme qui jeune encore, quitte pour la première fois cette famille dans laquelle jusqu’ici se sont concentrées toutes ses affections ; ces amis, qui ont été les confidents de toutes ses pensées ; les objets insensibles eux-mêmes, qui, n’ayant pas vieilli comme nous, retracent, par leur aspect, des souvenirs toujours vivants. Une autre existence, d’autres liens à contracter, d’autres hommes à fréquenter, d’autres lieux à visiter, mais rien à aimer sans cesse, rien qu’on puisse revoir tous les jours ! Quel changement dans l’esprit ! quel vide même dans l’âme !
Et quelle existence monotone ! toujours la mer, calme ou irritée sans doute, mais du moins toujours devant nous, comme si le navire était immobile. Changer à chaque instant d’horizon sans s’en apercevoir, continuer sa route sans autres points de remarque que ceux que donne le calcul ; avancer ou rester sans que l’impatience puisse se prendre à rien autre chose qu’à des vents qui ne dépendent pas de nous, qu’à une planche légère que les vagues soulèvent, malgré tous nos efforts ; redouter toutes les horreurs du besoin, considérer d’un œil morne le navire qui fuit à la lame dans les tempêtes, comme si, en l’abandonnant aux flots, il n’y avait plus d’espoir que dans le hasard, quelles situations diverses, et comment celui qui a vécu un seul jour de celle vie, la regrette-t-il toujours !
Ce sont précisément ces situations qui modifient l’âme de telle manière qu’elle n’y peut plus renoncer. Qui de nous n’a pas éprouvé, qu’à l’aspect d’un horizon sans bornes, l’âme s’étendait en quelque sorte avec l’espace ? Nous n’avons pas encore appliqué l’analyse aux sensations que nous communique la nature muette ; mais le cœur, qui n’attend pas pour être ému l’assentiment de la raison, nous a fait tressaillir cent fois en contemplant l’étendue immense qui se développe devant nous pour la première fois. Actuellement encore, le souvenir de ces heures trop rapides où nous restions plongés dans une extase muette à la vue de l’Océan, nous fait éprouver une sensation délicieuse ; le plaisir de la grandeur, physiquement parlant ; est un des premiers auxquels nous soyons sensibles, et c’est un de ceux que l’habitude, qui émousse tous les autres, nous rend le plus nécessaires. Quel est l’homme, jeté au milieu des mers qui, ne voyant que soi dans la nature, ne conçoive une espèce de sentiment de fierté, qui lui persuade, en quelque sorte, que tout est fait pour lui ? Dans les pays habités, les monuments de l’homme nous avertissent à chaque instant d’une puissance égale ou supérieure à la nôtre ; dans un désert, au contraire, la grandeur factice de l’homme disparaît, celle de la nature se montre, et rien ne donne à l’homme une plus haute idée de lui-même que celui d’un espace dont il n’y a que lui pour spectateur. Je ne crois pas qu’il faille chercher dans les institutions changeantes, la cause de la fierté naturelle des Arabes ou des Scythes : elle est tout entière dans le désert qu’ils habitent ; ce désert, qu’un homme fameux appelait un océan de pied ferme, et dont les tribus nomades se disent aussi les rois.
Ce sont là les deux sensations dominantes du navigateur ; son âme s’assimile avec cette nature imposante qui l’environne, et elle croit à sa grandeur, comme elle croit à celle des éléments ; accoutumée à lutter contre les flots, elle apprend à se raidir contre les obstacles, et elle croit à sa volonté comme à une puissance.
Notre âme a besoin de mouvement, elle a besoin, pour jouir, d’éprouver des émotions qui lui fassent craindre pour ses jouissances, et quels mouvements plus impétueux que ceux que produit cette vie errante ! quelles craintes plus vives que celles que donnent ces dangers toujours renaissants ! Le marin est franc, parce qu’il vit, pour ainsi dire, hors des conventions sociales ; il est insouciant sur l’avenir, parce qu’une vie semée de mille périls lui apprend à ne s’appuyer que sur le présent ; il est prodigue, parce que la conviction qu’il a acquise de la fragilité de la vie, l’invite à en jour à tout prix ; exempt des préjugés de sa nature, on dirait que c’est un véritable cosmopolite, parce que celui qui a beaucoup vu n’est jamais exclusif, et que ce qu’il oublie le plus promptement dans les solitudes immenses qui se déploient devant lui, ce sont les petites passions et les froids intérêts des hommes ; il est brusque, parce que son rude métier l’exige en quelque sorte, mais il est souvent humain, parce que la brusquerie ne s’allie jamais avec l’hypocrisie.
Enfin, et ce qui parait un problème insoluble, il court tous les dangers ; cent fois il jure, qu’échappé du naufrage, il n’ira plus s’exposer à de nouveaux périls : il n’attend plus que l’instant de recommencer une carrière qu’il a maudite si souvent. C’est encore l’étude du cœur humain qui explique nette apparente contradiction ; l’homme, comme on l’a remarqué avec raison, tient plus à la vie par le sentiment de ses peines que par celui des plaisirs. Le plaisir rassasie et dégoûte aussitôt ; la peine sous-force à courber le front, mais elle laisse au fond des cœurs l’espérance de moments plus heureux, et c’est toujours cette espérance-là qui nous porte en avant dans la vie. L’homme, engourdi dans le plaisir, se réveille pour ainsi dire dans le malheur ; les plus vives jouissances morales sont toujours celles qui ont été achetées par quelques peines. Sa joie enfin effleure agréablement ; mais le malheur nous blesse, et c’est des blessures du cœur qu’il sort un baume qui les guérit.
Où peut ajouter à cela que le besoin de se risquer est comme un noble instinct qui se réfugie au fond de l’âme pour triompher de ses penchants bas et égoïstes, qui, en rattachant l’homme à la terre, le rapetissent toujours.
Après tant de motifs d’aimer sa vie errante, comment s’étonnerait-on que les dangers qui raccompagnent soient capables d’en dégoûter le marin ? Rien ne peut déprendre l’âme d’un mouvement qui fait sa vie. Le repos qu’on substitue aux passions violentes n’est point un repos véritable ; c’est presque toujours un ennui profond. Aussi, le matin qui a quitté sa profession n’existe-t-il plus que par le regret ; dans sa vieillesse, tourmenté du besoin de s’agiter encore, on dirait qu’il ne s’attache plus à l’existence que par les souvenirs ; le murmure étourdissant des vagues plaît à son oreille ; combien de fois, durant de longs jours, il contemple, assis sur un rocher, la voile qui s’efface à l’horizon, ou la mouette rapide qui rase de son blanc plumage l’écume éblouissante des vagues ! Son imagination s’élance avec le dernier rayon du soleil couchant, et aborde avec lui sur les côtes de l’autre hémisphère ; la vue de la tempête elle-même ne peut l’arracher au spectacle des flots. Les dangers qu’il a courus sont affaiblis parte souvenir ; l’émotion puissante qu’il éprouvait après les avoir affrontés est encore toute vive dans son âme ; et ces regrets si vifs, cette mélancolie rêveuse attestent toujours qu’après avoir vécu d’une vie de son choix, il ne fait plus désormais que traîner des jours inutiles sur un élément qui n’est pas le sien.
Ce tableau fidèle des sensations dans la vie maritime, tracé par un des compatriotes de M. Corbière (Ed. Richer), trouvait ici naturellement sa place, et devait servir d’introduction à cet ouvrage. Il resterait à traiter une double question déjà longuement débattue, et qu’une nouvelle polémique ne ferait peut-être qu’embrouiller, c’est celle-ci :
Existe-t-il une littérature maritime ?
Quel est chez nous le créateur de cette littérature ?
Il est incontestable que le premier qui écrivit la relation d’un naufrage, d’une tempête, d’un accident de mer, fit de la littérature maritime, si littérature maritime il y a, et le premier qui fit cela est déjà bien loin de nous. Ainsi créa la littérature militaire, le premier qui décrivit une bataille, une retraite, un campement, un assaut. Or, voyez combien nous aurons de sortes de littérature, si nous accolons ce nom à chacun des différents sujets sur lesquels peut s’exercer la plument l’esprit d’un littérateur ? Nous croyons, nous, que la littérature est une, et qu’elle enchaîne dans son cadre immense toutes les créations de la pensée humaine.
Quant aux scènes proprement dites de la vie maritime, nous avons la conviction, et ce livre est la preuve, que M. Ed. Corbière est le premier, en France, qui leur ait donné véritablement la forme dramatique, et nous allons citer un fait : En 1829, il fut créé au Havre un journal spécialement consacré aux grandes catastrophes dont la mer est le théâtre. M. Corbière s’y essaya dans ce genre difficile : littérateur, observateur et marin, il avait à offrir aux fondateurs de ce recueil un triple gage de succès, et ce succès fut complet. Le Navigateur lui doit ses cinq années d’existence. Il se trouva des imitateurs qui revendiquèrent hautement la priorité, on les laissa dire ; il eût été trop facile de leur prouver qu’ils n’avaient point ouvert la carrière. Mais l’occasion se présente trop belle de les convaincre d’assertions erronées, pour que nous la laissions échapper. Or, ce livre, qui a pour titre la Mer et les Marins, contient en partie les premiers essais de M. Corbière ; c’est un fait que la justice d’abord et la reconnaissance nous fait un devoir de proclamer.
J. MOULENT,
Directeur du Navigateur.
Lorsque le vent s’est élevé avec trop de violence et que la mer a grossi de manière à empêcher le navire de continuer sa route au milieu des lames dont le choc pourrait l’endommager, on met à la cape, sous une voile que l’on présente obliquement au vent. Dans cette position, le bâtiment, conservant très peu de vitesse, dérive en cédant plutôt à l’impression de chaque vague, qu’en y résistant. Son avant, s’offrant à chaque coup de langage à la lame qui déferle, reçoit quelquefois des chocs très forts ; mais le navire cillant alors dans le sens de la force de la lame, évite au moins le changer qu’il y aurait à la rencontrer avec une vitesse opposée à sa direction. Une fois à la cape, l’équipage n’a plus rien à faire, et pendant tout le temps que dure la tempête, il faut attendre, dans cette position passive, que le mauvais temps s’apaise et permette de manœuvrer. C’est pendant ces longues heures de coup de vent et de dangers, que l’on peut remarquer plus particulièrement cette heureuse indifférence que l’habitude du péril donne aux matelots. Assis à l’abri des pavois ou de la chaloupe, pendant qu’une mer furieuse mugit autour d’eux et menace quelquefois d’engloutir le navire, on les voit se réunir et s’approcher le plus possible les uns des autres, pour raconter de ces contes dont la tradition perpétue le souvenir parmi les marins. Souvent ils chantent ensemble, d’une voix rauque, ces complaintes monotones comme le bruit des vagues qui les environnent, et mélancoliques comme la plupart des airs qu’aiment les gens de mer. C’est en vain que le vent gronde sur leurs têtes et siffle dans les cordages, que des torrents de pluie les inondent, et que la mer menace de les enlever : ils chantent comme l’ouvrier le plus paisible, au fond d’une boutique ou d’un atelier. Mais souvent leurs narrations ou leurs chants sont interrompus de la manière la plus terrible. Quand le navire, fatigué pour la lutte qu’il livre à la tempête, craque dans toutes les parties ; que la mâture, dans les mouvements effroyables du roulis, plie et menace de tout écraser par sa chute, une lame vient quelquefois tomber sur le pont avec un fracas effroyable ; tout ce qu’elle rencontre est brisé, entraîné ; et le navire, caché un instant sous cette montagne d’eau, ne se dégage de la lame qui l’a affaissé, qu’après avoir perdu tout ce qu’il avait sur le pont avec les hommes de quart que la vague furieuse a enlevés. Rien, peut-être, n’est plus terrible, quand un évènement de cette sorte a lieu, que le sentiment qu’éprouvent, en montant sur le pont, les hommes qui étaient couchés. Tout a disparu ; ils cherchent avec effroi leurs camarades : on appelle les gens de quart pour connaître ceux qui ont été assez heureux pour n’avoir pas été emportés. Dans les débris que le coup de mer a laissés, on examine si quelque infortuné n’a pas été écrasé au milieu de ce désordre affreux. On soude autant que possible les pompes, pour savoir si le choc terrible dans lequel le navire a paru devoir sombrer, n’a pas déterminé une voie d’eau. Et encore si, dans la violence de la bourrasque, la voile sur laquelle on avait mis en cape a été mise en pièces par l’impétuosité du vent ; il faut, dans l’impossibilité où l’on est de déferler une autre voile, attendre, écrasé par la mer qui tourmente le navire qui n’est plus appuyé, que la tempête se soit calmée, et que le temps permette de reprendre la route et de réparer autant que l’on peut les avaries qu’a causées le coup de mer.
Une tempête continuelle, une mer effrayante ont tellement fatigué et désemparé le navire, qu’il finirait peut-être par s’ouvrir s’il s’efforçait de rester encore longtemps à la cape : une seule ressource peut être tentée pour sortir de cette position, dans laquelle les pompes suffisent à peine à vider l’eau qui entre dans la cale par les coutures du bâtiment harassé : on se détermine à arriver vent arrière et à fuir avec le temps.
Mais, en se hasardant à tenter cette manœuvre, il est un danger que nul homme de mer ne saurait se dissimuler, et qu’il faut une grande résolution pour affronter : c’est celui de recevoir par le travers une lame qui peut faire sombrer le bâtiment : la certitude du péril présent l’emporte pourtant presque toujours sur la crainte du péril douteux. Chaque homme se porte donc à son poste, et va attendre avec zèle et attention la voix du capitaine, ou le signal qu’il donnera, si son commandement ne peut se faire entendre dans le mugissement de la tourmente et le bruit des vagues. La barre du gouvernail, qui, pendant la cape, avait été amarrée sous le vent, est confiée aux hommes les plus sûrs de l’équipage. Le moment où les lames paraissent devoir déferler avec moins de furie, est prévu, choisi ; chacun s’apprête. Le signal est donné ; la barre alors est mise précipitamment au vent ; un foc est hissé ; le vent frappe la voile qu’on lui présente, l’agite, la tord avec fureur ; et le bruit de cette toile, violemment froissée sur elle-même, se fait entendre par intervalles comme la détonation d’un coup de canon ; et ses claquements dominent un instant les sifflements horribles de la bourrasque qui souffle dans la mâture et les cordages. Le foc ainsi tourmenté ne résiste pas ; il se déchire en mille pièces ; mais le navire arrive, et une lame énorme qui l’approche en s’élevant jusqu’à la hauteur de ses hunes, le jette à une distance considérable du point où il a commencé son évolution. Le vent bientôt le pousse avec violence sur chacune des lames qui le prend par l’arrière, et qui, à chaque impulsion, menace de l’engloutir. Souvent, élancé sur le sommet de ces montagnes mobiles qui semblent vouloir s’écrouler sur lui, on croirait qu’en s’apiquant il va disparaître verticalement dans la lame qui le précède et dans laquelle se plonge son beaupré. Mais cette lame, qui l’a élevé si précipitamment, déferle le long des bords et le laisse ensuite comme à moitié submergé, dans le creux qu’elle fait en allant étendre à une demi-lieue devant lui son écume et sa masse imposante. C’est dans une position aussi critique que l’on sent combien les bons timoniers sont nécessaires ; car c’est presque de leur manière de gouverner que dépend le salut commun. Un faux coup de barre causé par la maladresse, la peur ou une distraction de ceux qui gouvernent, peut faire venir le navire en travers et le faire sombrer, ou du moins l’exposer à être défoncé par la mer. Placé sur une partie élevée ou cramponné dans les haubans, l’officier de quart, l’œil fixé sur l’arrière, prévoit le mouvement de chaque vague, devine sa direction, et commande aux timoniers le coup de barre qu’ils doivent donner pour que le derrière soit toujours présenté au coup de mer. Mais toute l’attention possible, toute l’habitude et le sang-froid qu’on peut supposer aux timoniers et aux meilleurs officiers, ne suffisent pas toujours pour préserver un navire qui fuit à mâts et à cordes, des accidents que l’on court sous cette dangereuse allure. Lorsque la lame, par exemple, surprenant par un mouvement irrégulier le navire dont la vitesse s’est ralentie, le frappe dans son arrière, souvent elle enlève dans ce choc irrésistible, toute la partie qui lui a opposé une résistance trop grande. Alors, le navire doit succomber inévitablement, car, ne pouvant plus fuir avec assez de promptitude après cette avarie, le coup de mer qui succède au premier qu’il a reçu, achève de le remplir, et doit suffire presque toujours pour le faire sancir. Les exemples funestes de quelques bâtiments qui n’ont échappé que par miracle à de semblables accidents de mer, prouvent assez combien il en est qui ont dû périr par ces accidents mêmes. Un fait qui a laissé dans ma mémoire des détails dont les circonstances où je me suis trouvé ensuite ont ravivé le souvenir, pourrait démontrer quels sont les périls que les plus grands navires mêmes courent en fuyant veut arrière au milieu d’une tempête. Un capitaine anglais ramenait en Europe, sur un trois mâts de 6 à 700 tonneaux, l’équipage du brick le Nisus et d’autres prisonniers capturés sur les atterrages de la Martinique en 1809. Rendu près des Açores, ce navire, tout neuf encore, fut assailli par une tempête qui rendit la mer furieuse. Les vents soufflaient dans une direction favorable, et le capitaine anglais s’obstina à ne pas vouloir mettre en cape, maigre les instances du capitaine et des officiers français, qui lui représentaient le danger qu’il courait en continuant à fuir vent arrière. Toutes les sollicitations furent inutiles, et quelques verres de grog achevèrent de confirmer le marin anglais dans son imprudente résolution. La nuit, lorsque la moitié de l’équipage anglais était seul reste sur le pont où le retenait le devoir, un coup de mer tomba à bord, et le fracas avec lequel il déferla, fit croire à ceux qui étaient en bas que le bâtiment avait touché et qu’il coulait. Tous se précipitèrent sur le pont : la mâture seule tenait encore ; mais quatorze canons avec leurs affûts, les embarcations, les ancres, le capitaine et les quarante hommes de quart avaient disparu. Au milieu de ce désordre épouvantable, on essaya de mettre à la cape ; la barre du gouvernail livrée à elle-même, et privée des quatre timoniers qui quelques minutes auparavant, en avaient tenu la roue, donnait des coups affreux d’un bord à l’autre du navire. Les premiers matelots qui voulurent s’en rendre maîtres furent écrasés ; mais enfin on parvint à la fixer sous le vent, et à rester en cape, sous un foc d’artimon. Les Français prisonniers, qui, par suite de l’accident, se trouvaient en bien plus grand nombre que les Anglais, s’emparèrent du bâtiment transport, et quand le temps le permit, ils firent route pour les côtes de France, où ils croyaient bien pouvoir atterrir et recevoir du sort une compensation aux dangers auxquels ils venaient d’échapper. Mais le hasard ne favorisa pas leur tentative : une frégate anglaise qui croisait devant Brest, chassa le navire désemparé et l’atteignit à la hauteur d’Ouessant. Lorsque le capitaine de cette frégate apprît que c’était en fuyant vent en arrière dans un trop mauvais temps, que le capitaine de sa nation avait disparu, il se contenta de dire froidement : Never mind so much the worth ! C’est égal, tant pis pour lui !
Le jour va poindre : ses premiers rayons déjà projetés vers le zénith ont averti l’officier de quart que le moment de faire faire la visite du gréement, par les gabiers, est arrivé. Le maître d’équipage a soin d’ordonner aux hommes qui montent dans la mâture, de porter attentivement leurs regards sur tous les points de l’horizon. À peine le premier gabier est-il parvenu sur les barres de perroquet, qu’il s’écrie, Navire ! Ce mot a fait tressaillir de joie tout l’équipage. Dans quelle partie le vois-tu ? demande l’officier au gabier : Par le bossoir de dessous le vent, là, à une lieue à peu près de distance. Un coup de sifflet de silence se fait alors entendre : un pilotin va prévenir le commandant ; la moitié de l’équipage qui n’était pas de quart, est aussitôt réveillée, et monte sur le pont en fixant les yeux sur le bâtiment découvert. L’officier ordonne de larguer toutes les voiles qui, pendant la nuit, avaient été serrées. Dans un instant la frégate est couverte de toile ; et tous les gabiers des hunes et les matelots, rangés sur les manœuvres, attendent avec leur vigilance ordinaire, excitée encore par l’espoir de quelque évènement, le commandement que l’officier de quart fait entendre dans le sonore porte-voix. Le cap a été mis sur le navire à vue, qui, s’apercevant de son côté qu’un grand bâtiment se dirige sur lui, en faisant blanchir la mer sur son avant, a mis dehors toutes ses voiles pour fuir selon l’allure la plus favorable à sa marche. Pendant la première heure de chasse, le jour s’est fait : des aspirants, avec une longue vue en bandoulière, se sont perchés sur la partie la plus élevée de la mâture, et de temps en temps ils en descendent pour informer le commandant de la manœuvre du bâtiment chassé. Les yeux tantôt fixés sur la boussole, au moyen de laquelle on relève les positions respectives des deux navires, et tantôt placés sur le tube de sa longue-vue, le commandant s’aperçoit qu’il ne tardera pas à être à portée de canon du navire chassé, qui, malgré la force de la brise, continue à tenir hautes toutes les voiles qu’il a pu livrer au vent. Le branle-bas de combat est ordonné à bord de la frégate : chacun se rend à son poste. On allume les mèches, le tambour résonne ; le sifflet perçant du maître d’équipage se mêle au bruit du tambour et du porte-voix de l’officier de manœuvre. Les chirurgiens ont disposé le triste appareil de leurs instruments, et les cadres pour recevoir les blessés sont déjà tendus dans le faux-pont. Le bâtiment chassé, qui voit les préparatifs que fait la frégate, emploie enfin les derniers moyens qui lui restent pour échapper à cette redoutable poursuite. Il jette à l’eau ses embarcations, sa drome, une partie de ses canons, et tous les fardeaux qu’il peut tirer le plus promptement de sa cargaison. À chacun des objets qui viennent passer en flottant le long de la frégate, l’équipage de celle-ci jette un cri de joie. Il est à nous, s’écrie-t-on : C’est un vaisseau de Compagnie ! à l’abordage ! à l’abordage ! Deux canons placés sur l’avant vont partir : ils tonnent. Le pavillon est hissé en même temps, et les boulets dépassent le bâtiment ennemi. Les houras partent alors de tous les points du navire. Déjà les canonniers de la batterie de dessous le vent, l’œil sur la culasse de leurs pièces, suivent, en pointant, le mouvement de la lame et du bâtiment qu’ils visent. Attention au commandement ! fait entendre le capitaine dans le vaste porte-voix qui communique à la batterie : Feu bâbord ! À ce mot la volée entière part avec fracas, et la mitraille crible de toutes parts les voiles, la mâture et le corps du vaisseau ennemi. À l’abordage ! à l’abordage ! répète l’équipage : les sabres se distribuent aussitôt ; les haches, les pistolets et les piques passent dans les mains des premières escouades, palpitantes d’impatience. Les grappins avec leurs chaînes se balancent au bout des vergues, et menacent de tomber dans le gréement de l’ennemi. Mais celui-ci, voyant la frégate à bout portant, et son équipage groupé sur l’avant pour sauter à son bord, envoie une bordée à mitraille qui crible le pont de son adversaire, et abat des files entières de matelots. Après ce succès inutile, contraint de se rendre à une force contre laquelle il lutterait en vain, il amène son pavillon, et évite ainsi le carnage que lui ferait redouter le terrible abordage d’une frégate française.
C’est aux approches de l’équateur que les grains blancs assaillent le plus ordinairement les navires, dans les moments où l’on est quelquefois le moins disposé à recevoir ces rafales perfides qui peuvent devenir funestes aux bâtiments d’une petite capacité.
Lorsque, favorisé par ce souffle léger que les marins, aux environs de la ligne, semblent vouloir recueillir avec avidité presque dans leurs plus petites voiles, le navire a tout mis dehors, le calme plat vient parfois succéder à la brise inconstante qui va mourir au loin en effleurant à peine une mer sans mouvement. Rarement, dans ces instants d’oisiveté, la surveillance se trouve sollicitée par la prévoyance de quelque danger ou de quelque évènement extraordinaire. Les voiles battent sur les mâts à chacun des coups de roulis que le navire éprouve encore, et ce bruit monotone et périodique, joint au craquement de la mâture qui s’incline avec le bâtiment sur chacun des bords, inspire, à tous les hommes de l’équipage, une fatigue, une langueur qui achèvent de les livrer au sommeil, dans des parages où la chaleur est déjà si accablante. Si, pendant ces heures de calme et d’ennui, un petit nuage vient à se détacher de l’horizon, et à parcourir avec vitesse l’azur d’un ciel inanimé, et que pour comble de malheur personne ne l’ait aperçu à bord, bientôt la bonté du navire et de la mâture sera mise à une rude épreuve ; car ce nuage qui accourt, et que personne ne voit, est un grain blanc ! Rien n’annonce son approche. La mer continue à être unie. Le soleil sous lequel le nuage a passé comme un lambeau de la gaze la plus transparente, darde ses rayons avec la même ardeur que si rien n’avait intercepté sa vive clarté. Ce n’est que lorsqu’un sifflement aigu se fait entendre dans les cordages et dans la mâture, qu’on s’aperçoit que le grain blanc est tombé à bord. Tout le monde saute à la manœuvre ; l’officier s’élance sur la barre du gouvernail pour aider le timonier à la pousser au vent. Il crie d’amener les voiles ; mais déjà la force subite du vent a tellement incliné le bâtiment que l’eau est presque rendue aux panneaux, et que la pente de la mâture empêche les voiles d’amener. Les mâts, surchargés du poids terrible de la rafale, plient comme s’ils allaient se briser. Dans un moment aussi alarmant, l’officier, pour le salut du navire, se décide à faire larguer les écoutes qui retiennent le point des voiles aux bouts de chacune des vergues : les écoutes sont larguées ; le vent alors, s’emparant des voiles qui ne sont plus tendues, les déchire en lambeaux et les enlève au loin avec un fracas effroyable. Le navire cependant, soulagé par la perle de presque toute sa voilure, arrive en suivant l’impulsion que lui donne sa barre portée depuis longtemps au vent. Il se redresse progressivement. Le grain qui l’avait assailli a paru à peine effleurer la surface tranquille de la mer ; le calme qu’il a interrompu pendant quelques minutes seulement, renaît ; on n’entend même plus à bord le sifflement de la rafale qui a passé comme un coup de foudre, et qui s’éloigne pour mourir dans l’espace. Mais la mâture a été ébranlée, brisée dans quelques parties ; les voiles n’ont laissé que des lambeaux sur les vergues que l’effort du vent a ployées et dépouillées de leurs agrès. Il faut réparer les avaries, visiter le gréement et la mâture pour connaître toute l’étendue des dommages occasionnés par le grain. C’est ainsi, comme on le voit, qu’au milieu du calme le plus parfait, les marins ont encore à redouter les accidents qui menacent à chaque instant leur vie aventureuse.





























