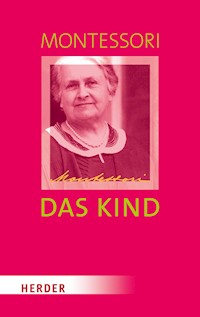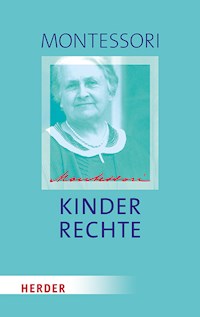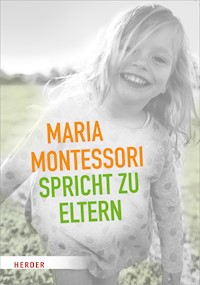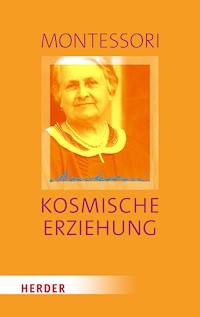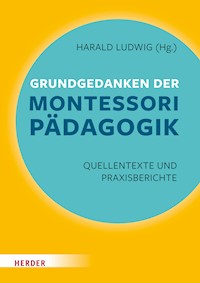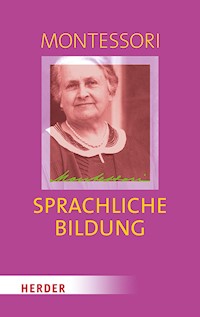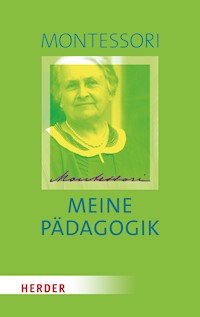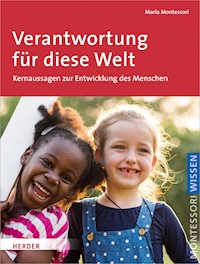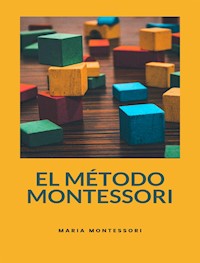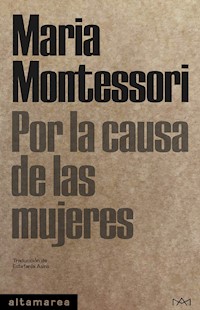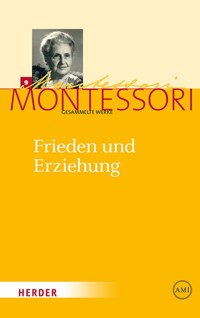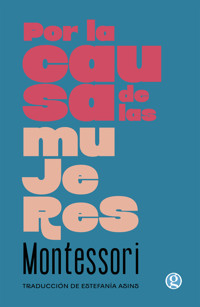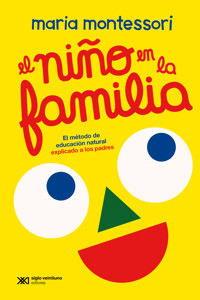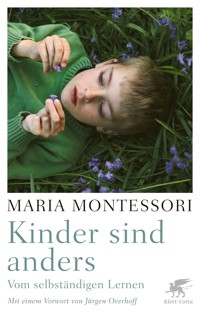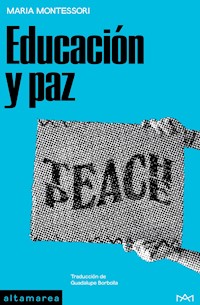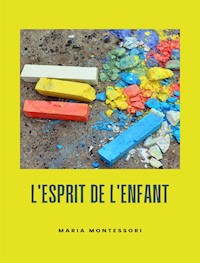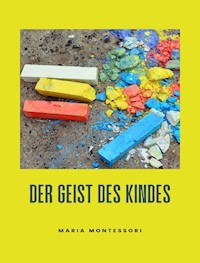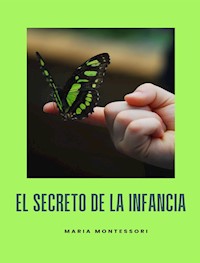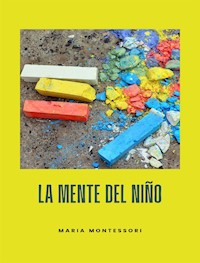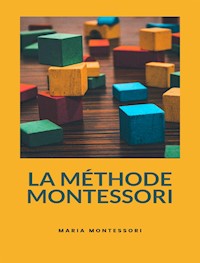
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Fondatrice d'une méthode éducative révolutionnaire, Maria Montessori est encore aujourd'hui une référence pour les parents et les enseignants. Ce volume réunit pour la première fois quatre de ses œuvres les plus significatives : "L'esprit de l'enfant", "L'enfant dans la famille", "Comment éduquer le potentiel humain" et "Éducation pour un monde nouveau". Convaincue que l'éducation ne doit pas être oppressive, mais qu'elle peut au contraire offrir une aide précieuse à la vie et au développement du potentiel de chaque individu, l'enseignement de Maria Montessori encourage l'enfant à manifester son propre caractère, à suivre ses propres tendances et à mettre à profit son inépuisable créativité. Guide précieux pour élever nos enfants dans un environnement positif et serein, "La Méthode" offrira des éclairages théoriques et pratiques à tous ceux qui ont à cœur l'équilibre et la joie des petits.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Contenu
INTRODUCTION
LA MÉTHODE MONTESSORI
CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
La méthode Montessori
MARIA MONTESSORI
INTRODUCTION
Un public déjà très intéressé attend cette traduction d'un livre remarquable. Depuis des années, aucun document éducatif n'a été attendu avec autant d'impatience par un public aussi large, et peu d'entre eux ont mieux mérité cette attente générale. Cet intérêt général est dû aux articles enthousiastes et ingénieux du McClure's Magazine de mai et décembre 1911, et de janvier 1912 ; mais avant la parution du premier de ces articles, un certain nombre d'enseignants anglais et américains avaient étudié attentivement l'œuvre du Dr Montessori et l'avaient trouvée nouvelle et importante. L'accueil étonnant accordé aux premières expositions populaires du système Montessori peut signifier beaucoup ou peu pour son avenir en Angleterre et en Amérique ; c'est plutôt l'approbation précoce de quelques enseignants qualifiés et d'étudiants professionnels qui le recommande aux travailleurs de l'éducation qui doivent finalement décider de sa valeur, interpréter ses détails techniques pour le pays en général et l'adapter aux conditions anglaises et américaines. C'est à eux, ainsi qu'au grand public, que s'adresse cette brève introduction critique.
C'est tout à fait dans les limites d'un jugement sûr que de qualifier l'œuvre du Dr Montessori de remarquable, de nouvelle et d'importante. Elle est remarquable, ne serait-ce que parce qu'elle représente l'effort constructif d'une femme. Nous n'avons pas d'autre exemple d'un système éducatif - original au moins dans sa globalité systématique et dans son application pratique - élaboré et inauguré par l'esprit féminin et la main . Il est également remarquable parce qu'il est le fruit d'une combinaison de sympathie et d'intuition féminines, d'une large perspective sociale, d'une formation scientifique, d'une étude intensive et prolongée des problèmes d'éducation et, pour couronner le tout, d'une expérience variée et inhabituelle en tant qu'enseignante et responsable de l'éducation. Aucune autre femme qui a abordé le problème du Dr Montessori - l'éducation des jeunes enfants - n'a apporté des ressources personnelles aussi riches et variées que les siennes. Ces ressources, en outre, elle les a consacrées à son travail avec un enthousiasme, un abandon absolu, comme celui de Pestalozzi et de Froebel, et elle présente ses convictions avec une ardeur apostolique qui commande l'attention. Un système qui incarne un tel capital d'efforts humains ne pouvait être sans importance. D'autre part, certains aspects du système sont en eux-mêmes frappants et significatifs : il adapte à l'éducation des enfants normaux des méthodes et des appareils utilisés à l'origine pour les déficients ; il est basé sur une conception radicale de la liberté de l'élève ; il implique un entraînement hautement formel des capacités sensorielles, motrices et mentales distinctes ; et il conduit à une maîtrise rapide, facile et substantielle des éléments de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique. Tout cela sera évident pour le lecteur le plus occasionnel de ce livre.
Aucune de ces choses, bien sûr, n'est absolument nouvelle dans le monde de l'éducation. Toutes ont été proposées en théorie ; certaines ont été mises en pratique plus ou moins complètement. Il n'est pas injuste, par exemple, de faire remarquer qu'une grande partie du matériel utilisé par le Dr Walter S. Fernald, surintendant de l'Institution pour les faibles d'esprit du Massachusetts à Waverley, est presque identique au matériel Montessori, et que le Dr Fernald a longtemps soutenu qu'il pouvait être utilisé à bon escient dans l'éducation des enfants normaux. (Les lecteurs américains seront peut-être intéressés de savoir que Séguin, , dont les travaux sont basés sur ceux du Dr Montessori, était autrefois directeur de l'école de Waverley). De même, la formation formelle à divers processus psychophysiques a été vivement encouragée ces derniers temps par bon nombre de chercheurs en pédagogie expérimentale, notamment par Meumann. Mais avant Montessori, personne n'avait produit un système dans lequel les éléments cités ci-dessus étaient combinés. Elle l'a conçu, l'a élaboré dans la pratique et l'a établi dans les écoles. C'est en effet le résultat final, comme l'affirme fièrement le Dr Montessori, d'années d'efforts expérimentaux tant de sa part que de celle de ses grands prédécesseurs ; mais la cristallisation de ces expériences dans un programme d'éducation pour les enfants normaux est due au seul Dr Montessori. Les caractéristiques accessoires qu'elle a franchement reprises d'autres éducateurs modernes, elle les a choisies parce qu'elles s'adaptent à la forme fondamentale de son propre schéma, et elle les a toutes unifiées dans sa conception générale de la méthode. Le système n'est pas original dans le sens où le système de Froebel l'était ; mais en tant que système, il est le produit nouveau du génie créateur d'une seule femme.
En tant que tel, aucun étudiant en éducation élémentaire ne devrait l'ignorer. Le système ne résout sans doute pas tous les problèmes de l'éducation des jeunes enfants ; il est possible que certaines des solutions qu'il propose soient partiellement ou complètement erronées ; certaines ne sont probablement pas disponibles dans les écoles anglaises et américaines ; mais un système d'éducation n'a pas à atteindre la perfection pour mériter d'être étudié, étudié et utilisé à titre expérimental. Le Dr Montessori est trop large d'esprit pour prétendre à l'infaillibilité, et trop scientifique dans son attitude pour s'opposer à un examen minutieux de son système et à la vérification approfondie de ses résultats. Elle déclare expressément qu'il n'est pas encore complet. En pratique, il est fort probable que le système finalement adopté dans nos écoles combinera des éléments du programme Montessori avec des éléments du programme des jardins d'enfants, tant "libéraux" que "conservateurs". Dans son déroulement effectif, le travail scolaire doit toujours être ainsi éclectique. Une politique du tout ou rien pour un seul système est inévitablement vouée à l'échec, car le public ne s'intéresse pas aux systèmes en tant que tels et refuse finalement de croire qu'un seul système contient toutes les bonnes choses. Nous ne pouvons pas non plus douter du bien-fondé de cette attitude. Si nous continuons, malgré les pragmatiques, à croire aux principes absolus, nous pouvons encore rester sceptiques quant à la logique de leur mise en pratique - du moins dans un programme d'éducation fixe. Nous ne sommes pas encore justifiés, en tout cas, d'adopter un programme à l'exclusion de tous les autres simplement parce qu'il est basé sur la philosophie la plus intelligible ou la plus inspirante. Le test pragmatique doit aussi être appliqué, et avec rigueur. Il faut essayer plusieurs combinaisons, observer et noter les résultats, les comparer, et procéder avec prudence à de nouvelles expériences. Ce procédé est souhaitable à tous les stades et à tous les degrés de l'éducation, mais surtout au stade le plus précoce, car c'est là qu'il a été le moins tenté et qu'il est le plus difficile. Il est certain qu'un système aussi radical, aussi clairement défini et aussi bien développé que celui du Dr Montessori offre, pour l'étude comparative approfondie des méthodes d'éducation précoce, de nouveaux matériaux d'une importance exceptionnelle. Sans accepter tous les détails du système, sans même accepter sans réserve ses principes fondamentaux, on peut l'accueillir comme étant d'une grande et immédiate valeur. Si l'éducation de la petite enfance mérite d'être étudiée, l'éducateur qui s'y consacre trouvera nécessaire de définir les différences de principe entre le programme Montessori et les autres programmes, et de procéder à des essais minutieux des résultats que l'on peut obtenir avec les divers systèmes et leurs combinaisons possibles.
L'une de ces combinaisons est suggérée dans cette introduction, qui aborde également les utilisations possibles de l'appareil Montessori à la maison ; mais il peut être utile de présenter d'abord les caractéristiques exceptionnelles du système Montessori par rapport au jardin d'enfants moderne sous ses deux formes principales.
Certaines similitudes de principe apparaissent rapidement. La vision de l'enfance du Dr Montessori est à certains égards identique à celle de Froebel, bien qu'elle soit en général nettement plus radicale. Tous deux défendent le droit de l'enfant à être actif, à explorer son environnement et à développer ses propres ressources intérieures par toute forme d'investigation et d'effort créatif. L'éducation doit guider l'activité, et non la réprimer. L'environnement ne peut pas créer le pouvoir humain, mais seulement lui donner l'étendue et la matière, le diriger, ou tout au plus l'appeler ; et la tâche de l'enseignant est d'abord de nourrir et d'aider, de surveiller, d'encourager, de guider, d'induire, plutôt que d'interférer, de prescrire ou de restreindre. Pour la plupart des enseignants américains et pour tous les enfants d'âge préscolaire, ce principe est familier depuis longtemps ; ils ne pourront que se réjouir de l'entendre énoncer de façon nouvelle et éloquente, d'un point de vue moderne. Dans l'interprétation pratique du principe, cependant, il existe une divergence marquée entre l'école Montessori et le jardin d'enfants. La "directrice" Montessori n'enseigne pas aux enfants en groupes, avec l'exigence pratique, aussi bien "médiatisée" soit-elle, que chaque membre du groupe participe à l'exercice. L'élève Montessori fait à peu près ce qu'il veut, tant qu'il ne fait pas de mal.
Montessori et Froebel sont également d'accord sur la nécessité de former les sens, mais le plan de Montessori pour cette formation est à la fois plus élaboré et plus direct que celui de Froebel. Elle a conçu, à partir de l'appareil de Séguin, un plan complet et scientifique pour la gymnastique formelle des sens ; Froebel a créé une série d'objets conçus pour une utilisation beaucoup plus large et plus créative par les enfants, mais en aucun cas aussi étroitement adaptés à l'entraînement de la discrimination sensorielle. Le matériel Montessori met en œuvre le principe fondamental de Pestalozzi, qu'il a tenté en vain de concrétiser dans un système réussi : il "développe pièce par pièce les capacités mentales de l'élève" en entraînant séparément, par des exercices répétés, ses différents sens et son aptitude à distinguer, comparer et manipuler des objets typiques. Dans le système des jardins d'enfants, et en particulier dans ses modifications "libérales", l'entraînement des sens est accessoire à une activité constructive et imaginative dans laquelle les enfants poursuivent des objectifs plus vastes que le simple arrangement de formes ou de couleurs. Même dans le travail le plus formel du jardin d'enfants, les enfants "font un dessin" et sont encouragés à dire à quoi il ressemble : "une étoile", "un cerf-volant", "une fleur".
En ce qui concerne l'éducation physique, les deux systèmes s'accordent à peu près sur les mêmes points : tous deux affirment la nécessité d'une activité corporelle libre, d'exercices rythmiques et du développement du contrôle musculaire ; mais alors que le jardin d'enfants cherche à obtenir tout cela par le biais de jeux collectifs ayant un contenu imaginatif ou social, le système Montessori met l'accent sur des exercices spéciaux destinés à donner un entraînement formel à des fonctions physiques distinctes.
Dans un autre aspect général, cependant, l'accord entre les deux systèmes, fort en principe, laisse le système Montessori moins formel plutôt que plus formel dans la pratique. Le principe, dans ce cas, consiste en l'affirmation du besoin de formation sociale de l'enfant. Dans le jardin d'enfants conservateur, cette formation est recherchée une fois de plus, principalement dans les jeux de groupe. Ceux-ci sont généralement imaginatifs, et parfois résolument symboliques : c'est-à-dire que les enfants jouent à être des fermiers, des meuniers, des cordonniers, des mères et des pères, des oiseaux, des animaux, des chevaliers ou des soldats ; ils chantent des chansons, se livrent à certaines activités semi-dramatiques - comme "ouvrir le pigeonnier", "tondre l'herbe", "montrer le bon enfant aux chevaliers", et ainsi de suite ; et chacun prend sa part dans la représentation d'une situation sociale typique. La formation sociale impliquée dans ces jeux n'est formelle que dans le sens où les enfants ne sont pas engagés, comme le sont souvent les enfants Montessori, dans une véritable entreprise sociale, comme celle de servir le dîner, de nettoyer la chambre, de s'occuper des animaux, de construire une maison de jouets ou de faire un jardin. On ne saurait trop insister sur le fait que même le jardin d'enfants le plus conservateur n'exclut pas, par principe, les entreprises "réelles" de ce dernier type ; mais dans une séance de trois heures, il en fait assez peu. Les jardins d'enfants libéraux en font davantage, notamment en Europe, où la séance est souvent plus longue. Le système Montessori n'exclut pas non plus totalement les jeux de groupe imaginatifs. Mais le Dr Montessori, en dépit d'un intérêt manifestement profond non seulement pour la formation sociale, mais aussi pour le développement esthétique, idéaliste et même religieux, parle de "jeux et d'histoires idiotes" d'une manière désinvolte et désobligeante, ce qui montre qu'elle n'est pas encore familiarisée avec l'habileté et le pouvoir remarquables des enfants américains dans l'utilisation de ces ressources. (Bien sûr, la jardinière d'enfants américaine n'utilise pas d'histoires "stupides", mais elle utilise des histoires, et à bon escient). Le programme Montessori implique beaucoup d'expériences sociales directes, tant dans la vie générale de l'école que dans les travaux manuels effectués par les élèves ; le jardin d'enfants élargit le champ de la conscience sociale de l'enfant par l'imagination. Les regroupements des enfants Montessori sont en grande partie libres et non réglementés ; les regroupements des enfants des jardins d'enfants sont plus souvent formels et prescrits.
Sur un point, le système Montessori est en accord avec le jardin d'enfants conservateur, mais pas avec le libéral : il prépare directement à la maîtrise des arts scolaires. Il ne fait aucun doute que le Dr Montessori a conçu un système particulièrement efficace pour apprendre aux enfants à écrire, une méthode efficace pour introduire la lecture et un bon matériel pour le travail précoce sur les chiffres. Les deux types de jardins d'enfants augmentent, bien sûr, la capacité générale d'expression de l'enfant : l'activité du jardin d'enfants ajoute à son stock d'idées, éveille et guide son imagination, augmente son vocabulaire et l'entraîne à l'utiliser efficacement. Dans un bon jardin d'enfants, les enfants entendent des histoires et les racontent, racontent leurs propres expériences, chantent des chansons et récitent des vers, le tout en compagnie d'auditeurs amicaux mais assez critiques, ce qui stimule et oriente encore plus l'expression que ne le fait le cercle familial. Mais même le jardin d'enfants conservateur n'apprend pas aux enfants à écrire et à lire. Il leur apprend beaucoup de choses sur les nombres, et on peut se demander s'il ne fait pas un travail plus fondamental dans ce domaine que le système Montessori lui-même. Les cadeaux de Froebel offrent une occasion exceptionnelle d'illustrer concrètement les conceptions de tout et de partie, par la création de tout à partir de parties, et la décomposition de tout en parties. Cet aspect du nombre est au moins aussi important que l'aspect de la série, que les enfants obtiennent en comptant et pour lequel le "long escalier" de Montessori fournit un si bon matériel. Le matériel Froebelian peut être utilisé très facilement pour le comptage, cependant, et le matériel Montessori donne quelques petites occasions d'unir et de diviser. En ce qui concerne la préparation à l'arithmétique, une combinaison des deux types de matériel est à la fois faisable et souhaitable. Le jardin d'enfants libéral, quant à lui, abandonnant l'utilisation des dons et des occupations du site à des fins mathématiques, ne tente pas de préparer ses élèves directement aux arts scolaires.
Par rapport au jardin d'enfants, le système Montessori présente donc les principaux points d'intérêt suivants : il applique beaucoup plus radicalement le principe de la liberté sans restriction ; ses matériaux sont destinés à l'entraînement direct et formel des sens ; il comprend des appareils conçus pour aider au développement purement physique des enfants ; son entraînement social est effectué principalement au moyen d'activités sociales actuelles et réelles ; et il offre une préparation directe aux arts scolaires. Le jardin d'enfants, par contre, comporte une certaine dose d'enseignement collectif, dans lequel les enfants sont tenus - pas nécessairement par l'autorité, mais par l'autorité, il est vrai, lorsque les autres moyens échouent - à des activités déterminées ; son matériel est destiné principalement à l'usage créatif des enfants et offre des possibilités d'analyse mathématique et d'enseignement du dessin ; enfin, sa procédure est riche en ressources pour l'imagination. Il convient de préciser et d'insister sur un point : les deux systèmes ne sont pas rigoureusement antagonistes en ce qui concerne ces caractéristiques. Une grande partie de l'activité au jardin d'enfants est libre, et le principe de prescription n'est pas entièrement abandonné par les "Maisons de l'enfance", comme en témoignent leurs règles et règlements ; le jardin d'enfants implique une formation sensorielle directe, et le système Montessori admet certains des blocs Froebel pour la construction et la conception ; il y a beaucoup d'activités purement musculaires au jardin d'enfants, et certains des jeux habituels des jardins d'enfants sont utilisés par Montessori ; le jardin d'enfants fait un peu de jardinage, de soins aux animaux, de travaux de construction et d'affaires domestiques, et le système Montessori admet quelques jeux sociaux imaginatifs ; les deux systèmes (mais pas la forme libérale du jardin d'enfants) travaillent directement vers les arts scolaires. Comme la différence entre les deux programmes est une question de disposition, d'accentuation et de degré, il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'une combinaison spécialement adaptée aux écoles anglaises et américaines ne puisse être élaborée.
Le contraste général entre une école Montessori et un jardin d'enfants semble être le suivant : alors que les enfants Montessori passent presque tout leur temps à manipuler des objets, en grande partie selon leur inclination individuelle et sous la direction de quelqu'un, les enfants du jardin d'enfants sont généralement engagés dans des travaux de groupe et des jeux ayant un arrière-plan et un attrait imaginatifs. Un principe possible d'ajustement entre les deux systèmes pourrait être énoncé ainsi : le travail avec des objets conçus pour l'entraînement formel sensoriel, moteur et intellectuel devrait être effectué individuellement ou dans des groupes purement volontaires ; l'activité imaginative et sociale devrait être menée dans des groupes réglementés. Ce principe n'est proposé que comme base possible de l'éducation pendant l'âge du jardin d'enfants ; car, en grandissant, les enfants doivent être instruits dans des classes, et ils apprennent naturellement à mener des entreprises imaginatives et sociales dans des groupes libres, et souvent seuls. Il ne faut pas non plus penser que ce principe est proposé comme une règle à laquelle il ne peut y avoir d'exception. Il est simplement suggéré comme une hypothèse de travail générale, dont la valeur doit être testée par l'expérience. Bien que les jardinières d'enfants elles-mêmes aient observé depuis longtemps que le travail en groupe avec le matériel de Froebel, en particulier celui qui implique une analyse géométrique et une conception formelle, fatigue rapidement les enfants, on a estimé que la jardinière d'enfants pouvait préserver ses élèves d'une perte d'intérêt ou d'une réelle fatigue en surveillant attentivement les premiers signes de lassitude et en arrêtant rapidement le travail dès leur apparition. Pour de petits groupes d'enfants plus âgés, qui peuvent faire ce genre de travail avec facilité et plaisir, il ne fait aucun doute que la contrainte inévitable de l'enseignement collectif est un facteur négligeable, dont toute bonne jardinière d'enfants peut prévenir les effets fatigants. Mais pour les enfants plus jeunes, un régime de liberté totale semble promettre de meilleurs résultats, du moins en ce qui concerne le travail avec des objets. Dans les jeux, par contre, l'enseignement en groupe implique très peu de contraintes et l'ensemble du processus est de toute façon moins fatigant. Différencier dans la méthode ces deux types d'activités est peut-être le meilleur moyen de les maintenir toutes deux dans un programme éducatif efficace.
Parler d'un programme éducatif efficace conduit cependant immédiatement à un aspect important du système Montessori, indépendamment de sa relation avec le jardin d'enfants, dont cette introduction doit maintenant traiter. Il s'agit de l'aspect social, qui trouve son explication dans l'histoire de la première école du Dr Montessori. Dans toute discussion sur la disponibilité du système Montessori dans les écoles anglaises et américaines - en particulier dans les écoles publiques américaines et les "Board schools" anglaises - il faut garder à l'esprit les deux conditions générales dans lesquelles le Dr Montessori a effectué ses premiers travaux à Rome. Elle avait ses élèves presque toute la journée, contrôlant pratiquement leur vie pendant leurs heures de veille ; et ses élèves venaient pour la plupart de familles de la classe ouvrière. Nous ne pouvons pas nous attendre à obtenir les résultats obtenus par le Dr Montessori si nous n'avons nos élèves sous notre direction que deux ou trois heures le matin, et nous ne pouvons pas non plus nous attendre à des résultats exactement similaires avec des enfants dont l'hérédité et l'expérience les rendent à la fois plus sensibles, plus actifs et moins influençables qu'eux. Si nous voulons faire une application pratique du schéma Montessori, nous ne devons pas négliger de considérer les modifications que des conditions sociales différentes peuvent rendre nécessaires.
Les conditions dans lesquelles le Dr Montessori a ouvert son école à Rome ne sont pas, en effet, sans équivalent dans les grandes villes du monde entier. Lorsqu'on lit son éloquent "discours inaugural", il est impossible de ne pas souhaiter qu'une "école à la maison" puisse se dresser comme un centre de vie enfantine pleine d'espoir au milieu de chaque pâté de maisons. Il vaudrait mieux, bien sûr, qu'il n'y ait pas du tout d'immeubles urbains ressemblant à des ruches, et que chaque famille puisse offrir à ses propres enfants, dans ses propres locaux, suffisamment de "jeux heureux dans des endroits herbeux". Il vaudrait mieux que chaque père et mère soit, d'une certaine manière, un expert en psychologie et en hygiène de l'enfant. Mais alors que des milliers de malheureux vivent encore dans les détestables falaises de nos villes modernes, nous devons accueillir la conception large du Dr Montessori de la fonction sociale de ses "Maisons de l'Enfance" comme un nouvel évangile pour les écoles qui servent les pauvres des villes. Quel que soit l'appareil didactique utilisé par ces écoles, elles devraient apprendre du Dr Montessori la nécessité d'horaires plus longs, de soins complets aux enfants, d'une coopération plus étroite avec le foyer et d'objectifs plus vastes. Dans ces écoles, également, il est probable que les deux caractéristiques fondamentales du travail du Dr Montessori - son principe de liberté et son plan de formation sensorielle - trouveront leur application la plus complète et la plus fructueuse.
Or, ce sont justement ces caractéristiques fondamentales qui seront le plus âprement attaquées chaque fois que l'on oubliera le statut social de la Casa dei Bambini originelle. Les mesures anthropométriques, les bains, l'apprentissage de l'autonomie personnelle, le service des repas, le jardinage et le soin des animaux peuvent être recommandés de manière générale pour toutes les écoles, même pour celles qui ont une session de trois heures et une classe d'élèves socialement favorisés ; mais la nécessité de la liberté individuelle et de l'entraînement des sens sera niée même dans le travail des écoles où les conditions correspondent étroitement à celles de San Lorenzo. Bien entendu, aucun éducateur pratique ne proposera de baignoires pour toutes les écoles, et il ne fait aucun doute que l'on fera preuve d'un sage conservatisme en transférant à une école donnée une fonction actuellement bien remplie par les foyers qui la soutiennent. Les problèmes soulevés par la proposition d'appliquer dans toutes les écoles la conception Montessori de la discipline et la formation du sens Montessori sont vraiment plus difficiles à résoudre. La liberté individuelle est-elle un principe éducatif universel, ou un principe qui doit être modifié dans le cas d'une école n'ayant pas un statut social tel que celui de la "Maison de l'Enfance" originelle ? Tous les enfants ont-ils besoin d'une formation sensorielle, ou seulement ceux dont l'héritage et le milieu familial sont défavorables ? Aucune discussion sérieuse sur le système Montessori ne peut éviter ces questions. Ce qui est dit ici en réponse à ces questions est écrit dans l'espoir que les discussions ultérieures puissent être quelque peu influencées pour garder à l'esprit le facteur réellement décisif dans chaque cas - la situation réelle dans l'école.
Il y a suffisamment d'occasions dans ces questions, bien sûr, pour une argumentation philosophique et scientifique. La première question implique un problème éthique, la seconde un problème psychologique, et toutes deux peuvent être suivies de questions purement métaphysiques. Le Dr Montessori croit en la liberté de l'élève parce qu'elle pense à la vie "comme à une déesse superbe, avançant toujours vers de nouvelles conquêtes". La soumission, la loyauté, l'abnégation ne lui semblent, apparemment, que des nécessités accessoires de la vie, et non des éléments essentiels de sa forme éternelle. Il y a là une occasion évidente de profondes différences de théorie et de croyance philosophiques. Elle semble également soutenir que la perception sensorielle constitue la seule base de la vie mentale et donc de la vie morale ; que "l'éducation sensorielle pré pare la fondation ordonnée sur laquelle l'enfant peut construire une mentalité claire et forte", y compris, apparemment, ses idéaux moraux ; et que la culture de l'objectif et des capacités imaginatives et créatives des enfants est beaucoup moins importante que le développement du pouvoir d'apprendre de l'environnement au moyen des sens. Ces vues semblent s'accorder assez étroitement avec celles de Herbart et, dans une certaine mesure, avec celles de Locke. Elles offrent certainement matière à un débat psychologique et éthique. Il est possible, cependant, que le Dr Montessori n'accepterait pas les vues qui lui sont attribuées ici sur la base de ce livre ; et en tout cas, ce sont des questions pour le philosophe et le psychologue. Une question pédagogique n'est jamais entièrement une question de principe.
Peut-on raisonnablement soutenir, alors, qu'une situation réelle comme celle de la première "Maison de l'Enfance" à Rome est la seule situation dans laquelle le principe de liberté de Montessori peut légitimement trouver une pleine application ? De toute évidence, l'école romaine est une véritable République de l'enfance, dans laquelle rien ne doit prendre le pas sur la prétention de l'enfant à poursuivre un but actif qui lui est propre. Les contraintes sociales y sont réduites au minimum ; les enfants doivent, certes, subordonner leur caprice individuel aux exigences du bien commun, ils n'ont pas le droit de se quereller ou de se gêner les uns les autres, et ils ont des devoirs à accomplir à des moments précis ; mais chaque enfant est citoyen d'une communauté gouvernée entièrement dans l'intérêt de ses membres également privilégiés, sa liberté est rarement entravée, il est libre de réaliser ses propres objectifs, et il a autant d'influence dans les affaires de la république que le membre moyen d'une démocratie adulte. Cette situation ne se reproduit jamais au foyer, car l'enfant n'est pas seulement un membre de la famille, dont les intérêts doivent être considérés avec les autres, mais littéralement un membre subordonné, dont les intérêts doivent souvent être franchement mis de côté pour ceux d'un membre adulte ou pour ceux du foyer lui-même. Les enfants doivent venir dîner à l'heure du dîner, même si continuer à creuser dans le sable serait plus à leur goût ou plus propice au développement général de leurs muscles, de leur esprit ou de leur volonté. Il est possible, bien sûr, d'affiner la théorie de l'appartenance de l'enfant à la communauté familiale et du droit de commandement des aînés, mais il n'en reste pas moins vrai que les conditions communes de la vie familiale interdisent toute liberté telle qu'elle est exercée dans une école Montessori. De même, une école à grand effectif qui choisit de couvrir dans un temps donné une telle quantité de travail que l'on ne peut faire confiance à l'initiative individuelle pour le faire, est obligée d'enseigner certaines choses à neuf heures et d'autres à dix heures, et d'enseigner en groupes ; et l'individu dont la vie est ainsi encadrée et confinée doit obtenir ce qu'il peut. Pour une école donnée, la question évidente est la suivante : compte tenu du travail à accomplir dans le temps imparti, pouvons-nous renoncer aux garanties d'un programme fixe et de l'enseignement par groupes ? La question plus profonde se pose ici : Le travail à faire est-il en soi si important qu'il vaut la peine de le faire faire aux enfants sous la contrainte ou par intérêt induit par le maître ? Ou pour le dire autrement : Le travail n'est-il pas tellement moins important que la liberté de l'enfant qu'il vaut mieux s'en remettre à la curiosité native et à un matériel astucieux et courir le risque qu'il perde une partie du travail, voire la totalité ?
Pour les écoles au-delà du niveau primaire, la réponse à cette question ne fait aucun doute. Il existe de nombreux moyens d'éviter que le travail scolaire ne devienne le processus mortifère et déprimant qu'il est si souvent, mais l'abandon de tous les horaires fixes et limités et des prescriptions de l'enseignement en classe ( ) n'en fait pas partie. Même si une liberté totale d'action individuelle était possible dans les écoles de niveau supérieur, il n'est pas certain qu'elle serait souhaitable, car nous devons apprendre à réaliser un grand nombre de nos objectifs dans la vie sous la contrainte de la société. Mais avec les jeunes enfants, la question devient plus difficile. Quel travail voulons-nous assurer à chaque enfant ? Si nos écoles ne peuvent tenir qu'une demi-journée, y a-t-il assez de temps pour que chaque enfant puisse faire ce travail sans un enseignement collectif à des heures précises ? La prescription et la contrainte qu'implique un tel enseignement collectif sont-elles vraiment suffisantes pour nuire aux enfants ou pour rendre notre enseignement moins efficace ? Ne pouvons-nous pas renoncer complètement à la prescription pour certaines parties du travail et la minimiser pour d'autres ? La question générale de la liberté individuelle est ainsi réduite à une série de problèmes pratiques d'ajustement. Il ne s'agit plus de la liberté totale ou de l'absence totale de liberté, mais de la médiation pratique entre ces deux extrêmes. Si l'on considère, en outre, que l'habileté de la maîtresse et l'attrait de sa personnalité, la puissance séduisante de l'appareil didactique et la facilité avec laquelle il permet aux enfants d'apprendre, sans parler d'une salle gaie et agréable et de l'absence de pupitres et de sièges fixes, tout cela peut concourir à empêcher que l'enseignement programmé en groupes ne devienne le moins du monde une occasion de contrainte, il est clair que, dans une école donnée, il peut être amplement justifié d'atténuer la rigueur du principe de liberté du Dr Montessori. Chaque école doit trouver sa propre solution au problème en fonction de ses conditions particulières.
L'adoption de la formation sensorielle semble être une question beaucoup moins importante pour une décision variable. Certains enfants peuvent en avoir moins besoin que d'autres, mais pour tous les enfants âgés de trois à cinq ans, le matériel Montessori s'avérera fastidieux cinating as well as profitable. Une grande partie de la théorie moderne de l'éducation est basée sur la croyance que les enfants ne s'intéressent qu'à ce qui a une valeur sociale, un contenu social ou une "utilité réelle" ; pourtant, une journée avec n'importe quel enfant normal donnera amplement la preuve du plaisir que prennent les enfants dans des exercices purement formels. La fascination pure et simple qu'exerce le fait de ranger des cartes sous le bord d'un tapis rendra un bébé heureux jusqu'à ce que toute réserve ordinaire de cartes soit épuisée ; et l'attrait purement sensoriel de jeter des pierres dans l'eau donne une satisfaction suffisante pour absorber pendant longtemps l'attention des enfants plus âgés - sans parler des adultes. L'appareil Montessori satisfait la faim des sens lorsqu'ils sont avides de nouveaux matériaux, et il présente en outre un intérêt pour les énigmes auxquelles les enfants répondent avec enthousiasme. Le Dr Montessori subordonne la valeur du contenu mental concret que son matériel fournit à sa valeur pour rendre les sens plus aiguisés ; cependant, il n'est pas du tout certain que ce contenu - aussi purement formel soit-il - ne donne pas aussi au matériel une grande partie de son importance. En effet, le raffinement de la discrimination sensorielle peut ne pas être particulièrement précieux en soi. Ce que dit le professeur G. M. Whipple sur ce point dans son Manual of Menial and Physical Tests (p. 130) a beaucoup de poids :
L'utilisation de tests sensoriels dans les travaux de corrélation est particulièrement intéressante. En général, certains auteurs sont convaincus qu'une discrimination aiguë est une condition préalable à une intelligence aiguë, tandis que d'autres sont également convaincus que l'intelligence est essentiellement conditionnée par des processus "supérieurs", et seulement de façon lointaine par la capacité sensorielle - sauf, bien sûr, si la diminution de la capacité est telle qu'elle interfère sérieusement avec l'expérience des sensations, comme dans la surdité partielle ou la perte partielle de la vision. Bien que ce ne soit guère le lieu ici de discuter de la signification évolutive de la sensibilité discriminative, on peut souligner que la capacité normale est de nombreuses fois supérieure aux exigences réelles de la vie, et qu'il est par conséquent difficile de comprendre pourquoi la nature a été si prolifique et généreuse ; de comprendre, en d'autres termes, quelle est la sanction de la capacité discriminative apparemment hypertrophiée des organes des sens humains. Les "explications téléologiques" habituelles de notre vie sensorielle ne parviennent pas à rendre compte de cette divergence. Encore une fois, le fait même de l'existence de cette capacité excédentaire semble rejeter d'emblée l'idée que la capacité sensorielle puisse être un facteur de conditionnement de l'intelligence - avec la réserve déjà signalée.
Il est tout à fait possible que la véritable valeur pédagogique de l'appareil Montessori soit due au fait qu'il maintient les enfants joyeusement engagés dans l'exercice de leurs sens et de leurs doigts au moment où ils ont le plus besoin d'un tel exercice et au fait qu'il leur apprend sans le moindre effort beaucoup de choses sur les formes et les matériaux. Ces valeurs ne sont pas susceptibles d'être affectées par des conditions scolaires différentes.
Dans l'utilisation du matériel pour l'entraînement sensoriel, les enseignants anglais et américains peuvent trouver leur compte dans deux avertissements généraux. Premièrement, il ne faut pas supposer que l'entraînement sensoriel à lui seul permettra d'accomplir tout ce que le Dr Montessori accomplit à travers l'ensemble de ses activités scolaires. Consacrer la majeure partie d'une matinée à l'entraînement sensoriel, c'est lui donner (sauf peut-être dans le cas des élèves les plus jeunes) une importance excessive. Il n'est même pas certain que l'utilisation générale des sens en soit affectée, sans parler de la perte d'opportunités pour une activité physique et sociale plus importante. Deuxièmement, l'isolement des sens doit être utilisé avec une certaine prudence. Couper la vue, c'est faire un pas vers le sommeil, et il ne faut pas exiger trop longtemps que l'enfant concentre son attention, dans cette situation, sur les perceptions sensorielles qu'il obtient par d'autres moyens que la vue. L'action mentale sans les moyens habituels d'information et de contrôle n'est pas une mince affaire.
La proposition, mentionnée plus haut, d'une combinaison réalisable du système Montessori et du jardin d'enfants, peut maintenant être exposée. Si elle est présentée très brièvement et sans défense ni prophétie, c'est parce qu'elle est faite sans dogmatisme, simplement dans l'espoir qu'elle s'avérera suggestive pour quelque enseignante à l'esprit ouvert, prête à essayer tout plan qui promet d'être bon pour ses élèves. Les conditions supposées sont celles du jardin d'enfants ordinaire des écoles publiques américaines, avec un programme de deux ans commençant avec des enfants de trois ans et demi ou quatre ans, un jardin d'enfants dont le nombre d'élèves n'est pas trop élevé, avec une jardinière d'enfants et une assistante maternelle compétentes, et avec l'aide de quelques étudiants de l'école de formation.
La première proposition consiste à utiliser le matériel Montessori pendant la majeure partie de la première année au lieu du matériel habituel de Froebel. Une partie du temps actuellement consacré aux images et aux histoires devrait également être consacrée à l'utilisation des appareils Montessori, y compris les appareils de gymnastique. Il n'est pas suggéré de ne pas utiliser de matériel Froebelien, mais de tisser les deux systèmes l'un dans l'autre, avec une transition graduelle de l'utilisation libre et individuelle des objets Montessori au même type d'utilisation des cadeaux Froebel de grande taille, en particulier les deuxième, troisième et quatrième. Lorsque les enfants semblent être prêts à le faire, il convient de commencer un certain nombre de travaux plus formels avec les cadeaux. Au cours de la deuxième année, le travail sur les cadeaux de Froebel doit prédominer, sans exclure absolument les exercices Montessori. Dans la dernière partie de la deuxième année, les exercices Montessori préparatoires à l'écriture doivent être introduits. Tout au long de la deuxième année, les enfants doivent disposer de tout le temps nécessaire pour raconter des histoires et travailler avec des images, et au cours des deux années, le cercle du matin et les jeux doivent être maintenus comme d'habitude. La période du déjeuner devrait bien sûr rester la même. Mon tessori, la jardinière d'enfants et son assistante devraient s'efforcer d'incorporer dans leur travail la précieuse formation à l'auto-assistance et à l'action indépendante qu'offre l'entretien du matériel et de l'équipement par les enfants eux-mêmes. Cela ne doit pas se limiter à l'appareil Montessori. Les enfants qui ont été formés à sortir, utiliser et ranger les objets Montessori jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la variété beaucoup plus riche de matériel dans le système Froebelian, devraient être capables de s'en occuper également. Bien sûr, si certains enfants peuvent revenir l'après-midi, il serait très intéressant d'essayer le jardinage, que Froebel et Montessori recommandent tous deux, et la vaisselle Montessori.
Pour le mépris éventuel de ceux pour qui tout compromis est dégoûtant, l'auteur de cette introduction ne cherche qu'une seule compensation : que tout enfant de maternelle qui adopterait sa suggestion lui permette d'en étudier les résultats.
Quant à l'utilisation du système Montessori à la maison, une ou deux remarques doivent suffire. En premier lieu, les parents ne doivent pas s'attendre à ce que la simple présence du matériel dans la crèche suffise à faire un miracle éducatif. Une directrice Montessori ne fait pas d'"enseignement" ordinaire, mais elle est appelée à des efforts très habiles et très fatigants. Elle doit surveiller, aider, inspirer, suggérer, guider, expliquer, corriger, inhiber. Elle est censée, en outre, contribuer par son travail à l'édification d'une nouvelle science de la pédagogie ; mais ses efforts éducatifs - et l'éducation n'est pas un effort d'investigation et d'expérimentation, mais un effort pratique et constructif - sont suffisants pour épuiser tout son temps, sa force et son ingéniosité. Cela ne fera aucun mal - sauf peut-être pour le matériel lui-même - d'avoir le matériel Montessori à portée de main à la maison, mais il doit être utilisé sous une direction appropriée pour être efficace sur le plan éducatif. En outre, il ne faut pas oublier que le matériel n'est en aucun cas la caractéristique la plus importante du programme Montessori. La meilleure utilisation du système Montessori à la maison viendra de la lecture de ce livre. Si les parents apprennent du Dr Montessori quelque chose de la valeur de la vie de l'enfant, de son besoin d'activité, de ses modes d'expression caractéristiques et de ses possibilités, et s'ils appliquent ces connaissances avec sagesse, l'œuvre du grand éducateur italien sera suffisamment réussie.
Cette introduction ne peut se terminer sans une discussion, même limitée, des problèmes importants que pose la méthode Montessori pour enseigner aux enfants à écrire et à lire. Nous disposons dans les écoles américaines de méthodes admirables pour l'enseignement de la lecture ; selon la méthode Aldine, par exemple, les enfants d'un niveau moyen lisent sans difficulté dix livres ou plus au cours de la première année scolaire, et progressent rapidement vers l'autonomie. Notre enseignement de l'écriture, cependant, n'a jamais été particulièrement remarquable. Nous avons essayé récemment d'apprendre aux enfants à écrire d'une main fluide par le "mouvement du bras", sans que les doigts forment beaucoup de lettres séparées, et nos résultats semblent prouver que l'effort avec les enfants avant l'âge de dix ans ne vaut pas la peine. Les directeurs d'école sensés se contentent de laisser les enfants des quatre premières classes écrire en dessinant les lettres, et il y a eu une conviction assez générale que l'écriture n'est en aucun cas particulièrement importante avant l'âge de huit ou neuf ans. Compte tenu du succès du Dr Montessori, qui a réussi à apprendre à des enfants de quatre et cinq ans à écrire avec facilité et habileté, ne devons-nous pas revoir notre estimation de la valeur de l'écriture et notre méthode d'enseignement ? Quels changements pouvons-nous introduire avec profit dans notre enseignement de la lecture ?
Ici encore, notre théorie et notre pratique ont souffert de la défense obstinée de principes généraux. Parce que, par des méthodes maladroites, on maintenait les enfants dans la tâche d'apprendre les arts scolaires au détriment incontestable de leur esprit et de leur corps, certains auteurs ont préconisé l'exclusion totale de la lecture et de l'écriture dans les premières classes. De nombreux parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école avant l'âge de huit ans, préférant les laisser "courir librement". Cette attitude est tout à fait justifiée par la situation des écoles dans certains endroits ; mais là où les écoles sont bonnes, elle ignore non seulement les avantages évidents de la vie scolaire en dehors de l'enseignement de la langue écrite, mais aussi l'absence presque totale de contrainte qu'offrent les méthodes modernes. Maintenant que le système Montessori ajoute une méthode nouvelle et prometteuse à nos ressources, il est d'autant plus déraisonnable : car, en fait, les enfants normaux sont désireux de lire et d'écrire à six ans, et ont beaucoup d'utilité pour ces réalisations.
Cela ne signifie pas, cependant, que la lecture et l'écriture sont si importantes pour les jeunes enfants qu'il faille leur accorder une importance excessive. Si nous pouvons les enseigner sans effort, faisons-le, et plus c'est efficace, mieux c'est ; mais rappelons-nous, comme le fait le Dr Montessori, que la lecture et l'écriture ne devraient constituer qu'une partie subordonnée de l'expérience de l'enfant et devraient répondre en général à ses autres besoins. Même avec les meilleures méthodes, la valeur de la lecture et de l'écriture avant six ans est discutable. Notre vie consciente est suffisamment livresque comme cela, et il semblerait, d'une manière générale, qu'il soit plus sûr de reporter le langage écrit jusqu'à l'âge où l'on s'y intéresse normalement, et même alors, de ne pas y consacrer plus de temps qu'une maîtrise facile et progressive ne l'exige.
Les avantages techniques du schéma Montessori pour l'écriture ne font aucun doute. L'enfant acquiert une maîtrise immédiate de son crayon par des exercices qui ont leur propre intérêt, simple mais passionnant ; et s'il n'apprend pas à écrire avec un "mouvement du bras", nous pouvons nous contenter de son aptitude à dessiner une écriture lisible et belle. Ensuite, il apprend les lettres - leurs formes, leurs noms, et comment les fabriquer - par des exercices qui ont la caractéristique technique très importante d'impliquer une analyse sensorielle approfondie de la matière à maîtriser. Meumann nous a appris dernièrement la grande valeur, dans tout travail de mémoire, d'une impression complète par une étude analytique prolongée et intensive. Dans l'enseignement de l'orthographe, par exemple, il est relativement inutile de concevoir des schémas de mémorisation à moins que les impressions originales ne soient fortes et élaborées ; et ce n'est que par une impression sensorielle soigneuse, variée et détaillée qu'un matériau tel que l'alphabet peut être ainsi imprimé. Le système Montessori d'impression des lettres est si efficace - surtout en raison de l'utilisation novatrice du sens du toucher - que les enfants apprennent à faire tout l'alphabet avant que le caractère abstrait et formel du matériel n'entraîne une diminution de l'intérêt ou de l'enthousiasme. Leur curiosité initiale pour les caractères qu'ils voient leurs aînés utiliser suffit à les mener à bien.
En italien, l'étape suivante est facile. Une fois les lettres apprises, il est facile de les combiner en mots, car l'orthographe italienne est si proche de la phonétique qu'elle présente très peu de difficultés pour quiconque sait prononcer. C'est précisément sur ce point que l'enseignement de la lecture en anglais par la méthode Montessori rencontrera son plus grand obstacle. En effet, c'est le caractère non phonétique de l'orthographe anglaise qui nous a largement incités à abandonner la méthode de l'alphabet pour apprendre à lire aux enfants. D'autres raisons, bien sûr, nous ont également incités à enseigner par la méthode des mots et des phrases, mais celle-ci a été et restera le facteur décisif. Nous avons trouvé plus efficace d'enseigner aux enfants des mots entiers, des phrases ou des rimes à la vue, en ajoutant aux impressions sensorielles l'intérêt suscité par un large éventail d'associations, puis en analysant les mots ainsi acquis dans leurs éléments phonétiques pour donner aux enfants un pouvoir indépendant dans l'acquisition de nouveaux mots. Le succès marqué que nous avons obtenu avec cette méthode ne permet nullement d'affirmer qu'il est "dans le processus caractéristique du développement naturel" que les enfants construisent des mots écrits à partir de leurs éléments - sons et syllabes. Il semblerait, au contraire, comme l'a conclu James, que l'esprit travaille tout aussi naturellement dans la direction opposée - en saisissant d'abord les ensembles, en particulier ceux qui ont un intérêt pratique, puis en travaillant jusqu'à leurs éléments formels. Dans l'enseignement de l'orthographe, bien sûr, les ensembles (mots) sont déjà connus à vue - c'est-à-dire que l'élève les reconnaît facilement en lisant - et le processus vise à imprimer dans l'esprit de l'enfant l'ordre exact de leurs éléments constitutifs. C'est parce que la lecture et l'orthographe sont en anglais des processus si complètement séparés que nous pouvons apprendre à un enfant à lire admirablement sans en faire un "bon orthographeur" et que nous sommes obligés de l'amener à ce dernier état glorieux par de nouveaux efforts. Nous gagnons à cette séparation tant en lecture qu'en orthographe, comme l'expérience et les tests comparatifs - en dépit des superstitions populaires contraires - l'ont prouvé de façon concluante. La maîtrise de l'alphabet par la méthode Montessori sera d'une grande utilité pour apprendre à nos enfants à écrire, mais ne sera qu'accessoirement utile pour leur apprendre à lire et à épeler.
Une fois de plus, donc, cette introduction tente de suggérer un compromis. Dans le domaine des arts scolaires, le programme utilisé avec tant d'efficacité dans les écoles italiennes et le programme qui a été si bien élaboré dans les écoles anglaises et américaines peuvent être combinés avec profit. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur l'écriture et la lecture en nous inspirant du Dr Montessori, en particulier de la liberté dont jouissent ses enfants dans le processus d'apprentissage de l'écriture et dans l'utilisation de leur pouvoir nouvellement acquis, ainsi que de son dispositif pour leur apprendre à lire de la prose reliée. Nous pouvons utiliser son matériel pour l'apprentissage des sens et aboutir comme elle à une maîtrise facile des symboles alphabétiques. Nous pouvons conserver nos propres méthodes d'enseignement de la lecture et, sans aucun doute, l'analyse phonétique qu'elles impliquent sera plus facile et plus efficace grâce à l'adoption de la méthode Montessori d'enseignement des lettres. L'ajustement exact des deux méthodes est bien sûr une tâche qui incombe aux enseignants dans la pratique et aux responsables de l'éducation.
Ce livre devrait être très intéressant pour tous les éducateurs. Peu d'entre eux s'attendront à ce que la méthode Montessori régénère l'humanité. Peu d'entre eux souhaitent qu'elle - ou toute autre méthode - produise une génération de prodiges tels que ceux qui ont été annoncés récemment en Amérique. Peu de gens approuveront l'acquisition très précoce par les enfants de l'art de la lecture et de l'écriture. Mais tous ceux qui ont l'esprit juste admettront le génie qui brille dans les pages qui suivent, et la remarquable suggestivité des travaux du Dr Montessori. C'est la tâche de l'étudiant professionnel de l'éducation d'aujourd'hui de soumettre tous les systèmes à une étude comparative minutieuse, et puisque le pouvoir inventif du Dr Montessori a cherché ses tests dans l'expérience pratique plutôt que dans l'investigation comparative, cette tâche plus ennuyeuse reste à faire. Mais quelle que soit la façon dont il examine les résultats de son travail, l'éducateur qui le lira ici honorera dans la Dottoressa Maria Montessori l'enthousiasme, la patience et la perspicacité constructive du scientifique et de l'ami de l'humanité.
Henry W. Holmes.
Université de Harvard, le 22 février 1912.
LA MÉTHODE MONTESSORI
CHAPITRE I
Une considération critique de la nouvelle pédagogie dans sa relation avec la science moderne
Je n'ai pas l'intention de présenter un traité de pédagogie scientifique. Le modeste dessein de ces notes incomplètes est de donner les résultats d'une expérience qui ouvre apparemment la voie à la mise en pratique de ces nouveaux principes de la science qui, ces dernières années, tendent à révolutionner le travail d'éducation.
On a beaucoup parlé, au cours de la dernière décennie, de la tendance de la pédagogie, suivant les traces de la médecine, à dépasser le stade purement spéculatif et à fonder ses conclusions sur les résultats positifs de l'expérimentation. La psychologie physiologique ou expérimentale qui, de Weber et Fechner à Wundt, s'est organisée en une science nouvelle, semble destinée à fournir à la nouvelle pédagogie cette préparation fondamentale que la psychologie métaphysique d'autrefois fournissait à la pédagogie philosophique. L'anthropologie morphologique appliquée à l'étude physique des enfants est aussi un élément fort de la croissance de la nouvelle pédagogie.
Mais malgré toutes ces tendances, la Pédagogie Scientifique n'a encore jamais été définitivement construite ni définie. C'est une chose vague dont on parle, mais qui n'existe pas, en réalité. Nous pourrions dire qu'elle a été, jusqu'à présent, la simple intuition ou suggestion d'une science qui, à l'aide des sciences positives et expérimentales qui ont renouvelé la pensée du XIXe siècle, doit sortir des brumes et des nuages qui l'ont entourée. Car l'homme, qui a formé un monde nouveau grâce au progrès scientifique, doit lui-même être préparé et développé par une pédagogie nouvelle. Mais je ne tenterai pas ici d'en parler plus longuement.
Il y a quelques années, un médecin connu créa en Italie une école de pédagogie scientifique, dont l'objet était de préparer les maîtres à suivre le nouveau mouvement qui commençait à se faire sentir dans le monde pédagogique. Cette école a eu, pendant deux ou trois ans, un grand succès, si grand, en effet, que les maîtres de toute l'Italie y affluaient, et elle a été dotée par la ville de Milan d'un splendide matériel scientifique. En effet, ses débuts furent des plus propices, et une aide généreuse lui fut accordée dans l'espoir qu'il serait possible d'établir, grâce aux expériences qui y étaient menées, "la science de la formation de l'homme".
L'enthousiasme qui a accueilli cette école est dû, dans une large mesure, au soutien chaleureux que lui a apporté l'éminent anthropologue Giuseppe Sergi, qui, pendant plus de trente ans, s'est efforcé de diffuser parmi les enseignants italiens les principes d'une nouvelle civilisation fondée sur l'éducation. "Aujourd'hui, dans le monde social, disait Sergi, une nécessité impérieuse se fait sentir : la reconstruction des méthodes éducatives ; et celui qui lutte pour cette cause, lutte pour la régénération de l'homme. " Dans ses écrits pédagogiques rassemblés dans un volume sous le titre de "Educazione ed Istruzione" (Pensieri),[1] il donne un résumé des conférences dans lesquelles il a encouragé ce nouveau mouvement, et dit qu'il croit que la voie de cette régénération désirée réside dans une étude méthodique de celui qui doit être éduqué, menée sous la direction de l'anthropologie pédagogique et de la psychologie expérimentale.
"Depuis plusieurs années, je me suis battu pour une idée concernant l'instruction et l'éducation de l'homme, qui m'a paru d'autant plus juste et utile que j'y ai réfléchi plus profondément. Mon idée était que, pour établir des méthodes naturelles et rationnelles, il était indispensable de faire des observations nombreuses, exactes et rationnelles de l'homme en tant qu'individu, principalement pendant la petite enfance, qui est l'âge auquel les bases de l'éducation et de la culture doivent être posées.
"Mesurer la tête, la taille, etc. ne signifie pas en effet que l'on établit un système de pédagogie, mais cela indique la route que l'on peut suivre pour arriver à un tel système, car si l'on veut éduquer un individu, il faut avoir une connaissance précise et directe de lui."
L'autorité de Sergi suffisait à convaincre beaucoup de gens qu'avec une telle connaissance de l'individu, l'art de l'éduquer se développerait naturellement. Cela conduisit, comme il arrive souvent, à une confusion d'idées parmi ses disciples, résultant tantôt d'une interprétation trop littérale, tantôt d'une exagération des idées du maître. Le principal problème était de confondre l'étude expérimentale de l'élève avec son éducation. Et comme l'une était la voie qui conduisait à l'autre, qui aurait dû en découler naturellement et rationnellement, on donna tout de suite le nom de pédagogie scientifique à ce qui était en réalité une anthropologie pédagogique. Ces nouveaux convertis portaient comme bannière le "Tableau Biographique", croyant qu'une fois cet étendard fermement planté sur le champ de bataille de l'école, la victoire serait gagnée.
L'école dite de pédagogie scientifique a donc formé les enseignants à la prise de mesures anthropométriques, à l'utilisation d'instruments esthésiométriques, à la collecte de données psychologiques - et l'armée de nouveaux enseignants scientifiques a été formée.
Il faut dire que dans ce mouvement l'Italie s'est montrée en avance sur son temps. En France, en Angleterre, et surtout en Amérique, des expériences ont été faites dans les écoles primaires, basées sur une étude de l'anthropologie et de la pédagogie psychologique, dans l'espoir de trouver dans l'anthropométrie et la psychométrie, la régénération de l'école. Dans ces tentatives, ce sont rarement les enseignants qui ont effectué les recherches ; les expériences ont été, dans la plupart des cas, entre les mains de médecins qui s'intéressaient davantage à leur science particulière qu'à l'éducation. Ils ont généralement cherché à tirer de leurs expériences une contribution à la psychologie ou à l'anthropologie, plutôt que d'essayer d'organiser leur travail et leurs résultats en vue de la formation de la pédagogie scientifique tant recherchée. Pour résumer brièvement la situation, l'anthropologie et la psychologie ne se sont jamais consacrées à la question de l'éducation des enfants dans les écoles, et les enseignants formés scientifiquement ne se sont jamais montrés à la hauteur des véritables scientifiques.
La vérité est que le progrès pratique de l'école exige une véritable fusion de ces tendances modernes, dans la pratique et dans la pensée ; une fusion qui amènera les scientifiques directement dans le domaine important de l'école et en même temps élèvera les enseignants du niveau intellectuel inférieur auquel ils sont limités aujourd'hui. C'est vers cet idéal éminemment pratique que tend l'Ecole Universitaire de Pédagogie, fondée en Italie par Credaro. L'intention de cette école est d'élever la Pédagogie de la position inférieure qu'elle a occupée comme branche secondaire de la philosophie, à la dignité d'une science définie, qui couvrira, comme la Médecine, un champ large et varié d'études comparatives.
Et parmi les branches qui lui sont affiliées, on trouvera très certainement l'Hygiène pédagogique, l'Anthropologie pédagogique et la Psychologie expérimentale.
En effet, l'Italie, pays de Lombroso, de De-Giovanni et de Sergi, peut revendiquer l'honneur d'être prééminente dans l'organisation d'un tel mouvement. En effet, ces trois scientifiques peuvent être appelés les fondateurs de la nouvelle tendance de l'anthropologie : le premier a ouvert la voie à l'anthropologie criminelle, le second à l'anthropologie médicale et le troisième à l'anthropologie pédagogique. Pour la bonne fortune de la science, tous les trois ont été les chefs reconnus de leurs lignes de pensée spéciales, et ont été si éminents dans le monde scientifique qu'ils ont non seulement fait des disciples courageux et précieux, mais ont également préparé les esprits des masses à recevoir la régénération scientifique qu'ils ont encouragée. (Pour référence, voir mon traité "Anthropologie pédagogique").[2]
Notre pays peut être fier de tout cela à juste titre.
Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe dans le domaine de l'éducation, ce sont les intérêts de l'humanité en général, de la civilisation, et devant de si grandes forces, nous ne pouvons reconnaître qu'un seul pays, le monde entier. Et dans une cause d'une si grande importance, tous ceux qui ont donné à une contribution quelconque, même si ce n'est qu'une tentative non couronnée de succès, sont dignes du respect de l'humanité dans tout le monde civilisé. Ainsi, en Italie, les écoles de pédagogie scientifique et les laboratoires d'anthropologie, qui ont vu le jour dans les différentes villes grâce aux efforts des instituteurs et des inspecteurs scolaires, et qui ont été abandonnés presque avant d'être définitivement organisés, ont néanmoins une grande valeur en raison de la foi qui les a inspirés, et des portes qu'ils ont ouvertes aux hommes pensants.
Il n'est pas nécessaire de dire que ces tentatives étaient prématurées et découlaient d'une compréhension trop faible des nouvelles sciences encore en cours de développement. Toute grande cause naît d'échecs répétés et de réalisations imparfaites. Lorsque saint François d'Assise vit son Seigneur dans une vision et reçut des lèvres divines l'ordre "François, reconstruis mon église", il crut que le Maître parlait de la petite église dans laquelle il était agenouillé à ce moment-là. Et il se mit immédiatement à la tâche, portant sur ses épaules les pierres avec lesquelles il voulait reconstruire les murs tombés. Ce n'est que plus tard qu'il prit conscience du fait que sa mission était de renouveler l'Église catholique par l'esprit de pauvreté. Mais le saint François qui a porté si ingénument les pierres, et le grand réformateur qui a conduit si miraculeusement le peuple au triomphe de l'esprit, sont une seule et même personne à des stades différents de développement. Ainsi, nous, qui travaillons à une grande fin, sommes membres d'un seul et même corps ; et ceux qui viennent après nous n'atteindront le but que parce qu'il y a eu ceux qui ont cru et travaillé avant eux. Et, comme saint François, nous avons cru qu'en portant les pierres dures et stériles du laboratoire expérimental sur les vieux murs croulants de l'école, nous pourrions la reconstruire. Nous avons regardé les aides offertes par les sciences matérialistes et mécaniques avec le même espoir que saint François regardait les carrés de granit qu'il devait porter sur ses épaules.
Ainsi, nous avons été entraînés dans une voie fausse et étroite, dont nous devons nous libérer, si nous voulons établir des méthodes vraies et vivantes pour la formation des générations futures.
Préparer les professeurs à la méthode des sciences expérimentales n'est pas chose facile. Quand nous les aurons instruits en anthropométrie et en psychométrie de la manière la plus minutieuse possible, nous n'aurons créé que des machines dont l'utilité sera des plus douteuses. En effet, si c'est de cette façon que nous devons initier nos maîtres à l'expérimentation, nous resterons toujours dans le domaine de la théorie. Les maîtres de l'ancienne école, préparés d'après les principes de la philosophie métaphysique, comprenaient les idées de certains hommes considérés comme des autorités, et remuaient les muscles de la parole en parlant d'eux, et les muscles de l'œil en lisant leurs théories. Nos professeurs scientifiques, au contraire, sont familiarisés avec certains instruments et savent comment bouger les muscles de la main et du bras pour se servir de ces instruments ; en outre, ils ont une préparation intellectuelle qui consiste en une série d'épreuves typiques, qu'ils ont, d'une manière stérile et mécanique, appris à appliquer.
La différence n'est pas substantielle, car les différences profondes ne peuvent exister dans la seule technique extérieure, mais résident plutôt dans l'homme intérieur. Ce n'est pas avec toute notre initiation à l'expérimentation scientifique que nous avons préparé de nouveaux maîtres, car, après tout, nous les avons laissés à la porte de la vraie science expérimentale ; nous ne les avons pas admis à la phase la plus noble et la plus profonde de cette étude, à cette expérience qui fait les vrais scientifiques.