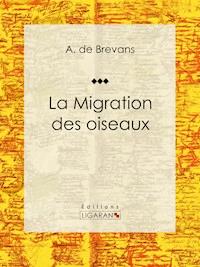
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce n'est pas des moindres curiosités ou des moindres merveilles de la nature que la translation bisannuelle du monde des oiseaux des contrées du Nord vers celle du Midi, et de celles-ci vers les premières. Certaines espèces parmi les quadrupèdes, les poissons et les insectes, sont aussi soumises à des migrations..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054606
©Ligaran 2015
À Toussenel
Maître,
Après la nature, notre reine souveraine, vous avez été le grand inspirateur de ce livre : Veuillez en agréer l’hommage.
A. DE BREVANS.
Ce n’est pas une des moindres curiosités ou des moindres merveilles de la nature que la translation bisannuelle du monde des oiseaux des contrées du Nord vers celle du Midi, et de celles-ci vers les premières. Certaines espèces parmi les quadrupèdes, les poissons et les insectes, sont aussi soumises à des migrations : mais l’universalité, on peut dire, et la régularité de ce double mouvement de va-et-vient chez les oiseaux, comme s’il était astreint aux oscillations d’une vaste pendule ; la puissance de locomotion qu’il suppose chez ces êtres, en apparence si frêles, pour accomplir leurs vastes parcours ; la sagacité qu’il implique pour prévoir les saisons, les conditions de l’atmosphère et la direction dans l’espace, étonnent l’imagination, et la surprise diminue à peine lorsqu’on cherche à approfondir les choses, à déterminer les causes, les lois, les péripéties de ce grand phénomène.
Ce qu’il y a de clair, tout d’abord, c’est qu’ils suivent le soleil, les heureux mortels ; échappant ainsi aux froidures et aux tristesses de l’hiver. – Ah ! si l’homme avait des ailes et pouvait se contenter de ce léger bagage, combien d’entre nous suivraient leur exemple !
Le fait de la migration des oiseaux nous est révélé, au printemps et à l’automne, par les grands vols que nous voyons passer et se perdre à l’horizon, par tous les volatiles, souvent étrangers à la contrée, que nous rencontrons dans les bois, dans les champs, à des époques déterminées et qui, quelques jours après, ont tous disparu. Mais de là à savoir d’où ils viennent, où ils vont, quel mobile les pousse, il y a loin ! Il a fallu bien des observations ; il a fallu surtout que les communications s’établissent entre les contrées les plus éloignées, en un mot, que l’histoire naturelle ait eu le temps et la possibilité de se constituer, pour que nous arrivions à une connaissance tant soit peu précise. Jusque-là et dans tous les siècles passés, que de fables, que de contes ont été émis sur ce sujet, comme sur bien d’autres. En voyant les oiseaux disparaître aux approches de l’hiver, on a supposé qu’ils se métamorphosaient en quelques autres espèces animales, ou qu’ils se réfugiaient dans des trous et s’y engourdissaient à la manière des loirs et des marmottes. Des charmantes hirondelles, les filles de l’air par excellence, on a osé dire qu’elles s’immergeaient dans de hideux batraciens : donnant pour preuve à l’appui que des pêcheurs, en ayant ramené dans leurs filets et les ayant mises à cuire avec d’autres captures, ranimées par la chaleur elles avaient repris les marais et s’y enfouissaient dans la vase, comme leur vol. Et ce conte-bleu a eu tellement cours, qu’il y a quelques années à peine, un journal sérieux de Paris le rapportait encore comme tout récent. – Risum teneatis !
Or nous savons pertinemment aujourd’hui, par les témoignages de nombreux voyageurs-explorateurs, que tandis que nous nous pressons autour de nos foyers, en hiver, l’hirondelle se chauffe gaiement au brillant soleil des oasis d’Afrique. Dès le milieu du siècle dernier, le naturaliste Adanson écrivait à Buffon que dans son long séjour au Sénégal, il avait toujours vu cet oiseau y arriver à l’époque où il quitte la France, et en partir au temps où il nous revient. D’autre part, son passage dans les contrées intermédiaires est constaté partout, comme nous le constatons nous-mêmes lorsque nous voyons les sujets de l’espèce se rassembler en foule pour se préparer au départ, puis disparaître pour repasser en octobre en rasant le sol d’un vol continu et en cinglant droit au Sud, ainsi qu’il sera dit en son lieu. Le continent africain est donc leur lieu de station hivernale, comme l’Europe est leur point de station estivale. Et ainsi des autres oiseaux qui, purement et simplement, changent de climats, grâce aux moyens de locomotion dont la nature les a pourvus, et plus ou moins au loin, selon leur tempérament et leurs conditions d’existence.
Les contes fantastiques du passé ont eu, sans doute, pour origine le manque d’observations suivies et généralisées, ainsi que l’ignorance des faits et gestes des oiseaux par la rareté des communications sur la surface du globe ; mais bien aussi la difficulté pour l’esprit humain de se rendre compte des moyens d’action qui leur sont dévolus pour accomplir de si longs voyages. L’homme moderne a, comme moyens de locomotion, la vapeur, les navires ; comme direction, la boussole, le calcul sidéral, la topographie ; comme connaissance du temps, le calendrier, le chronomètre ; comme prévision de l’état de l’atmosphère, le baromètre, le thermomètre, l’hygromètre et les observations météorologiques : autant de moyens factices, produit de la science, qui s’ajoutent à ceux qui lui sont naturels et qui les centuplent. L’oiseau n’a que ces derniers ; mais portés à une puissance dont nous ne pouvons nous faire idée à première vue. Il importera donc, pour se rendre compte de la migration, qu’après en avoir déterminé les causes et les motifs, on en pose la possibilité, la facilité même, pour les oiseaux. Le travail est facile, car la science est faite sur ce point : Notre grand naturaliste Buffon en a lui-même tracé les bases dans son excellent Discours sur la nature des oiseaux, et il n’y a qu’à les rappeler.
Il y développe longuement la nécessité de l’étude de cette phase importante de la vie des êtres volatiles, comme complément de l’histoire naturelle ; par cette raison que tant que nous ne connaîtrons pas leurs agissements dans cette période, nous ne saurons d’eux que la moitié de leur existence ; et il s’était promis d’y consacrer un traité spécial ; mais là comme dans l’exécution de son vaste plan de l’histoire entière du règne animal, le temps lui a fait défaut. Il est douteux, d’ailleurs, que dans l’état des connaissances d’alors et la difficulté des communications sur une assez vaste étendue, il eût pu y apporter d’autres lumières précises que celles de sa grande intuition des choses de la nature. Lui-même le reconnaît par cette réflexion d’un sens plus général, mais aussi modeste que vrai : « Ce n’est qu’avec le temps, et je puis dire dans la suite des siècles, qu’on pourra donner une histoire complète des oiseaux. » – Il n’y a donc pas à critiquer quelques incertitudes ou erreurs de son œuvre ; mais à suivre son exemple en rassemblant, en précisant, en développant, les notions acquises au temps présent. C’est le but de ce livre, qui laissera encore une large marge aux explorateurs de l’avenir, car bon gré mal gré, nombre de points resteront encore dans la pénombre.
Depuis Buffon, et, pour une bonne part, à l’aide de ses données plus certaines, les observations se sont multipliées en raison de l’activité des esprits dans toutes les branches de l’histoire naturelle et des relations sans cesse croissantes entre les contrées de notre globe. Olivier de Serres, Frédéric Cuvier, Dupont de Nemours se sont occupés de la question ; mais Toussenel, un chasseur naturaliste, qui a puisé ses connaissances sur le vif tout autant que dans la science, a jeté un grand jour sur la migration dans son livre du Monde des oiseaux, aussi charmant et humoristique dans la forme que savant et judicieux dans le fond ; et on peut dire qu’à lui seul il a formulé le second pas dans cette étude.
Comme cet excellent ami des bêtes et des gens, et le mien personnel à ce double titre, j’ai beaucoup couru les champs et les bois dans mon jeune âge, et je les cours encore avec grand enchantement, chassant et pourchassant la gent volatile, et par conséquent obligé, autant que désireux, de m’enquérir de ses faits et gestes. J’en avais rapporté un contingent d’observations, lorsque sentant l’insuffisance de l’appréciation individuelle et forcément locale sur un fait d’une si vaste étendue – aucun observateur n’ayant le don d’ubiquité – l’idée me vint d’ouvrir, en quelque sorte, un observatoire général et permanent. Le journal La Chasse Illustrée, qui me fait l’honneur de me compter au nombre de ses collaborateurs, m’en offrait l’occasion et le moyen. Je conviai tous ses lecteurs de bon vouloir à une collaboration commune, les priant d’envoyer à ce bureau central des bulletins détaillés de la migration de leur région, comprenant le commencement et la fin des passages, leur direction et leur intensité, l’état atmosphérique, la direction du vent, le degré de température, et tous les renseignements particuliers qu’ils pourraient recueillir.
L’attrait du sujet en lui-même, par ce temps d’investigations et de recherches de connaissances positives en toutes directions, la certitude que dorénavant les observations individuelles auraient leur organe et leur utilisation, eurent assez d’action pour qu’un certain nombre de correspondants répondissent à cet appel et voulussent bien envoyer, de points forts divers, des communications fréquentes et suivies. Il est résulté de ces documents, pris sur nature, un ensemble de notions plus précises et dont quelques-unes ont le mérite d’une complète originalité. C’est l’occasion de féliciter et de remercier ici même ces honorables collaborateurs, dont les noms et les avis seront souvent cités comme autorités et références.
Telles sont les bases de ce travail qui réunira, dans une étude spéciale, les connaissances acquises précédemment et celles recueillies à ce jour sur la migration des oiseaux.
Une dernière considération est nécessaire. Les migrations des mêmes espèces varient naturellement de date selon la latitude des lieux ; on pourrait dire plus exactement, suivant leur ligne isothermique ; par la raison bien simple que quelle que soit la vélocité des oiseaux, il leur faut un temps pour franchir les espaces, surtout en tenant compte des stationnements sinon constants du moins habituels. Il convient donc de fixer la ligne à laquelle se rapportent les indications données, sous peine de manquer de précision. Cette ligne ou cette zone, pour prendre une marge suffisante, sera comprise entre le quarante-sixième et le cinquantième parallèle Nord, ce qu’on peut appeler la zone de Paris ; et, pour restreindre le sujet à ses données les plus certaines, il sera surtout fait mention des espèces principales et les plus intéressantes des oiseaux d’Europe, qui se voient communément entre les Alpes et l’Océan Atlantique.
Enfin, aucun homme, quelque nomade qu’ait été son existence, n’étant assez cosmopolite pour que ses idées, ses connaissances, ces appréciations et ses observations n’aient, pour ainsi dire, un goût de terroir, le cachet de la contrée où il a passé sa jeunesse et la plus grande part de sa vie active, forcément mes propres considérations auront surtout pour point de départ ce qui se passe dans l’Est de la France, mon pays natal ; bien que je sache et que je doive même prévenir le lecteur que dans le monde des oiseaux, comme dans celui des humains, les us et coutumes changent ou se modifient selon les lieux, d’après l’adage : autre pays, autres mœurs !
Les oiseaux font leur nourriture, pour l’universalité des espèces, d’abord des insectes et des vers, ensuite des graines, des fruits et des plantes elles-mêmes ; et quelques-uns des oiseaux ou autres animaux vivants et morts. Pour leur part, dans l’ordre général de la nature, ils remplissent la fonction de compensateurs ou d’éliminateurs de l’exubérance vitale, semée avec une si grande profusion sur la surface de la terre pour assurer la persistance des races, et d’expurgateurs des détritus insolubles et nuisibles, en accomplissant la grande loi de la sustention de la vie par son propre ressort, selon un orbe de circulation qui part du sol et qui y retourne.
On conçoit, dès lors, que la généralité des oiseaux serait condamnée à périr de faim, lorsque les contrées septentrionales sont dépourvues d’insectes et de vers, dans l’atmosphère refroidie, sur le sol couvert de neige et dans les eaux prises par les glaces ; que le règne végétal a achevé son évolution annuelle ; que les bestioles ont disparu ou se sont enfouies. Il aurait fallu, pour qu’il en fût autrement, qu’ils eussent, comme les animaux à sang froid, la faculté de s’enfouir et de s’engourdir, ainsi qu’on l’a supposé dans le passé ; mais la chaleur du sang, qui est un complément de leur existence aérienne, y met obstacle ; ou qu’ils puissent passer une longue période dans le jeûne et l’abstinence, ce qui serait à l’inverse de l’ordre physique où toute force active exige une alimentation proportionnelle. Si quelques espèces et quelques individus isolés résistent et demeurent sous les froids climats, de plein gré ou forcément, c’est qu’ils trouvent à glaner un reste de nourriture qui serait insuffisant pour la masse ; et encore bien des privations, bien des angoisses sont leur partage. La preuve en est qu’on ne les retrouve pas plus nombreux ni en meilleur embonpoint, à la fin de l’hiver, que ceux qui nous reviennent après avoir subi les fatigues d’un long voyage, et qu’ils sont réduits souvent à venir chercher à nos portes un peu de nourriture.
Un parti, donc, leur restait à prendre ; émigrer en masse vers de plus chaudes contrées où toute vie n’a point cessé. La nature leur en a donné le moyen, et ils en profitent.
La subsistance ! telle est donc la cause première de la migration des oiseaux. Sans aucun doute, l’abaissement de la température n’est pas insensible à leur constitution nerveuse et impressionnable ; néanmoins, chaudement vêtus pour la plupart, ils le supportent jusqu’à un certain degré, pourvu qu’ils aient le vivre ; mais ils ne s’y exposent point de gaieté de cœur, et la chaleur est leur vrai milieu. Dans mon enfance, j’avais une passion pour les charmants petits cinis ou serins d’Europe. Comme il m’était pénible de les voir perpétuellement enfermés dans une cage étroite, je leur donnais souvent la liberté. Je dus y renoncer par les froids vifs : leur première impulsion était de voler droit au foyer où ils se grillaient les pattes, indifférents à la souffrance, tant ils étaient charmés de sentir une chaude température.
Le froid n’est en réalité qu’un point secondaire par rapport à eux ; bien qu’il soit le premier en ce qu’il détermine le précédent. L’une et l’autre causes, en tout cas, étant simultanées, sont largement suffisantes pour motiver la migration et il est inutile de chercher ailleurs. C’est pour la généralité des oiseaux une question de vie ou de mort.
Les oiseaux d’Europe, en comprenant sous ce nom tous ceux qui nichent plus ou moins dans notre continent, s’élèvent à environ cinq cents espèces. Sur ce nombre, tout au plus trente ou quarante, telles que les perdrix, le moineau franc, etc., sont sédentaires et demeurent à poste fixe sur les lieux qui les ont vu naître. Toutes les autres émigrent plus ou moins au Sud : les unes se contentant de la limite des grands froids, les autres gagnant les contrées plus tempérées du midi de l’Europe ou celles plus chaudes de l’Afrique septentrionale ; d’autres, enfin, s’avançant jusque sous les tropiques ou n’hésitant pas à franchir l’équateur pour retrouver dans l’hémisphère austral un climat analogue à celui qu’elles viennent de quitter. On a l’indication de ces divers parcours par des observations suivies et bien déterminées aujourd’hui, comme on l’a déjà vu pour l’hirondelle, et, spécialement pour la transmigration équatoriale, par la présence de nombre de nos espèces d’Europe dans l’autre hémisphère ; ensuite par quelques faits particuliers, notamment celui-ci : vers 1820, un naturaliste de Bâle, voyant une cigogne de passage qui portait un trait par le travers du corps, ne put résister à la curiosité de savoir ce que pouvait être ce phénomène anormal et tua l’oiseau. Ce trait n’était autre qu’une flèche qui fut reconnue comme particulière aux peuplades sauvages qui habitent les contrées voisines du Cap de Bonne-Espérance. Ainsi cette cigogne avait été blessée dans ces parages, et, néanmoins, grâce à sa puissance de locomotion, elle avait pu accomplir un immense trajet malgré sa blessure et l’obstacle de la flèche.
Cette même simultanéité de présence de quelques-unes de nos espèces sur le continent américain a fait qu’on s’est demandé si les mieux doués comme vol ne pouvaient point passer directement de l’un à l’autre des deux continents, soit des côtes de France, d’Espagne ou d’Afrique, et réciproquement.
La grande Frégate, le maître-voilier parmi les oiseaux, le petit Pétrel ou l’oiseau des tempêtes, se rencontrent en plein océan : d’où l’on peut conclure qu’il ne leur coûterait pas plus d’effort de traverser l’espace entier que de retourner à leur point de départ. Le naturaliste Cotesby rapporte avoir vu également un hibou, tout à fait en haute mer. Mais un vol de douze cents lieues d’une traite va au-delà de notre imagination, et, en attendant des preuves positives, il est plus naturel de penser que les espèces communes à l’ancien et au nouveau monde ont passé ou passent de l’un à l’autre par le Nord, là où les terres se rapprochent, au point de se toucher presque au détroit de Bering.
L’homme, attaché à la terre et ne pouvant quitter sa surface par ses moyens naturels, a bien trop de peine à concevoir ces grands parcours aériens et la merveilleuse faculté de direction qu’ils impliquent, pour qu’il ne lui soit pas nécessaire de s’en rendre un compte exact. L’examen rapide de l’organisme de ces êtres, si frêles et si puissants, néanmoins, nous donnera le mot de l’énigme.
La puissance du vol des oiseaux, leur facilité d’évolutions, nous apparaissent chaque jour. Les Martinets de nos cités que nous voyons, le soir, prendre leurs ébats par familles et décrire de grands et rapides circuits, passent comme des traits ; à peine pouvons-nous distinguer leur forme. L’alouette mignonne, tout en chantant sa joyeuse chanson, monte, monte dans le ciel et disparaît à nos yeux. Elle s’élève ainsi à près d’un kilomètre, toujours chantant à pleine poitrine, et sa voix nous arrive encore claire et distincte à l’oreille. Le pigeon messager, si fort de mode aujourd’hui, fait de vingt à trente lieues à l’heure, dans ses grandes courses, etc., etc.
C’est que le vol est l’attribut par excellence de l’oiseau qui doit, dans ses types les plus caractéristiques, parcourir l’atmosphère et y remplir sa mission. La nature a concentré dans cette faculté toute son action. Elle a construit le volatile en taille-vent, ou pour mieux dire en plan horizontal comme notre cerf-volant ; de telle sorte, qu’il n’a besoin que d’un minime effort pour prendre son point d’appui sur l’air, quelque mobile et peu résistant que soit ce fluide, et que toute sa puissance reste libre pour l’évolution. Sa légèreté spécifique, c’est-à-dire son poids par rapport à son volume, est sans proportion avec celle de tous les autres animaux, car l’épaisse toison de plumes qui constitue la majeure partie de ce volume n’a qu’une pesanteur infime : d’autre part, sa charpente osseuse, très résistante néanmoins, est réduite à sa plus simple expression, à des lamelles ou à de légers tubes creux ; ses muscles, strictement économisés n’ont de développement que sur la poitrine, centre d’action des ailes, où ils représentent un volume plus considérable que ceux de tout le reste du corps pris ensemble. Sa respiration est double ; ce qui explique chez un grand nombre l’action simultanée du vol et du chant. Enfin, la chaleur de son sang est le foyer indispensable de sa vélocité.
Quant à l’application de cette force mécanique, elle n’est pas moins judicieusement combinée. Elle repose sur la forme elliptique très allongée du corps et le plan horizontal, en quelque sorte rectiligne, des ailes, qui offrent le moins de résistance possible au milieu ambiant, c’est-à-dire à l’air ; sur la conformation de ces dernières, rames ou voiles motrices, à la fois résistantes et souples, dont les surfaces inférieures disposées en courbes hélicoïdales, multiplient les points d’appui et décrivent, dans leur double mouvement de haut en bas et d’avant en arrière, deux spires de propulsion rassemblant la force et la convergeant dans l’axe général ; sur la mobilité du centre de gravité, soit latéralement pour le maintien de l’équilibre, par la souplesse des articulations qui unissent les ailes au corps, soit longitudinalement pour le mouvement ascensionnel et descensionnel, par l’allongement ou le retrait du cou et la position en avant ou en arrière des ailes ; et, finalement sur la queue, gouvernail pivotant à effet multiple et circulaire.
De toutes ces actions réunies, résulte la force et l’aisance de propulsion que nous constatons et que quelques naturalistes estiment à quatre-vingts lieues à l’heure pour les plus fins voiliers, comme le Martinet en plein essor, et qu’on évalue communément de quinze à vingt lieues, pour toutes les espèces bien douées, dans les grandes excursions. Buffon cite à l’appui deux exemples devenus légendaires : le faucon d’Henry II qui, s’étant emporté après une outarde canepetière à Fontainebleau, fut pris le lendemain à Malte et reconnu à son collier ; celui envoyé au duc de Lerme, des îles Canaries, et qui revint en seize heures, d’Andalousie à Ténériffe ; ce qui ferait, pour un trajet de deux-cent-cinquante lieues en ligne droite, près de seize lieues à l’heure.
À cette rapidité, souvent vertigineuse, il fallait, sous peine de mésaventures perpétuelles, un guide sûr et certain ; c’est-à-dire une vue rapide, pénétrante dans ses impressions. La nature n’a point omis d’y pourvoir. L’œil de l’oiseau, proportionnellement au volume de la tête, est grand et largement ouvert. Indépendamment des deux paupières qui fonctionnent verticalement, une troisième, située en dessous, dans le grand angle de l’organe, se meut transversalement : semi-diaphane, son office est d’atténuer l’intensité de la lumière dans les moments de repos, et de polir, de lubrifier constamment la cornée pour la délicatesse de la vision. Une quatrième membrane supplémentaire placée au fond de l’œil, paraît être un épanouissement du nerf optique développant la puissance des impressions. Le globe lui-même est doué d’une certaine élasticité qui lui permet de se bomber ou de s’aplatir selon le besoin ; de telle sorte que l’oiseau est, à son gré, myope ou presbyte, pour voir de près ou de loin ; ce qui revient à dire qu’il porte avec lui son microscope et son télescope.
Buffon déclare, et son dire n’a rien d’exagéré, que la portée de la vue des rapaces du haut vol est de vingt fois plus grande que celle de l’homme. On en peut conclure que l’oiseau, en général, embrasse d’une façon précise et certaine l’espace qu’il est susceptible de parcourir en un jour, et s’y dirige d’autant mieux qu’à la perfection de l’organe correspondent forcément des perceptions plus nettes pour son entendement, en même temps qu’une mémoire des lieux stimulée par des sensations plus vives. Cette mémoire, développée dès le bas-âge par une vie vagabonde à la recherche perpétuelle de la nourriture et par les relations de famille et d’espèce, est encore un apanage de l’oiseau. Elle grave dans son entendement le souvenir du canton, du bosquet ou du recoin, qui l’ont vu naître, comme celui des contrées par lesquelles il s’en est éloigné ; et l’attrait de ce souvenir, puissant chez les volatiles, le ramène avec une précision mathématique, à son berceau ou à son habitat d’élection. Ainsi en est-il d’une façon manifeste, pour le pigeon voyageur, pour les hirondelles dont un couple est revenu dix-sept années de suite à la même fenêtre, d’après l’observation précise du naturaliste italien Spallanzani ; et, selon toute apparence pour la généralité des autres.
Notre grand naturaliste Buffon ne considère pas que le sens du toucher soit très développé chez l’oiseau. En ceci, il semble avoir trop restreint le tact aux conditions de cette faculté chez l’homme et particulièrement dans sa main ; c’est-à-dire à la notion de la forme et de l’état des corps. La sensibilité nerveuse de l’oiseau est extrême : la délicatesse de toute sa structure l’indique, et il ne faut que voir l’appréhension qui le saisit au moindre contact pour n’en pouvoir douter. Il a surtout un genre de sensibilité extérieure développée à un degré énorme et qui lui est propre ; c’est celle de l’état calorifique, hygrométrique et électrique de l’atmosphère. Ses plumes, composées d’une tige sur laquelle s’implantent de fines barbes portant elles-mêmes une quantité infinie de barbules ténues et légères, sont autant d’hygromètres et d’électromètres qui lui transmettent leurs impressions, et on peut dire que l’oiseau est un appareil météorologique vivant et des plus complets.
Chacun de nous ressent plus ou moins, et les rhumatisés en savent quelque chose, les influences de l’état et des mouvements de l’atmosphère : le vent d’Est est frais et léger ; celui du Sud, sec et chaud ; celui d’Ouest, humide et froid ; celui du Nord, froid et sec. Mais combien l’exquise impressionnabilité de l’oiseau doit en être mise en éveil et y saisir de nuances qui nous échappent ? La plus légère modification lui est aussitôt révélée : c’est là son baromètre ! La plus légère brise lui indique sa provenance, c’est là sa boussole ! Il porte donc avec lui tout un observatoire instantané. – Et ce n’est point tout encore !
Le sens de l’ouïe est également poussé chez lui au raffinement ; la pureté de la voix des oiseaux chanteurs en serait à elle seule la preuve manifeste, si nous n’étions perpétuellement à même de constater le développement de cette faculté par l’éveil de l’oiseau au plus léger bruit. Cette sensibilité d’audition utile à la sauvegarde de tous, est chez les migrateurs nocturnes, autres que les Hiboux et les Chouettes qui voient dans les ténèbres, le complément de la vue : elle leur révèle l’état des lieux qu’ils parcourent par les bruissements du vent dans les forêts, dans les plaines : par le murmure des ondes dans les fleuves et les cours d’eau ou la voix des flots sur les rives ; par tous les bruits de la terre, en un mot. Pour ces géographes praticiens, tout est indication.
La connaissance des saisons, des jours, des heures, leur est donnée par leurs propres impulsions intérieures, l’amour, la mue, etc. ; par les astres, la température, les évolutions des plantes et des insectes ; par tous les signes de la nature : ne nous étonnons donc plus de la sagacité des oiseaux !
Le sauvage humain qui n’a point comme nous, civilisés, les renseignements et les moyens pratiques que la science met à notre usagé, est bien forcé de compter sur ses organes et sur ces mêmes données physiques, comme moyens d’appréciation ; et nous savons le degré de perspicacité qu’il y acquiert.
C’est à ce point, chez l’oiseau, que le développement de ces maîtres sens, la vue, l’ouïe, le tact, ainsi que la facilité d’évolution qui en fait un explorateur perpétuel, l’aurait constitué en être supérieur dans la nature, si le centre commun des sensations et des impressions, le cerveau, avait reçu chez lui une ampleur proportionnelle. Il n’en est point ainsi. Petite tête et peu de cervelle ! Et les notions si vives que l’oiseau reçoit se circonscrivent, quant au résultat, à la fonction qui lui est dévolue, sans contribuer à l’entendement général. C’est un voyageur magnifiquement doté pour la locomotion et la direction, un observateur à l’œil subtil pour tout ce qui concerne la conservation et l’entretien de l’existence ; hors de là, le moindre mammifère lui en remontrerait en intelligence et en sagacité. Ce n’est donc pas tout à fait sans motif qu’un certain nombre de locutions, peu honorifiques pour les oiseaux, sont passées dans le langage usuel : Tête de linotte, bête comme une oie, etc., etc. Assez d’autres belles qualités leur sont reconnues ! Il ne faudrait donc point prendre par trop au pied de la lettre l’infaillibilité de l’oiseau dans ses jugements, dans ses agissements. Comme pour les humains, avec toute leur raison et leur science, sa perspicacité, son entendement, sont parfois mis en défaut, et nous en verrons des exemples ; mais ce qu’il fallait établir, c’était, d’une part, les causes de la migration ; de l’autre, les moyens mis à la disposition des oiseaux pour l’accomplir. Cela fait, voyons la marche qu’ils suivent.





























