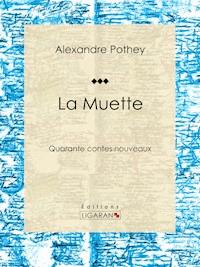
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'était en 1862. Le café avait été servi dans ce magnifique atelier de la place Vintimille que tout Paris connaît. Les portières de velours grenat, relevées sur des patères de bronze antique, laissaient voir dans le fond les splendeurs de la salle du festin. Les lumières des lustres brisaient leurs feux aux angles des cristaux et des pièces d'orfèvrerie finement ciselées."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335047783
©Ligaran 2015
C’était en 1862.
Le café avait été servi dans ce magnifique atelier de la place Vintimille que tout Paris connaît.
Les portières de velours grenat, relevées sur des patères de bronze antique, laissaient voir dans le fond les splendeurs de la salle du festin.
Les lumières des lustres brisaient leurs feux aux angles des cristaux et des pièces d’orfèvrerie finement ciselées.
Les masses de fleurs et de fruits, habilement disposées, égayaient doucement les regards.
La réunion se composait d’une trentaine d’hommes, vieux et jeunes, mais presque tous connus dans le monde de la politique, des lettres et des arts.
Un ancien ambassadeur à Naples, des membres de l’Institut, des peintres, des journalistes et des musiciens, plongés dans de vastes fauteuils, semblaient éprouver ce doux état de béatitude qui convient si bien aux consciences tranquilles à l’heure d’une agréable digestion.
Crosti avait détaillé, avec une grâce exquise, le grand air du Barbier.
Puis Ismaël, Villaret et David chantèrent le trio de Guillaume.
Enfin Charles de Bériot égrena les perles de sa Tarentelle.
Le charme avait fait naître le silence.
Les officiers de la Légion d’honneur frappaient doucement, en mesure, l’air de leur index, comme s’ils eussent voulu retenir les vibrations harmoniques trop tôt fugitives.
Les simples chevaliers, respectant les distances, accompagnaient ce geste avec de petits mouvements de tête.
La tenue des autres était irréprochable.
– Depuis quelque temps, le gouvernement est très inquiet, fit une voix rauque et sourde.
Les regards se tournèrent vivement vers celui qui venait de proférer ces paroles. C’était un homme dont le visage sinistre n’avait rien de remarquable.
Mais, lui, sans plus s’émouvoir, reprit :
– Depuis quelque temps, le gouvernement est très inquiet.
Tous les jours on reçoit au ministère des rapports des préfets, des sous-préfets, des commissaires des départements, qui signalent les progrès terribles que la Muette fait dans la province.
On savait bien déjà que Paris et la banlieue étaient infestés par ce fléau ; mais aujourd’hui qu’il s’étend, qu’il gagne jusqu’aux bourgades les plus reculées, il est du devoir du gouvernement de prendre une attitude !
Il faut sévir !
Par quels moyens ?
Voilà la question.
La Muette, comme vous le savez, est une réunion de gens sans foi ni loi, sans feu ni lieu, qui rêvent le renversement de l’ordre social établi, par les moyens les plus violents.
Ceux de 93 pâliraient près des leurs.
Le fer, le feu, le poison, le vol, le viol, sont leurs procédés les plus bénins.
La police le sait, mais elle ne peut rien faire ! En effet, dans la Muette,
On ne se rassemble jamais,
On ne parle pas,
On n’écrit point !
Quelle action voulez-vous que la police ait contre de semblables misérables ?
Ainsi par exemple, le soir, entrez dans un café : Vous voyez des gens qui jouent au billard, D’autres aux cartes,
D’autres aux dominos,
D’autres enfin qui fument tranquillement leur pipe dans un coin.
Observez attentivement,
Vous ne remarquez rien.
Eh ! mon Dieu ! ils font tous partie de la Muette.
La police le sait ! Elle ne peut rien y faire !
Au coin de chaque rue vous voyez, dans de grands cadres, des photographies d’individus qui vous sont complètement inconnus, tout à fait indifférents, et qui, d’ailleurs, ne sont pas déjà si jolis que cela.
Les uns ont un air féroce ;
Les autres ont un air niais.
Pourquoi sont-ils là ?
Assurément c’est pour se reconnaître entre eux, car ils sont tous de la Muette.
La police le sait ; oui, mais…
Paris est sillonné par une quantité d’omnibus qui, depuis sept heures du matin jusqu’à minuit passé, parcourent la cité en tous sens.
Avez-vous parfois remarqué les physionomies étranges des gens qui sont sur l’impériale de ces voitures ?
Pour quel motif flânent-ils ainsi au lieu de travailler ?
Dans notre jeunesse, dites-moi, montait-on sur l’impériale des omnibus ?
Ce sont certainement des affiliés de la Muette qui surveillent les personnes qui vont et viennent, qui s’absentent ou qui rentrent dans Paris, les maisons qu’on démolit, celles qui s’édifient…
Quelle atteinte portée à la sécurité publique !…
La police le sait, mais… que voulez-vous ?
Dans la Muette, comme du reste dans toutes les sociétés secrètes bien organisées, il y a des fanatiques.
Ce sont des gens d’un certain âge, d’une assez bonne position de fortune, qui s’installent généralement dans un quartier pauvre.
Ils prodiguent les bienfaits autour d’eux.
Ils donnent des secours aux malheureux ;
Des médicaments aux malades ;
Des vêtements aux petits enfants.
Puis, quand ils ont bien capté la confiance de leur arrondissement, ils attrapent une fluxion de poitrine et meurent dans les trois jours.
Naturellement la foule assiste à leurs obsèques, et les affiliés de la Muette, mêlés dans les groupes, chuchotent :
– Ce brave homme est mort !
– C’est un grand malheur !
– C’est la faute du gouvernement !
– Nous avions l’habitude de vivre dans un Paris dont les rues étaient très étroites.
– C’était sale pendant l’hiver.
– Ça sentait mauvais pendant l’été.
– Mais enfin nous étions accoutumés à cela.
– Aujourd’hui on a créé de larges voies de communication, de longs boulevards qui n’en finissent plus, où le vent dévastateur s’engouffre en toute saison.
– On ne peut plus sortir de chez soi sans attraper des fluxions de poitrine !
– Nos enfants se feront peut-être à ce nouveau régime, mais il est positif que c’est ainsi qu’on veut détruire notre génération.
– Voyez plutôt ! Ce pauvre homme est mort !
Alors les faubourg sont dans un état d’exaspération difficile à décrire !
On arme !
La police le sait… Elle n’y peut rien faire !
Des personnages éminents font partie de la Muette.
Ainsi M. A… est l’un des chefs principaux. Homme d’un goût parfait, esprit distingué, poète remarquable, il n’aurait certainement jamais écrit la romance :
s’il n’y avait quelque chose là-dessous.
En effet, c’est le chant de ralliement de la Muette.
Chaque matin, vous voyez entrer dans les cours de vos maisons un inspecteur de la Muette, déguisé en pauvre, qui chante cette ineptie, tantôt sur un air et tantôt sur un autre :
Les fenêtres s’ouvrent,
On jette des sous…
Le bonhomme les recueille et, le soir, il les porte à M. A… qui sait ainsi combien il y a de membres effectifs de la Muette présents à Paris.
Au surplus, ce sont ces recettes qui lui ont créé une fortune colossale en si peu de temps.
On ne peut l’expliquer autrement.
La police le sait… mais, quoi ?
Mgr D… est l’orateur sacré de la Muette.
Toutes les fois qu’il plaide – non, – qu’il prêche, la foule assiste à ses sermons.
Pourquoi ?
Ce n’est certes point à cause de son talent ?
Ni de son aménité, n’est-ce pas ?
Ni de ses convictions religieuses ?
Il est moins catholique que M. Renan.
C’est tout simplement parce que, sur les six sous qu’on donne pour sa chaise, un seulement revient à l’église ; le reste alimente le trésor de la Muette.
La police le sait…
La nature humaine a ses faiblesses, et les gens de la Muette n’en sont pas plus exempts que le reste des mortels.
Pour certains d’entre eux, le besoin de se réunir, de parler et d’écrire, se fait parfois impérieusement sentir.
Ce sont ceux-là qui, tous les jours, s’assemblent à la Bourse.
En effet, qu’est-ce que la Bourse ?
Construite avec l’argent des commerçants notables, la Bourse, dans le principe, fut instituée, purement et simplement, pour faciliter d’honorables transactions commerciales.
Les affiliés de la Muette ont changé tout cela.
Ils ont chassé les marchands de leur temple.
Là, à des heures convenues, ils s’entassent, se pressent, se bousculent, montent sur le dos les uns des autres.
Ils écrivent sur des petits morceaux de papier des choses que ni vous ni moi ne pourrions comprendre.
Ils poussent des cris insensés, sans signification dans aucune langue.
Prêtez l’oreille pendant une minute :
« Comment sont arrivés les Anglais ?
– Avec baisse d’un huit !
– Diable ! J’ai un écart, heureusement je suis à cheval sur le Lombard !
– J’ai deux mille cinq cents Italiens !
– Qui font ?
– Cinquante-deux.
– Je prends quinze mille dont cinq sous.
– Quelle imprudence ! vous sauterez !
– Non, je veux couvrir ma vente de primes.
– Bon, le ferme ressort !
– Je suis dans le mouvement ! »
Ils perturbent la fortune publique !
Les uns font semblant de se ruiner ;
C’est pour émouvoir la compassion des gens simples.
Les autres font semblant de s’enrichir ;
C’est pour surexciter les instincts d’envie et de cupidité dans les masses.
Cette fortune est fictive.
En voulez-vous la preuve ?
Eh bien ! essayez donc d’emprunter cent francs à l’un de ces faux millionnaires, vous verrez comment vous serez reçus !
En vérité, un grand péril est là !
La police le sait… Que voulez-vous qu’elle fasse ?
Des êtres naïfs s’étonnent parfois du succès et de la gloire de Timothée Trimm.
Est-il nécessaire de démontrer que l’illustre écrivain est le plus grand agitateur des temps modernes ?
Les esprits sensés, qui savent lire entre les lignes, constatent chaque jour les violences les plus audacieuses perfidement cachées sous une forme légère.
Bien aveugle qui ne voit rien !
La police le sait ; elle ne peut rien faire.
Ces misérables ont tous chez eux un portrait de saint Nicotin.
C’est un tableau qui représente un vieil ivrogne, fumant sa pipe, buvant une chope et lisant un livre badin posé sur une tête de mort.
Cette composition que vous voyez d’ici, paraît d’abord bien simple.
Horrible subterfuge ! Menaçante ironie !
Eh ! ne voyez-vous pas que c’est le portrait de Victor Hugo, qui est le chef suprême de la Muette ?
Seulement il n’est pas ressemblant, pour que la police ne puisse pas le reconnaître !
Le livre qu’il lit, ce n’est point un aimable badinage : ce sont des listes de proscription ;
La chope, c’est le poison qu’on doit verser aux femmes et aux enfants pour ne pas effrayer les populations ;
La tête de mort, c’est le symbole de l’échafaud ;
Et la fumée de la pipe, c’est l’emblème de l’incendie qui doit, d’ici peu, ravager Paris et les départements !
La police le sait ; elle est impuissante !
Le 15 janvier de chaque année, les chefs principaux de la Muette se réunissent au-dessus du Mont Blanc.
Là, après s’être livrés à de folles orgies, ils dansent une ronde en chantant une chose abominable dont, jusqu’à présent, la police n’a pu saisir que trois couplets, à cause de l’élévation.
Ils ont choisi un air bien gai pour chanter cette romance si triste.
Écoutez plutôt.
AIR : Ah ! le bel oiseau, maman !
I
II
III
Quoi de plus révoltant que ce chant de sauvages ?
Hélas ! la police le sait ; elle n’y peut rien faire !
Comme je vous le disais en commençant, en présence des progrès constants de la Muette, il est du devoir du gouvernement de prendre une attitude.
Il faut sévir !
Quels sont les moyens de répression qu’on doit employer ?
Grave question qu’on agite dans les conseils de l’État.
En effet, peut-on, sans jeter un certain trouble dans les populations, supprimer ou transporter en masse tous les individus qui vont le soir au café,
Jouent aux cartes,
Aux dominos,
Au billard,
Ou fument leur pipe ?
Ceux qui se font photographier,
Montent sur l’impériale des omnibus,
Qui secourent les pauvres,
Suivent les enterrements,
Vont à la messe,
À la Bourse,
Lisent le Petit Journal,
Ou possèdent le portrait de saint Nicotin ?
On hésite.
Les avis diffèrent, et cela se conçoit.
Mais, pleins de confiance, nous espérons qu’une détermination prochaine sauvera la société ébranlée sur ses bases.
Le portrait de Saint Nicotin se vend chez Ét. Carjat 10, Rue Notre-Dame-de-Lorette, 10 (Les commandes se payent d’avance)
La nuit était belle, froide et claire.
L’ancien ambassadeur et l’homme sinistre, titubant légèrement tous deux, suivaient les anciens boulevards extérieurs.
Ils épanchaient ainsi leurs idées dans une douce familiarité :
« Ah ça ! dites donc, vous ? fit le diplomate.
– Monseigneur ?
– Est-ce vrai toute cette lugubre histoire que vous nous racontiez tantôt ?
– Votre Excellence pourrait-elle en douter ?
– C’est que cela m’a tout l’air d’une assez mauvaise plaisanterie.
– Oh ! Monsieur !
– Et vous me faites l’effet d’un alarmiste !
– Des gros mots ! ! ! Bonsoir, citoyen ! »
Je n’ai certainement pas l’intention de vous contrarier, mais je vous assure que le plus beau pays du monde, c’est la Franche-Comté, – surtout du côté de chez nous.
Nos montagnes ne sont pas aussi hautes que les Alpes, mais elles sont bien plus jolies. Il n’y a point de glaciers, comme en Suisse, et c’est à peine si, dans le mois de juillet, vous retrouverez de çà de là quelques champs de vieille neige blanchissant les cimes sur le versant nord.
C’est sur ces hauteurs que, pendant l’été, deux philosophes – un vieux et un jeune, – isolés du reste du monde, surveillent les troupeaux de vaches venus de la plaine. Joignant l’expérience à l’activité, ils fabriquent ces grands disques d’excellent vachelin que vous autres, gens de la ville, vous appelez fromage de Gruyère. Chaque génisse porte une sonnette au cou ; les taureaux ont une grosse cloche, et quand le matin la bande accourt à l’abreuvoir, cela produit un carillon vif, joyeux, pénétrant, qui n’est pas de la petite musique, croyez-le bien.
Le bétail couche à l’air libre, sur l’herbe aromatique et fine qui le nourrit. Pour le garder, pas n’est besoin de ces chiens féroces qui mordent les jarrets des pauvres bêtes. Quand un loup se hasarde en ces contrées, le taureau sait bien défendre tout seul ses compagnes qui mugissent en ouvrant de gros yeux effarés.
L’aigle et le grand-duc tournoient sur les hauts sapins, mais la gelinotte s’abrite sous la feuillée, et les rapaces sont réduits à se rabattre sur les vipères qui dorment, en plein soleil, enroulées sur les rochers. L’exquise gelinotte est réservée pour l’instituteur « Monsieur le maître », comme nous disons, – ou pour le voyageur revenu de bien loin. C’est justice, car le premier est un pauvre brave homme qui a donné de bons conseils à deux ou trois générations, et le second nous raconte d’émouvantes histoires, le soir, à la veillée.
En descendant un peu, nous trouvons les forêts de chênes nains et de coudriers, avec la glandée pour les sangliers, et les avelines pour les amoureuses. Au mois de septembre, nos jeunes gens viennent y récolter les noisettes, provision d’hiver. Ils chantent nos vieux airs, dans notre vieux patois que je traduis si mal :
Le poète a raillé. On ne mange point de chats dans nos montagnes. Nous mangeons le lièvre, de taille moyenne, il est vrai, mais bien préférable à ces grands imbéciles de lièvres allemands dont la chair est sans saveur.
Le you you, lancé à pleine poitrine, ondule sur les coteaux, traverse les collines et va tout au loin s’éteindre dans la vallée. Le chant cesse brusquement. On entend, sous la coudraie, de petits cris suivis de rires. Ce sont nos jolies mugnottes, attirées par la pipée, qui viennent aussi remplir leurs bas de laine de noisettes et de faînes.
C’est moi qui jetais bien le you you dans les airs ! J’avais seize ans, des poumons tout neufs ; le clairon du coq, le chant du paon, la trompe du pâtre n’auraient pu couvrir ma note aiguë, pleine et vibrante. Nu-pieds, vêtu d’une chemise de toile et d’un pantalon de droguet, j’abaissais les plus hautes branches des arbustes pour cueillir les bouquets de fruits, quand tout à coup je tombais en extase, frappé d’une adorable vision. C’était Lydie, la fille de notre voisine, qui venait me surprendre. Oh ! qu’elle était belle et charmante, avec ses grands yeux moqueurs, et sa bouche souriante qui laissait voir des dents fines, blanches, humides ! Je demeurais tout interdit. Un vieux sanglier, troublé par mes clameurs, débouchait du taillis en labourant de ses défenses le sable du sentier. Lydie, feignant l’effroi, se jetait dans mes bras.
Mon sang bouillait, mon cœur bondissait, mes tempes éclataient, mais que voulez-vous ? comme un sauvage que j’étais – et que je suis encore, – j’avais le respect de la jeunesse, de la grâce et de la fraîcheur !
Nous revenions vers le village en récoltant les pêches qui mûrissent le long des roches chauffées par le soleil. Je connaissais dans la rivière les endroits où gisent les écrevisses si succulentes, et les truites trois-quarts si vives, si délicates. (J’espère bien que personne ne contestera mon adresse à pêcher la truite et l’écrevisse.) Il y avait aussi ces grosses carpes qui sont si bonnes cuites dans du vin rouge, avec des oignons et des tartines sous le ventre. Ah ! les joyeux soupers et le bel appétit !
Nos rivières, nos torrents, nos ruisseaux, parlons-en. J’ai vu la verte Adriatique et la Méditerranée aux flots bleus ; j’ai vu l’Océan tout gris et la Manche qui brise ses lames avec d’immenses panaches d’écume. Mais la mer a partout la même voix grondeuse, grave, solennelle. Nos rivières murmurent, chantent, babillent, et elles ont toutes un accent différent. La profondeur et la largeur de leur lit, la hauteur des chutes, les accidents causés par les rochers varient leurs mélodies à l’infini. Est-ce ma faute, à moi, si vous ne savez pas noter les harmonies diverses de la nature ? Soyez tranquilles ; nous autres, nous saurons toujours distinguer la chanson de l’Ognon de la chanson du Rahin.
Le pays n’est pas riche, mais il n’y a point de misérables. Nous vendons nos bœufs, nos veaux et nos moutons aux beaux messieurs de la ville. L’industrie réside dans une fabrique devis à bois, dans une usine de clefs de montre et dans deux ou trois scieries de planches. C’est maigre, sans doute, mais cela nous suffit pour garnir nos celliers de ces vins de Poligny, de Salins ou d’Arbois, agréables au palais, chauds au cœur, et qui ne sont convenablement goûtés que chez nous.
Par un matin d’avril, tiède et lumineux, je quittai la montagne. Lydie et sa mère voulurent absolument accompagner mes parents, qui me conduisirent à deux lieues de là pour attendre, sur la grande route, la diligence de Paris. Les adieux furent pénibles, comme bien vous pouvez croire. Quand Lydie m’embrassa pour la dernière fois, elle rougit très fort en murmurant tout bas : « Grand innocent ! » Mes parents ne sont plus, mes amis d’enfance m’ont oublié et je n’ai pas un pouce de terre dans ce beau canton que j’aime tant. Souvent, je me suis dit : « – Décidément, j’irai là-bas l’année prochaine. Je veux faire un dîner dont voici le menu : Énorme pyramide d’écrevisses, truites frites au beurre, ragoût de lièvre, filet de sanglier, gelinotte rôtie devant un feu clair, pêches, avelines et vachelin. Lydie me versera de tous les vins du pays, et nous causerons des jours passés. »
Je n’ai jamais pu réaliser ce beau projet. Pourquoi ? Qu’importe ! Mais bientôt, quand la mort m’aura rendu libre, mon âme retournera dans la douce vallée. Pendant l’hiver, je sifflerai furieusement dans les branches des grands sapins, et je mêlerai de sinistres lamentations à la voix puissante du torrent. L’été, à la tombée du jour, j’accrocherai les jupes des jeunes filles aux ronces sauvages qui bordent la route ; j’allumerai les feux-follets qui égarent les voyageurs dans les marécages, et je nicherai des couleuvres dans les trous d’écrevisses.
Les fillettes viendront confier leurs terreurs à la mère Lydie, vieille au nez crochu, au menton de galoche ; mais ma première amoureuse répondra en hochant la tête :
– Taisez-vous, petiotes. C’est un enfant du pays qui souffre et qui se plaint, parce qu’il n’a pas su, ou qu’il n’a pas pu, vivre et mourir parmi les siens.
Puisque vous me consultez sur l’emploi de vos vacances, croyez-moi, mon cher ami, prenez le chemin de fer qui vous conduira en quelques heures à l’extrémité du département de la Haute-Saône. C’est une contrée peu explorée, très pittoresque, toute remplie de souvenirs historiques et de légendes fabuleuses. Si l’Irlandais Colomban a fondé le monastère de Luxeuil, c’est son compagnon saint Dèle qui a créé celui de Lure. À deux pas de cette charmante petite ville, on vous montrera l’endroit où, en enfonçant son bâton dans la terre, le missionnaire fit surgir d’énormes sources qui forment une rivière presque navigable. C’est un lieu sauvage, plein d’ombre et de fraîcheur, où les loutres aiment à venir pêcher de succulents poissons.
Mais quittez la ville pour gagner au plus tôt la chaîne de nos incomparables montagnes. Vous laisserez sur votre droite l’éminence sur laquelle s’élève la chapelle de Ronchamp. Autrefois, il y avait là une Notre-Dame qui faisait bien plus de miracles que celles de Lourdes ou de la Salette, et guérissait tous les affligés. Les mécréants qui se permettaient de rire de la bonne dame étaient saisis par les moines et plongés tout vivants dans des in-pace qu’on retrouve encore dans les ruines d’une ancienne abbaye. C’est un moyen péremptoire pour stimuler la foi, et quelques bons esprits regrettent amèrement que cet usage ne soit plus dans nos mœurs.
Avancez toujours ; visitez rapidement la houillère de Ronchamp, la verrerie de Champagney et les ruines du château de Passavent : c’est alors que votre excursion prendra son véritable caractère.
Tout en pointant la carte de l’état-major, suivez bien mon récit. Après avoir traversé Plancher-Bas, vous avez à votre droite de hautes carrières d’ardoises et à votre gauche le Rahin, dont les eaux grondent en sautant sur leur lit de roches ; mais plus loin, après le Magny et les dernières chaumières du Rapois, la route se resserre entre deux montagnes et vous traversez le torrent sur un pont de bois. Marchez encore quelque temps sous le chemin couvert et vous remarquerez bientôt une branche de sapin, creusée en gargouille, qui sort du talus et laisse tomber le filet clair d’une source vive dans une auge rustique de granit rose. Les bestiaux s’arrêtent ici pour boire, car la source jouit d’une excellente renommée. Tout à côté, à demi cachée par les ronces grimpantes, est une grotte percée par la main des hommes. Ce trou, haut de deux mètres, large d’autant, est noir et d’un aspect sinistre. Au bruit de vos pas, vous entendez les vipères et les couleuvres fuir dans les broussailles.
Vous vous demandez quel est cet antre ? C’est une galerie qui conduit à une mine d’argent. En effet, il y a une soixantaine d’années, un paysan passant le soir dans ce lieu désert, vit apparaître la Vierge Blanche qui, du bout de sa baguette de coudrier, lui indiqua l’endroit où gisaient des richesses inouïes. Aidé de quelques compagnons, le brave homme attaqua le sol et découvrit presque aussitôt des filons brillants d’argent natif intercalés dans les fissures des roches. Le travail était pénible et lent, car la dynamite n’était point inventée ; les frais dépassaient les bénéfices, et la mine fut abandonnée. Dans ce petit pays, je pourrais vous indiquer vingt gisements précieux qui ne sont pas exploités, mais qui prouvent que Plancher-les-Mines est bien digne de son nom.
C’est à cette fontaine que m’est arrivée une singulière aventure. Un dimanche, en plein midi, je m’étais assis sur une roche moussue, et, tirant de la poche de ma veste une galette de sarrazin, je déjeunais de bel appétit ; je buvais, luxe insensé, dans un gobelet en cuir bouilli. Tout à coup, j’entendis des cris, des chants et des rires, et du tournant du chemin je vis déboucher tout un essaim de vierges folles. C’étaient les mugnottes d’Auxelles qui se rendaient à la fête de Fresse, la plus belle du pays, comme vous le savez sans doute. À ma vue, elles s’arrêtèrent un peu surprises ; elles contemplaient ce grand dadais de seize ans qui, les jambes ballantes, restait la bouche ouverte ; elles examinaient curieusement ma mise, ma galette et ma tasse en cuir bouilli. L’une d’elles me reconnut probablement, car elle s’écria :
– Ço lo boube à Piarre, qué devint cheux son unquiem Doudou.
(C’est le fils de Pierre qui va chez son oncle Auguste).
La glace était rompue, les jeunes filles s’approchèrent en riant. Elles étaient huit, vêtues de leurs plus beaux atours, cornettes en velours parsemé de paillons d’or, corsages garnis de rubans, jupons multicolores ; il y avait des brunes, des blondes et des rousses, des yeux noirs, des yeux verts, des yeux bleus ; elles me montraient dans leur sourire narquois un tas de dents blanches, et, pour un moment, je me crus un innocent agneau offert en pâture à une bande de crocodiles. Je ne courais aucun danger, car elles étaient trop nombreuses. Ah ! si elles n’eussent été que trois !…
Les folles voulurent boire dans ma tasse en cuir bouilli, et, pour préserver leurs caracos, je fus obligé de leur approcher moi-même la coupe des lèvres. À vrai dire, ma main tremblait un peu.
Elles me contraignirent ensuite à leur chanter une romance, et, à quatre reprises, je dus leur débiter cette poésie sentimentale :
Charmées, elles écoutaient sans comprendre. Les natures simples ont le privilège d’être profondément émues par de semblables inepties.
Pour me remercier, les belles filles vinrent m’embrasser tour à tour, et, suivant l’usage du pays, je leur rendis cette politesse. Comment se fait-il que huit bouches si fraîches et si roses puissent vous laisser les joues si brûlantes ?
Les effrontées me quittèrent enfin et longtemps je les entendis chanter :
Après avoir copieusement soupé à Plancher-les-Mines, priez votre hôte de vous guider vers la Planche-des-Belles-Filles. Il y consentira, sans doute, et c’est une petite excursion dont vous garderez bon souvenir. Pour moi, je me souviens avec plaisir d’avoir fait cette ascension en compagnie de mon oncle Doudou et de ma cousine Laïde.
Nous partîmes à la tombée du jour. Doudou portait en bandoulière son carnier chargé de victuailles, et, comme contrepoids, une peau de bouc qu’il avait rapportée d’Espagne du temps qu’il était soldat. La peau de bouc contenait six litres de vin de Vouhenans. Mon oncle aimait à prendre ses précautions, et ce n’est pas moi qui l’en blâmerai.
La nuit était sans lune, mais les étoiles brillaient au ciel. Après avoir un peu remonté le cours de la rivière, mon oncle prit un étroit sentier. La montée commençait. Il n’y a rien au monde d’aussi joli que le ballon de chez nous, la Planche-des-Belles-Filles. Les envieux lui préfèrent le ballon de Servance ; mais il ne faut pas les écouter, car les gens de Servance sont de ces êtres qui veulent toujours avoir un ballon plus beau que celui des autres.
Le sentier monte à travers de grands pâturages semés de quelques arbres fruitiers et conduit à une forêt de hêtres et de chênes. Dans le bois, le chemin devient difficile parce qu’on ne voit plus clair et que le pied à chaque instant se heurte à de grosses racines. Quand je trébuchais, Laïde riait en se moquant, et, dame ! je rageais. Mais voilà que, dans une clairière, cette petite folle se prit à crier :





























