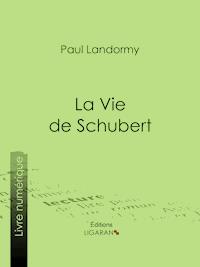Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Dans ce troisième tome de "La musique française", Paul Landormy nous invite à une exploration approfondie de l'évolution musicale en France. Ce volume se concentre sur une période charnière où la musique française a subi des transformations significatives. Landormy, avec une érudition remarquable, analyse les oeuvres et les influences des compositeurs qui ont marqué cette époque. Il examine comment les événements historiques, les innovations technologiques et les échanges culturels ont façonné le paysage musical français. L'auteur s'intéresse particulièrement à l'impact de la modernité sur les compositions et les styles, mettant en lumière les tensions entre tradition et innovation. Ce tome est une ressource précieuse pour comprendre les dynamiques qui ont conduit à l'émergence de nouveaux genres et à la redéfinition des esthétiques musicales. Grâce à une approche à la fois analytique et narrative, Landormy réussit à rendre accessible une période complexe tout en respectant la rigueur académique. Les lecteurs sont ainsi invités à découvrir les subtilités de la musique française, à travers des analyses détaillées et des réflexions critiques, qui enrichissent leur compréhension de cet art en perpétuelle évolution. L'AUTEUR : Paul Landormy, éminent musicologue français du XXe siècle, est reconnu pour ses contributions significatives à l'étude de la musique française. Né à la fin du XIXe siècle, il a consacré sa carrière à l'analyse et à la critique musicale, se spécialisant dans l'évolution de la musique en France. Landormy a étudié à l'École normale supérieure, où il a développé une passion pour la musicologie, discipline alors en plein essor. Il a écrit plusieurs ouvrages qui sont devenus des références incontournables pour les amateurs et les spécialistes de la musique. Ses écrits se distinguent par leur profondeur analytique et leur clarté, permettant aux lecteurs de saisir les nuances des oeuvres et des mouvements musicaux. Bien que peu d'informations personnelles soient disponibles sur sa vie, son héritage intellectuel perdure à travers ses publications. Landormy a également contribué à de nombreuses revues académiques, partageant ses recherches avec un public plus large. Son travail a influencé des générations de musicologues et continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre l'histoire et l'évolution de la musique française.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
CHAPITRE I : LA MORT DE CLAUDE DEBUSSY, LES DERNIÈRES ANNÉES DE FAURÉ, DE VINCENT D’INDY ET DE PAUL DUKAS
CHAPITRE II : LE JAZZ
CHAPITRE III : UNE RÉVOLUTION MUSICALE? LE GROUPE DES « SIX » JEAN COCTEAU
CHAPITRE IV : INFLUENCES SUR LES « SIX » ERIK SATIE, SCHÖNBERG, STRAWINSKY
CHAPITRE V : AUTRES INFLUENCES SUR LES « SIX » : ROUSSEL, FLORENT SCHMITT, DÉODAT DE SÉVERAC, RAVEL
CHAPITRE VI : LE GROUPE DES SIX : LOUIS DUREY, HONEGGER, DARIUS MILHAUD, FRANCIS POULENC, GEORGES AURIC, GERMAINE TAILLEFERRE
LOUIS DUREY
ARTHUR HONEGGER
DARIUS MILHAUD
FRANCIS POULENC
GEORGES AURIC
GERMAINE TAILLEFERRE
CHAPITRE VII : REGARDS EN ARRIÈRE
SAINT-SAËNS
ANDRÉ MESSAGER
ALFRED BRUNEAU
SILVIO LAZZARI
GEORGES HÜE
GUSTAVE CHARPENTIER
PIERRE DE BRÉVILLE
MAURICE EMMANUEL
GABRIEL PIERNÉ
ALFRED BACHELET
GUY ROPARTZ
PAUL DUPIN
G.-M. WITKOWSKI
CHARLES KŒCHLIN
CHAPITRE VIII : REGARDS EN ARRIÈRE
FRANCIS CASADESUS
HENRI BÜSSER
HENRI RABAUD
OMER LETOREY
REYNALDO HAHN
ROGER-DUCASSE
MAX D’OLLONE
HENRY FÉVRIER
ANTOINE MARIOTTE
MARCEL LABEY
RAOUL LAPARRA
LOUIS AUBERT
PAUL LADMIRAULT
GUSTAVE SAMAZEUILH
LOUIS DUMAS
ADOLPHE PIRIOU
JACQUES LARMANJAT
GABRIEL GROVLEZ
PHILIPPE GAUBERT
CANTELOUBE DE MALARET
MAURICE DELAGE
ANDRÉ CAPLET
D.-E. INGHELBRECHT
PAUL LE FLEM
MARCEL SAMUEL-ROUSSEAU
CHAPITRE IX : DE DROITE ET DE GAUCHE
CLAUDE DELVINCOURT
JACQUES DE LA PRESLE
PIERRE VELLONES
JACQUES IBERT
MAURICE YVAIN
GEORGES MIGOT
ROLAND MANUEL
LILI BOULANGER
MARCELLE SOULAGE
LOUIS BEYDTS
GEORGES DANDELOT
JEAN RIVIER
MARCEL DELANNOY
EMMANUEL BONDEVILLE
JEANNE LELEU
RAYMOND LOUCHEUR
HENRI MARTELLI
SUZANNE DEMARQUEZ
CHAPITRE X : DE DROITE ET DE GAUCHE
MAURICE JAUBERT
P.-O. FERROUD
HENRI BARRAUD
ROBERT BERNARD
HENRI SAUGUET
MAURICE DURUFLÉ
CLAUDE ARRIEU
MANUEL ROSENTHAL
ANDRÉ JOLIVET
ÉMILE PASSANI
MAXIME JACOB
YVES BAUDRIER
MAURICE THIRIET
JEAN CARTAN
CAPDEVIELLE
TONY AUBIN
DANIEL LESUR
OLIVIER MESSIAEN
ELSA BARRAINE
JACQUES CHAILLEY
JEAN FRANÇAIX
JEAN HUBEAU
LES ORGANISTES
CONCLUSION
CHAPITRE I
LA MORT DE CLAUDE DEBUSSY, LES DERNIÈRES ANNÉES DE FAURÉ, DE VINCENT D’INDY ET DE PAUL DUKAS
Le 25 mars 1918, Claude Debussy succombait aux atteintes fatales d’une atroce maladie qui, depuis quelques années, faisait de sa vie un perpétuel martyre. Avec lui disparaissait un des plus extraordinaires génies que la France ait jamais produits.
Alors un double phénomène se manifeste : d’une part, la gloire du merveilleux musicien ne cesse de grandir ; et, en même temps, son influence sur les jeunes artistes tombe tout d’un coup à rien.
C’est une époque de l’histoire de la musique qui s’achève.
Il en reste vivantes, et combien vivantes, des œuvres comme le Prélude à l’après-midi d’un Faune, le Quatuor en sol, Pelléas, les Nocturnes pour orchestre, la Mer, le Martyre de saint Sébastien, d’innombrables mélodies et pièces de piano, d’un art à la fois subtil et profond, parfois rêveur et parfois ironique, tantôt doucement mélancolique et tantôt violemment dramatique, toujours sobre et concentré, souvent d’un mystérieux enveloppement dû à de savoureuses harmonisations qui révolutionnent la technique musicale et l’engagent pour un temps sur une route toute nouvelle.
La mort de Claude Debussy, qui coïncide à peu près avec la fin de la « grande guerre », marque un tournant décisif dans l’évolution des formes de l’art. Un autre style et une autre technique vont naître du besoin même d’un renouvellement, après trop de parfaits chefs-d’œuvre, d’une espèce par suite périmée.
Ils vont naître aussi des secousses d’un formidable bouleversement social et des leçons de la guerre, – des leçons enfin du jazz.
Igor Strawinsky jouera son rôle, et un rôle capital, dans ce brusque changement de méthode, et son action se fera profondément sentir sur la jeune école française.
Ce sont les effets de ces diverses causes que nous aurons prochainement à démêler, – et comment ils en résultent.
Et nous allons quitter Debussy, hélas ! sans nous attarder davantage à sa chère et précieuse compagnie. Mais, encore une fois, au temps où nous prenons les choses, il est déjà le Passé.
Marchons en avant.
Prolongeons cependant cet adieu. Rappelons que la mort de Claude Debussy passa en France assez inaperçue. Paris bombardé avait d’autres soucis. On ne lui fit ni funérailles solennelles, ni pompeuses oraisons funèbres. On n’organisa point de festivals de ses œuvres. Le grand homme partit comme il avait toujours été, ironique et discret. L’enterrement eut lieu au Père-Lachaise le 28 mars, parmi quelques fidèles amis. Cette façon de quitter la comédie ou la tragédie du monde lui convenait assez. Il n’eût point sans doute désiré à cette ultime séparation plus d’apparat.
Mais, à l’étranger, la nouvelle de sa mort provoqua une émotion considérable. En tous pays, alliés ou neutres, allemands, autrichiens et hongrois, on consacra à sa mémoire d’importants articles de journaux et de revues. Celui du célèbre critique Ernest Newman, dans le Musical Times, fut un des plus significatifs.
En France, quelques chroniques furent consacrées, dans des sens très divers, à l’auteur de Pelléas.
Dans la Revue des Deux-Mondes du 15 mai 1918, Camille Bellaigue, ancien camarade de Debussy au Conservatoire, mais son adversaire obstiné comme critique musical, ne renonça sur aucun point à l’opinion qu’il avait toujours exprimée. Il voulut bien reconnaître que « Debussy buvait dans son verre, lequel n’était pas grand, mais d’un mince cristal où se jouaient, en reflets irisés, d’incertaines et changeantes couleurs ». Musique sans mélodie, prétendait-il, presque sans rythme et sans architecture. Il fallait que, jusqu’au delà de la tombe, le génial novateur restât incompris de quelques-uns.
D’autres au moins lui rendaient justice. Nous n’en citerons qu’un parmi ceux-là, et ce sera Gaston Carraud, qui avait été l’un des premiers à proclamer le rang éminent que Debussy tiendrait dans l’histoire de l’art. Dans un article de la Liberté du 1er avril et un article du Courrier musical du 15 avril, il s’appliquait à exalter toutes les vertus essentiellement françaises de l’art debussyste.
Peu de temps après, lors de la reprise de Pelléas à l’Opéra-Comique, Gaston Carraud écrivait ces lignes qui firent sensation de la part d’un critique d’une compétence notoire, d’ailleurs si profondément attaché à l’art de Franck et de Vincent d’Indy : « Pelléas échappe désormais aux adulations ou aux moqueries de la mode. Il trouve directement et simplement le chemin du cœur… Le véritable exemple que donne Pelléas dans sa mesure exquise est d’une force, d’une profondeur, d’une spontanéité prodigieuses dans l’expression, d’une sensibilité, non pas seulement précieuse et troublante, mais la plus largement, la plus naturellement pathétique. Sa délicatesse même est puissante ; sa recherche, fraîcheur et générosité de l’âme comme de l’imagination. Ce qui s’en dégage, maintenant que son écriture a perdu sa fleur surprenante de nouveauté, c’est le grand esprit classique éternellement nouveau qui finit toujours par ressortir des œuvres d’art vraiment belles, même quand elles se sont dressées contre lui. »
Mais qui oserait aujourd’hui en disputer ? Plus elle va, plus l’œuvre de Debussy semble se remplir du contenu qui parut tout d’abord lui manquer, de pensée et d’émotion.
Je me rappelle ma première rencontre avec Debussy. C’était chez lui, en 1904, dans son modeste appartement de la rue Cardinet si curieusement aménagé avec un souci d’art des plus minutieux. Il m’y recevait avec une politesse raffinée mais un peu distante. Il se méfiait des inconnus. Il ne se donnait ou ne se prêtait pas volontiers, même pour un court instant, ni sur l’impression d’une immédiate sympathie. J’allais lui demander son opinion sur la musique française d’alors, ses tendances, son avenir, ses vertus essentielles. Je devais publier dans la Revue bleue un article sur cette question. Qu’était-ce donc pour lui que la musique ? La musique française ? Que cherchait-elle ? Que voulait-elle dire ? Quel était son rôle, son but ? « La musique française, répondait-il, veut avant tout faire plaisir. Couperin, Rameau, voilà de vrais Français ! Cet animal de Gluck a tout gâté. A-t-il été assez ennuyeux, assez pédant, assez boursouflé !…» Et il continuait : « Le génie musical de la France, c’est quelque chose comme la fantaisie dans la sensibilité ! » Il concluait : « Il faut débarrasser la musique de tout appareil scientifique. La musique doit humblement chercher (il y revenait) à faire plaisir ; il y a peut-être une grande beauté possible dans ces limites. »
Il fut très mal compris.
Sa réponse, publiée, produisit le plus fâcheux effet dans le camp surtout des franckistes.
Cet hédonisme déplut, d’autant plus qu’on l’interpréta de la façon la plus étroite. On crut que Debussy renonçait à tout ce qu’il peut y avoir de grand et de profond dans l’art musical, qu’il le réduisait à un jeu de sonorités agréables pour l’oreille, superficiel et vain. On ne voulait se souvenir ni de Golaud, ni d’Arkel, ni de Pelléas non plus et de la malheureuse petite Mélisande. « Faire plaisir ? » Il y a tant de manières de nous donner le plaisir musical ! Notre plaisir n’est-il pas parfois de verser des larmes ou de frissonner d’épouvante ?
Mais il faut que l’effet ne soit pas cherché délibérément. Il faut qu’il se produise spontanément, l’émotion coulant des sources jaillissantes de l’inspiration, et non des savantes combinaisons d’un effort trop voulu. Il faut que, malgré tout et dans ses manifestations les plus passionnées, l’art reste un jeu et qu’on sente que l’artiste ne s’est pas pris la tête à deux mains pour découvrir et mettre en action les ressorts cachés qui troubleront notre cœur.
Liberté, facilité et joie de la création, même de la douleur créée, telle reste l’attitude de l’artiste.
J’en, éprouvais le sentiment il y a quelques jours en écoutant ce chef-d’œuvre, le Martyre de saint Sébastien, presque encore inconnu du public, et qui, sous la pénétrante direction de Charles Münch, arrachait à mon voisin des larmes. Je suffoquais moi-même sous l’impression de tant de beauté, de tant de grandeur, d’une telle force d’expression.
Monteverdi, Rameau, Gluck, Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy, voilà de quelques noms illustres jalonnée la route royale du drame musical, voilà en quelques dates capitales situées les grandes époques de la musique.
Derrière Debussy disparu, quelques anciens compositeurs, et des plus nobles, survivaient qui prolongèrent quelque temps le style d’un art antérieur. Citons au moins ici Gabriel Fauré, Vincent d’Indy et Paul Dukas.
GABRIEL FAURÉ était bien plus âgé que Debussy. Il était né en 1845, Debussy en 1862.
Comme Debussy, Fauré est un novateur, mais d’une tout autre espèce. Ce n’est pas un révolutionnaire. Entre le passé et lui, il ne creuse pas un fossé. Il reste fortement attaché à la tradition. Il renouvelle l’harmonie sans la bouleverser, par de minimes changements à peine apparents. Il n’invente pas un seul accord. Mais il les enchaîne autrement. Si, sur une de ses pages vous jetez un rapide coup d’œil, vous n’y apercevrez rien que d’habituel, rien qui dérange vos souvenirs classiques. Cela vous semble à première vue tout simple, tout naturel, tout facile. Mais lisez mieux, déchiffrez, jouez. Comme tout devient nouveau ! Quelle harmonie inconnue vous découvrez, naissant sous vos doigts par de si petits mouvements, par le déplacement d’une seule note à un ton ou un demi-ton d’intervalle ! Tout cela n’a pas l’air de bouger, et cette quasi-immobilité sonore remue en vous des fibres tellement intimes et secrètes. Sur ce fond, donc à peine mouvant, mais instable cependant et qui fuit sans cesse sous l’oreille qui y cherche un appui, se pose une phrase ferme et précise comme la parole dont elle suit le contour aisé et dont elle rejoint les accents touchants. Voilà du nouveau certes, et qui modifie tout sans grand bruit.
Fauré avait tout d’abord aimé les douceurs de la vie. Il fut d’abord un mondain. Il le fut à un certain âge, dans sa jeunesse. Mais il était déjà autre et il le devint de plus en plus. Il n’était pas un homme tellement léger. Il avait pensé, conçu un idéal, travaillé pour le réaliser. Nous en avons la preuve dans des ouvrages comme Pénélope, d’une beauté si pure et si détachée, d’une si transparente spiritualité.
Le fils de Gabriel Fauré, M. Ph. Fauré-Frémiet, essaye d’expliquer en quoi consiste le caractère très particulier de la sensibilité d’un tel artiste. Il parle d’une force imaginative, d’une soif de « formuler tout ce qu’on voudrait de meilleur, » d’une impossibilité à se complaire dans la volupté, pourtant délicieusement ressentie, qui éloigne Gabriel Fauré d’une œuvre essentiellement troublante comme l’Après-midi d’un Faune. Notons que Fauré admirera Debussy mais ne l’aimera pas. Claude Debussy est un voluptueux qui ne s’enquiert de rien autre chose que de volupté, – étant donné d’ailleurs qu’il en connaît de tous ordres. Gabriel Fauré est un voluptueux d’abord, mais il conçoit au-dessus de la volupté des raisons de vivre d’un autre rang, et il s’y rattache tous les jours davantage.
C’est dans la fin de sa vie, qu’attristé par une cruelle infortune qui modifia en partie son caractère, il s’élève de plus en plus haut au-dessus de l’agrément des sens. Il y est induit par le malheur qui le frappe. Ce qu’on ignore trop, en effet, c’est que depuis 1903, Fauré sut qu’il devenait sourd. Alors commence pour lui le long calvaire qu’a connu Beethoven. « Je fais tout mon possible, écrit-il, pour améliorer ma santé dans l’espoir que mes oreilles en seront améliorées. À tout instant j’ai l’occasion de constater combien la musique m’échappe, et cela me cause une tristesse toujours plus grande !… Je suis atterré par ce mal !… Il y a des périodes de musique, des sonorités dont je n’entends rien, rien !… de la mienne comme de celle des autres ! »
Et, ce qui est plus affreux encore, le peu qu’il entendait parfois, il l’entendait faux. Il percevait les notes graves une tierce au-dessus, les notes aiguës une tierce au-dessous de leur hauteur réelle. On imagine les cacophonies qui en résultaient ! Et quel supplice pour un musicien !
Comme Beethoven, Fauré s’efforçait de cacher son infirmité « pour qu’on ne lui retirât pas son gagne-pain » : la critique du Figaro et la direction du Conservatoire. Les bons confrères murmuraient autour de lui : « Fauré est sourd, il ne peut pas juger une œuvre, il ne peut plus présider un jury d’examen. » Mais il n’avait aucune fortune. Ses œuvres ne rapportaient presque rien. Il fallait vivre…
Jamais il n’entendit Pénélope !
Il ne l’entendit qu’en lui-même, dans son beau rêve intérieur !
Mais il secouait le « manteau de misère…Un beau paysage, un peu de grand soleil, la visite d’un ami, une bonne lettre suffisaient à le rasséréner. » Il n’était pas en cela comme Beethoven, le révolté qui se mettait si volontiers en colère contre la Nature, contre les hommes et contre Dieu. Fauré acceptait plus volontiers les pires infortunes, ou s’en accommodait tant bien que mal.
Et puis « il avait mille choses à dire. » Il sentait mille pensées musicales s’éveiller en lui, pensées nouvelles, « dernière manière », que la surdité peut-être faisait naître.
Ce n’est plus alors le mondain sémillant, recherché des petits cercles ; ce n’est plus du tout « l’homme des salons ». C’est l’homme qui peine et qui souffre et qui veut tout de même accomplir jusqu’au bout sa tâche, écrire toute la musique qu’il sent sourdre en lui des profondeurs de son être et dont son infirmité ne saurait arrêter le flot jaillissant.
La dernière période de sa vie, période si tragique, qui va de 1903 à 1924, se marque par des ouvrages d’un style tout particulier, d’une sombre gravité parfois, – parfois seulement – d’une austère résignation, et de plus en plus dépouillé, mis à nu, presque décharné. C’est d’alors que datent le 4e et le 5eImpromptus, les 7e, 8e, et 9eBarcarolles, les 9e et 10eNocturnes, ce qu’il a peut-être écrit de plus beau pour le piano.
Mais ce n’est pas au piano que son écriture se dénude le plus ; là il conserve toujours une richesse de coloris et de fleurs parfumées qui rappellent un peu, au moins du dehors, le premier Fauré.
Tout de même, on ne le suit plus. Le public est déconcerté. Seuls quelques connaisseurs l’approuvent. La majorité des auditeurs l’abandonnent et s’en tiennent aux séductions plus faciles du Fauré d’autrefois.
Mais parlons de cette Pénélope qui l’occupa sept ans, de 1907 à 1913, et sur laquelle la correspondance publiée par M. Fauré-Frémiet nous apporte de nombreux détails.
Combien il se passionne pour ce long travail ! Mais il ne se fait pas d’illusions sur lui-même. Il sait qu’il n’invente pas un genre nouveau de composition. Seulement, dans un genre inventé par d’autres et combien de fois renouvelé, il apporte un langage neuf : ses tournures mélodiques et ses harmonies sont bien à lui. Qu’importe dès lors qu’il emprunte à Wagner son système de leitmotive ! C’est là, écrit-il, le système wagnérien ; mais il n’y en a pas de meilleur. » Et il énumère les thèmes qu’il a déjà trouvés. Il y en a un (celui des Prétendants) qui ne le satisfait pas complètement, qui lui semble un peu « wagnérien ». – « Il est vrai, ajoute-t-il, que ce diable d’homme semble avoir épuisé toutes les formules. » Quelle singulière appréhension ! Comment Fauré pouvait-il craindre de ressembler à Wagner, lui qui n’a pas le moindre trait commun avec l’auteur de la Tétralogie ! Lui, si particulier dans sa façon de dire, si vraiment unique, et d’abord si Français !…Mais il est modeste.
Un autre jour, il note, à propos de l’entrée de Pénélope : « Je la tiens dans mon esprit, mais je ne l’ai pas encore réalisée. » Et cette Pénélope, comme il l’a dessinée ! Comme il a rendu toute sa pensée fidèle et son sentiment confiant et son amour indéfectible dans un langage si ferme et d’une émotion intérieure si intense !
Bientôt après : « Voici enfin que Pénélope est entrée en scène… les Prétendants veulent forcer la porte ; la vieille Euryclée leur barre le passage, et l’orchestre gronde avec le thème obstiné de ces messieurs, et par-dessous, avec un fragment du thème d’Ulysse qui leur mord les jambes. Et cela monte, monte jusqu’à l’explosion d’un accord qui, dans le Prélude, traduit le plus pathétiquement la douleur de Pénélope. C’est sur l’éclat et l’expression de cet accord qu’elle apparaît…»
Ah ! l’admirable accord en effet ! Et quelle poignante expression dans une simple harmonie, ou plutôt dans l’enchaînement de ces deux harmonies :
Fauré écrit une autre fois : « J’ai fait, – je crois, – de très bonne besogne hier. J’ai traité, et j’ai grand espoir de l’avoir réussi, tout ce passage : « Il reviendra, j’en suis certaine, » jusqu’à : « Et qu’un jour je pourrai l’adorer davantage. » Tu vois [il s’adressait à sa femme] qu’il y avait de quoi piétiner depuis trois jours, mais hier tout cela s’est formulé, et après toute l’animation croissante des premiers vers, – avec, dans l’accompagnement, la partie héroïque et presque joyeuse du thème d’Ulysse, – j’ai trouvé pour ces mots : « J’ai tant d’amour à lui donner encore » des accords amplement pathétiques et expressifs, – je l’espère, – avec, dans l’accompagnement, le thème largement présenté de Pénélope… Aujourd’hui, je suis un peu dans l’exaltation agréable de mes pages musicales trouvées hier et que je vais mettre tout à fait au point en les recopiant. »
Comme on la comprend cette « exaltation agréable » quand on songe à cette chose sublime qu’est la phrase : « J’ai tant d’amour à lui donner encore ! »
Et voyez les formules de modestie que Fauré redouble : « Je crois », « j’espère », il n’ose pas dire qu’il est sûr.
Cependant le chef-d’œuvre naissait. La répétition générale en eut lieu le 2 mars 1913, à Monte-Carlo, dans un milieu tout à fait incompréhensif et dans des conditions d’exécution assez médiocres. Fauré ne s’attend à rien qui « voisine avec la perfection ». De la part du directeur, il sent que son œuvre est « totalement incomprise ». Ce directeur « a une façon de dire : « C’est de la musique classique, c’est un opéra classique, » qui dissimule mal un mépris sans limite. »
Mais quelle revanche, à Paris, au théâtre des Champs-Élysées, où Bréval et Muratore triomphent vocalement et plastiquement ! Hasselmans conduit la partition en grand artiste. Dès les premières notes, exactement dès cette première mesure de l’ouverture, d’une sonorité si pleine, si onctueuse et si chaude, nous sommes pris par cette musique simple, réservée, intime, d’une si noble pudeur dans ses mouvements les plus ardents de passion.
Au temps même où il composait Pénélope, Fauré écrivait cet admirable cycle de mélodies, la Chanson d’Ève (1907-1910), dans lequel, avec le poète van Lerberghe, il évoquait le premier âge du monde. Il y apportait une fraîcheur d’impression extraordinaire, et comme le souvenir d’un témoin.
Heureux choix que celui de ce jeune van Lerberghe, sitôt disparu. D’ailleurs, sauf quelques hésitations initiales, Fauré n’a-t-il pas toujours bien choisi ses poètes ? Sans culture littéraire très étendue, il savait s’informer, et un goût naturel très sûr le guidait. Pour débuter, il alla au plus grand des poètes français, à Victor Hugo (Le Papillon et la Fleur, Mai, Dans les ruines d’une abbaye.) Mais il s’aperçut bien vite qu’il faisait fausse route. Victor Hugo n’est pas musicable : son vers est fait d’images trop voyantes, d’un relief trop sculptural, qui crève le tissu musical ou en écrase le dessin. Et puis le sentiment intérieur n’y a pas assez de part. Théophile Gautier donnait bientôt matière à un chef-d’œuvre : la Chanson du Pêcheur, Leconte de Lisle inspirait à Fauré sa délicieuse Lydia et quelques-unes de ses pages les plus harmonieuses, quand ce ne seraient que les célèbres Roses d’Ispahan ou le Parfum impérissable. Il y a souvent chez Leconte de Lisle une certaine préciosité émue qui s’accorde à merveille avec quelques-unes des inclinations essentielles de Gabriel Fauré. Sully Prudhomme offrait Au bord de l’eau et les Berceaux, Armand Silvestre (qui l’eût cru ?) Automne et le Secret, Villiers de l’Isle-Adam, les Présents. Fauré arrive enfin à Verlaine et s’y tient quelque temps (Clair de lune, la Bonne Chanson, les Mélodies de Venise).Samain lui fournit l’occasion d’un de ses plus émouvants chefs-d’œuvre : Soir.
Jusqu’à présent, Fauré ne s’est guère égaré, sauf dans deux ou trois cas que nous avons omis à dessein, et dont l’erreur volontaire s’explique par des raisons d’amitié.
Pour finir, il va vers les jeunes, et ses deux derniers poètes sont des débutants : il ne s’est point trompé. Par deux fois van Lerberghe lui apporte des thèmes poétiques de haute valeur : la Chanson d’Ève (très appréciée de Maeterlinck) et le Jardin clos (1915-1918). Musique toute nouvelle, vraiment « troisième manière », musique close, fermée aux oreilles non averties des subtilités minutieuses d’une harmonie des plus étranges dans sa simplicité trompeuse. Musique de connaisseurs. Musique sans éclat, toute en lumière intérieure. Musique presque sans couleur, musique blanche.
H. de la Ville de Mirmont, le jeune poète mort à la guerre, ouvrait, d’autre part, à Gabriel Fauré en 1922 (deux ans avant sa mort), la voie des souvenirs et lui présentait l’image de son passé ardent, de ses passions toujours émues malgré l’âge. En écrivant l’Horizon chimérique, Fauré nous a laissé une œuvre toute différente de la Chanson d’Ève, du Jardin clos et aussi des charmants Mirages de la baronne de Brimont, une œuvre pleine de couleur, de mouvement, d’emportement même. Et quand on songe que cet ouvrage, débordant de vie et de jeunesse, d’ardeur et d’enthousiasme, fut composé par un homme dont l’organisme « détruit », atteint de mille souffrances diverses, semblait ne tenir à l’existence que par un « fil ténu », on est saisi de stupeur.
La vieillesse de Fauré est aussi l’âge d’une musique de chambre assez différente de celle qu’il avait autrefois composée, de la 1reSonate pour piano et violon, des deux Quatuors avec piano et du 1erQuintette. La 2eSonate de violon, le 2eQuintette, les deux Sonates de violoncelle, le Trio, le Quatuor à cordes, nous offrent l’exemple d’un art autrement concentré, de plus en plus dépouillé, et ramené à ses éléments essentiels. Parfois Fauré va jusqu’à se priver de l’usage traditionnel du bithémathisme et à composer un mouvement entier sur un seul thème. Les parties de piano se dénudent de plus en plus. Toutes les fleurs, autrefois rassemblées avec amour, sont alors dédaignées. Le contrepoint règne dans toute sa sévérité, ainsi et surtout dans le Quatuor à cordes. Et nous n’hésiterons pas à reconnaître qu’il en résulte, malgré tant de beauté, une certaine monotonie. Mais il y a aussi une grandeur certaine dans cette recherche de l’austérité à quoi s’astreint, pour terminer sa vie, celui qui unissait jadis toutes les grâces les plus séduisantes pour en composer ses charmes réputés. Et ce qu’il y a d’admirable, c’est que souvent encore cette sévérité dernière reste une caresse.
En 1919, Fauré dut enfin quitter la direction du Conservatoire, devenue impossible, la surdité faisant sans cesse de nouveaux progrès.
Le Maître prit courageusement parti de cette retraite forcée. Il se livra entièrement à la composition.
Il voyageait, cherchant de beaux paysages et composant toujours : « Il arrivait, défaisait sa malle et posait sur la table son papier blanc, un carnet d’esquisses, quelques lettres. Le lendemain, dès la toilette faite, il se mettait à l’ouvrage. Il semblait calme et lointain, bienveillant et inaccessible… Autour de lui, nulles feuilles éparses dans la tempête des ébauches et des retouches : un ordre naturel, nécessaire, de la raison involontaire…Autant les manuscrits de sa jeunesse sont pleins de ratures, d’additions et de retouches, autant ceux de la dernière période et l’ultime manuscrit du Quatuor à cordes sont nets et élégants, lucides, est-on tenté de dire, comme si lui-même transparaissait en eux. »
Ainsi parle son fils, M. Fauré-Frémiet.
Fauré vieillissait. Mais l’humeur restait égale, malgré la cruelle surdité. À près de 80 ans, Fauré laissait sa porte ouverte à tous ; il accueillait amis et importuns. S’il travaillait, il posait doucement sa plume et penchait sa tête pour tâcher d’entendre des paroles qu’il saisissait si difficilement.
Ses vieux amis disparaissaient l’un après l’autre. Il lui restait trois camarades de jeunesse : Gigout, Messager et d’Indy. Parmi les compositeurs plus jeunes, il aimait beaucoup Paul Dukas.
Et toujours en voyage ! Il y avait en lui une sorte de perpétuelle « insatisfaction », un perpétuel besoin de changement. Il y avait là en son âme un instinct très profond qu’il a merveilleusement exprimé, avec quelle force, avec quelle fougue, dans cet Horizon chimérique qui restera une des plus belles inspirations de sa vieillesse.
La mer est infinie et mes rêves sont fous.
La mer chante au soleil en battant les falaises
Et mes rêves légers ne se sentent plus d’aise
De danser sur la mer comme des oiseaux soûls.
Charles Panzera, à qui il est dédié, « créa » cet Horizon chimérique de façon inoubliable, avec un feu, une ardeur et en même temps un style impressionnants. Cela eut lieu le 13 mai 1922 à la Société nationale. N’oublions pas que de même que la Bonne Chanson, écrite pour voix de femme, perd infiniment à être chantée par un homme ; l’Horizon chimérique ne convient nullement aux voix de femmes. Il y faut de toute nécessité le timbre d’une voix mâle. Ces dames ont bien assez de mélodies à chanter dans les abondants recueils du Maître Fauré. Qu’elles laissent leur part aux hommes : chacun son affaire.
Fauré avait certes de mauvais moments : « Je sens, disait-il une fois, que je serai toujours malheureux, toujours insatisfait et que je n’aurai donné de bonheur à personne, ce qui est humain par-dessus tout. » Parole bien amère, mais qui ne traduit sans doute pas un état d’âme constant. Elle fut probablement prononcée dans un jour de détresse un peu exceptionnel. Ces durs retours sur soi-même témoignent tout au moins d’une âme assez grave. Ce ne fut point, nous le disions, un homme si léger, – trop faible, oui, peut-être et qui ne savait pas résister à ceux qu’il aimait, qui n’avait pas de « courage contre l’affection » : c’est ainsi qu’il put faire du mal parfois, – « du mal qu’il regretta ».
Sa vieillesse fut, en somme, malheureuse ; et le merveilleux, c’est qu’il ait supporté si patiemment son infortune. Infortune multiple ! Car, outre qu’il était sourd, la plus affreuse des infirmités pour un musicien, il était pauvre et vivait, sinon dans le besoin, au moins dans la gêne.
Ce fut une grande joie pour lui que cet hommage qui lui fut rendu en Sorbonne dans cet inoubliable festival auquel participèrent, sous la présidence du chef de l’État, les plus illustres artistes français (20 juin 1922). C’était tout de même un spectacle poignant que celui de cet homme qui assistait à un concert de ses œuvres dont il ne percevait pas un seul son. Il regardait devant lui, pensif et, malgré tout, satisfait et reconnaissant.
Tous les étés, de dévoués amis, M. et Mme F. Maillot, le recueillaient dans leur vaste et paisible maison de campagne d’Annecy-le-Vieux qui domine la vallée. Devant un admirable paysage, dans une confortable demeure, entouré de calme et de silence, Fauré était merveilleusement installé pour composer. C’est là qu’il écrivit la plupart de ses derniers ouvrages. C’est là que, sentant sa fin prochaine, il dicta ses dernières volontés : « On trouvera les deux premiers morceaux de mon Quatuor sur ma table à écrire à Paris. Le troisième morceau est ici. Je désire que l’on demande à Roger Ducasse d’indiquer les mouvements, nuances et autres indications que je n’ai pas eu le temps d’écrire. Il est très habitué à ma musique et saura s’y reconnaître mieux que personne. Ceci fait, je désire que le Quatuor ne soit publié et joué qu’après avoir été essayé devant le petit groupe d’amis qui ont toujours entendu mes œuvres les premiers : Dukas, Poujaud, Lalo, Bellaigue, Lallemand, etc. J’ai confiance en leur jugement, et c’est à eux que je confie le soin de décider si ce Quatuor doit être édité ou détruit. » Quelle modestie encore !
Bientôt après, le lundi 3 novembre 1924, Fauré s’en allait, après une longue vie remplie de quelques plaisirs, de quelques joies et plus encore de douleurs, mais illuminée du rayonnement de nombreux et si doux chefs-d’œuvre.
On a fait un grand effort, ces dernières années, pour étendre le renom du compositeur de Pénélope, pour lui amener de nouveaux admirateurs, pour obtenir à son génie exceptionnel la gloire qui lui est due. Il s’est constitué, en 1938, une société des Amis de Gabriel Fauré. Tout de suite, cette société organisa, à la salle Pleyel, un concert qui réunissait sur l’affiche les noms les plus illustres parmi les interprètes du Maître. Il n’y avait pas moyen de résister à l’appel de tant de célébrités. La salle Pleyel fut remplie d’un public enthousiaste. Ce fut une très émouvante soirée.
Ce succès considérable ne doit pas faire illusion. La tâche est ardue d’amener le grand public à une musique aussi secrète, aussi modeste, aussi confidentielle que celle de Gabriel Fauré. Exceptons peut-être quelques rares ouvrages, tel le Requiem, qui parlent directement à tous un langage immédiatement pénétrant.
Mais les pièces de piano, les mélodies, la musique de chambre et même cette admirable Pénélope, comme tout cela reste loin de la foule, de cette foule surtout sensible aux grands éclats des effets appuyés ! On n’expliquera jamais assez aux auditeurs des concerts fauréens ce qu’ils doivent chercher dans un art qui semble vouloir se dérober aux oreilles incultes. C’est pourquoi il est utile de répandre dans le public la connaissance des livres où il trouvera le commentaire fidèle de la véritable pensée, des véritables intentions du Maître. On citera ici l’admirable chapitre du livre d’Émile Vuillermoz, Musiques d’aujourd’hui, l’ouvrage lumineux de Charles Kœchlin et celui pieusement filial de M. Fauré-Frémiet (déjà nommé), l’étude pénétrante de Joseph de Marliave. Il est paru, en outre, plus récemment un livre intitulé Gabriel Fauré et ses mélodies, par Vladimir Jankélévitch, dont on ne peut que recommander la lecture à tous les aspirants fauréens.
Vladimir Jankélévitch montre à merveille comment, malgré l’apparence, l’évolution de Gabriel Fauré est sans angle et sans détour. « Fauré est tout de suite lui-même. » Tout de suite il parle « tout bas » pour des auditeurs avertis, pour des connaisseurs, pour des raffinés, qui comprennent à demi-mot et n’ont pas besoin de grands cris ni de grands gestes pour être touchés, séduits ou émus. Il parle une langue qui est pure musique, qui ne se soucie guère de décrire, de peindre, qui ne s’attache guère à évoquer les objets extérieurs : il se contente d’y faire allusion par de lointaines analogies. Sa musique est avant tout de la musique qui veut être écoutée pour elle-même et qui n’en suscitera pas moins, par des ressorts cachés, l’image de mystérieux décors, de décors de rêve, de décors presque tout spirituels, pourrait-on dire, tellement ils ont peu de lien avec la réalité. Et s’il traduit des sentiments, c’est dans une langue qui veut d’abord être appréciée pour sa beauté intrinsèquement musicale. Il y a, en effet, une émotion qui se dégage de la pure musique en dehors de ce qu’elle peut exprimer.
Cette musique de Fauré, c’est un perpétuel tour de magicien, un tour de passe-passe. Son ironie s’amuse sans cesse à ces « fausses modulations », à ces modulations « circulaires » qui « égarent les lourdauds ». On part d’un ton, les accords modulants s’enchaînent, on se demande où l’on va, on croit s’éloigner beaucoup et l’on s’aperçoit en fin de compte qu’on n’a point bougé et qu’on se trouve de nouveau précisément d’où l’on vient. Harmonie délicieusement fuyante, qui se moque, et qui nous trouble de sa charmante indécision. Formons-nous à ces jeux exquis. Vladimir Jankélévitch nous y invite et nous y prépare.
Je n’adresserai qu’un reproche à Vladimir Jankélévitch. Mais en est-ce un ? Je lui pardonnerais bien volontiers son adoration un peu partiale pour Fauré, pour son dieu. C’est ainsi que, comparant Debussy et Fauré, il sacrifie à ce dernier l’auteur de Pelléas. Pourquoi ? Parce qu’il estime Fauré plus concentré, plus intérieur, plus purement musicien. Fauré se passe de la richesse, de la variété, de l’abondante humanité qu’on rencontre chez Debussy. Il se contente de peu, mais ce peu est d’un prix infini. « Debussy, plus cultivé sans doute, vibre follement à tous les souffles de la poésie, de la peinture et de la musique ; les cinq sens à l’affût, il guette les moindres bruits du siècle, devance les snobismes, s’éparpille infiniment pour capter tous les tressaillements de la terre et des hommes. » Toute la nature, toute la vie, on les trouve chez Debussy. La musique suffit à Fauré. Vladimir Jankélévitch n’aime point qu’on mélange la musique et la vie. La musique est, pour lui, en dehors et au-dessus de la vie : « Il n’y a pas besoin d’être musicien, écrit-il, pour aimer Beethoven, et même, tout compte fait, il est préférable de ne l’être point, tant cet art est impur, encombré d’humanité, de sociologie et de métaphysique, tant il est de plain-pied avec la vie. » Et au contraire : « Il n’y a que les natures musiciennes pour goûter parfaitement ce langage exquis et savoureux qui est celui de Pénélope. »
Ne soyons pas exclusifs. Prenons chaque plaisir à son temps et à son rang. Continuons d’être émus par Debussy, continuons d’admirer un art tout chargé d’humanité comme celui de Beethoven, mais aimons, pour sa délicatesse infinie, Fauré, le plus significatif représentant, avec Mozart, de la musique pure.
Fauré et d’Indy furent liés d’amitié, et à ce point que l’on contait que c’était Vincent d’Indy qui avait orchestré Pénélope. Nous ne le croyons point. Mais qu’on ait pu lui attribuer cette paternité est un fait caractéristique qui ne se serait point produit si l’on n’avait pas su les deux compositeurs très étroitement unis l’un à l’autre depuis leur première jeunesse.
Pourtant, point d’hommes, point d’artistes plus divers. L’un toute douceur, toute caresse, toute séduction, d’un caractère plutôt faible. L’autre, rude, escarpé, impétueux, homme de foi et de volonté.
Nul compositeur ne fut plus discuté que VINCENT D’INDY. Ses opinions religieuses, ses opinions politiques, ses doctrines artistiques, son attitude souvent agressive, tout en lui était matière à controverse. On l’accusait volontiers d’étroitesse d’esprit et d’avoir fondé une école de musique, la Schola Cantorum, où l’on enseignait la composition selon des méthodes entièrement stériles. On l’accusait d’écrire lui-même une musique sans émotion et sans vie, une musique d’ennui. Il n’avait que des partisans enthousiastes ou des ennemis acharnés.
Tout en faisant leur part aux défauts indéniables du caractère, aux intransigeances regrettables des doctrines de Vincent d’Indy et à l’inégalité de ses ouvrages, j’ai toujours trouvé ses ennemis bien injustes à son égard.
Je ne puis oublier ma dette de reconnaissance envers lui.
Je me vois arrivant à Paris du fond d’une province. On n’avait pas encore représenté Pelléas. Toute la vie musicale parisienne me paraissait s’être réfugiée à la Schola Cantorum. Là, là seulement, j’entendais autre chose que les symphonies de Beethoven et les drames wagnériens. Avec quelle joie, avec quelle avidité je découvrais Roland de Lassus et Costeley, Carissimi et Schütz, Monteverdi, Lully, Rameau, Haendel et Bach. L’Orfeo de Monteverdi, notamment, fut une de ces révélations dont on reste touché pour la fin de ses jours. Et je me rappelle toute une salle frémissant d’émotion et d’admiration, stupéfaite de tant de beauté et d’une beauté si proche, si vivante, si peu « d’ordre archéologique ! »
L’homme qui nous donnait tout cela, qui renouvelait pour nous le monde des sons, c’était Vincent d’Indy. On a dit que la Schola tenait ses fenêtres fermées sur la rue. Peut-être, mais elle ouvrait largement ses portes à un radieux passé.
Et elle ne nous apportait pas que la connaissance d’un passé ignoré. Elle était pour nous le présent, l’un des plus riches présents que la France ait jamais possédés, avec Duparc, Chausson, d’Indy, Lekeu, Magnard, Bordes et tant d’autres. Dukas et Fauré, les seuls grands musiciens étrangers à cette école étaient les amis de d’Indy. Le nom de d’Indy résumait pour nous tout un splendide mouvement dont nous suivions passionnément le développement. Quand Debussy sortira de l’ombre, c’est encore à la Schola que nous lui entendrons accompagner inoubliablement, à Bréval, les Chansons de Bilitis. Et l’on y chantait aussi les mélodies de Fauré.
Un soir, Blanche Selva entre sur l’estrade au bras d’Ysaye, couple majestueux, suivi du quatuor Parent, qui nous donnent une splendide exécution du Sextuor de Chausson.
Ces lointaines années renaissent dans ma mémoire et tout un flot de jeunesse remonte en même temps dans mon cœur.
Je revois d’Indy, tout droit en sa longue taille, avec sa redingote boutonnée, d’une étoffe unie, sobre, sévère, et sa petite cravate noire qui lui barrait la gorge, sous le col, d’un petit trait si net. Ce n’était pas un effet cherché, mais l’expression d’une simplicité : il avait réduit une fois pour toutes sa tenue à la correction la plus sommaire et s’épargnait tout vain souci d’élégance.
Élégant, il l’était cependant naturellement avec son corps souple et sa belle tête au front puissant, aux yeux profonds, au regard pénétrant, aux cheveux fièrement rejetés en deux masses noires sur les côtés.
C’était « un homme », c’était la plus grande force agissante d’alors. Un homme d’action. Il associait étroitement la religion à la musique, et on lui opposait la théorie de « l’art pour l’art ». La lutte entre les deux partis devenait de plus en plus ardente à mesure que la réputation de Debussy grandissait et que son Pelléas faisait plus d’adeptes.
Les partis engendrent une politique, des batailles, des ruses de guerre et des diplomaties ; et il est toute une politique musicale dont les effets peuvent être parfois déplorables, surtout quand cette politique proprement musicale se joint aux préoccupations de l’autre, de la grande politique, de la politique sociale. Ce fut le cas pour d’Indy comme pour ses adversaires.
Le pire est quand la politique retentit dans la composition même. Pour ma part, je regrette profondément que Vincent d’Indy ait mêlé à une œuvre comme la Légende de saint Christophe les controverses de la place publique. Là il descend trop bas dans la polémique. Que l’œuvre d’art soit une œuvre de foi, rien de mieux ; qu’elle exprime cette foi avec toute la fermeté et la ferveur possibles, on n’y voit nul inconvénient. Mais qu’elle rejette tous les débats de pure doctrine et les personnalités ! Ce qui n’empêche Saint Christophe de renfermer des pages magnifiques, comme nous le verrons tout à l’heure.
Et puis il faut penser au reste de l’œuvre où d’Indy laisse de côté des disputes trop particulières. D’Indy ne fut pas qu’un doctrinaire, il fut aussi un grand artiste, même quand il écrivit des ouvrages comme Fervaal et l’Étranger, où l’on sent encore le combattant qui tient à imposer ses idées et sa foi, mais surtout quand il composa Wallenstein, le Poème des Montagnes, la Symphonie cévenole, le 2eQuatuor, la Sonate de violon et la Sonate de piano. Là il ne prêche plus, il ne cherche personne à convertir ; il ne nous offre que de la beauté toute pure. Et ce que ses ennemis se refusèrent longtemps, – se refusent encore aujourd’hui – à constater dans de tels ouvrages, c’est l’émotion qui s’en dégage et la poésie dont ils sont tout parfumés. Poésie de ses montagnes de l’Ardèche, poésie des pins odorants au soleil et des vastes landes parsemées de bruyères, poésie des vastes horizons au delà du Rhône jusqu’aux sommets lointains des Alpes neigeuses. Qui donc peut écouter sincèrement le début de la Symphonie sur un thème montagnard sans tressaillir à ce pressant appel de la nature ? Et quelle symphonie l’École française a-t-elle produite qui soit supérieure ou peut-être même égale à celle-là ? C’est un des plus beaux chefs-d’œuvre de la musique de France et, à côté, l’on peut citer Jour d’été à la Montagne, de la même veine savoureuse.
Et puis, comme d’Indy enseignait aux musiciens le respect de leur art et la loi du travail ! Il donnait l’exemple. Toujours à la tâche, infatigable, ne se laissant abattre par aucune circonstance défavorable.
« Surtout, écrivait-il à Mme Marguerite-Marie de Fraguier, qui a publié sur lui un livre de bien jolis souvenirs, surtout ne soyez plus désorientée ; il ne faut jamais l’être. Il s’agit d’accepter la vie comme elle vient et de ne pas vouloir la faire comme on voudrait qu’elle fût. Et dans n’importe quelle situation, même la plus fâcheuse, soyez certaine qu’il y a moyen de travailler… »
Et encore : « Les peines morales sont presque toujours un grand stimulant au travail… Quant aux impedimenta physiques dont vous me parlez, laissez-moi vous dire que ce sont un peu des enfantillages… Personnellement, mes années de meilleure et plus abondante production ont été celles où je travaillais entouré de mes trois enfants en bas âge, qui riaient, pleuraient, se querellaient en bas de mon piano. »
Le travail, le travail contre vents et marées, voilà la grande loi qu’affirmait d’abord Vincent d’Indy. Et il n’hésitait pas à demander à ses élèves « vingt minutes d’attention réfléchie sur une seule mesure » dans un devoir de contrepoint.
Le travail, qui ne supplée point à l’inspiration, mais qui est la condition sans laquelle l’œuvre d’art ne se parfait point et le sentiment intérieur ne se traduit pas en formes parlantes. « L’expression, voilà le but. » L’expression ! Le mot qu’il avait sans cesse sur les lèvres et dont il cherchait à fixer les moyens efficaces.
Homme de volonté, de foi par-dessus tout. De foi très arrêtée dans ses éléments doctrinaux. Foi qu’on peut admirer même si on ne la partage pas. Foi en son Dieu, mais aussi en son art et en son œuvre.
Homme de foi, mais en même temps de rêve, et dont on ne peut comprendre la nature contrastée qu’en évoquant avec quelque précision l’image de son pays d’origine.
Rude contrée que ces montagnes du Vivarais. Rudes gens aussi que les paysans qui l’habitent. Toujours méfiants et prêts à la lutte, « ces hommes dont les ancêtres huguenots et catholiques se sont entretués pour défendre leurs idées ». Ils sont demeurés tenaces, menaçants. Leurs cimetières se côtoient sans se mêler. « Certains villages sont restés tout entiers protestants ; et les catholiques voisins y ont gagné des convictions d’autant plus solides que sans cesse ils combattent sous leur drapeau pour les défendre. »
Autrefois, en 1907, il fallait cinq heures de diligence pour monter de la gare de Valence aux Faugs. La maison de d’Indy, en granit, un peu dans le style des châteaux Louis XIII, occupe le point culminant d’un vaste point de vue qui s’étend du Rhône aux Cévennes. Tous les matins, de son cabinet de travail, d’Indy assistait au lever du soleil : « Il paraît là, montrait-il, derrière cette montagne que vous voyez en face. »
La nature fut toujours pour d’Indy le grand refuge et l’inspiratrice.
Dans sa jeunesse, que de voyages à pied, sac au dos, à travers la France ou l’Italie ! Il logeait n’importe où, dans les auberges, dans les granges, et, s’il était reçu parfois chez des particuliers, il reconnaissait l’hospitalité qu’on lui offrait en se mettant au piano et en faisant danser.
Avant d’être marié, il habitait une autre maison que les Faugs, peu éloignée, Chabret, le berceau de la famille d’Indy. C’est là qu’il écrivit le Poème des Montagnes. La maison de Chabret, abritée par une forêt de hêtres, est voisine de belles prairies où paissent des « bestiaux blancs gardés par de joyeux enfants ». Tout près, le village de Boffres, où quelquefois d’Indy, réunissant quelques amis, faisait chanter à l’église du Palestrina…
C’est ce cadre, abrupt, sévère – sévère et doux – qu’il faut imaginer si l’on veut pénétrer jusqu’au fond l’âme même de d’Indy et la signification de son œuvre.
Œuvre puissante et généreuse, mais parfois d’un abord un peu décourageant avec ses thèmes aux arêtes vives, ses constructions étranges, son ton austère.
Il y faut découvrir un cœur passionné malgré la rude discipline qu’il s’impose, et ne point s’étonner des élans impérieux d’un romantisme dont la mode d’aujourd’hui se trouve fort éloignée.
Il faut monter très haut, dans une contrée sauvage, pour atteindre les sommets d’où l’art de Vincent d’Indy rayonne. Mais quel vaste point de vue il nous découvre et quel air pur on y respire !
À la fin de la guerre de 1914, la vie de Vincent d’Indy et son art se modifièrent quelque peu. Alors le Maître faisait d’assez longs séjours, pendant les moments de liberté que lui laissait la Schola, dans le Midi, à Agay, sur les bords de la Méditerranée.
Il vécut là une existence nouvelle, il découvrit un ciel plus clair, une nature plus aimable. Il oubliait les rudesses de la nature cévenole, il s’ouvrait à des impressions plus douces et d’autre part, qu’il le voulût ou non, il subissait l’influence du mouvement musical des jeunes.
Ses dernières œuvres, De Bello Gallico (3eSymphonie, 1918), le Poème des Rivages (1918-1921) pour orchestre, Thème varié, fugue et chanson pour piano (1925), la Sonate en ré pour violoncelle et piano, le Concert pour flûte, piano, violoncelle et cordes (1926), le 2eTrio en sol pour piano, violon et violoncelle, les Contes de fées (1927) semblent marquer un retour aux formes de la sonate préclassique, celle de Corelli ou de Scarlatti, et s’inspirent aussi de l’exemple de Rameau. Elles s’attachent souvent plus à plaire qu’à émouvoir. Moins de romantisme, le souci de faire court, mais sans rien oublier des exigences architecturales. Une remarquable fraîcheur, une étonnante jeunesse et toute la force et la richesse de la pensée subsistent.
Durant cette dernière période, deux œuvres pour le théâtre : la Légende de saint Christophe (1928) et le Rêve de Cinyras (1927).
La Légende de saint Christophe fut donnée à l’Opéra avec une distribution exceptionnellement remarquable : Germaine Lubin, Franz, Rouard, Huberty.
Vincent d’Indy écrit lui-même les poèmes de ses opéras. Il a tiré la Légende de saint Christophe de la Légende dorée de Jacques de Voragine. Cette légende il la fait conter, comme les Passions de Bach, par un « historien » qui paraît sur le proscenium avant chaque acte, le rideau baissé derrière lui. Le rideau se lève ensuite, et du récit on passe à l’action. Ces pages en style de narration sont, en général, d’une grande beauté, d’une simplicité noble et émouvante.
Et voici la légende :
Le géant Auférus a juré de servir le plus puissant des dieux. Il sert d’abord la Reine de Volupté, puis le Roi de l’Or, enfin le Prince du Mal, Sathanaël. Mais devant la Croix et l’ombre de la Cathédrale, le Prince du Mal est obligé de courber la tête. Il n’est donc point le plus puissant des dieux. Auférus le quitte pour chercher le Maître des Maîtres que Sathanaël lui avoue être « le Roi du Ciel ».
En quête de ce Roi du Ciel, Auférus interroge les monarques, les guerriers, le pape lui-même. Tous lui répondent : « Je ne suis pas le Roi du Ciel. » Il s’adresse enfin à un vieil ermite qui lui révèle les vertus chrétiennes comme le seul chemin de la découverte après laquelle il aspire de toute son âme. Auférus s’emploie humblement comme passeur au bord d’un torrent furieux. Et voici qu’un enfant se présente pour franchir le torrent. Il le prend sur son épaule. L’enfant est lourd comme le monde. Il se fait connaître : c’est l’Enfant Jésus et il baptise Auférus, qui s’appellera désormais Christophore.
Maintenant Christophe est persécuté. Le Roi de l’Or reparaît pour le juger et le Prince du Mal pour le faire périr en état de péché. La Reine de Volupté ira le tenter dans le cachot où on vient de le jeter. Christophe la convertit. Elle sera baptisée du sang du martyr et convertira le peuple autour d’elle par la grâce de ses propres vertus.
Vincent d’Indy a eu l’art de donner à la vieille légende un intérêt dramatique soutenu. Le récit de « l’historien » lui permet très heureusement de passer rapidement sur tel épisode qu’il valait mieux raconter sans le mettre en scène, qui aurait alourdi le drame ou aurait peu prêté au commentaire musical. En fait, le public de 1921 ne cessait d’être pris par cette curiosité passionnée de « ce qui allait arriver » sans laquelle il n’y a pas de théâtre vivant.
L’œuvre est vivante en effet, et, bien qu’écrite par un symphoniste, elle est en même temps d’un homme de théâtre.
Vincent d’Indy n’avait jamais écrit une œuvre ni aussi riche, ni aussi parfaite. Jamais il n’avait réalisé plus bel équilibre dans la composition d’ensemble d’un ouvrage scénique. Les huit tableaux des trois actes forment une série de « morceaux » admirablement construits chacun pour sa part et dont la liaison compose un vaste monument de la plus lumineuse harmonie.
Chaque tableau est court. L’auteur n’abuse point de notre patience, ni des ressources inépuisables de son art. Il a serré le développement et concentré l’expression. Il ne pouvait être plus sobre. Et ce langage concis, ramassé, d’un accent incisif et pressant, ne cesse de traduire l’émotion la plus vive et la plus pénétrante.
Les deux points culminants de l’œuvre sont, d’une part, cette symphonie qui sert de prélude au 3e acte sous le titre de la Queste de Dieu et qui résume en quelques traits vigoureux l’ascension passionnée d’Auférus vers la Vérité, et d’autre part la scène où, dans le cachot, Auférus, résistant aux séductions de la Dame de Volupté, lui communique sa foi. L’illumination soudaine de la future chrétienne est rendue dans une page maîtresse qui est un merveilleux trait de génie.
Voilà « une œuvre », et qu’on voudrait revoir à la scène.
Après cela, et après tout ce qu’il avait jusque-là composé, on put s’étonner que Vincent d’Indy fît représenter sur un théâtre d’amateurs, la Petite Scène (1927), une « comédie musicale », en réalité une véritable opérette, le Rêve de Cinyras, sur un poème de Xavier de Courville, et qu’il ait réussi à y apporter tant de légèreté, d’esprit, de souplesse et de gaîté. On ne pouvait mieux faire.
Jusqu’à la dernière heure, Vincent d’Indy non seulement demeura robuste et ardent, mais il conserva la fraîcheur et la vivacité d’imagination de la jeunesse.
Il s’éteignit dans sa 81e année sans avoir cessé de produire (2 décembre 1931).
Des trois amis, qui furent trois grands maîtres, et qui disparurent tous trois après 1918, Gabriel Fauré, Vincent d’Indy et PAUL DUKAS, le troisième est celui dont nous avons le moins à dire, d’abord parce que c’était un homme secret et qui ne se laissait pas facilement pénétrer. Même avec l’aide de son grand admirateur et fervent biographe, Gustave Samazeuilh, nous ne savons pas grand’chose de sa vie.
Nous pourrions faire l’histoire de ses travaux et de ses œuvres. Mais ils ne sont point nombreux. Paul Dukas a fort peu produit. Il ne se croyait jamais suffisamment préparé à ses tâches par ses études et ses réflexions antérieures. Il passait de longues périodes de sa vie dans un silence d’ailleurs fécond et un fructueux recueillement. Mais le fruit en était long à mûrir. L’œuvre restait longtemps sur le métier. Extraordinairement soucieux de perfection, Dukas ne se jugeait jamais satisfait de lui-même et de ce qu’il avait produit. Le compte est vite fait de ce qu’il consentit à faire connaître au public : l’Ouverture pour le roi Lear (1888), la Symphonie en ut majeur (1896), l’Apprenti sorcier (1897), d’après la ballade de Gœthe, qui par son étourdissant succès, le fit connaître dans le monde entier, la Sonate de piano (1900), les Variations, également pour piano, sur un thème de Rameau (1903), une des plus hautes manifestations de la pensée du compositeur, où se révèle le plus évidemment la parenté de son art avec celui de Beethoven, du Beethoven des dernières sonates et des derniers quatuors : même solidité et même hardiesse dans l’architecture, même sereine poésie du détachement et de la résignation, – de la tendresse aussi, de la tendresse très pure, exempte de sensualité, – sombres angoisses parfois suivies d’allégresse éclatante. Mais ne nous arrêterons-nous pas quelques instants à ce chef-d’œuvre, Ariane et Barbe-Bleue (Opéra-comique, 10 mai 1907) qui, passé au répertoire de l’Opéra, demeure un des ouvrages les plus marquants de notre théâtre musical ?
Barbe-Bleue n’a pas fait périr ses femmes successives, comme on le croit. Il les a enfermées dans un souterrain sans lumière et sans liberté. Et il a épousé Ariane, qui arrive dans le château tristement fameux pleine de curiosité, comme celles qui l’y ont précédée. Elle veut savoir le secret du maître. Elle aussi, elle ouvrira la porte défendue avec la petite clef d’or tentatrice. Mais c’est dans une intention différente : « D’abord, dit-elle, il faut désobéir. C’est le premier devoir quand l’ordre est menaçant et qu’il ne s’explique pas. » Elle ne juge pas commettre une faute et ne redoute point les conséquences de son audace. Elle ne craint pas Barbe-Bleue. Elle le brave. Les paysans du voisinage le lui livrent garrotté, le livrent à la vengeance de ses victimes. Mais Ariane défait les liens de Barbe-Bleue et demeure à sa merci, sûre de sa beauté et du triomphant effet de sa calme volonté. Barbe-Bleue reste interdit. Ariane alors prononce ce simple mot : « Adieu ! » et dépose un baiser sur le front de celui qu’elle va quitter pour toujours. Barbe-Bleue fait un mouvement pour la retenir. C’est en vain. Suivie de sa nourrice, Ariane se dirige vers de nouveaux destins, tandis que les autres femmes, délivrées par Ariane, qui leur a montré la beauté de la vie libre dans la lumière, entourent le maître blessé qu’elles ne veulent point abandonner, non plus que leur monotone servitude.
Maeterlinck offrait à Paul Dukas un beau poème, le poème de la délivrance, un poème plein de pensée, plein de sous-entendus symboliques, de fécondes réticences, à dessein un peu vague dans quelques-unes de ses indications, pour mieux laisser sa part à la méditation, – riche d’humanité dans son fond un peu obscur.
L’essentiel n’est pas dit.
À nous de le deviner.
À la musique de l’exprimer, pour nous y aider.
En 1910, Paul Dukas écrivit quelques pages pour servir de commentaire à la signification poétique et musicale du personnage d’Ariane. Il débutait ainsi : « Personne ne veut être délivré. La délivrance coûte cher parce qu’elle est l’inconnu et que l’homme (et la femme) préférera toujours un esclavage « familier » à cette incertitude redoutable qui fait tout le poids du « fardeau de la liberté ». Et puis, la vérité est qu’on ne peut délivrer personne : il vaut mieux se délivrer soi-même. Non seulement cela vaut mieux, mais il n’y a que cela de possible. » Et tout le drame d’Ariane est là : elle délivre des femmes qui ne veulent pas être délivrées. Elle s’aperçoit enfin de son erreur, elle comprend qu’elle est seule à mettre sa liberté au-dessus de son amour. Cas exceptionnel, cas unique qui rend justement impraticable l’amour, la plus étroite des servitudes. Vivre libre, idéal qui met l’homme en dehors de la société, en dehors de ses semblables, en dehors de son propre bonheur. Mais où va donc Ariane après son inutile effort ?…
Après Ariane, Paul Dukas a encore composé une très belle œuvre, la Péri, ballet créé en avril 1912 au Châtelet aux Concerts de danse de la Trouhanowa.
Mais depuis la « grande guerre » jusqu’à sa mort survenue presque subitement en 1935, on regrette qu’il n’ait plus rien donné au public, – ou si peu : une seule pièce pour piano, l’émouvante Plainte au loin du Faune, composée pour la Revue musicale, en hommage à la mémoire de Claude Debussy.
Son art est d’un savant architecte dont les procédés de construction ressemblent parfois, nous l’avons dit, à ceux du Beethoven de la dernière manière. Ajoutons que cet art est d’une richesse somptueuse. Il emplit nos oreilles de savoureuses satisfactions que n’a jamais recherchées l’auteur de la Messe en ré et de la IXe Symphonie, et c’est en quoi il en diffère bien plus qu’il ne lui ressemble par certains côtés. La sensualité (harmonique et orchestrale) est une des plus saillantes caractéristiques du tempérament de Paul Dukas. Et cette sensualité s’allie en un singulier mélange à la haute intellectualité de ses ambitions architecturales et à son penchant si curieusement méditatif.
On a reproché à Paul Dukas de manquer d’abandon, de tendresse. Reproche très exagéré et qui n’atteint pas en particulier certaines pages si touchantes des Variations sur le thème de Rameau, auxquelles nous avons déjà fait allusion.
En tout cas, Paul Dukas possède, comme aucun autre, la force, l’éclat qui va souvent jusqu’à la splendeur éblouissante.
Il excelle à exprimer la noblesse de l’effort, la beauté morale de l’audace réfléchie, de la témérité victorieuse, de l’héroïsme. Il traduit avec autant de bonheur « la beauté physique de la lumière » et, par opposition, le « mystère tragique des ombres ».
Ses dons expressifs ont d’autant plus de valeur qu’ils se révèlent dans une forme absolument parfaite.
Entre le romantisme de Vincent d’Indy et l’impressionnisme de Claude Debussy, – ses deux amis très chers, – Paul Dukas représente la tradition classique dans ce qu’elle a de plus noble, de plus fier et en même temps de plus vivant et de plus ouvert à tous les enrichissements progressifs du devenir musical.
Paul Dukas ne « s’abandonnait » pas souvent dans sa musique. Mais l’homme s’abandonnait volontiers dans l’amitié : il fut le plus sûr, le plus délicat, le plus affectueux des amis. Robert Brussel nous l’affirma, lui qui fut son ami pendant quarante années.
Cette sensibilité, elle se manifeste dans des œuvres où il faut la chercher sous une enveloppe parfois brillante, parfois sévère ; mais elle n’échappe pas à qui est vraiment sensible lui-même.
Cette sensibilité, c’est ce qui lui inspire ses plus belles pages, et lui-même était le premier à s’en rendre compte. Il le disait bien : « Il faut savoir beaucoup et faire de la musique avec ce qu’on ne sait pas. » C’est l’inconscient qui dicte les chefs-d’œuvre.
Il était extrêmement difficile pour lui-même. Il avait un sens critique impitoyable qui s’exerçait plus sévèrement sur ses propres ouvrages que sur ceux des autres. C’est ainsi qu’il fut amené à mettre de côté, à renoncer à publier, à brûler des œuvres dont il a fait entendre à ses amis des fragments que ceux-ci avaient trouvés très beaux. Une 2eSymphonie, une Sonate piano et violon, une partition pour accompagner la traduction de la Tempête de Shakespeare, un drame musical, le Nouveau Monde, un poème chorégraphique, le Sang de Méduse, un morceau d’orchestre destiné à Koussewitzky, un ballet pour l’Opéra, un poème symphonique, le Fil de la Parque, ont ainsi disparu.
Paul Dukas n’était pas seulement un grand musicien. C’était aussi un esprit très cultivé et d’une érudition extrêmement étendue. Sa bibliothèque témoignait de la variété de ses goûts. On y trouvait Dominique à côté des Balzac et des Flaubert, quelques Russes, peu d’historiens, sauf Michelet, mais des poètes en renom et des philosophes, des contes et des légendes de tous les pays. On y trouvait, Villon, Charles d’Orléans, Ronsard, du Bellay, Verlaine, Rimbaud, à côté de Gœthe et de Dante. Spinoza voisinait avec Nietzsche. On y trouvait Heine, Keats, Shelley, Rémy de Gourmont, Kipling, Conrad, Sainte-Beuve, Rabelais, Chateaubriand, Épictète, Pascal, Marc-Aurèle, Renan, Emerson, Hugo, Mallarmé, Jules Laforgue, Maeterlinck et bien d’autres.