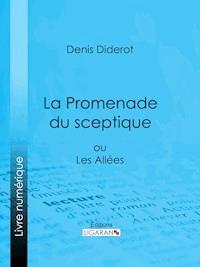
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait de la notice : "Cet ouvrage a été fait par M. Diderot pendant qu'il était à la Bastille. M. Berryer, qui était alors lieutenant de police, sur de lui que c'était à cela qu'il avait employé son loisir, et que, n'ayant ni plumes, ni encre, ni papier, il y avait suppléé par quelqu'un de ces moyens que le désespoir fait souvent imaginer aux prisonniers."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001228
©Ligaran 2015
Les prétendus connaisseurs en fait de style chercheront vainement à me déchiffrer. Je n’ai point de rang parmi les écrivains connus. Le hasard m’a mis la plume à la main ; et trop de dégoûts accompagnent la condition d’auteur, pour que dans la suite je me fasse une habitude d’écrire. Voici à quelle occasion je m’en suis avisé pour cette fois.
Appelé par mon rang et par ma naissance à la profession des armes, je l’ai suivie, malgré le goût naturel qui m’entraînait à l’étude de la philosophie et des belles-lettres. J’ai fait la campagne de 1745, et je m’en glorifie j’ai été dangereusement blessé à la journée de Fontenoi ; mais j’ai vu la guerre, j’ai vu mon roi augmenter l’ardeur de son général par sa présence, le général transmettre à l’officier son esprit, l’officier soutenir l’intrépidité du soldat, le Hollandais contenu, l’Autrichien repoussé, l’Anglais dispersé, et ma nation victorieuse.
À mon retour de Fontenoi, j’allai passer le reste de l’automne au fond d’une province, dans une campagne assez solitaire. J’étais bien résolu de n’y voir personne, ne fût-ce que pour observer plus rigoureusement le régime qui convenait à ma convalescence mais mes semblables ne sont faits ni pour vivre inconnus, ni pour être négligés : c’est la malédiction de notre état. Sitôt qu’on me sut à C…, la compagnie me vint de toute part. Ce fut une persécution, et je ne pus jamais être seul.
Il n’y eut que vous, mon cher Cléobule, mon digne et respectable ami, qui ne parûtes point. Je reçus, je crois, toute la terre, excepté le seul homme qu’il me fallait. Je n’ai garde de vous en faire un reproche : était-il naturel que vous abandonnassiez les amusements de votre chère solitude, pour venir sécher d’ennui parmi la foule d’oisifs dont j’étais obsédé ?
Cléobule a vu le monde et s’en est dégoûté ; il s’est réfugié de bonne heure dans une petite terre qui lui reste des débris d’une fortune assez considérable ; c’est là qu’il est sage et qu’il vit heureux. « Je touche à la cinquantaine, me disait-il un jour ; les passions ne me demandent plus rien, et je suis riche avec la centième partie d’un revenu qui me suffisait à peine à l’âge de vingt-cinq ans. »
Si quelque jour un heureux hasard vous conduit dans le désert de Cléobule, vous y verrez un homme d’un abord sérieux, mais poli ; il ne se répandra point en longs compliments, mais comptez sur la sincérité de ceux qu’il vous fera. Sa conversation est enjouée sans être frivole ; il parle volontiers de la vertu ; mais du ton dont il en parle, on sent qu’il est bien avec elle. Son caractère est celui même de la divinité, car il fait le bien, il dit la vérité, il aime les bons et il se suffit à lui-même.
On arrive dans sa retraite par une avenue de vieux arbres qui n’ont jamais éprouvé les soins ni le ciseau du jardinier. Sa maison est construite avec plus de goût que de magnificence. Les appartements en sont moins spacieux que commodes ; son ameublement est simple, mais propre. Il a des livres en petit nombre. Un vestibule, orné des bustes de Socrate, de Platon, d’Atticus, de Cicéron, conduit dans un enclos qui n’est ni bois, ni prairie, ni jardin ; c’est un assemblage de tout cela. Il a préféré un désordre toujours nouveau à la symétrie qu’on sait en un moment ; il a voulu que la nature se montrât partout dans son parc ; et, en effet, l’art ne s’y aperçoit que quand il est un jeu de la nature. Si quelque chose semble y avoir été pratiqué par la main des hommes ; c’est une sorte d’étoile où concourent quelques allées qui resserrent entre elles un parterre moins étendu qu’irrégulier.
C’est là que j’ai joui cent fois de l’entretien délicieux de Cléobule et du petit nombre d’amis qu’il y rassemble ; car il en a, et ne craint pas de les perdre. Voici par quel secret il sait les conserver il n’a jamais exigé d’aucun qu’il conformât ses sentiments aux siens, et il ne les gêne non plus sur leurs goûts que sur leurs opinions : c’est là que j’ai vu le pyrrhonien embrasser le sceptique, le sceptique se réjouir des succès de l’athée, l’athée ouvrir sa bourse au déiste, le déiste faire des offres de service au spinosiste ; en un mot toutes les sectes de philosophes rapprochées et unies par les liens de l’amitié. C’est là que résident la concorde, l’amour de la vérité, la vérité, la franchise et la paix ; et c’est là que jamais ni scrupuleux, ni superstitieux, ni dévot, ni docteur, ni prêtre, ni moine n’a mis le pied.
Ravi de la naïveté des discours de Cléobule, et d’un certain ordre que j’y voyais régner, je me plus à l’étudier, et je remarquai bientôt que les matières qu’il entamait étaient presque toujours analogues aux objets qu’il avait sous les yeux.
Dans une espèce de labyrinthe, formé d’une haute charmille coupée de sapins élevés et touffus, il ne manquait jamais de m’entretenir des erreurs de l’esprit humain, de l’incertitude de nos connaissances, de la frivolité des systèmes de la physique et de la vanité des spéculations sublimes de la métaphysique.
Assis au bord d’une fontaine, s’il arrivait qu’une feuille détachée d’un arbre voisin, et portée par le zéphyr sur la surface de l’eau, en agitât le cristal et en troublât la limpidité, il me parlait de l’inconstance de nos affections, de la fragilité de nos vertus, de la force des passions, des agitations de notre âme, de l’importance et de la difficulté de s’envisager sans prévention, et de se bien connaître.
Transportés sur le sommet d’une colline qui dominait les champs et les campagnes d’alentour, il m’inspirait le mépris pour tout ce qui élève l’homme sans le rendre meilleur ; il me montrait mille fois plus d’espace au-dessus de ma tête que je n’en avais sous mes pieds, et il m’humiliait par le rapport évanouissant du point que j’occupais à l’étendue prodigieuse qui s’offrait à ma vue.
Redescendus dans le fond d’une vallée, il considérait les misères attachées à la condition des hommes, et m’exhortait à les attendre sans inquiétude et à les supporter sans faiblesse.
Une fleur lui rappelait ici une pensée légère ou un sentiment délicat. Là c’était au pied d’un vieux chêne, ou dans le fond d’une grotte, qu’il retrouvait un raisonnement nerveux et solide, une idée forte, quelque réflexion profonde.
Je compris que Cléobule s’était fait une sorte de philosophie locale ; que toute sa campagne était animée et parlante pour lui ; que chaque objet lui fournissait des pensées d’un genre particulier, et que les ouvrages de la nature étaient à ses yeux un livre allégorique où il lisait mille vérités qui échappaient au reste des hommes.
Pour m’assurer davantage de ma découverte, je le conduisis un jour à l’étoile dont j’ai parlé. Je me souvenais qu’en cet endroit il m’avait touché quelque chose des routes diverses par lesquelles les hommes s’avancent vers leur dernier terme, et j’essayai s’il ne reviendrait pas dans ce lieu à la même matière. Que je fus satisfait de mon expérience ! Combien de vérités importantes et neuves n’entendis-je pas ! En moins de deux heures que nous passâmes à nous promener de l’allée des épines dans celle des marronniers, et de l’allée des marronniers dans son parterre, il épuisa l’extravagance des religions, l’incertitude des systèmes de la philosophie et la vanité des plaisirs du monde. Je me séparai de lui, pénétré de la justesse de ses notions, de la netteté de son jugement et de l’étendue de ses connaissances ; et, de retour chez moi, je n’eus rien de plus pressé que de rédiger son discours, ce qui me fut d’autant plus facile que, pour se mettre à ma portée, Cléobule avait affecté d’emprunter des termes et des comparaisons de mon art.
Je ne doute point qu’en passant par ma plume, les choses n’aient beaucoup perdu de l’énergie et de la vivacité qu’elles avaient dans sa bouche ; mais j’aurai du moins conservé les principaux traits de son discours. C’est ce discours que je donne aujourd’hui sous le titre de la Promenade du Sceptique, ou de l’Entretien sur la Religion, la Philosophie et le Monde.
J’en avais déjà communiqué quelques copies ; elles se sont multipliées, et j’ai vu l’ouvrage si monstrueusement défiguré dans quelques-unes, que craignant que Cléobule, instruit de mon indiscrétion, ne m’en sût mauvais gré, j’allai le prévenir, solliciter ma grâce, et même obtenir la permission de publier ses pensées. Je tremblai en lui annonçant le sujet de ma visite ; je me rappelai l’inscription qu’il a fait placer à l’entrée de son vestibule ; c’est un beatus qui moriens fefellit en marbre noir, et je désespérai du succès de ma négociation ; mais il me rassura, me prit par la main, me conduisit sous ses marronniers, et m’adressa le discours suivant :
« Je ne vous blâme point de travailler à éclairer les hommes ; c’est le service le plus important qu’on puisse se proposer de leur rendre, mais c’est aussi celui qu’on ne leur rendra jamais. Présenter la vérité à de certaines gens, c’est, disait ingénieusement un de nos amis, un jour que je m’entretenais avec lui sous ces ombrages, introduire un rayon de lumière dans un nid de hiboux ; il ne sert qu’à blesser leurs yeux et à exciter leurs cris. Si les hommes n’étaient ignorants que pour n’avoir rien appris, peut-être les instruirait-on ; mais leur aveuglement est systématique. Ariste, vous n’avez pas seulement affaire à des gens qui ne savent rien, mais à des gens qui ne veulent rien savoir. On peut détromper celui dont l’erreur est involontaire ; mais par quel endroit attaquer celui qui est en garde contre le sens commun ? Ne vous attendez donc pas que votre ouvrage serve beaucoup aux autres ; mais craignez qu’il ne vous nuise infiniment à vous-même. La religion et le gouvernement sont des sujets sacrés auxquels il n’est pas permis de toucher. Ceux qui tiennent le timon de l’Église et de l’État seraient fort embarrassés s’ils avaient à nous rendre une bonne raison du silence qu’ils nous imposent ; mais le plus sûr est d’obéir et de se taire, à moins qu’on n’ait trouvé dans les airs quelque point fixe hors de la portée de leurs traits, d’où l’on puisse leur annoncer la vérité.
– Je conçois, lui répondis-je, toute la sagesse de vos conseils ; mais sans m’engager à les suivre, oserais-je vous demander pourquoi la religion et le gouvernement sont des sujets d’écrire qui nous sont interdits ? Si la vérité et la justice ne peuvent que gagner à mon examen, il est ridicule de me défendre d’examiner. En m’expliquant librement sur la religion, lui donnerai-je une atteinte plus forte que celle qu’elle reçoit de la défense qu’on me fait de m’expliquer ? Si le célèbre Cochin, après avoir établi les moyens de sa cause, s’était avisé de conclure à ce que la réplique fût interdite à sa partie, quelle étrange idée n’eût-il pas donnée de son droit ! Que l’esprit d’intolérance anime les Mahométans ; qu’ils maintiennent leur religion par le fer et par le feu, ils sont conséquents ; mais que des gens qui se disent imitateurs d’un maître qui apporta dans le monde une loi d’amour, de bienveillance et de paix, la protègent a main armée, c’est ce qui n’est pas supportable. Ont-ils donc oublié l’aigreur avec laquelle il réprimanda ces disciples impétueux qui le sollicitaient d’appeler le feu du ciel sur des villes qu’ils n’avaient point eu le talent de persuader ? En un mot, les raisonnements de l’esprit fort sont-ils solides, on a tort de les combattre ; sont-ils mauvais, on a tort de les redouter.
– On pourrait vous répondre, reprit Cléobule, qu’il y a des préjugés dans lesquels il est important d’entretenir le peuple.
– Et quels ? lui repartis-je vivement. Quand un homme admet une fois l’existence d’un Dieu, la réalité du bien et du mal moral, l’immortalité de l’âme, les récompenses et les châtiments à venir, qu’a-t-il besoin de préjugés ? Lorsqu’il sera profondément initié dans les mystères de la transsubstantiation, de la consubstantiation, de la Trinité, de l’union hypostatique, de la prédestination, de l’incarnation, et le reste, en sera-t-il meilleur citoyen ? Quand il saurait cent fois mieux que le sorboniste le plus habile, si les trois personnes divines sont trois substances distinctes et différentes ; si le Fils et le Saint-Esprit sont tout-puissants, ou s’ils sont subordonnés à Dieu le Père ; si l’union des trois personnes consiste dans la connaissance intime et mutuelle qu’elles ont de leurs pensées et de leurs desseins ; s’il n’y a point de personnes en Dieu ; si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont rois attributs de la Divinité, sa bonté, sa sagesse et sa puissance ; si ce sont rois actes de sa volonté, la création, la rédemption et la grâce ; si ce sont deux actes ou deux attributs du Père, la connaissance de lui-même, par laquelle le Fils est engendré, et son amour pour le Fils, d’où procède le Saint-Esprit ; si ce sont rois relations d’une même substance, considérée comme incréée, engendrée et produite ; ou, si ce ne sont que rois dénominations, en serait-il plus honnête homme ? Non, mon cher Cléobule, il concevrait toute la vertu secrète de la personnalité, de la consubstantialité, de l’homoousios et de l’hypostase, qu’il pourrait n’être qu’un fripon. Le Christ a dit : aimez Dieu de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même : voilà, la loi et les prophètes. Il avait trop de jugement et d’équité pour attacher la vertu et le Salut des hommes à des mots vides de sens. Cléobule, ce ne sont point les grandes vérités qui ont inondé la terre de sang. Les hommes ne se sont guères entretués que pour des choses qu’ils n’entendaient point. Parcourez l’histoire ecclésiastique, et vous serez convaincu que si la religion chrétienne eût conservé son ancienne simplicité ; que si l’on n’eût exigé des hommes que la connaissance de Dieu et l’amour du prochain ; que si l’on n’eût point embarrassé le christianisme d’une infinité de superstitions qui l’ont rendu dans les siècles à venir indigne d’un Dieu aux yeux des gens sensés ; en un mot, que si l’on n’eût prêché aux hommes qu’un culte dont ils eussent trouvé les premiers fondements dans leur âme, ils ne l’auraient jamais rejeté, et ne se seraient point querellés après l’avoir admis. L’intérêt a engendré les prêtres, les prêtres ont engendré les préjugés, les préjugés ont engendré les guerres, et les guerres dureront tant qu’il y aura des préjugés, les préjugés tant qu’il y aura des prêtres, et les prêtres tant qu’il y aura de l’intérêt à l’être.
– Aussi, continua Cléobule, il me semble que je suis au temps de Paul, dans Éphèse, et que j’entends de toute part les prêtres répéter les clameurs qui s’élevèrent jadis contre lui. « Si cet homme a raison, s’écrieront ces marchands de reliques, « c’est fait de notre trafic, nous n’avons qu’à fermer nos ateliers « et mourir de faim. » Ariste, si vous m’en croyez, vous préviendrez cet éclat, vous renfermerez votre manuscrit, et ne le communiquerez qu’à nos amis. Si vous êtes flatté du mérite de savoir écrire et penser, c’est un éloge qu’ils seront forcés de vous accorder. Mais si, jaloux d’une réputation plus étendue, l’estime et la louange sincère d’une petite société de philosophes ne vous suffisent pas, donnez un ouvrage que vous puissiez avouer. Occupez-vous d’un autre sujet, vous en trouverez mille pour un qui prêteront, et même davantage, à la légèreté de votre plume.
– Quant à moi, Cléobule, lui répondis-je, j’ai beau considérer les objets qui m’environnent, je n’en aperçois que deux qui méritent mon attention, et ce sont précisément les seuls dont vous me défendez de parler. Imposez-moi silence sur la religion et le gouvernement, et je n’aurai plus rien à dire. En effet, que m’importe que l’académicien *** ait fait un insipide roman ; que le père *** ait prononcé en chaire un discours académique ; que le chevalier de *** nous inonde de misérables brochures ; que la duchesse *** mendie les faveurs de ses pages ; que le fils du duc *** soit à son père ou à un autre ; que D *** compose ou fasse composer ses ouvrages ? tous ces ridicules sont sans conséquence. Ces sottises ne touchent ni à votre bonheur ni au mien. La mauvaise histoire de *** serait par impossible quatre fois plus mauvaise encore, que l’État n’en serait ni mieux ni plus mal réglé. Ah ! mon cher Cléobule, cherchez-nous, s’il vous plaît, des sujets plus intéressants, ou souffrez que nous nous reposions.
– Je consens, reprit Cléobule, que vous vous reposiez tant qu’il vous plaira. N’écrivez jamais s’il faut que vous vous perdiez par un écrit ; mais si c’est une nécessité que vous trompiez votre loisir aux dépens du public, que n’imitez-vous le nouvel auteur qui s’est exercé sur les préjugés ?
– Je vous entends, Cléobule ; vous me conseillez, lui dis-je, de traiter les préjugés du public de manière à faire dire que je les ai tous. Y pensez-vous ? et quel exemple me proposez-vous là ?





























