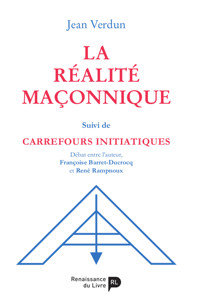
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La Réalité maçonnique :Ce livre-culte pour de nombreuses loges françaises et belges est devenu un classique de la littérature maçonnique. Il fit sensation à sa parution en 1982. Jamais jusqu’alors, un franc-maçon expérimenté à grandes responsabilités dans son obédience n’avait encore révélé à ce point son vécu maçonnique. Aux légendes, approximations et falsifications diverses, Jean Verdun oppose la réalité dont il est un témoin privilégié.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ecrivain rigoureux, romancier et dramaturge, Jean Verdun a été Grand Maître de la Grande Loge de France. Il est membre d’honneur de la Grande Loge de Belgique et travaille à présent dans un atelier du Grand Orient de France.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La
réalité
maçonnique
Suivi de
Carrefours initiatiques
Débat entre l’auteur,
Françoise Barret-Ducrocq et René Rampnoux
Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
La réalité maçonnique
Jean Verdun
Mise en pages : CW Design
Imprimerie : V.D. (Temse, Belgique)
978-2507-05555-4
© Renaissance du Livre, 2017
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Jean Verdun
La réalité maçonnique
Du même auteur
Romans
Les jeunes loups, Julliard
L’École de Paris, Julliard
Retournons rue Montorgueil, Julliard
Brumaire, Julliard
La Soirée chez Ramon, Julliard,
Mille matins d’été, Robert Laffont
L’Amour de loin, Robert Laffont
Le Carnaval du Père-Lachaise, Flammarion
Chroniques de l’Abbaye, Le Rocher
La Franc-Maçonne du Luberon, Éditions retrouvées
Récits autobiographiques
Aux éditions Aubéron
L’Enfant nu
Sainte-Victoire, Magique Montagne (photographies de Laurencine Lot)
Théâtre
Aux éditions Detrad
L’Architecte
Retour au bercail
L’Empereur de rien
Tibi ou Mieux que nos pères
Royal au-delà
La Jeune fille honteuse
À l’Abbaye
Bébé-Fleur
Grand jour d’espoir au cap Misène
Les Merveilles
Aux éditions des Quatre Vents
L’Alibi d’amour
Œuvres maçonniques
Carnets d’un Grand Maître, Le Rocher
Le Franc-Maçon récalcitrant, Le Rocher
La Nouvelle Réalité maçonnique, Albin Michel
Lumière sur la Franc-Maçonnerie universelle, Detrad
Rhapsodie en bleu, Dervy
À pied
J’ai toujours aimé me rendre à pied rue Puteaux. Pendant des années, je n’y suis même jamais allé autrement. Après la tenue, un de mes frères me raccompagne chez moi en voiture. Du temps que j’étais apprenti, ce fut souvent Pierre. Ancien Vénérable de la Nouvelle Jérusalem, il connaissait bien l’atelier. C’est par lui que j’ai commencé d’approcher la réalité maçonnique. Pierre bavardait volontiers. Je le bombardais de questions. Il m’enseigna qu’à certaines un maître ne répond pas.
Quand Pierre quitta mon quartier pour aller habiter en banlieue, d’autres chauffeurs se proposèrent et je suis rentré des dizaines et des dizaines de fois avec Gérard, Guy, Gabriel, Jef, Jacques, Henri ou celui de nos nouveaux apprentis qui, surmontant sa timidité, s’offrait et s’offre encore – heureusement – pour me ramener chez moi. En chemin, il m’interroge comme je questionnais Pierre. Devenu maître à mon tour, je ne satisfais pas toutes ses curiosités.
Plus tard, bien plus tard, mes fonctions à la direction de la Grande Loge de France m’obligèrent à passer chaque jour ou presque rue Puteaux. Plus moyen de trouver le temps de m’y rendre à pied. Métro, voiture, taxi, tout était bon pour bondir de mon bureau professionnel à mon bureau maçonnique avant le départ des secrétaires. Mais alors, chaque fois que j’ai pu éviter de m’encombrer de ma voiture, j’ai pris plaisir à faire à pied le trajet de la rue Puteaux à mon domicile. C’était comme une compensation. Bien souvent, le chef des services administratifs, dont j’avais prolongé la journée de travail aussi tard que la mienne, insistait pour me raccompagner. Je refusais, tenant, même fatigué, à ce petit quart d’heure de marche solitaire dans les rues animées des environs de la place de Clichy.
Combien de milliers de fois ai-je ainsi parcouru ce trajet dans un sens ou dans l’autre ? Ces trottoirs, avec leurs restaurants, leurs cinémas, leurs boîtes de nuit, leurs cabarets, leurs filles, constituent pour moi les parvis du temple, propylées qu’il faut gravir pour accéder à la Grande Loge et qu’il faut redescendre quelques heures plus tard. J’aime que ce soit lentement : pour ménager un intervalle entre le monde profane et le monde maçonnique. Je prends ainsi, pendant la marche, un temps de réflexion et de décompression. J’en ai tiré autant de profit que des tenues elles-mêmes. J’ai peut-être aussi voulu, surtout dans les premières années, m’offrir de cette manière la douceur de me laisser raccompagner par l’un ou par l’autre. Bien m’en a pris. Les liens fraternels se tissent dans le temple, mais on les nourrit sur les parvis et la petite place où j’habite se prête agréablement aux conversations du soir entre deux frères, qui ont participé à la même tenue, pratiqué le même rituel et qui, dans l’excitation de l’après, prolongent la soirée plus tard qu’ils ne le devraient, afin d’échanger, comme des étudiants insomniaques, impressions maçonniques, espoirs, déceptions, idées, projets ou confidences.
Les dix marronniers de ma petite place en connaissent long sur la Franc-Maçonnerie. Je me demande même quel livre en a jamais révélé autant qu’ils en ont entendu, depuis le programme d’action d’un Grand Maître à la veille de son élection jusqu’aux propos découragés ou trop ardents des compagnons que je réunissais chez moi, du temps que j’étais Premier Surveillant de ma loge. Au début de mon vénéralat, je donnais la préférence à Gérard quand il se proposait pour me raccompagner. Secrétaire de la loge, il me tenait informé des rumeurs et de l’opinion des frères sur ma conduite de l’atelier. Nous réglions aussi, dans sa voiture arrêtée sous les marronniers, nos affaires administratives. Je signais de confiance à la lueur du tableau de bord les formulaires qu’il me présentait et je lui dictais l’ordre du jour de la prochaine tenue.
Oui, vraiment, ces marronniers, s’ils ont un peu d’oreille et un peu de mémoire, devraient avoir réuni la matière d’un bon livre sur la Franc-Maçonnerie. Précisément le livre qui nous manque. Mes fraternels chauffeurs m’ont si souvent demandé de guider leur choix dans la trop abondante bibliothèque maçonnique et je fus si souvent embarrassé pour leur répondre. Aucun ouvrage ne me satisfait pleinement. Aucun ne fait autorité. Il est vrai qu’il ne saurait s’imaginer une apologétique maçonnique. Il est vrai que nul auteur ne saurait se croire autorisé à parler au nom de la Franc-Maçonnerie en général ou de la Grande Loge en particulier. Quelle que soit son érudition. Quels que soient ses titres et dignités.
Au maçon libre dans la loge libre s’imposent seulement les Landmarks transmis oralement par la tradition, les anciennes constitutions et singulièrement celles qui ont été rédigées par le pasteur Anderson au début du xviiie siècle. Ajoutons-y les textes constitutionnels de chaque obédience et les règlements particuliers de chaque loge. C’est tout. Comme ces divers textes, à l’exception des règlements particuliers des loges, sont d’un accès facile à qui veut se documenter, il eût sans doute été préférable que personne n’écrivît jamais rien sur la Franc-Maçonnerie. Les bibliothèques ressembleraient alors à tous ces ouvrages d’histoire qui n’y font aucune allusion, même sur des sujets où de toute évidence nos loges se sont trouvées au cœur de l’événement ou du mouvement des idées. Mais il n’en va pas ainsi. Bien au contraire, il pleut, et tout maçon comprendra ce que je veux dire, de la pseudo-littérature maçonnique partout.
Je suis sûr que, s’ils savaient écrire, mes marronniers pourraient mieux faire. Ils n’ont entendu que du vrai. Ils ne peuvent avoir l’outrecuidance de détenir la vérité, toute la vérité, sur une confraternité de caractère universel où tant d’hommes si divers ont été pris en plusieurs siècles par des courants parfois si opposés.
« Mais toi, Jean, pourquoi ne l’écrirais-tu pas, ce livre ? » m’ont demandé certains, et non des moindres ou des moins avertis.
Tenter ce que nul n’a jamais réussi ? J’y ai rêvé au cours des années, laissant se gonfler un manuscrit secret d’où, périodiquement, je détachais des morceaux pour les publier dans des revues ou en tirer la matière de conférences. Un livre qui pourrait tomber sans rien trahir dans n’importe quelles mains. Un livre que n’encombreraient pas les stériles querelles d’obédiences et n’obscurcirait pas cette science des ânes que devient notre symbolisme sous certaines plumes pédantes ou maladroites. Un livre de l’expérience quotidienne, celui que nous réclament les candidats à l’initiation, les apprentis, les compagnons, les nouveaux maîtres. Un livre personnel, à lire avec toutes les précautions d’usage, ouvrage d’écrivain plutôt que de franc-maçon en mission d’information. Un livre en discontinu, comme va la vie initiatique, jamais rectiligne, toujours improbable, faite d’allers et de retours, de redites et, par le jeu des divers degrés, de nouveaux éclairages. Le contraire d’un livre de professeur, qui viserait à enseigner par la méthode exotérique, ou d’historien, qui devrait prouver. Non pas non plus un simple témoignage. Le franc-maçon témoigne par ses actes et non par ses écrits sur la Franc-Maçonnerie. Mon engagement ne m’autorise d’ailleurs pas la froideur du témoin. Un livre qui, pourtant, sentirait le moins possible la chapelle, rien n’étant plus opposé à la volonté d’universalisme des francs-maçons que l’esprit de chapelle. Un livre, surtout, dont je m’honorerais qu’il ne soit pas classé sur le mauvais rayon des ouvrages de vulgarisation, si malencontreusement commis par tant d’amoureux transis des mystères, ces éternels hérétiques de toutes les religions, philosophes de pacotille, défroqués impénitents de la kabbale, du zen, de l’alchimie ou du tantrisme, dont je mentirais si j’affirmais qu’il ne s’en trouve jamais en loge, mais où ils n’ont jamais fait la loi.
La réalité maçonnique, telle que je l’ai vécue, ne ressemble à rien de tout ça, même si notre symbolisme a puisé aux multiples sources des grandes traditions ésotériques. La réalité maçonnique se tient avec beaucoup plus de subtilité entre deux eaux : celle de la lente coulée des traditions de la connaissance et celle, tellement plus tourbillonnante, du projet social à court et à long terme, car le projet maçonnique a toujours voulu accompagner l’accomplissement spirituel des hommes de leur épanouissement physique, social et matériel.
Aussi, le livre dont je demande l’inspiration à mes marronniers se devrait-il d’être sans prétention dans le flot des livres de théoriciens qui submergent les librairies sur tous les sujets imaginables. La réalité maçonnique émousse les prétentions. Mais je ne saurais me refuser, cela va de soi, la liberté de l’écrire comme je l’entends et d’y exprimer l’homme que je suis devenu, avec l’espoir que ce livre sera lu comme on écoute en loge, dans le respect de l’orateur, s’il parle avec sincérité, en son nom et seulement en son nom.
Je sais, pourtant, qu’on ne passe pas sans risque de se perdre d’une tradition très ancienne et orale aux rugosités de la phrase écrite, à la boxe des mots. Quel art ne faudrait-il pas, en effet, pour rendre ce qui se passe d’intime, d’indicible dans la loge, une fois les travaux ouverts dans la forme accoutumée ? Je le sens bien, moi qui, pour m’éviter un plongeon trop brutal d’un univers dans l’autre, me suis si constamment rendu à pied rue Puteaux.
Aussi l’erreur serait assurément de se précipiter au galop sur le chemin de l’initiation maçonnique pour le parcourir bride abattue afin de s’en faire une idée, comme on croit devoir aujourd’hui se faire une idée approximative de tout. Je me souviens d’un de ces impatients qui, un soir, après une tenue, m’avaitraccompagné chez moi. Je le voyais amer et je le devinais blessé par quelque mésaventure familiale, conjugale ou professionnelle. « Ce qu’on peut être seul dans la vie », me dit-il dès que je fus assis auprès de lui dans sa voiture. Je l’invitai à se débonder. Il fut agressif, cherchant à me provoquer. Depuis trois ans qu’il était en loge, il n’y avaitrien trouvé de ce qu’il avait espéré. Déçu par le Vénérable, déçu par l’atelier, déçu par la Franc-Maçonnerie tout entière, il enrageait dans une solitude exaspérée, s’en prenant à moi comme si je portais la responsabilité des faiblesses trop humaines qu’il dénonçait d’une voix éraillée par la colère.
Il pleuvait. Les marronniers de ma petite place, effeuillés par l’hiver, mal éclairés, dressaient au-dessus de nous leurs branches nues, maigres, luisantes et glacées. Me croyait-il d’une solidité adamantine pour me parler de la sorte ? Sa colère passa en moi. Je me fâchai : « Assez, lui dis-je durement, assez de ces récriminations perpétuelles, assez de ce pitoyable besoin d’amour, d’attention, de considération, de consolation que certains d’entre vous viennent chercher en loge comme dans un hospice. Tu es entré de ton plein gré dans un ordre initiatique, dans rien de moins et rien de plus. La fraternité vient de surcroît, comme une grâce, et quand elle ne vient pas, il faut vous en prendre à vous-mêmes. »
J’ai eu grand tort de parler ainsi à un homme qui m’avait déclaré un instant plus tôt : « Ce qu’on peut être seul dans la vie. » Qui est seul ? Qui ne l’est pas ? La dureté de mes propos fait preuve que nos titres et dignités sont des représentations symboliques de la valeur bien plus que des certificats. Je ne sais pas ce que ce frère est devenu. Nous n’en avons plus entendu parler. Je suppose qu’après sa malheureuse, trop courte et donc inutile expérience en loge, il se figure avoir découvert une réalité maçonnique bien différente de la fiction qui lui avait été, croit-il, proposée lors de son initiation. Or, c’est tout le contraire. À la réalité, il a opposé sa propre fiction et il n’est pas le seul à se tromper ainsi, car c’est à pied, à petits pas, qu’il faut approcher la réalité maçonnique, afin de la découvrir peu à peu à travers le voile des symboles et les turbulences du vécu.
Nous voilà très loin, j’ai pris tout le temps de l’apprendre, de la démarche littéraire, car la littérature oppose au monde réel une fiction, c’est-à-dire une autre réalité, celle que la volonté totalisatrice du créateur a su élaborer ou suggérer. Le créateur fait coexister les contraires : le bon et le méchant, le juste et l’injuste, le faux et le vrai, le vécu et l’inventé, son rêve et la réalité des autres.
La petite littérature les fait coexister en deux volets nettement séparés et opposés.
La grande littérature les mêle dans les mêmes êtres, les mêmes événements.
Toutes deux créent le mouvement, la grande littérature mieux que la petite, mais un peu de la même façon, en contraignant lelecteur à passer d’un pôle à l’autre, en provoquant en lui une salutaire agitation. C’est pourquoi la littérature est une des grandes écoles de formation des hommes.
La méthode maçonnique, qui repose avant tout sur une pratique du symbolisme, propose aussi à sa façon des fictions totalisatrices, dont il est pardonnable à chacun de se détourner, comme d’un roman qui « trahirait » la réalité, d’une histoire trop belle pour être vraie. D’où les inévitables déceptions du cheminement initiatique. Mais ce qui demeure contradictions intrinsèques en littérature se résout en Franc-Maçonnerie dans une réalité du dépassement par l’intervention du principe ternaire, qui nous fait si communément appeler « frères trois points ». Seul, à ma connaissance, André Breton a eu, de nos jours, l’intuition d’une démarche comparable dans son approche du surréel.
Que n’ai-je su dire ces choses, pourtant si simples, à ce frère vindicatif et amer sous mes marronniers dépouillés et lugubres ? Les aurait-il admises, d’ailleurs ? Vraisemblablement pas. Crispé, il s’en tenait à la plus élémentaire opposition d’une réalité et d’une fiction, telles qu’elles affleurent en surface de la petite littérature. Il m’entraîna sur son terrain. Je me sens mieux armé aujourd’hui pour lui répondre.
Par ce livre.
Pour stupéfier Nicole
Je crois bien être devenu franc-maçon par brusquerie amoureuse, emporté que je fus un beau jour, un très beau jour, dans une inspiration subite et le désir de stupéfier Nicole.
Chenonceaux. Un tendre soleil matinal de printemps. Neuves sont les feuilles des arbres. La limpide lumière les fait briller. Après une nuit passée dans un hôtel des bords de Loire, une calme journée s’annonce, dégagée des contraintes. Nicole et moi vivons heureux. Nous avons un peu plus de trente ans. Nous nous promenons à pas lents dans les jardins et nous causons.
Je dis soudain :
– Tout bien pesé, je vais demander mon admission dans la Franc-Maçonnerie.
Nicole en reste pantoise. Elle en a les jambes coupées, me déclare-t-elle. Nous allons nous asseoir sur un banc. Son étonnement a de quoi m’enchanter. Elle ne me demande même pas si j’ai parlé sérieusement. Elle m’a cru, alors que je suis loin de me croire moi-même. Ce qui la déroute pourtant, me confie-t-elle, c’est d’avoir à imaginer rétrospectivement le chemin que j’ai pu suivre pour aboutir à cette décision sans qu’elle en ait eu la moindre intuition.
De mon côté, je suis assez surpris qu’elle entre aussi facilement dans le jeu. Hier encore, je pensais à tout autre chose qu’à la Franc-Maçonnerie. Je n’ai pas, comme elle peut le croire, préparé ou retardé mon coup. Au sens propre du terme, j’ai parlé en l’air, un peu pour voir ses réactions, un peu, et sans doute surtout, pour le plaisir de donner, après une bonne nuit, un piquant nouveau à cette matinée. Nous avons dix ans de mariage. Le minimum que je dois à ma femme est de rester imprévisible, mais tout de même pas au point d’inventer n’importe quoi. Nicole est beaucoup trop fine pour se laisser surprendre par du peu ou de l’invraisemblable. D’année en année, il faut doubler la mise.
Or, la voilà qui suit. Elle ne prend pas du tout cette idée jetée en l’air pour une lubie. Pourtant, rien ne peut nous paraître à tousdeux plus éloigné de moi que la Franc-Maçonnerie, avec son fumet mystérieux de société secrète, ses relents de vieux radicalisme, ses diableries en gants blancs et tabliers, ses cérémonies d’initiation qu’on subit corde au cou, poitrine dénudée, les yeux bandés.
Si j’ai doublé la mise, Nicole relance. Elle ne s’attendait pas, me dit-elle, à me voir m’engager sur cette voie, absolument pas, et je dois même, à l’avenir, si je ne veux pas la rendre cardiaque, ménager un peu mieux mes effets, mais pourquoi pas ?
Pris au jeu, j’entre dans le débat et j’en suis ravi. Nous aimons, elle et moi, mesurer en de telles occasions les profondeurs de l’autre. Elle comprend très vite que ma décision n’est pas arrêtée. Je comprends, de mon côté, qu’elle voit plus loin que moi dans les raisons cachées de mon inspiration apparemment subite. Voilà une belle mise à nu en perspective. N’était-ce pas ce que je voulais ?
*
En vérité, ce débat venait moins à l’improviste qu’il n’y paraissait. Nicole savait fort bien qu’il faisait suite à la tendre bataille que je menais depuis plusieurs années avec une de mes tantes.
– Mon petit Jean, me disait-elle, et me répétait-elle de plus en plus souvent, vous devriez vous faire franc-maçon.
Je répondais invariablement :
– Ma tante, je suis prêt à suivre la plupart de vos conseils, mais pas celui-là. S’il est une chose dont je suis sûr, c’est que je ne deviendrai jamais franc-maçon.
– Vous auriez tort, mon petit Jean, la Franc-Maçonnerie vous conviendrait parfaitement et vous ferait le plus grand bien.
À l’approche de la soixantaine, ma tante avait de la vie sociale une riche expérience qu’elle tirait d’une existence à plusieurs plis et mouvementée. Fragile égérie à douze ans du très vieux Georges Clemenceau, mariée une première fois à seize ans, veuve, remariée à mon oncle, ministre gaulliste de premier plan à la Libération, veuve à nouveau, très entourée d’hommes politiques et courtisée par plusieurs, ayant dû servir d’une façon ou d’une autre pour les services secrets français, elle aimait les zones d’ombre de la vie publique dont elle me paraissait, d’ailleurs, exagérer l’importance. Pour un jeune romancier, elle était une mine d’anecdotes et d’informations. Généreuse, infiniment curieuse de tout, sauf d’art et de littérature où elle n’entendait rien, sans parti pris, ouverte aux idées les plus étrangères à sa classe, elle savait susciter l’intérêt d’hommes les plus divers avec, de sa part à elle, une prédilection soit pour les personnages en vue, soit au contraire pour des êtres très simples et passionnés. Elle possédait l’art de les mettre en confiance avec un étrange mélange d’innocence et de rouerie. Au restaurant ou dans son salon, sa conversation tournait au chuchotis, même quand la conversation en tête à tête ne méritait aucune discrétion particulière. Rien ne pouvait mieux l’exciter que d’avoir à rencontrer dans la même journée, et en deux entretiens successifs, un ministre en exercice et un parlementaire de l’opposition. Certains la jugeaient sans idées parce qu’elle ne s’en tenait jamais à une seule. Aucune, sans doute, ne venait d’elle, mais je pus vérifier qu’elle en avait emprunté beaucoup de première main à ceux qui les avaient émises. Comme elle aimait contredire, elle se servait des unes contre les autres avec un opportunisme inversé. Ce qui la brouilla plusieurs fois avec des amis de longue date et finit, quand elle commença de vieillir, par la couper tout à fait de l’Élysée où le général de Gaulle et ses proches collaborateurs ne la laissèrent plus s’introduire.
Elle fut pendant des années mon journal parlé.
Pendant ces mêmes années – j’avais, moi, de vingt à trente ans –, ma tante ne manquait jamais une occasion de me révéler l’appartenance à la Franc-Maçonnerie de l’un ou l’autre de ses amis. Comme elle fréquentait surtout des hommes politiques, il s’agissait généralement de parlementaires ou du personnel des cabinets ministériels, si bien que la Franc-Maçonnerie m’apparaissait presque exclusivement comme une officine de tractations politiques. Pour me faire ces révélations, ma tante usait des mêmes chuchotis que pour ses autres confidences. Elle se contentait même parfois de disposer trois doigts sur la table du restaurant, car elle ne prononçait jamais le mot Franc-Maçonnerie dans un lieu public. Je relevais, bien sûr, la contradiction. Pourquoi me le dire, et comment le savait-elle, si cela était si secret ?
Nicole et moi nous amusions de ce théâtre d’ombres. Nous ne prenions ma tante qu’à demi au sérieux : la Résistance, le contre-espionnage, la Franc-Maçonnerie, les entretiens secrets ménagés par elle dans son salon entre des hommes publics ostensiblement opposés, tout ce tortueux dessous des cartes nous semblait relever beaucoup plus d’une marotte de ma tante que d’un envers du décor. « Elle fait du Balzac », disais-je à Nicole.
Notre première surprise, et de taille, fut le retour au pouvoir du général de Gaulle qu’elle ne cessait de prophétiser depuis cinq ans. Pour le coup, elle avait vu juste et, comme ce ne fut pas la seule de ses prévisions qui se réalisa, je me mis à attacher plus de prix à ses confidences, tout en continuant à les traiter comme de la matière brute pour mes futurs romans. Mais la rouéedevina vite que je l’écoutais désormais d’une oreille plus attentive et elle en tira la conclusion que j’avais mûri. C’est alors qu’elle me proposa de devenir franc-maçon : un pas à faire, selon elle, pour me déniaiser, pour passer de l’autre côté de la réalité des choses et me garantir contre le risque commun à tant de gens, celui de se fier aux apparences, d’avaler les informations sans y rien comprendre et de finir comme la plupart : en gobe-mouches.
– Ma tante, lui dis-je, tenez pour certain que je ne me ferai jamais franc-maçon, mais expliquez-moi un bon coup de quoi il s’agit.
Je souris aujourd’hui avec attendrissement de la lumière que ma chère tante jeta ce jour-là sur nos temples. Dois-je dire qu’elle n’avait rien compris à la Franc-Maçonnerie ? Il est des erreurs qui chatouillent les vérités essentielles, des erreurs nobles, inspirées par une intuition tâtonnante et non point par l’ignorance ou les ragots. Le souvenir de ces erreurs, une fois rétablie la vérité, me donne une impression curieuse autour des tempes : celle d’un souffle de vent qui me frôlerait de part et d’autre de la tête, car l’erreur, quand elle effleure la vérité, la dévoile et rend alors joyeusement lucide.
Ma balzacienne tante considérait la Franc-Maçonnerie comme la première école de formation des hommes et des citoyens parce qu’elle apprenait à ses adeptes, au moyen du symbolisme, l’art du double langage.
– Me souhaiteriez-vous plus hypocrite, ma tante, pour me pousser ainsi à chercher une formation dans pareille école ?
– Il ne s’agit nullement de cela, mon petit Jean, mais vous n’avez pas assez réfléchi à ce qui permet aux hommes de vivre en société : tant d’intérêts qui se contrecarrent, tant de besoins avoués et inavoués qui jettent les hommes les uns contre les autres, tant de diversité dans les intelligences, dans les moyens de chacun. On ne peut pas tenir un même et seul langage pour tout le monde à la fois, ou alors ce langage n’exprime rien de réel, rien de vrai : il ne communique pas.
Ma tante me livrait, à ce moment-là, tout le fruit de son expérience de la chose publique et son discours avait de quoi m’horrifier tant il me semblait aller à l’encontre des fondements de la démocratie.
Il y a toujours deux langages, m’assurait-elle, le langage public et le langage secret. Le langage public, en démocratie, est celui qu’on tient pour se faire élire et, une fois élu, pour gouverner ; le langage secret, celui qu’on réserve à ses proches, s’il leur est accessible, et aux rares hommes responsables qui sont capables de l’entendre. La valeur d’un homme public se mesure à la nature de l’écart entre ses deux langages. Les naïfs et les irresponsables n’en tiennent qu’un. Les médiocres et les malhonnêtes se contredisent de bout en bout. Les grands hommes publics ont deux langages parallèles, qui se rejoignent dans leurs objectifs à long terme. Le général de Gaulle est un maître du double langage.
– Serait-il franc-maçon ?
– Non pas, mais il a été formé dans les écoles chrétiennes qui, sur ce plan-là, donnent un enseignement assez semblable à celui des francs-maçons.
J’avouai à ma tante ne rien comprendre à son discours : comment les francs-maçons s’y prennent-ils donc pour égaler jésuites et frères des écoles chrétiennes dans l’art de l’hypocrisie ?
Non de l’hypocrisie, protesta-t-elle, mais du grand art qu’exige la prise des responsabilités sociales, et elle me supplia de faire effort pour ne pas me montrer plus bête que je n’étais. Les francs-maçons, m’expliqua-t-elle, ont des degrés, des grades, et à chacun de ces degrés ils apprennent à avoir un comportement différent et à tenir un certain langage.
– Quand vous avez fait ça pendant quelques années, vous imaginez bien, mon petit Jean, que vous avez appris à être à l’aise dans tous les milieux en adaptant votre langage à chacun d’eux. C’est la plus belle école d’efficacité dans les rapports sociaux.
– Au même titre que les écoles chrétiennes ?
– Mieux accordée à notre époque, moins sectaire, moins embarrassée de la question de Dieu. Ah, quel bon franc-maçon vous feriez, mon petit Jean !
– Je ne prends pas cela pour un compliment, ma tante.
Cette grosse blague du double langage devint alors un sujet de plaisanterie entre Nicole et moi. Je tenais successivement à ma femme des langages amoureux différents et l’un d’eux, très vert, ne lui ayant pas déplu, je susurrai :« Ah, quelle bonne franc-maçonne vous feriez ! »
L’ affaire, dans notre esprit à tous deux, restait jugée : la Franc-Maçonnerie enseignait, du propre aveu de sa recruteuse, l’art de la duplicité politique et méritait sa mauvaise réputation.
Mais ma tante, têtue, voulut alors me présenter à un franc-maçon mieux capable qu’elle de me révéler le fond des choses. Elle nous invita donc à dîner, Nicole et moi, avec un vieux magistrat à la retraite, converti au bouddhisme et qui partageait son temps libre entre Paris et Formose où il s’était lié à Tchang Kaï-chek. Ma tante m’avait averti que ce vieillard au visage parcheminé occupait un des sommets de la hiérarchie maçonnique et elle espérait bien que je l’interrogerais sans détour devant elle. « Il n’attend que ça », m’avait-elle dit.
N’ayant pu éviter ce contact, je m’attachai bien sottement à le rendre stérile. Tout, dans le personnage, me rebuta : son grandâge, son air de vieux sage oriental, son titre de président, ses liens avec Tchang Kaï-chek. Ma tante nous laissa seuls un moment, certainement à regret. Je ne me prêtai à aucune ouverture et, conformément à nos usages, le vieux monsieur me voulut libre au point de ne même pas risquer une allusion au motif de notre rencontre.
Ma tante, bien déçue, revint à la charge quelques mois plus tard. Cette fois, ce fut à un général qu’elle voulut me présenter, maçon lui aussi et champion toutes catégories du double langage puisqu’il n’était rien de moins que le patron du contre-espionnage français. Je le connaissais d’ailleurs déjà de vue : c’était l’homme qui, un soir de mai 1958, s’entretenait chez elle avec un futur Premier ministre, venu sans doute s’assurer discrètement de ses sentiments à l’égard de De Gaulle.
Ma conversation avec ce général, dont je n’ai jamais pris la peine de vérifier depuis s’il était vraiment franc-maçon ou si ma tante le supposait seulement tel, fut joviale, badine, sans importance. Cette fois encore, je ne me prêtai à aucune ouverture, ni pour devenir maçon ni pour devenir espion. Ma tante fut à nouveau bien déçue. Elle imputa ma réserve à la timidité. En vérité, je pensais de plus en plus que la Franc-Maçonnerie n’avaitpas usurpé sa mauvaise réputation et que ses mystères en cachaient bien d’autres auxquels je n’avais aucune envie d’être initié.
La chère femme ne lâcha pas prise pour autant. À quelques mois de là, elle me téléphone un matin pour que nous déjeunions ensemble au restaurant le jour même, car elle a une proposition urgente à me faire. J’accepte et nous avons à peine commandé les plats qu’elle m’entreprend de nouveau sur la Franc-Maçonnerie. Elle est certaine, me dit-elle, absolument certaine que je suis maçon né. Elle ne comprend pas mon entêtement à ne même pas vouloir en discuter sérieusement avec les gens qu’elle me fait rencontrer. De quoi ai-je donc peur ? S’informer n’engage à rien. Forte de cette conviction, elle a pris rendez-vous avec Richard Dupuy, le jeune Grand Maître de la Grande Loge de France, pour lui parler de moi. Elle sera reçue le lendemain. Est-ce que je l’autorise à solliciter pour moi une audience ? Richard Dupuy est un homme qu’elle trouve extrêmement séduisant. Un très bel homme. Il lui plaît beaucoup. Elle est convaincue qu’il me plaira de même.
Pour le coup, je me mis en colère :
– Non, ma tante, non, m’écriai-je, non et définitivement non. Je vous interdis le moindre mot sur moi à ce Richard Dupuy. Qu’il soit bel homme, c’est votre affaire, pas la mienne.
J’eus droit à de sévères remontrances. Ma tante me reprocha mes préjugés. Elle me déclina une liste impressionnante de noms connus pour me prouver qu’il existait des maçons de tous les bords, de toutes les tendances politiques, de tous les âges.
– Cela fait une belle salade, répondis-je.
Elle m’agaçait vraiment avec cette histoire. Je la sentais tout excitée par la perspective de ce rendez-vous avec Richard Dupuy : elle n’avait pas encore de Grand Maître dans sa collection d’hommes importants et ma défaillance l’empêcherait, le lendemain, de dire à sa nouvelle connaissance :« Je vous amène un jeune romancier très doué qui perd son temps dans la littérature. »
– Allons, ma tante, lui dis-je cruellement, vous trouverez bien d’ici à demain quelque chose de plus consistant que moi à proposer à ce si beau Grand Maître.
Ma tante n’insista plus et pendant les années qui suivirent ne me reparla plus de Franc-Maçonnerie. Je n’y repensai plus moi-même jusqu’au jour où un ami m’entretint de régulation des naissances et des nouvelles méthodes contraceptives, sujet tout à fait nouveau pour moi. Je me rappelle même avoir cherché, ce soir-là, le mot régulation dans le dictionnaire, car il n’était pas encore entré dans mon vocabulaire. Me voyant intéressé, cet ami me remit une carte d’invitation pour deux personnes à une conférence d’un certain docteur Pierre-Simon au Grand Orient de France. Nous voici donc, Nicole et moi, dans la petite rue Saulnier, cherchant l’entrée du Grand Orient. Ma tante avait toujours fait tant de mystères à propos de la Franc-Maçonnerie que nous étions assez stupéfaits d’être ainsi invités à pénétrer dans le repaire des francs-maçons, et je remis ma carte d’invitation au vieux monsieur qui gardait la porte, et dont la poitrine était barrée d’un cordon bleu, comme j’aurais tendu un billet d’entrée à un gardien de zoo.
Notre première surprise fut qu’il nous laissa passer sans plus de formalités. Une grande salle avec une estrade drapée de tricolore et dominée par un buste de Marianne. Des rangées de chaises disposées face à l’estrade. Aucun mystère. De la Franc-Maçonnerie au grand jour. Je fus un peu désappointé, car je n’aurais pas détesté que le voile fût soulevé plus lentement.
Nous étions arrivés parmi les premiers. La salle ne tarda pas à se remplir d’hommes et de femmes dont la plupart avaient de trente à quarante ans et qui, dans leur majorité, semblaient être venus par couples. Certains, mais rares, portaient un cordon bleu. Notre ami entra, nous chercha des yeux, nous aperçut et vint s’asseoir auprès de nous. Il ne portait pas de cordon et, comme je n’avais pas osé lui demander s’il était lui-même franc-maçon, je le surveillai du coin de l’œil pour tenter de le deviner à son comportement. Ce fut en vain.Nous semblions être ses seules connaissances dans cette salle. « Je n’imaginais pas du tout la Franc-Maçonnerie sous ce jour », lui dis-je. Il me répondit que ce n’était là qu’une de ses facettes.
Peu après, une dizaine de personnages gagnèrent l’estrade. Parmi eux, le docteur Pierre-Simon.
Je cherche aujourd’hui à me rappeler pourquoi le ton me parut si nouveau, si insolite. Pierre-Simon, qui fit de constants progrès d’éloquence quand il devint Grand Maître, un peu moins de dix ans plus tard, s’exprimait alors assez mal. Les mots jaillissaient, bousculant la syntaxe. La voix n’était pas bien placée. Le discours sautillait, donnant l’impression de courir après la pensée. Grand, mince, la petite moustache provocante, l’orateur forçait pourtant l’attention de son auditoire et je sentais dans la salle et en moi une grande qualité d’écoute.
En fait, l’homme qui nous parlait de cette façon un peu décousue allait puissamment contribuer à mettre au premier plan de l’actualité le sujet dont il nous entretenait : les méthodes contraceptives, leur utilité sociale et leur justification morale. Un sujet tout à fait neuf pour moi et la plupart de ses auditeurs et auditrices. Des idées absolument nouvelles. Je n’avais alors jamais entendu parler de stérilet ou de diaphragme. La pilule contraceptive me semblait relever de la science-fiction. Pierre s’exprimait en médecin, ce qui l’autorisait à employer des mots précis pour décrire les organes sexuels et les plaisirs qu’ils dispensent, mais cette liberté de langage n’aurait pas suffi à me surprendre. C’est à une autre liberté que j’ai été immédiatement sensible : celle dont j’ai appris depuis qu’elle s’acquiert dans la loge, une liberté qui permet de tout dire sans jamais élever le ton, sans chercher les effets de tribune, puisque personne dans le temple n’applaudira ni ne protestera, celle qui apprend surtout à transmettre ses convictions sans s’adresser jamais à un adversaire imaginaire ou présent qu’il s’agirait de ridiculiser ou de réduire.
Pierre-Simon mettait évidemment de la malice à violer tant de tabous, mais il les violait avec une malignité sereine. Aucun auditeur et aucune auditrice ne pouvait se sentir visé dans sa propre maladresse amoureuse. Et pourtant, l’orateur ne se privait pas d’insister sur certaines misères sexuelles qu’il déclarait très répandues. À la télévision ou à la radio, ses propos auraient fait à l’époque un scandale inimaginable. Il s’agissait là d’un discours éminemment privé, transformé en discours public selon les règles d’un art de la communication qui ne tenait ni au talent du conférencier, ni même à une qualité de la pensée qui lui fût strictement personnelle. Je me demandais :« S’agirait-il donc de la fameuse science du double langage si chère à ma tante ? » À mesure que les intentions de l’orateur se précisaient, mon esprit se mobilisait, je respirais d’une autre façon et je me disais avec une allégresse contenue mais profonde : « Enfin du neuf ! »
Je n’étais pourtant nullement émoustillé par les techniques contraceptives qui m’étaient révélées. Pour tout dire, Nicole et moi nous étions fort bien accommodés de celles qui, de tout temps, ont rendu les amants heureux ou, si l’on préfère, que les amants heureux ont, de tout temps, su maîtriser. Ce qui me touchait dans ce discours, au demeurant assez opposé à la morale dominante pour prendre à mes yeux valeur de contre-valeur, c’était, plus importante pour moi que le sujet traité, cette volonté de l’orateur d’inscrire son projet social et sa réflexion morale dans une architecture. Je ne sais quoi m’avertissait que Pierre-Simon n’était pas capable à lui seul d’avoir conçu cette architecture. En même temps, il ne donnait pas l’impression de l’avoir empruntée pour les besoins de sa cause comme on s’empare de la pensée d’autrui afin de renforcer ou de rapiécer la sienne. J’avais en face de moi un homme qui, de toute évidence, prenait un malin plaisir à s’avancer en novateur, mais qui n’avançait pas à découvert, car il emportait avec lui la construction déjà ancienne à laquelle il destinait la nouveauté qu’il prônait. D’un meilleur orateur, je me serais méfié. D’un ponte rengorgé de ses propres découvertes, je me serais amusé. Un propagandiste du plaisir sexuel ou un simple technicien du stérilet m’auraient vite agacé. Bien au contraire, Pierre-Simon nous offrait une décoction assez savoureuse de malice, de sincérité, de tabous violés, de contre-valeurs, d’aspiration à une forme nouvelle de rapports entre les êtres, avec la volonté à tout moment d’inscrire cette nouvelle forme de rapports dans une conception élargie et progressive de l’ordre universel. De plus, il n’assenait pas des vérités établies à un auditoire enthousiaste ou hostile, mais suggérait des possibilités, comme s’il entendait nous laisser libres d’en faire ce que nous voudrions sans encourir sa condamnation. Cela, aucun professeur, aucun orateur, aucun de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, avaient communiqué avec moi par la parole ou par les livres ne m’en avait donné aussi fortement l’impression.
La conférence terminée, l’auditoire fut invité à poser des questions. La plupart descendirent assez bas dans le technique et le concret : une bien surprenante soif d’informations précises. Le médecin y répondit sans parvenir toujours à replacer le débat au niveau où il l’avait ouvert. Un vieillard portant cordon évoqua, la voix stridente d’émotion, la mémoire de sa fille morte en couches après de nombreuses naissances et s’écria : « Je salue le Temple de la Liberté où nous sommes, seul lieu, dans la Franced’aujourd’hui, où l’humanité puisse reprendre espoir. » Un silence très fraternel enveloppa l’auditoire et les questions reprirent. Dans mon heureux égoïsme, je ne me doutais pas jusqu’alors que le sujet fût aussi brûlant.
Après la séance, notre ami nous invita, Nicole et moi, à prendre un verre.
– Vous connaissez personnellement ce docteur Simon ? lui demandai-je.
– Il est mon Vénérable, me répondit-il.
Et je connus dans ce petit café, proche de la rue Saulnier, ce que bien d’autres ont connu depuis avec moi : une première conversation sur la Franc-Maçonnerie avec un franc-maçon. Je demeurais très réticent. Notre ami n’avait ni l’ancienneté ni une culture maçonnique suffisante pour satisfaire ma curiosité.
– Le docteur Simon a parlé sur deux plans, lui dis-je, celui des techniques contraceptives et un autre. C’est cet autre plan qui m’intéresse. Pour le premier, il m’a ouvert les yeux et je l’en remercie, mais il ne s’agit que de l’aspect social et pratique des choses. J’en reconnais toute l’importance, mais il m’a semblé déceler une autre dimension dans son discours et c’est cette autre dimension que je porte au crédit du Grand Orient de France.
– Mais le docteur Simon n’appartient pas au Grand Orient, protesta mon ami en s’esclaffant comme si je venais de parler contre une évidence. Il est de la Grande Loge.
Et nous voilà partis sur de subtiles distinctions auxquelles je ne comprenais rien et qui, visiblement, ennuyaient Nicole. Pour mon premier petit pas vers la Franc-Maçonnerie, je butais sur cette fastidieuse question des obédiences et de leur régularité. Mieux valait aller nous coucher.
À quelques jours de là, je téléphonai à notre ami pour lui demander de me ménager un entretien avec le docteur Pierre-Simon. « Maçonnique et non gynécologique », précisai-je.
Je sortis incertain et déconcerté du déjeuner où je fus convié. Le moins que je puisse en dire est que le docteur Simon ne se mit pas en frais pour m’attirer dans la Franc-Maçonnerie et me prit même à rebrousse-poil. L’ ayant félicité pour sa conférence et la qualité du débat, il se moqua de moi : une conférence profane et un débat plus profane encore, d’où il était lui-même sorti fort déçu, me déclara-t-il. Rien à voir avec une tenue maçonnique.
– Car il existe une manière profane et une manière maçonnique de placer un stérilet ? lui demandai-je.
C’était, selon lui, l’évidence même. Dans un cas, il s’agissait de participer au progrès social par le progrès matériel, ce qui était du ressort des gens de métier, des associations de bienfaisance et des partis politiques, dans l’autre, de participer à ce même progrès sur le parvis d’un temple élevé à la gloire du Grand Architecte de l’Univers, distinction fondamentale, qui situe l’initiation maçonnique au plus haut niveau des grandes prises de conscience humaines.
Notre conversation tourna là-dessus et sur les raisons qui amenaient une fois encore, à propos de la contraception, un franc-maçon comme lui à s’opposer aux dogmes religieux tout en recherchant le dialogue avec les Églises. Mon intolérance d’alors ne me portait nullement à souhaiter ce dialogue et je déclarai me sentir a priori plus proche du Grand Orient, s’il s’était débarrassé du Grand Architecte. Pierre-Simon me répondit que ce serait bien dommage pour moi, mais qu’au demeurant les deux grandes obédiences françaises ne se faisaient pas concurrence et avaient passé un accord, qui établissait la libre circulation des membres de leurs loges respectives.
À mesure que notre conversation se prolongeait, j’y voyais de moins en moins clair et mon interlocuteur s’amusait visiblement à m’embrouiller.
– Comment expliquez-vous, demandai-je, qu’avec le type de culture qui est le mien, essentiellement littéraire, j’en conviens, je puisse être à ce point ignorant de la Franc-Maçonnerie ? Pour tout vous avouer, je ne comprends même pas ce que vous entendez par initiation. J’oscille entre une aversion pour des pratiques tribales et une curiosité de mauvais aloi. Auriez-vous un livre à me conseiller ?
Sans grande conviction, Pierre-Simon me cita plusieurs titres que je notai sur un bout de papier. J’étais assez mécontent de notre entretien. N’en déplaise à ma tante, j’avais l’impression que mon profil ne correspondait pas à celui que recherchaient les francs-maçons. Pierre-Simon m’avait raconté qu’avant de passer les épreuves d’initiation chaque postulant devait se présenter devant la loge, un bandeau noir sur les yeux, pour subir un interrogatoire. Ma tante et le contre-espionnage, Pierre-Simon et la contraception, Grand Architecte ou pas, Grande Loge ou Grand Orient, valeurs et contre-valeurs, opposition aux dogmes et dialogue avec les Églises, belle ambition de servir l’homme et chemins bien obscurs pour y parvenir, les bandeaux noirs s’accumulaient. Tout cela me paraissait très compliqué. L’ ambiguïté n’avait en elle-même rien pour me déplaire, au contraire, mais la Franc-Maçonnerie me paraissait la pousser un peu loin. Je pris congé de Pierre-Simon dans la plus totale indécision. Nous nous séparâmes sur le trottoir, devant le restaurant, sans autre conclusion qu’un vague et détaché « à votre disposition » aussi peu engageant qu’encourageant.
*
Chenonceaux. La journée s’avance. Nous avons visité le château. Nous avons déjeuné. Nous nous sommes longuement promenés en causant librement. La lumière a changé.
Une belle journée d’amour, si simple, si douce. Et pourtant, la roue folle du destin qui s’arrête. De propos en propos, nous en sommes arrivés à conclure que j’allais faire ma demande d’admission. Sans visée précise. Un coup de dés. Apparemment, nous n’avons besoin, Nicole et moi, que de nous-mêmes. J’ai jeté, le matin, une parole en l’air. Ma femme l’a prise au sérieux. À présent, moi qui refuse tous les engagements, me voilà presque résolu à prendre celui-là. Nous en ressentons une vague impression de danger, de compromission.
Nicole insiste pour que je lise quand même quelques livres afin de me documenter plus sérieusement. Je réponds que le docteur Simon semblait plein de réserve en me donnant une courte liste d’ouvrages, comme s’il jugeait sans importance que je les lise ou pas.
– Une fois entré là-dedans, peut-on en sortir aisément ? me demande Nicole.
Elle redoute que je laisse des gens sur lesquels nous avons reçu des informations si contradictoires prendre barre sur moi. Nous évoquons la formule d’André Gide : « N’entre pas sans désir. » Or, je n’ai point à proprement parler le désir de me lier vraiment à ces inconnus.
Soudain, Nicole me dit :
– C’est donc l’après que tu prépares.
Émerveillé par sa finesse, je comprends aussitôt ce qu’elle entend par là. J’ai commencé depuis un an déjà le long récit de mon adolescence qui paraîtra, déguisé en roman, sous le titre L’ Enfant nu. Nicole n’a encore lu qu’une centaine de pages du manuscrit, mais le ton ne peut la tromper. Aucune complaisance. Une apparente froideur, même pour raconter l’assassinat de mon père. J’écris L’ Enfant nu avec un bistouri.
– Après L’ Enfant nu, tu crains de ne plus te suffire, me dit-elle.
Elle voit juste. Au plus profond de moi, je prépare l’après. Je sais que, une fois ce nouveau livre publié, le petit garçon sera enterré. L’ homme adulte, qui pourra naître alors de sa dépouille, je ne l’imagine pas.
Il est temps de rentrer à Paris. Nicole prend le volant et nous choisissons les petites routes pour prolonger, par un lent retour, cette journée décisive.
– Eh bien, il faut le faire, me dit-elle.
Son grand-père maternel était franc-maçon, brave homme d’inspecteur primaire, qui a combattu toute sa vie pour l’école publique. Ce grand-père, le général de ma tante, le vieux magistrat sinologue, Pierre-Simon, l’ami qui nous avait invités à la conférence, tous ces parlementaires de gauche et de droite indiscrètement dévoilés par ma tante, les porteurs de cordon bleu dans la salle du Grand Orient, il n’est décidément pas facile d’entrevoir ce qui peut rassembler ces hommes. Ajoutons Mozart et la confusion devient complète.
Faut-il le faire ? Ne pas le faire ? Je suggère à Nicole d’arrêter la voiture pour que nous puissions encore marcher un moment le long d’un champ. Nous franchissons un petit pont, à pied, dans la direction du soleil couchant sur l’horizon des blés verts.
– J’accomplirai le premier pas, dis-je, mais je leur laisserai faire le second. Si j’ai bien compris leur manière d’agir, il faut se présenter à eux les yeux bandés. Il leur appartient donc à eux et pas à moi d’être clairvoyants.
À aucun moment, tout au cours de la journée, nous n’avions eu le sentiment que cette décision éventuelle pourrait n’avoir quepeu de conséquence. Nous dramatisions sans doute, mais, formés comme nous l’avions été tous deux par les anciens Grecs, nous pensions au destin beaucoup plus qu’à notre destinée. L’ avions-nous rencontré, ce jour, à Chenonceaux ?
Il faisait nuit quand nous avons approché de Paris. À la vue de ces millions de lumières entre lesquelles nous allions nous glisser, je demandai :
– Quelles sont celles qui éclairent, ce soir, les fenêtres des maçons de ma future loge ?
– Tu entrerais dans celle du docteur Simon ?
– Je ne sais pas. J’ignore comment cela se passe. Peut-être la sienne. Peut-être une autre. Ce sont eux qui décideront.
Il nous paraissait fort étrange et quelque peu absurde, en cet instant, d’avoir un jour, bientôt peut-être, à traiter en frères les anonymes détenteurs de ces petites lumières.
– Tu ne parles de rien à ta tante ?
– Oh, surtout pas ! Elle insisterait pour que je passe par le Grand Maître et elle ameuterait tous ses amis parlementaires. C’est du contraire que j’ai envie.
Je fus initié deux ans plus tard sans que ma tante n’en sût rien. J’attendis d’être maître pour le lui révéler, la remercier et lui demander, sans trop d’espoir, un minimum de discrétion.
La Pierre brute





























