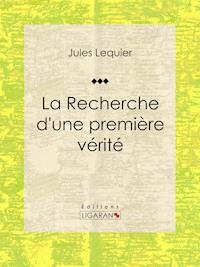
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous offrons à l'attention des personnes qui s'intéressent aux travaux les plus élevés de l'esprit quelques parties achevées et quelques fragments d'un grand ouvrage que des circonstances fatales et ensuite la mort, une mort douloureusement imprévue, ont seuls empêché l'auteur de finir et de publier pour l'honneur de son nom et l'avancement de la philosophie."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049831
©Ligaran 2015
Le présent ouvrage est la reproduction des Fragments posthumes que Renouvier a fait imprimer après la mort de Lequier, en 1865, « à un petit nombre d’exemplaires », qui ne furent « pas mis en vente », mais « distribués » seulement « à quelques personnes choisies ».
Il a paru à M. Louis Prat, interprète des dernières volontés de Renouvier, que le moment était venu que ce qui reste de l’œuvre inachevée de Lequier et qui n’est connu du public philosophique que par les morceaux détachés qui ont paru dans les Essais de critique générale et dans la Critique philosophique, fût vraiment publié pour la première fois, ou, comme dit Renouvier, fit « l’objet d’un tirage ordinaire et d’une publicité sans réserve ». Ainsi se trouve levé le demi-interdit qui pesait sur la pensée de Lequier et se trouvent rassemblés, autant qu’ils peuvent l’être, les membres dispersés du poète-philosophe, disjecti membra poetae. Nous remercions bien vivement M. Louis Prat d’avoir eu l’idée première de cette publication et de l’avoir rendue possible en nous donnant l’autorisation de reproduire le texte des manuscrits de Lequier, acquis par Renouvier à la mort de son ami, et pieusement recueillis et mis en ordre par lui.
L.D.
Lequier a inspiré les amitiés les plus ardentes et les plus dévouées : celle de Renouvier a empêché son nom de périr, sauvé la partie achevée de son œuvre et lui a assuré la gloire. Il lui est arrivé, un demi-siècle après sa mort, d’éveiller encore la sympathie du plus zélé, du plus consciencieux des érudits, lequel s’est fait son biographe, M. Prosper Hémon.
M. Hémon ignorait jusqu’au nom de Lequier, lorsqu’au cours d’une promenade aux environs de Saint-Brieuc, il rencontra à la Ville-Gaudu, près de la grève des Rosaires, en Plérin, un manoir délabré. Une vieille femme qui se trouvait là, filant sa quenouille de lin, lui dit que la maison qu’il avait sous les yeux était close, inhabitée depuis des années, qu’on ne lui connaissait pas de propriétaire actuel et qu’on doutait même qu’elle en eût un. Intrigué, M. Hémon laissa la bonne femme dévider son récit et apprit que le dernier occupant de cette villa en ruines était un homme d’une haute intelligence et d’un grand cœur, tombé dans la misère pour avoir fait un usage trop généreux d’une grande fortune, dont la raison s’était « dérangée » à la suite de chagrins d’amour vers la fin de sa vie et qui s’était noyé, d’après les uns, volontairement, mais, selon M. Moro, curé de Plérin, par accident, sur la côte d’en face, « au-dessous de la pointe saillante de Pordic, à côté des Grandes Roches Noires, derrière le rocher du Poissonnet », La vieille ajouta que cet homme était un grand savant qui avait instruit des princes et qu’on lui avait élevé une statue au cimetière de Plérin. Μ. Hémon crut à une de ces légendes qui éclosent naturellement sur les lèvres des gens simples en Bretagne. Il fut bien surpris de trouver en effet au cimetière qui entoure l’église de Plérin, une statue du sculpteur Elmerich portant cette inscription :
Ce monument a été élevé à la mémoire d’un ami malheureux et d’un homme d’un grand génie par Renouvier. JULES LEQUIER, né à Quintin en 1814, décédé à Plérin en 1862. Priez pour lui ! Ses œuvres : La Feuille de Charmille – Abel et Abel – La Recherche d’une Première Vérité – Le dialogue du Prédestiné et du Réprouvé.
M. Hémon, qui est historien et a l’âme d’un fureteur, n’eut plus désormais de repos qu’il n’eût reconstitué la vie de ce grand homme inconnu. Il fouilla les archives, le Greffe du Tribunal de Saint-Brieuc, les registres de l’état civil de Quintin, recueillit les témoignages de toutes les personnes qui avaient connu Lequier et avaient été mêlées de près ou de loin à sa vie, entra, par l’intermédiaire de Jacob, professeur de philosophie au Lycée de Saint-Brieuc, en relation avec Renouvier, lequel lui remit presque tous les manuscrits de Lequier restés en sa possession, carnets, brouillons de lettres, fragments d’ouvrages philosophiques. Il déchiffra et recopia de sa main tous ces manuscrits souvent raturés, à peine lisibles. Il mit plus de vingt ans à recueillir ainsi les documents qui devaient lui servir à écrire la vie émouvante, douloureuse et tragique de Lequier.
Nous allons résumer son œuvre encore inédite, et destinée peut-être à le rester, en la commentant et la rectifiant au besoin à l’aide des souvenirs et des notes de Renouvier, qui nous ont été obligeamment communiqués par Louis Prat.
Lequier (Joseph-Louis-Jules) est né à Quintin (Côtes-du-Nord) le 29 janvier 1814. Son père était officier de santé et chirurgien de la marine. Rentré dans la vie civile à la fin de la Révolution, il s’établit à Quintin et s’y maria ; puis, après s’être fait recevoir docteur à la Faculté de Montpellier, il vint se fixer à Saint-Brieuc. Il semble avoir été un esprit distingué ; il a pu léguer à son fils quelques-unes de ses qualités intellectuelles. Mais Lequier a subi surtout l’influence de sa mère. C’était une femme pieuse, charitable et bonne. Elle ne vivait que pour son fils. Celui-ci l’a tendrement et passionnément aimée. Il évoque son image en ces termes dans une lettre à un ami : « Vous rappelez-vous les yeux si doux et si fiers de celle dont les courtes absences autrefois, à Quintin, me causaient une telle douleur que j’allais me cacher dans le grenier pour pleurer » ?
Jules Lequier eut l’enfance choyée d’un fils de famille et d’un fils unique. D’apparence frêle et timide, avec ses longs cheveux bruns tombant sur sa collerette brodée, il allait au collège, escorté de sa bonne, qui le protégeait contre les dangers de la rue et la brutalité des camarades. Il commença ses études à dix ans au collège communal de Saint-Brieuc ; là, il forma d’ardentes amitiés avec Le Gal la Salle et les frères Épivent, dont l’aîné, de neuf ans plus âgé que lui, se destinait à l’Église et devait l’initier aux études théologiques et lui en communiquer le goût et la passion. Avant la un de ses études, il fut arraché à son milieu, envoyé à Pont-Levoy, où il fit sa seconde et sa rhétorique, puis il vint à Paris, d’abord au collège Stanislas, ensuite à l’Institution Laville, pour se préparer à l’École Polytechnique, où il entra en 1834, à l’âge de vingt ans.
Des années de collège, ce qui compte le plus, ce sont les vacances. Jules Lequier passait les siennes dans une maison de campagne que son père avait fait construire au bord de la mer, sur une hauteur plantée d’arbres, à la Ville-Gaudu, en Plérin, que, par snobisme littéraire, il devait baptiser Plermont (Plérin-Mont). Là il vivait entre sa mère et une servante dévouée, qui joue dans sa vie le rôle de la nourrice antique. Marianne Feuillet. Le Dr Lequier n’avait en vue que la santé de son fils, il prépara sans s’en douter son éclosion morale, en l’envoyant à Plermont. C’est là en effet que s’est épanouie l’enfance heureuse de Lequier, c’est là qu’il s’est éveillé à la vie intellectuelle, qu’il a pris conscience de sa vocation philosophique ; c’est là que se place l’épisode célèbre qu’a immortalisé la Feuille de charmille, « récit véridique, je n’en puis douter, dit Renouvier, d’une vive impression d’enfance » ; c’est là qu’il a connu les premières ivresses de la pensée, qu’il a eu, avec le futur évêque Épivent, des discussions ardentes sur ce capital problème de la liberté, à la solution duquel il devait consumer sa vie. Plus tard, revenant avec attendrissement sur ce temps heureux, il s’écrie :
Vous rappelez-vous ? La Ville Guy ! Les veillées ! La prière du soir ! Et nos entretiens ! Comme nous aimions à parler des pèlerins d’Emmaüs ! O tardi corde ad credendum ! Et nos promenades pendant lesquelles je lisais avec vous quelque chose du bréviaire ! Et mes embarras obstinés sur le libre arbitre et sur la grâce ! (Lettre à Épivent).
C’est à Plermont que Lequier prit aussi conscience pour la première fois de son action sur les autres. Sans autre compagnie que celle des enfants du village, il se grisait avec eux de liberté et de jeu. Il les entraînait à sa suite, soit dans les rochers qui bordent la plage, soit dans la cave de la fée Margot, cette grotte préhistorique, ouverte au milieu des joncs épineux, sur la mer, au flanc de la falaise, et il les tenait sous le charme par le récit des belles histoires qu’il savait ou qu’il inventait. Par la verve de son esprit, par sa bonne humeur et sa grâce autant que par la distinction naturelle de ses manières et la supériorité de son éducation, il avait fait la conquête de ce petit monde rustique et avait à ses yeux le prestige d’un chef. Toute sa vie, dans tous les milieux, par la seule force de sa parole, il devait ainsi apparaître comme un « maître » ou un « enchanteur », et exercer une sorte de fascination sur ceux qui l’approchaient.
Les vacances à Plermont ne représentent pas seulement l’aube brillante de la vie de Lequier, sa « minute florale » ; elles l’ont marqué pour la vie. C’est à Plermont qu’il a contracté le goût de la solitude champêtre, de la « vie en plein ciel » et de la méditation sub dio. C’est là qu’il voudra accomplir son œuvre, dans le silence et le recueillement de la lande bretonne ; c’est là que, pour y avoir été heureux, il viendra chercher l’apaisement aux heures de misère et de désespoir. Plermont est le cadre où s’est déroulée son existence tourmentée ; ce fut son port de salut, son refuge, avant d’être son enfer et le lieu de sa mort. Dans la mesure où le milieu fait l’homme, Lequier a été le philosophe de Plérin.
Son éducation, qui l’avait toujours laissé libre, exempt de contrainte, son caractère passionné, ardent, absolu en tout, faisaient de Lequier un être impropre à la vie et devaient rendre stériles chez lui, en un sens, les plus beaux dons de l’intelligence. Tout d’abord il manqua sa carrière de polytechnicien. Il sortit de l’École dans les services d’État-major, où l’on envoyait alors un nombre restreint – souvent trois – d’élèves. Mais, ayant échoué aux examens de sortie de l’École d’État-major, il fut versé dans l’infanterie. Plutôt que de subir ce qu’il considérait comme une disgrâce, il donna sa démission en 1838. Coup de tête qui rentre bien dans le caractère de Lequier, lequel ne s’est jamais inspiré que de lui-même, s’est toujours cabré contre les évènements et leur a opposé une volonté butée.
Au moment où il brisait ainsi de gaîté de cœur son avenir militaire, la fortune allait se montrer pour lui particulièrement cruelle. En 1839, son père meurt presque subitement à l’âge de cinquante-huit ans.
Jules Lequier rêvait alors de consacrer sa vie « à l’élucubration d’un problème qu’il regardait comme le premier, presque l’unique, de la science et de la pratique : le problème de la liberté de l’homme » et, quand il « n’aurait pas eu trop du repos et de la liberté de l’âme pour mener à bonne fin la construction de sa doctrine, une fatalité déplorable », dit Renouvier, le vouait « à une œuvre bien différente… Il entrait dans le monde chargé du poids des dettes paternelles, dettes honorables qu’il acceptait sans réserves pour tout héritage d’un père tendrement aimé ». Désormais jusqu’à sa mort, il eut à se débattre « contre les nécessités de la vie et sous l’étreinte d’obligations qu’il ne pouvait remplir ». Renouvier nous le montre « partagé entre deux vies, pour ainsi dire, et deux tourments : le travail de l’enseignement, instable et peu rétribué, qui défrayait la subsistance journalière et permettait de payer l’intérêt de la dette ; puis, dans les heures qui pouvaient s’arracher à ce premier devoir, la passion de l’idée, la recherche de la vérité, un devoir aussi pour ceux qui ont mission ».
Ces éloquentes paroles ne sont pas rigoureusement exactes. Renouvier était mal informé. À la mort de son père, Jules Lequier n’était pas ruiné, mais sa situation de fortune se trouvait sensiblement amoindrie. Il avait été frustré de l’héritage de son oncle maternel, Digaultray du Cartier, ancien terroriste, enrichi sous la Révolution, qui, pour expier son passé et faire œuvre pie, avait laissé en mourant aux orphelins de Plaintel, du Fail et de Quintin une donation de 200 000 francs. D’autre part, le Dr Lequier avait écorné sa fortune par des constructions dispendieuses. Sa succession était cependant encore importante. Mais Jules Lequier eut bientôt fait de l’engloutir. En dix ans, il avait dépensé plus de 135 000 francs ; des biens paternels il ne lui restait plus que la Ville-Gaudu, encore grevée d’hypothèques, et dans le même temps il avait fait de nombreux emprunts à ses amis : Le Gal la Salle, Paul Michelot, Charles Renouvier, Sainte-Claire Deville. Tous les témoins de sa vie s’accordent à le dire, il ne sut jamais restreindre ses dépenses : « L’argent lui fondait entre les mains. – Il aurait eu un million de rentes qu’il l’aurait dépensé en bonnes œuvres. – Il n’a jamais eu conscience de la valeur de l’argent. Jamais il ne s’est inquiété de ses emprunts, soit pour un remboursement même partiel, soit pour le paiement de quelque intérêt, fût-ce à des prêteurs dans le besoin. »
Ce trait, qui met en cause la probité de Lequier, est caractéristique de son humeur hautaine et s’explique par elle. Il n’admettait pas que sa volonté eût à subir l’entrave des besoins matériels. Tout lui était bon pour y parer. C’était un solliciteur âpre, tenace, qu’on ne décourageait point. D’ailleurs, il avait un mépris superbe de l’argent : il ne se faisait aucun scrupule de le prendre où il se trouvait, et il le dépensait sans compter. Pour remplir sa mission philosophique, n’était-il pas fondé à recourir à la bourse de ses amis ? Il pensait que ceux-ci s’honoraient en lui prêtant, et ils le pensaient comme lui, Jules Lequier croyait à sa mission spirituelle, comme Auguste Comte à sa mission sociale et, besogneux hautain, il estimait que venir matériellement en aide aux penseurs, ce n’était que justice, d’après le principe de la subordination du temporel au spirituel. Ce romantisme économique contient sans doute le germe des pires abus. Il faut reconnaître avec Renouvier que Lequier était « impratique » ou avec B. Jacob qu’il n’avait pas « le sens du déterminisme et des conditions rigoureuses de l’action », mais il y aurait du pharisaïsme bourgeois à le lui reprocher trop vivement ; comme Auguste Comte, il était plein d’illusions et péchait par excès d’idéalisme. Son mépris de la richesse était sincère et il prouva par la suite qu’il était capable, au besoin, de s’en passer.
C’est ainsi qu’en 1839, déjà aux prises avec les embarras d’argent, il quitte Paris et, comprenant qu’on ne peut vivre pauvre qu’en Bretagne, s’enferme avec sa mère dans la solitude de la Ville-Gaudu. Il s’est juré de n’en sortir que ce rêve réalisé : se faire un nom, conquérir la gloire par ses travaux philosophiques ou, comme il dit, « devenir l’émule de ces hommes dont mon père ne prononce le nom qu’avec respect, le soir, près du foyer, pendant qu’on l’écoute en silence ».
Il était, nous l’avons dit, en possession de son idée maîtresse, celle « autour de laquelle toutes les parties de la philosophie et de la morale » doivent « se grouper, se coordonner ». Dès lors « il n’eut plus qu’un objet, qu’un but : porter dans l’esprit humain un de ces coups, de ces ébranlements qu’il est quelquefois donné au génie et à l’ardeur des convictions de produire, pour cela se livrer à un travail qui le plaçât au rang des hommes si peu nombreux qui ont en eux la puissance et la volonté d’une œuvre et le mit en état de paraître un jour revêtu devant tous de cette même force et de cette même volonté qu’il se sentait dans sa conscience ». (Renouvier.)
Comme Descartes, Lequier s’isole pour penser, pour mûrir et « conduire à leurs conclusions les idées qui s’agitent et bouillonnent en lui ». (L. Prat.) Mais, à cette date, la solitude ne répond pas seulement chez lui à un besoin intellectuel, elle procède encore d’une humeur farouche. Physiquement il est déprimé, malade, il se plaint d’une fatigue extrême. Moralement aussi il est changé, il est sombre, amer, désabusé. Il ne veut plus frayer avec les hommes et cesse de paraître à l’église, il va jusqu’à l’abandon de toute pratique religieuse. À cette misanthropie hautaine se joint une grande exaltation des sentiments personnels. Il se tient à l’écart de ses amis de jeunesse qui formaient à Saint-Brieuc une société littéraire et y avaient fondé un journal ; il repousse leurs avances, se réserve pour une tâche plus haute, il se sent loin d’eux et s’en détache. « La froideur, la mesure, le fini dans les affections, écrit-il, est ce qui m’irrite le plus. » Il sait bien qu’il est vain de « s’irriter », qu’il « vaut mieux accepter les hommes tels qu’ils sont, avec leur frivolité, leurs petitesses ». Mais le bon sens ou la sagesse vulgaire n’est point son fait. Il ne conçoit l’amitié que sous la forme d’une passion ardente, d’une communion intime et profonde d’âme, de sentiments et de pensées. Telle est celle qui l’unit à Le Gal la Salle. Avec lui il s’ouvre tout entier, il se répand en confidences, il lui écrit des lettres qui sont des volumes. Ce qui reste de ces lettres, presque toutes détruites après sa mort selon ses dernières volontés, trahit la fougue de la jeunesse, ses déclamations, son intransigeance. On y relève aussi la trace de ses pensées philosophiques, témoin cette fine et profonde analyse de la volonté :
Vouloir, c’est vouloir toujours, avec audace, avec ardeur. Qui a bien voulu, qui a voulu fortement dans un instant, voudra toujours ; mais on se trompe souvent, on croit avoir voulu quand on n’a fait que désirer. Ô désolation de l’erreur ! S’être cru actif parce qu’on était entraîné, avoir pris la faiblesse la plus misérable pour l’excès même de la force ! Cette idée est vraiment accablante. Mais l’erreur dont je parle est facile à distinguer. Dans les véritables actes de la volonté il y a quelque chose de victorieux, de calme, d’abstrait, de certain, qui ne trompe jamais.
Lequier, sous cette forme sentencieuse et abstraite, s’exhorte lui-même à vouloir, à dégager sa volonté de ses rêves, à la réaliser, à produire le chef-d’œuvre qu’il porte et qu’il a conscience de porter en lui.
Cependant une pareille tension de volonté, une aussi forte concentration intellectuelle ne pouvaient se prolonger longtemps. D’ailleurs, les ressources de Lequier étaient épuisées ; il lui fallait se procurer des moyens de vivre. Il quitte donc Plermont et en 1843, repart pour Paris, emmenant avec lui sa mère et sa vieille servante Marianne, et s’installe dans un modeste appartement, 10, rue Guy-de-la-Brosse, à quelques pas de l’École Polytechnique. L’École Égyptienne venait de s’ouvrir, sous la direction de Poinsot et le protectorat du maréchal Soult ; il y entre comme professeur de composition française. Ces fonctions qu’il acceptait par nécessité, il sut les remplir, et même avec éclat.
Il avait acquis, dit Renouvier, une instruction classique et littéraire très soignée quand il entra à l’École Polytechnique en 1834… Il était, comme critique purement littéraire (rhétorique dans le sens le plus élevé du mot), d’une pénétration psychologique et d’une subtile ingéniosité qui nous émerveillaient. Quel dommage qu’un enseignement de cette valeur n’ait été donné qu’en chartre privée aux élèves de l’École Égyptienne à Paris !
L’enseignement ne détourna pas Lequier de ses études personnelles. Sa passion philosophique, au contraire, s’anima à Paris d’une ardeur nouvelle, au point d’alarmer Mme Lequier qui, en mourant (1844), recommanda son fils en ces termes à sa servante dévouée : « Oh ! Marianne, veille bien sur mon pauvre Jules, il a au cœur une passion qui, je le crains bien, sera la cause de sa mort ». Mme Lequier cependant s’associait aux ambitions intellectuelles de son fils, à son rêve de gloire ; elle s’effrayait seulement de l’ardeur d’une passion dont elle sentait d’instinct le danger. Lequier de son côté écrit : « Celle que je pleure eut à ses derniers jours la consolation d’entendre des voix qui lui promettaient un grand avenir pour son fils, des voix dont l’autorité pouvait satisfaire sa prudence. Son dernier mot fut pour l’achèvement de ce travail ébauché. »
Ces voix qui prédisaient la gloire de Lequier étaient celles de ses amis qu’il avait pris pour confidents de sa pensée et devant qui il laissait éclater son génie. Une des particularités de cet esprit, ami de la solitude, est de ne pouvoir se passer d’auditeurs qu’il associe à ses pensées.
Autrefois, écrit-il, je pouvais à peine penser seul… Je me détruisais, je me hachais, je me réduisais en poussière… J’allais donc chercher des hommes ; n’importe qui me suffisait, pourvu qu’il eût l’air de penser et qu’il lançât quelques mots. Alors, je m’écoutais et je pensais. (Lettre à Renouvier.)
Mais, s’il lui suffisait à la rigueur d’être écouté, encore valait-il mieux pourtant que son auditeur fût capable d’entrer vraiment dans sa pensée, d’y répondre et ainsi de l’aider à la développer, à l’approfondir. Il y avait pour lui, sans doute, comme pour Socrate, des auditeurs qui l’inspiraient, et l’on sait par son propre témoignage que Renouvier fut de ceux-là.
Renouvier n’avait pas, toutefois, le privilège de ces entretiens philosophiques avec Lequier. Beaucoup d’autres y avaient part ; tous s’accordent à dire qu’ils sentaient passer sur eux, en l’écoutant, le souffle de l’inspiration et s’inclinaient, pleins de respect, devant la beauté incomparable de son langage. En ces circonstances, dit L. Prat, le génie de Lequier « s’imposait, il était éclatant, irradiant ». Lorsqu’il s’abandonnait à sa verve, à la fougue de son imagination, au jaillissement intérieur de sa pensée, sans avoir le temps de se critiquer, de se corriger et de se reprendre, il était simplement admirable. Comme les impuretés du métal au contact de la flamme, ses défauts se volatilisaient, si on peut dire, à la chaleur de l’improvisation ; il n’y avait plus ni subtilité de raisonnement ni recherche de style ; seule se déployait, dans un élan spontané, naïf et sincère « la puissance évocatrice des images, des idées. Et c’était si beau, m’a dit Renouvier, ces improvisations, souvent mêlées de morceaux récités de mémoire, que cela passait, et de beaucoup, tout ce qu’il a laissé de plus magnifiquement écrit. Il y avait des moments où il était l’être vraiment grand, noble et pur qu’il avait rêvé d’être, où il touchait au sublime ». (L. Prat.) Le génie de Lequier – c’est Renouvier qui l’affirme – ne s’est révélé tout entier qu’à ceux qui ont pu le voir et l’entendre. C’est un génie oratoire qui ne se communique pas seulement, mais se crée et se développe par la parole ; et ses écrits, d’une forme si parfaite, n’en sont pourtant que l’écho affaibli.
Cependant, la domination de Lequier sur les esprits tenait moins encore au prestige de la parole qu’à la profondeur et à la force de la pensée. Aussi s’exerçait-elle sur les esprits les plus différents de lui et les moins sujets à se laisser éblouir, comme Renouvier. Les entretiens philosophiques que les deux amis eurent ensemble dès l’École Polytechnique et, après leur sortie de l’École, dans leurs longues promenades à Paris, rappellent ceux de Berthelot et de Renan, avec cette différence que l’un des deux reconnaissait l’autre comme son maître. Illusion de l’amitié ? Modestie touchante de celui des deux qui, seul précisément, devait réaliser son œuvre et atteindre effectivement la gloire que l’autre en un sens a manquée ? Non pas. « Si Lequier doit beaucoup à Renouvier, dit Louis Prat, Renouvier – et il n’a pas manqué à le reconnaître – doit autant et peut-être plus encore à Lequier ». C’est aussi l’opinion d’un bon juge, O. Hamelin. « M. Renouvier paraît n’avoir rien exagéré en appelant Jules Lequier son maître » ; et, s’il a reproduit « dans le Second Essai de Critique générale un certain nombre des fragments du grand ouvrage auquel Lequier avait travaillé toute sa vie, La Recherche d’une première vérité, c’était sans doute indispensable, car la part de Lequier dans cet ouvrage est considérable ». Et Hamelin indique avec précision les « trois idées » essentielles dont Renouvier est redevable à Lequier : d’abord « l’idée très ancienne chez lui de l’importance capitale de la croyance », ensuite « les idées de la liberté prise au sérieux et du rapport de la liberté et de la croyance ».
Mais on ne saurait reconstituer d’une façon exacte et complète la physionomie de Lequier à l’aide des souvenirs qu’il a laissés à ses amis, notamment à Renouvier. Celui-ci en effet signale, avec sa grande loyauté intellectuelle, la position fausse où il est vis-à-vis de celui qu’il appelle son maître : il se sépara de lui sur un point capital, le catholicisme. On a le droit de se demander si, en raison de ce dissentiment, le plus grave qui puisse exister entre deux philosophes, Renouvier a été, au moins sur ce point spécial, aussi clairvoyant et aussi juste envers Lequier qu’il a cru et surtout qu’il a voulu l’être. Il tient la foi de son ami pour une inconséquence, pour une illusion qui ne repose que sur des sophismes :
Catholique ! Je lui disais et lui répétais sans cesse, écrit-il, qu’il l’était à la condition qu’il lui fût possible d’interpréter les dogmes de telle manière qu’ils fussent d’accord avec sa philosophie. Mais, comme il avait une foi ardente, – avec absence totale de sens critique en histoire et en exégèse – et d’autre part, de fortes convictions d’ordre rationnel, il croyait tout naturellement cet accord possible et son interprétation fondée…
Je n’ai jamais partagé à aucun degré les illusions que Lequier se faisait sur la possibilité de soutenir son apologétique chrétienne. Elles tiennent au fond à ce qu’il s’était persuadé que sa philosophie était vraiment la philosophie des dogmes conciliaires.
Sa rare aptitude aux analyses morales des caractères et à la critique littéraire s’alliait à l’ignorance des premiers éléments de la critique historique et de la critique des textes. C’était ainsi. Il spéculait sur la parole du Seigneur dans la Vulgate exactement comme si Jésus-Christ avait, non seulement dit cela, totidem verbis, mais parlé latin, le latin de saint Jérôme. Et de même pour les mots de l’Ancien Testament ! Cela avait quelque chose de touchant, quoique bien étrange, chez un si grand esprit. Cela peut donner à réfléchir sur la foi, que l’on conteste quelquefois, de certains hommes illustres du XVIIe siècle.
Lequier est donc croyant autant que philosophe. Il est même essentiellement un croyant. « C’est de la religion qu’il est allé à la philosophie, dit B. Jacob ; et chez lui le philosophe n’a pensé que pour justifier le croyant. » La plupart de ses notes « se rapportent au mystère de la Trinité, de la Rédemption, à la nature de Jésus-Christ, à la damnation éternelle… Il a constitué sa philosophie sous l’influence du catholicisme, et la philosophie n’avait qu’un but à ses yeux : justifier le catholicisme ». C’est peut-être trop dire, mais, quand cela serait vrai, qu’en faut-il conclure ? D’après Renouvier et Jacob, le dogmatisme religieux exclut la liberté d’esprit philosophique. Logiquement peut-être, psychologiquement, non. Rien de plus commun qu’une foi candide d’enfant s’alliant à une entière liberté de pensée ; rien au fond de plus naturel. Ce sont les tièdes qui craignent de n’être pas en règle avec le dogme ; mais ceux qui ont en la vérité du dogme une foi absolue, comment prendraient-ils ombrage des hardiesses d’une pensée sincère ? L’idée d’un désaccord possible entre la révélation et la raison ne les effleure même pas ; elle ne se présente pas et ne saurait se présenter à leur esprit. C’est ainsi que Lequier a pu être et a été sincèrement croyant et librement, voire audacieusement philosophe.
Sa philosophie est un approfondissement du dogme théologique. Ce dogme, il n’a pas à l’établir, à le soumettre à la critique ; il ne le met pas en question, il le tient pour fondé, il l’accepte comme fait historique et comme doctrine. Parti pris sans doute, mais qui est à la base et dans la logique du catholicisme, qui en est le postulat et le principe.
Ne mutilons pas la personnalité de Lequier, acceptons-la tout entière : chez lui, le penseur et le croyant ne font qu’un, se développent parallèlement, sans s’entraver, sans se nuire, et l’enthousiasme philosophique se double toujours de l’exaltation mystique. Lequier a le tempérament de sa race ; il est foncièrement, profondément religieux ; la foi naïve du sentiment s’unit en lui à la foi raisonnée et ce théologien philosophe est un humble dévot. Nul état religieux ne lui est étranger. Comme Plotin, il a connu l’extase : Dieu lui a « parlé ». Et il faut l’entendre à la lettre : il a eu des hallucinations de l’ouïe qu’il interprète comme un signe que Dieu lui a donné de sa présence réelle et sensible. Il écrit à Mgr Épivent :
Je vous parle comme un homme qui s’imagine avoir été témoin d’un miracle que Dieu a daigné faire pour lui, dans sa solitude, un jour où il était plus triste que d’ordinaire. Vous me prendrez pour un visionnaire et cependant je vous dis que Dieu m’a parlé…
Il y a encore une autre parole de Dieu à moi, sortie de la bouche d’un prêtre, une autre parole, que je n’entendis aussi que dans un écho, et qui fut assez forte pour m’obliger à baisser la tête, à m’agenouiller, à faire le signe de la croix que ma main droite avait oublié.
Enfin, Lequier mentionne soigneusement sur ses carnets des visions extatiques qu’il eut à l’époque de sa grande ferveur métaphysique et religieuse (1846). La dévotion particulière qu’il avait à la Vierge et à l’Enfant Jésus, et dont témoigne le poème philosophique publié dans les Fragments sous le titre : Cantique à la Conscience, se matérialisa sous la forme suivante, notée par lui au moment même :
N’oublier jamais le 15 août 1846, jour de l’Assomption de Marie au ciel.
Memento hujus lactis validi, quod tibi præbuere divinæ ubera Mariæ, labraque simul fratris tui, tuique amici dulcissimique Domini Jesus Christi (In perpetuum Amen).
Memento (16 août, dimanche 1846) communionis tue dulcissimæ sanctissimæque unitatis in sanguine Jesus Christi, tui amiculi suæque matris castæ et amantissimæ Mariæ et tut simul.
Memento hujus triplicis osculi et Jesu Christi et Mariæ et tui nascentis ex uno et eodem corde ardenti.
Non ! Quand tu serais plus tard accablé de malheurs, tu devrais encore te croire bienheureux ; si tu te plaignais de Dieu, tu serais par trop ingrat. Soutenez-moi, mon Dieu !
Puis, « d’après une vue claire et distincte, qui lui fut révélée le 17 août 1846, dans une église de Paris », Lequier reconstitue les scènes de la Passion et termine par un acte de contrition où il met toute son âme :
Écrit au Luxembourg le 18 août 1846. – Petit Jésus, je veux être ton bon petit ami. Nous nous suspendrons ensemble à la même mamelle, sur ton sein virginal, bonne petite Mère Marie ; puis nous prendrons chacun notre mamelle, puis nous mêlerons le lait maternel sur nos petites lèvres, puis nous approcherons ces mêmes petites lèvres de ta bouche chérie, ô bonne Mère.
D’aucuns diront qu’il eût fallu jeter un voile sur ces aberrations dévotes où se montre la faiblesse d’un grand esprit, mais, outre qu’il manquerait quelque chose à « l’expérience religieuse », si de tels documents, quand ils se rencontrent, n’étaient pas produits, il faut, pour comprendre la foi religieuse de Lequier, savoir quels éléments y entrent, quelles formes elle revêt et à quels excès elle se porte. Que ce mysticisme sensuel n’inspire qu’une aversion profonde, à la fois instinctive et raisonnée, à un pur philosophe comme Renouvier, on le conçoit sans peine. Mais c’est à de tels moments et par de tels signes que Lequier a pris conscience de sa « mission », s’est senti « l’élu de Dieu », et plus tard, quand il désespérera de son œuvre, ce sont ces souvenirs qu’il évoquera, c’est à la Vierge encore qu’il fera appel pour ranimer son courage, témoin les lignes suivantes où se déroule dans un raccourci puissant le tableau de sa vie entière :
Il avait aperçu un but sublime, par une route qu’on pouvait s’ouvrir. Jeune homme, te sens-tu le courage d’un héros ? En marche, se dit-il. Il part : ses confidents se vantent déjà de sa gloire. Il marche, il marche, il trébuche, il se traîne. Lassé, enfin, d’une fatigue surhumaine, incertain s’il suffirait à un effort suprême (qui peut-être ne suffirait pas), il s’arrête au bruit lointain des rires qui succèdent aux applaudissements du départ. S’était-il donc trompé ? Dans son accablement il jette les yeux autour de lui. Vous êtes à ses côtés, montrant le but qu’il faut atteindre, Virgo Fidelis !
Lequier est l’homme de tous les contrastes. Il s’est montré à nous philosophe et mystique, il va nous apparaître comme politicien.
L’année 1848 le ramène en Bretagne. Il se présente à la députation dans les Côtes-du-Nord comme républicain catholique. « Élevé dans la foi catholique et dans l’amour du peuple, dit-il dans son programme électoral, je veux consacrer toutes mes forces à soutenir les vrais intérêts du peuple et ceux de cette religion, amie du peuple, qui, la première, la seule, fit retentir autrefois dans le monde, ces belles paroles aujourd’hui notre devise : Liberté, Égalité, Fraternité. »
Il écrit à Renouvier (12 avril 1848) que, « sans avoir fait aucunes démarches », il a été porté sur plusieurs listes indépendantes : l’une, « dressée par les ouvriers de Saint-Brieuc », où son nom est le 12e sur 16, plus « deux autres : la liste du clergé, d’une part, et la liste du comité légitimiste qui n’a pu s’accorder avec l’évêque. J’ai été admis sur l’une et sur l’autre comme élément de fusion et par là mes chances sont considérables. » Si considérables qu’elles soient, il ne les juge pas cependant suffisantes et voudrait les accroître en y ajoutant celles de candidat… officiel. C’est là l’objet de sa lettre. La liste républicaine étant arrêtée (elle l’était avant son arrivée à Saint-Brieuc), il ne peut être question de l’y inscrire ; mais, comme cette liste ne saurait passer tout entière, – c’est de quoi il se porte garant – « le gouvernement provisoire » ne pourrait-il pas donner à entendre qu’« il verrait sans déplaisir » la nomination « de Lequier » ? Puisque sur la liste « censée républicaine » figurent, d’une part, « certaines maîtresses ganaches, qui ne sont pas encore décidées à voter pour la République (textuel) » – c’est Lequier qui souligne, – et, de l’autre, « Jules Simon, qui excite de si vives antipathies dans le clergé et la population ouvrière qu’il est impossible qu’il soit nommé », est-ce que « notre Commissaire, M. Conart », ne pourrait pas, « sur un ordre venu de Paris, écrire aux maires des communes que, dans le cas où il y aurait un nom à remplacer sur la liste censée républicaine, il engage à y substituer le mien, individuellement, par exemple » ? (souligné par L.).
Tu vois donc bien ce qu’il me faut ; il ne s’agit nullement d’un nom imposé par le gouvernement, après une liste arrêtée, qui a l’agrément du gouvernement, une liste de recommandés ; il s’agit le recommander mon nom en sous-ordre, en donnant ainsi témoignage que ce nom n’est pas repoussé par le gouvernement ; et ce qui peut autoriser à le faire, c’est que, à coup sûr, la liste censée républicaine, à supposer qu’elle l’emporte, ne saurait passer tout entière.
Ainsi présentée, la candidature de Lequier réunissait tous les avantages ; elle était officielle sans l’être ; les voix des républicains, des catholiques, sans préjudice de celles des légitimistes dissidents, lui étaient assurées. Et Lequier savait qu’il pouvait entièrement compter sur l’appui personnel de Renouvier, secrétaire de la Commission d’instruction publique et en relations avec les chefs du parti républicain.
Je mets donc entre tes mains, cher ami, mon affaire, lui écrit-il. Vois, pèse, considère et décide. Ce que tu feras sera bien. J’ai envie de te prier de communiquer au moins quelques passages de ma lettre à M. Barthélémy-Saint-Hilaire, peut-être aussi à Terrien, qui m’a promis Marrast à un moment donné… Parles-en, si tu le trouves bon, à M. Lamennais.
L’intrigue était savamment ourdie : Lequier faisait appel à tous les partis, comptait des amis dans chacun ; il croyait avoir toutes les chances. Mais il se faisait, à son ordinaire, bien des illusions. Il ne fut pas élu, il arriva le 20° sur la liste, avec 47 547 voix sur 144 377 votants. C’était pour lui un désastre, car il était ruiné, « Les électeurs des Côtes-du-Nord, écrit mélancoliquement M. Hémon, avaient manqué une occasion unique de mettre en évidence un concitoyen de grande valeur, qu’ils auraient sauvé en même temps de la misère et du désespoir. »
À la suite de son échec électoral Jules Lequier se retira à Plermont et se remit au travail avec plus d’acharnement que jamais.
M. Hémon a reconstitué sa vie à cette époque dans le plus grand détail. Il nous le montre, l’hiver, pendant les journées pluvieuses, confiné dans une pièce du premier étage, dont il avait fait à la fois sa chambre à coucher et son cabinet d’étude. Cette pièce contenait un bureau encombré de cahiers, de feuillets et une bibliothèque d’un millier de volumes (ouvrages de médecine et auteurs sacrés). Le philosophe ne quittait sa table de travail que lorsque « la voix dolente de quelque mendiant faisait entendre une prière » ; il « entrebâillait » alors sa fenêtre et « laissait discrètement tomber une pièce de monnaie enveloppée dans un carré de papier ».
Par les belles journées, en toute saison, « il quittait Plermont au matin et, un carnet en main, il s’en allait par les chemins creux ou le long des falaises et des plages solitaires ». Il rejoignait parfois, à la Pointe des Tablettes, les deux douaniers de garde, Jean-Louis Ollivier et Jean Jacopin, « qu’il avait pris en amitié ». Le plus souvent il s’entretenait familièrement avec eux : mais il leur récitait aussi, s’ils l’en priaient, « quelque passage » de ses « grands ouvrages ». « Ils l’écoutaient avec recueillement » et, « quand sa voix s’était tue, le bon Jacopin ne manquait pas de proclamer que le morceau était d’une profondeur incroyable ». – « Ce Monsieur Jules est un magicien en paroles », renchérissait Ollivier.
L’été, « quand la chaleur était accablante », Lequier se rendait à « la Cave Margot » et y passait de longues heures dans la méditation et la rêverie ; puis, vers le soir, il flânait lentement sur les hauteurs qui surplombent la mer, jusqu’à ce que l’Angelus eût tinté à l’église de Pordic. Alors il fermait le livre ou le carnet qu’il tenait à la main et, pressant un peu le pas, il regagnait son ermitage de Plermont, prenait à la hâte un léger repas et se remettait au travail, lisant ou écrivant fort avant dans la nuit. Quand il sentait sa vue fatiguée, « au lieu de se coucher, souvent il s’enveloppait d’un manteau pour descendre jusqu’aux grives, où il poursuivait encore jusqu’à l’aurore ses méditations de la journée ».
Cette vie de solitude et de tension cérébrale dura trois ans. Elle devait conduire Lequier à la folie.
« Ce fut, dit Renouvier, au moment le plus critique de la gestation de son œuvre que Jules Lequier, confiné dans une solitude des Côtes-du-Nord, excédé de travail et de veilles, exalté par un effort de concentration au-dessus des forces humaines, se vit en proie à un accès aigu qui bouleversa chez lui l’usage de la raison. »
Renouvier parait s’être trompé et sur la gravité de cette crise et sur ses causes. Il s’en tient aux termes du bulletin médical qui l’attribue au surmenage. Lequier aurait en réalité supporté la vie d’isolement et de labeur acharné qu’il menait à Plermont, s’il n’avait été torturé par les soucis d’argent. En 1850, il dut vendre la maison de ses parents à Saint-Brieuc. Il s’adressa dans sa détresse à sa tante Digaultray, qui consentit à doubler la somme de 10 000 francs qu’elle lui laissait par testament, mais sous la condition expresse qu’il ne pourrait employer cette somme qu’à éteindre la dette qu’il avait contractée envers son cousin Palasne de Champeaux et qui s’élevait exactement à 20 000 francs. Ce legs dérisoire, dont ne lui revenait rien, et injurieux, puisqu’il n’était qu’un détour pour le contraindre à reconnaître et à payer ses dettes, le mit dans un état d’exaspération violente et fut la cause déterminante, – principale, sinon unique – de sa folie. On lit, dans le « Plan de l’ouvrage » qu’il avait projeté : « Le legs. – Confidences. – Épisode : Dinan ». « Dinan » désignant l’asile où il fut enfermé, « le legs » est le drame, dont « Dinan » est le dénouement.
Au début de sa crise (28 février 1851), Lequier voulut saisir une hache pour se couper un bras. On le garda deux jours en observation à l’hôpital de Saint-Brieuc (1-2 mars). La crise persistant, Le Gal la Salle et l’abbé Cocheril, professeur de philosophie au Collège Saint-Charles, le conduisirent à l’asile de Lehon à Dinan. Dans des moments de lucidité, il écrivit des lettres désespérées à ses amis, protestant contre une persécution fondée sur d’injustes soupçons. L’un d’eux, Paul Michelot, s’émut de ces plaintes et le fit entrer à ses frais dans la maison du Dr Blanche à Passy. Là, du 12 au 29 avril, « il reçut, dit Renouvier, les soins les plus dévoués de la science et de l’amitié et, à la suite d’une consultation qui fit reconnaître la liberté comme moins dangereuse que la séquestration chez une âme de cette trempe, il reprit peu à peu l’équilibre de ses admirables facultés, sous les yeux de ses amis et de celui même qui écrit ces lignes… Tous ceux qui l’ont approché dans le temps même de sa crise ont admiré (chez lui) l’énergie morale, la puissance de raisonnement, la mémoire merveilleuse et l’intensité de l’effort sur lui-même. Cette crise lui laissa (à quelques heures près, dont il perdit la mémoire, a-t-il raconté depuis), le souvenir le plus exact et le plus précis des évènements et de la succession de ses propres idées. »
Selon L. Prat, la crise mentale de Lequier aurait été d’un caractère si idiosyncrasique qu’elle défie et confond la science, impropre à juger de cas aussi exceptionnels et qui se trompe en leur appliquant le nom commun de folie. Parmi les amis de Lequier, Le Gal de la Salle seul a cru à l’aliénation : il est vrai qu’il était médecin et avait assisté le malade en pleine crise. Lequier, lui, ne s’est jamais cru fou et il a réussi à convaincre Renouvier, Michelot, qu’en effet il ne l’était point et ne l’avait jamais été. Il fallait que les raisons invoquées par lui fussent bien fortes pour qu’il ait pu faire admettre à Renouvier, contre les apparences, contre l’avis des médecins, que la crise de 1852, exaltation délirante, bouleversement momentané, était autre chose que de l’aliénation.
Quelles étaient donc ces raisons ? J’en vois de deux sortes, tirées, les unes du retour, si complet par la suite, de Lequier à la raison, ou, comme dit Renouvier, « à l’équilibre de ses admirables facultés », les autres des souvenirs mêmes que Lequier avait gardés de sa crise et qui lui permettaient de la reconstituer et de l’interpréter dans un langage saisissant de vérité psychologique et de beauté dramatique.
Comment croire, en effet, que cet homme-là eût jamais été fou, qui, évoquant les épreuves tragiques de sa vie, disait : « Voyez, pourtant ma raison y résiste ! » comme dans cette lettre à Renouvier :
Je doute fort que tu te fasses la moindre idée, c’est-à-dire que je sais qu’il est absolument impossible que tu te fasses la moindre idée de ce que j’ai souffert ici. Te rappelles-tu (et ceci n’est pas un reproche) que tu te réservais quelques doutes sur l’état par lequel j’avais passé, dans l’aventure de Dinan ? Eh bien, mon cher ami, quand je te raconterai (car je te le raconterai) ce que j’ai souffert ici, tu sortiras de ce doute et tu auras la très consciencieuse et très rationnelle conviction que, si j’avais été fou, il y a longtemps que je le serais redevenu et pour jamais. Tiens ceci pour assuré (28 nov 1855).
Comment douter encore de la raison d’un homme qui invoque le souvenir de cette crise mentale, où il a senti ses facultés près de sombrer, comme un avertissement, comme un préservatif et une sauvegarde contre le danger de pareilles crises ? Ayant passé par là, il sait maintenant se vaincre, se rendre maître de lui-même.
Depuis Dinan, écrit-il dans le même temps, je porte un fardeau que tu ignores certainement. La fatigue s’accumule, c’est une vérité et une vérité terrible. Mais je me suis inspiré de Dinan, j’ai imité de mon mieux cet homme de Dinan que j’ai été. Je ne me suis pas mis en colère, j’ai trouvé moyen de ne pas me mettre en colère (30 juillet 1853).
Mais c’est surtout en parlant de sa crise, de cette crise dont son esprit lucide avait suivi la progression et noté l’explosion, que Lequier donnait l’impression d’avoir, par je ne sais quel miracle, gardé intacte la flamme de la raison dans la fièvre d’une imagination en délire. Lequier, qui mettait « à profit jusqu’aux épreuves de sa vie » pour l’élucidation des problèmes philosophiques, avait projeté d’écrire sous ce titre : « Épisode, Dinan » le douloureux récit de sa crise mentale. « Ceux qui ont reçu ses confidences, qui l’ont entendu développer ses souvenirs et ses impressions, dit Renouvier, se seraient attendus à trouver dans ce livre (resté malheureusement à l’état de projet et dont il n’a pas été trouvé trace dans ses brouillons) une composition probablement unique dans toutes les littératures. » Louis Prat a souvent entendu dire à Renouvier que l’épisode de Dinan, raconté par Lequier, était d’une éloquence dramatique à ce point prodigieuse que celui qui évoquait de tels souvenirs avec de tels accents, loin d’apparaître comme une victime de la folie, semblait un héros que sa force d’esprit et de volonté élevait au-dessus de la raison commune. Lequier allait plus loin encore et voyait dans ses souffrances une « épreuve » de Dieu, c’est-à-dire un nouveau signe de sa mission et reconnaissait la « nécessité » de cette épreuve dans un esprit de soumission et de résignation chrétiennes. Ainsi son imagination grandissait et relevait jusqu’à ses malheurs, leur donnait un sens surnaturel et une forme sublime.
Guéri ou déclaré tel par le Dr Blanche, Lequier revint en Bretagne. Il était ruiné. En 1851, il avait vendu son dernier lopin de terre. Pour la seconde fois, il lui fallait se créer des ressources par le travail. Il les trouva dans l’enseignement privé.
Son caractère naturellement difficile, ombrageux et cassant, que la maladie avait encore altéré et aigri, allait lui rendre ces fonctions particulièrement pénibles. « Parfait avec ses amis, Jules Lequier, écrit Renouvier, était extraordinairement épineux et impratique dans les relations où il entrait de la dépendance, avec des questions d’intérêt, et on ne peut plus susceptible avec les étrangers. J’ai vu cela cent fois. Il se brouillait avec les gens et leur en voulait à mort. »
C’est ainsi qu’entré comme précepteur chez M. Pierrugues, officier supérieur d’artillerie, lorsque, les études de son élève finies, il reçut son congé, il jugea insuffisante l’indemnité qui lui était offerte, se brouilla avec M. Pierrugues et lui intenta un procès. C’est ainsi encore qu’au Collège Saint-François-Xavier de Besançon, où nous le trouvons ensuite professeur de mathématiques, il entre en lutte avec le directeur et avec l’archevêque et engage contre ce dernier un procès. Son avocat lui explique ainsi psychologiquement son cas : « J’ai été élevé par les Jésuites, m’a-t-il dit (il est catholique et fort brave homme d’ailleurs). Du moment que vous avez fait seulement acte de dignité, tout était perdu. »
En 1855, Lequier revient à Plermont qu’il ne quittera plus. Il est découragé, amer, il s’abandonne à son sort. La solitude où il s’enferme, au lieu de lui apporter l’apaisement, tend et surexcite ses facultés. Son ardeur pour l’étude, sa piété, sa charité revêtent une forme aiguë, agitée et comme factice. En même temps qu’il reprend ses travaux philosophiques (ils ont toujours été sa grande diversion au chagrin : ainsi, c’est pendant la douloureuse période de Besançon qu’il avait écrit les Αbels), il assume des tâches charitables, instruit les enfants des villages autour de Plermont, recueille en sa maison et soigne tout un hiver trois d’entre eux atteints de la teigne. L’un s’enfuit, lui volant sa montre, mais fut pris de remords et la rapporta ; Lequier lui pardonna et le reprit. Près de Plerimont habitait un carme déchaussé, le P. Loysel, interdit comme alcoolique : Lequier entreprit de le ramener dans la bonne voie et de faire lever l’interdiction qui pesait sur lui.
Sa piété devenait chaque jour plus ardente ; il multipliait les pratiques de dévotion. Le 8 septembre 1857 on le vit arriver à Guingamp tout poudreux ; il avait fait dix lieues à pied pour assister au Couronnement de la Madone. En compagnie de Marianne et du jeune Ollivier, le fils de son ami le douanier, dont il avait fait son élève et son secrétaire, il allait tous les soirs s’agenouiller au jardin devant une croix de bois, placée au-dessus d’une statuette de la Vierge, et faisait la prière à haute voix, substituant aux actions de grâces rituelles des invocations poétiques à Jésus et à Marie. Il en vint à passer « chaque jour des heures entières dans une demi-obscurité, en méditation extatique devant une grande croix en papier rouge, qu’il avait collée sur la glace de sa chambre ». Enfin il rêvait d’acquérir un tertre, d’y établir un calvaire et une sorte d’oratoire qu’on apercevrait de loin en mer.
Cependant il vivait dans une grande misère. Sa fierté ombrageuse lui rendait plus sensible que les privations matérielles l’humiliation d’avoir à les subir. « Il est dur, écrit-il, d’être pauvre, mais il est affreux d’être ruiné. » Quand il venait à Saint-Brieuc, il fuyait ses anciens amis et allait déjeuner pour dix à douze sous à l’Écu de France, chez son ancien condisciple Marc Liscornet. Celui-ci confia un jour à MM. Le Gal la Salle et Foucaud sa peine d’avoir à le traiter si mal. « Donne-lui, lui dirent-ils, du bon vin, du poulet, et réclame-lui le prix ordinaire. – Mais s’il fait des observations ? – Tu lui diras que le prix des denrées a baissé. Mais rassure-toi, il ne s’apercevra de rien, il ne demandera aucune explication, il est dans le ciel ! » Et cela se passa en effet ainsi pendant des années.
Enfin, il cessa de venir à Saint-Brieuc. Il n’osait plus se montrer avec ses vêtements usés et passés. Son amie, Mme Lando, ouvrant un jour devant lui, comme par hasard, les battants d’une grande armoire, lui montra quantité de vêtements que son mari, paralytique, ne mettrait jamais plus. Elle en était encombrée, on lui rendrait service si… « Elle n’en dit pas davantage : il avait compris son intention et fixait sur elle un regard si douloureux qu’elle n’osa achever la phrase commencée ». (P. Hémon.)
Une occasion s’offrit cependant de l’arracher à la misère : le poste d’archiviste du département des Côtes-du-Nord était devenu vacant, on le demanda pour lui et il allait l’obtenir, mais, – c’était bien sa chance ! – il se trouva devancé de quelques heures par un concurrent.
Il devint alors de plus en plus sombre et farouche. En 1860, son secrétaire Ollivier l’ayant quitté, il écrit : « Il vient un moment où tout manque à la fois : on se trouve seul et on a peur. Ce mot seul acquiert un sens profond, terrible. »
En 1862 il avait épuisé toutes ses ressources, jusqu’aux économies de Marianne et de sa sœur, domestique comme elle. C’est alors qu’il vit s’écrouler ses dernières espérances, celles qu’il avait fondées sur un mariage avec une amie d’enfance, Mlle Deszille, lequel « lui eût apporté (à cause de la situation de fortune de Mlle Dessille) la fin de ses épreuves, l’état de bonheur qu’il avait toujours rêvé dans la vie de famille et les moyens de publier son ouvrage ». Mlle Deszille avait refusé sa main à Lequier, – trois mois après son internement à Dinan ! – alléguant l’opposition de ses parents. Lorsque M. Deszille mourut en 1861, Lequier crut que « Mlle Deszille, laissée à sa propre détermination, prononcerait le oui définitif. Mais justement alors elle se décida résolument pour le refus. C’est sur le coup de cette résolution que se produisirent les symptômes d’égarement rapportés par les journaux de Saint-Brieuc et qui se terminèrent par le suicide ou par la mort accidentelle, car on ne saura jamais ce qu’il en est. » (Note de Renouvier.)
Qu’a été, dans la vie de Lequier, cet amour à la perte duquel on nous dit qu’il n’a pu survivre ? D’après ses lettres, on croirait qu’il en a été le centre, le but constant et unique. Selon Renouvier, il fut seulement une passion de jeunesse « rentrée plus tard, beaucoup plus tard, dans son âme, devenue dans les dernières années (vers 1860) l’unique pensée de sa vie de cœur ».
À Saint-Brieuc, pendant ses années de collège, Jules Lequier avait pour camarade de jeu Anne (ou Nanine) Dessille. Entre ces enfants s’était établie, sous les yeux des parents et encouragée par eux, une amitié ardente et pure. D’après M. Hémon, « les rares témoins de cette époque lointaine » en avaient gardé un souvenir édifié et attendri. Un jour, disaient-ils, c’était un pieux rendez-vous à une messe matinale où l’on se retrouvait ensemble, unis dans la prière ou même voisins à la table de la communion. Une autre fois, c’était un pèlerinage convenu à un oratoire écarté, où, sans s’aborder, on échangeait seulement une fleur, laissée comme par hasard sur une tombe. Toutefois les parents, observant les progrès de cette amitié trop vive, crurent bon par prudence de séparer les jeunes gens. Jules fut envoyé du collège de Saint-Brieuc à celui de Pont-Levoy. Ils se revoyaient aux vacances et ils s’écrivaient. Puis Jules Lequier s’éloigna. Lorsqu’il revint en Bretagne, résolu à y vivre et à y accomplir son œuvre, son amie lui apparut ou réapparut ce qu’elle avait été peut-être pour lui dès l’enfance, comme « un parti ». Mais il n’en était plus un pour elle : il était ruiné et avait été enfermé comme fou, lorsqu’il demanda sa main en 1861. Les parents s’opposèrent au mariage ; Mlle Deszille lui renvoya ses lettres et lui demanda de brûler celles qu’il avait reçues.
Nous avons les lettres de Lequier : elles le montrent sous un jour nouveau et complètent ce que nous savons déjà de sa puissance de séduction et de charme. Cette puissance tient pour une bonne part à la force d’illusion qui est en lui et qui émane de lui. De plus, à quelque moment et sous quelque aspect de sa vie qu’on le considère, il parait alors se révéler tout entier et à plein. Est-il amoureux ? Il se persuade qu’il n’est et n’a jamais été qu’amoureux, que l’amour est toute sa vie. Sans doute il convoite la gloire et veut laisser une œuvre, mais pourquoi ? Uniquement pour en faire hommage à l’élue de son cœur et pour franchir la distance qui le sépare d’elle dans sa situation de fortune présente. Il le dit, et le fera croire, car il le croit lui-même au moment où il le dit. Ainsi il oublie son génie pour ne penser qu’à son bonheur, ou plutôt le bonheur même, il ne veut le devoir qu’à son génie et ne le sépare pas de l’exercice de son génie.
Eh bien, oui, écrit-il à Mlle Deszille, je voulais venir à vous par la gloire. Vous étiez pour moi le prix de la gloire. Souvent j’ai rêvé – heureux songe ! – que j’apportais à vos pieds née du sang le plus pur de mon cœur, éclose aux feux ardents du chagrin et arrosée de ces larmes d’autant plus fécondes qu’elles sont plus amères, une fleur, d’une beauté sans égale, qui vous enivrait de son parfum.
Et encore :
J’amassais des matériaux, fruit d’un long labeur, résultat d’études immenses, pour des travaux dont vous étiez l’âme et qui reproduisaient de toutes parts votre image.
À cette tâche il pouvait succomber et périr. N’était-elle pas au-dessus de ses forces ? La tension, l’effort surhumain, qu’elle imposait à ses facultés, pouvaient faire éclater sa raison. Ce danger, il le connaissait, il en avait le pressentiment, mais il l’affrontait héroïquement et en silence.
Sans vous rien dire, sans vous rien demander, puisque le respect et l’honneur me tenaient la bouche fermée, je me proposai résolument de vaincre la fortune. C’était une tâche difficile. Il fallait d’abord sauver mon âme et mes facultés, ces facultés qui étaient mes armes. Vous ne pouvez savoir, mademoiselle, ce que certains revers, certains soucis ont d’action dissolvante sur les hommes de la trempe la plus héroïque et, si je levais devant vos yeux les voiles qui vous cachent ma vie, vous apercevriez des dangers terribles là où vous ne soupçonniez que des peines. Il fallait donc sauver mon âme.
Ainsi une passion au cœur, des soucis d’argent, des travaux philosophiques et des doutes, une défiance de soi, allant jusqu’à des craintes pour sa raison, voilà dans quels tourments s’agitait la vie de Lequier à Plermont. Mais une double espérance le soutenait : celle de la gloire et celle de l’amour, « prix de la gloire ». D’où cette façon originale de faire sa cour : à celle qu’il aime, il ne peut apporter les biens matériels, la fortune, mais il offre en hommage la gloire du philosophe, à laquelle il a le droit de prétendre, bien plus, qu’on lui décerne déjà. N’est-ce pas là un assez beau titre d’honneur, et de nature à toucher le cœur d’une femme aussi intelligente que bonne ?
Hardi voyageur dans le monde de la pensée, j’ai tenté plus d’une fois des routes, j’ai sondé plus d’un abîme… La passion du vrai, la bonne foi, cette autre intelligence supérieure à l’intelligence, m’ouvraient des perspectives plus vastes et m’éclairaient de nouvelles questions.
… Je ne me doutais guère, en quittant ma retraite, que les grands problèmes dont je tenais déjà la solution presque entière, allaient être offerts à la méditation de plusieurs dans les termes même où je les avais posés.
Allusion aux Essais de Critique générale, dans lesquels Renouvier faisait honneur à Lequier de sa position nouvelle du problème de la liberté. Cette allusion se précise dans ce qui suit :
Il y a un an, quand un ami, transporté d’espérance, accourait à moi en disant : « Tiens ! L’avenir et la gloire t’appartiennent ! Tu les as bien gagnés », que vis-je au-delà de cette couronne qu’il me montrait ? Récemment, quand des rivaux généreux m’appelaient leur maître, qu’ils m’écoutaient les yeux brillants et me pressaient les mains avec enthousiasme, où était ma pensée ?
Il y a longtemps que toute vanité est sortie de mon âme. J’avais une trop haute idée de ce qui est vraiment grand pour me laisser prendre par l’orgueil des petits succès.
J’ai parlé de gloire. Dieu m’est témoin que depuis longtemps, et en ce moment surtout, dans ce cœur trop plein de vous pour que la vanité puisse y trouver place, vous régnez sans partage. Oh ! si je la désire…
Ainsi Lequier confond ses rêves de gloire et son rêve d’amour. L’amour est d’abord « le prix de la gloire », ce qui la rend désirable ; il est ensuite ce qui l’inspire et ce qui y conduit ; il est enfin sa réalisation la plus haute et la plus pure. Lequier mêle l’amour à toutes ses pensées, à ses buts d’avenir, à sa tâche présente. On trouve, dans des brouillons de lettres, ces phrases inachevées qui sont comme des cris de passion :
Pendant que, dévoré de soucis, je traçais les trop imparfaites esquisses d’une œuvre où votre image brillait de toutes parts et qui aurait été immortelle si… pouvait suppléer au talent, mille idées son honneur : il est déjà bien cruel de n’être pas aimé, mais être blâmé, méprisé, peut-être, de celle qu’on aime, quel supplice ! Lequier s’écrie :
Mais il faut que vous connaissiez le plus cruel, le plus intolérable de mes chagrins. La cause de cet affreux chagrin, c’était votre blâme. Je n’ai guère occupé vos pensées, c’est vrai ! Mais, à un certain moment, un jour, je ne sais quand, vous avez dit en vous-même : « Il a mal agi », et en vous bornant à m’oublier vous avez pu vous croire encore généreuse. Je m’arrête. C’en est trop, je n’ai plus de courage. Une sueur froide mouille mes tempes.
Et il ne peut se disculper ; il ne peut qu’implorer Dieu, le supplier d’éclairer cette âme qui se détourne de lui, qui le méconnaît et l’offense :
Mon Dieu ! Ôtez-lui cette pensée ! Est-ce que tout m’accuse ? Rien ne plaide donc en ma faveur ? Je suis condamné au silence ; le respect l’exige. Au malheur de vous avoir déplu n’ajoutons pas celui de vous avoir offensée. Taisons-nous. Mais le premier des devoirs est de défendre le premier des biens. Parlons donc. Mais que lui dirai-je ? Que savez-vous et qu’ignorez-vous ? Que dois-je ici vous apprendre ? Assez et rien de trop… Tâche impossible ! Et pourtant je ne puis demeurer sous le coup d’une imputation qui me blesse profondément dans mon honneur. Qu’est-ce au fond que ce ténébreux amas de puérilités ! Oh ! prenez pitié de mon trouble !
Nous sommes ici en présence d’un mystère qu’il faut renoncer à pénétrer. Admettons que, quelque intérêt que Lequier eût à l’éclaircir, il ne pouvait le faire en effet sans manquer à l’honneur ou au respect, aux ménagements de tout ordre, qu’il devait à Mlle Deszille. La vie a de ces imbroglios, de ces situations sans issue. Quel drame ! Et comme il retentit dans l’âme de Lequier en accents douloureux !
Il excuse, il veut excuser d’abord Mlle Deszille :
Votre blâme, blâme immérité, mademoiselle, sachez-le, vous n’en êtes pas coupable, puisque vous avez été mal instruite… Sans doute, j’ai fait des fautes, mais pas cette faute indigne !
Après l’avoir excusée, il l’accuse, mais avec quels ménagements ! Ce qui serait excusable chez une autre ne l’est pas chez elle, si bonne vis-à-vis de lui, qu’elle connaît, qu’elle aime et dont elle ne devrait pas douter.
Vous avez pu m’accuser, moi, sans m’entendre, sans supposer que peut-être je pourrais me justifier, sans qu’une voix vous ait crié du fond des entrailles : Arrêtez ! Sur des ouï-dire, sur des rapports sans consistance, m’attribuer d’odieux procédés, des procédés dont l’idée me glace ! Que ferait de plus la haine ? Quoi ! dans la plus noble des âmes, rien n’a protesté ! Vous m’avez hardiment condamné, absent et muet !… La chrétienne n’a pas protesté !





























