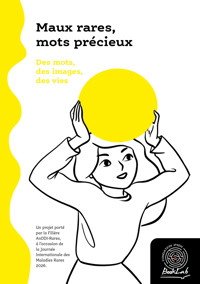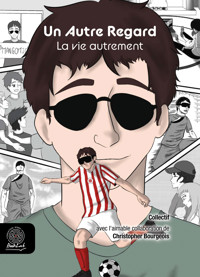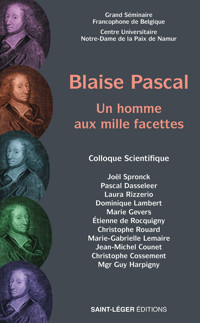57,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anthemis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Cet ouvrage a pour but d’analyser de manière efficace les perspectives et opportunités qui s’offrent aux dirigeants d’entreprise tout au long de leur carrière, en fournissant au lecteur une vision globale, transversale et interdisciplinaire du sujet.
Tout d’abord, Gabrielle Eymael se penche sur le statut social du dirigeant d’entreprise et décrit la couverture sociale et les conditions d’octroi de chaque prestation. Elle expose ensuite la méthode de calcul des cotisations, permettant à l’indépendant de prévoir le montant de ses prochaines charges sociales. Enfin, les réformes en matière de droits sociaux et de calcul des cotisations, actuellement en cours de discussion, sont abordées afin de permettre au lecteur de se préparer aux changements à venir. Dans un second temps, Thierry Dekoker et Christian Thibaut fournissent un résumé complet et précis des diverses formes de rémunérations, pour mieux appréhender cette notion parfois complexe du « package salarial » du dirigeant d’entreprise. Pierre Vanhaverbeke se penche ensuite sur la problématique des faux indépendants et consacre la deuxième partie de son exposé aux sociétés de management. Il met ainsi en lumière les avantages, les inconvénients et les risques liés à la création d’une telle structure. Thierry Litannie et Sébastien Watelet abordent enfin la problématique de l’investissement immobilier du dirigeant d’entreprise selon une double question : investir à titre personnel ou par le biais d’une société immobilière, d’exploitation ou de management ? Ce problème complexe, surtout lorsque l’acquisition concerne un immeuble destiné à être occupé par le dirigeant au titre de logement, est analysé dans le contexte des dernières réformes fiscales adoptées par le législateur.
Cet ouvrage intéressera les consultants, conseillers starters, banquiers, dirigeants d’entreprise et tous ceux qui, à la faveur de leur activité professionnelle, sont confrontés à ces questions.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LES ATELIERS DES FUCaM
Collection sous la direction de Patrick Jaillot
LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE
Aspects sociaux et fiscaux
Thierry DEKOKER Gabrielle EYMAEL Thierry LITANNIE Christian THIBAUT Pierre VANHAVERBEKE Sébastien WATELET
© 2013, Anthemis s.a. Place Albert I, 9, B-1300 Limal Tél. 32 (0)10 42 02 90 - [email protected] - www.anthemis.be
Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit, réservées pour tous pays.
Dépôt légal : D/2013/10.622/9 ISBN : 978-2-87455-781-1
Mise en page : MC Compo ePub : ebookme
Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Sommaire
Le statut social du dirigeant
Gabrielle EYMAEL
Les rémunérations directes et indirectes du dirigeant d’entreprise
Thierry DEKOKER et Christian THIBAUT
Le dirigeant d’entreprise et la société de management
Pierre VANHAVERBEKE
Dirigeants d’entreprise et investissement immobilier – problèmes d’actualité
Thierry LITANNIE et Sébastien WATELET
Table des matières
Le statut social du dirigeant
Gabrielle EYMAEL1
Juriste (UCM)
Introduction
Le dirigeant d’entreprise se voit appliquer en Belgique le statut de travailleur indépendant. À ce titre, il doit, en principe, payer des cotisations sociales qui lui permettent de sauvegarder ses droits sociaux.
Il faut dès le départ souligner que ces droits sont réservés aux indépendants qui exercent leur activité à titre principal ou en tant que conjoint aidant cotisant au maxi-statut. Il faut également que des cotisations minimales soient versées dans le régime des travailleurs indépendants. En d’autres termes, ceux qui ont obtenu une exonération ou une réduction de cotisations ne bénéficient pas des droits prévus par le statut social.
Ce statut a fortement évolué mais reste toutefois plus limité que celui des travailleurs salariés.
Une description de la couverture sociale et des conditions d’octroi de chaque prestation est donc nécessaire d’une part pour y recourir en cas de besoin, mais également pour pouvoir déterminer les couvertures sociales complémentaires que l’indépendant se doit de prévoir pour être parfaitement assuré.
Le présent exposé ne peut toutefois que décrire brièvement chaque prestation. Il est donc conseillé de s’adresser à sa caisse d’assurances sociales pour connaître les conditions précises d’octroi dans des situations particulières.
Comme cela a déjà été précisé, une des conditions premières de l’octroi de droits est le paiement de cotisations sociales.
La base du calcul de celles-ci sera d’abord examinée. Cette base de calcul peut être influencée par les charges professionnelles du dirigeant d’entreprise. Parmi ces charges, on peut retrouver des cotisations versées volontairement pour obtenir des droits complémentaires.
La méthode de calcul exposée permettra de déterminer le montant de cotisations auquel l’indépendant doit s’attendre.
Que ce soit au niveau des droits sociaux ou du calcul des cotisations sociales du travailleur indépendant, des réformes sont en cours de discussion. Ces réformes seront également évoquées afin de permettre au lecteur d’y voir plus clair.
Section 1Les droits sociaux du dirigeant d’entreprise
Le statut social des travailleurs indépendants s’est constitué au fil des années en commençant par la création des allocations familiales en 1937, l’octroi d’une pension en 1956 et l’assurance maladie-invalidité en 1963. Plus près de nous, la création d’une assurance sociale en cas de faillite ou de cessation forcée vient compléter un statut qui apporte actuellement une certaine sécurité au travailleur indépendant, mais ne le couvre pas totalement face aux aléas de la vie.
§ 1. Des droits pour les travailleurs indépendants
Pour pouvoir bénéficier des droits sociaux prévus par le statut social, il faut d’abord être assujetti à ce statut. En d’autres termes, il faut que l’activité exercée soit considérée comme une activité indépendante.
L’assujettissement est déterminé en fonction de différents critères définis par la loi.
Ces critères sont analysés dans l’exposé de Messieurs Thibaut et Dekoker. Il en est de même pour les critères de distinction entre une activité indépendante et une activité salariée.
Il faut ensuite que l’indépendant se soit affilié auprès d’une caisse d’assurances sociales.
§ 2. Des droits sociaux pour certaines catégories d’indépendants
Si les obligations (dont le paiement de cotisations sociales) s’imposent à tous les travailleurs indépendants, le bénéfice des droits sociaux est réservé aux travailleurs indépendants cotisant à titre principal et à ceux cotisant au maxi-statut du conjoint aidant.
Il faut donc pouvoir déterminer exactement la catégorie de cotisant avant d’attribuer les droits sociaux du régime indépendant.
L’indépendant à titre principal est celui qui soit n’exerce qu’une activité indépendante, soit pratique à côté de cette activité une autre activité qui ne peut être considérée comme principale au sens de la législation des travailleurs indépendants.
Cette matière est régie par les articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967.
L’activité indépendante sera considérée comme complémentaire si la personne dispose d’au moins un mi-temps dans le régime salarié ou celui des agents de l’État ou s’il exerce 6/10e d’un horaire complet pour les enseignants nommés. Le bénéfice d’un préavis, d’un crédit-temps ou d’allocations de chômage2 peut permettre, sous certaines conditions et pour une certaine durée, de maintenir un assujettissement à titre complémentaire.
L’assujettissement à titre principal ou celui en tant que conjoint aidant maxistatut donne en principe accès à tous les droits sociaux.
Le mini-statut du conjoint aidant (réservé au conjoint aidant né avant le 1er janvier 1956) permet uniquement l’octroi des indemnités d’incapacité de travail et de l’allocation de maternité.
Les indépendants exerçant leur activité à titre complémentaire sauvegardent leurs droits dans l’autre régime (salarié par exemple) dont ils dépendent et ne disposent donc pas de droits dans le régime indépendant. Il existe toutefois, sous certaines conditions, la possibilité de valoriser des années de carrière en matière de pension, pour autant que des cotisations au moins égales à celles des indépendants à titre principal aient été payées.
§ 3. Des droits en échange du paiement de cotisations sociales
Outre le fait de disposer d’une catégorie de cotisant permettant l’octroi des droits, il faut encore que les cotisations sociales réclamées par la caisse d’assurances sociales aient été payées.
Lorsqu’une exonération ou une réduction de cotisations sociales3 est obtenue, cela entraîne la perte totale des droits.
L’obtention d’une dispense de cotisations enlève les droits en matière de pension pour les trimestres concernés mais assure la sauvegarde de l’assurance maladie-invalidité et des allocations familiales.
Si, par ailleurs, la caisse d’assurances sociales n’arrive pas à récupérer les cotisations enrôlées à charge d’un affilié et qu’elle finit par considérer ces cotisations comme irrécouvrables, aucun droit ne sera octroyé pour les trimestres impayés.
Dans certaines hypothèses, aucun paiement de cotisation n’est toutefois exigé. Pour chaque prestation, il sera précisé si les cotisations doivent être payées ou pas.
§ 4. Les prestations familiales
Le régime indépendant comporte différentes prestations :
l’allocation de naissance ;la prime d’adoption ;les allocations familiales.Le paiement des allocations familiales n’est plus lié depuis le 1er juillet 2008 au paiement de cotisations sociales. Le simple fait d’être travailleur independent affilié à une caisse d’assurances sociales permet d’ouvrir le droit aux allocations familiales.
L’attributaire est la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales. Si des allocations peuvent être payées dans le régime des travailleurs salariés, c’est, sauf exception, ce dernier régime qui prévaut. Il permet en effet, dans l’état actuel de la législation, de bénéficier d’allocations plus élevées.
Lors de l’inscription d’un enfant à l’administration communale, celle-ci remet aux parents deux attestations, l’une est destinée à la caisse d’assurances sociales et permet à la fois l’octroi de l’allocation de naissance4 et des allocations familiales. L’enfant reste bénéficiaire d’allocations familiales :
inconditionnellement jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans ;jusqu’à l’âge de 21 ans pour l’enfant handicapé ;jusqu’à l’âge de 25 ans : en faveur de l’enfant qui suit des cours ;pour l’étudiant demandeur d’emploi et seulement pendant une période de 180 ou 270 jours suivant qu’il ait ou non atteint l’âge de 18 ans au moment de l’introduction de sa demande d’allocations de chômage, ceci pour autant qu’il ait terminé un cycle d’études et qu’il soit resté inscrit comme demandeur d’emploi ;en faveur de l’enfant qui ne suivant plus de cours, prépare un mémoire de fin d’études supérieures à condition que celui-ci soit une condition pour l’obtention de son diplôme. L’enfant bénéficiera des allocations familiales durant une période qui ne peut excéder un an et qui commence après les dernières vacances d’été et finit à la date de la remise du mémoire ;en faveur de l’enfant lié par un contrat d’apprentissage à condition que le salaire mensuel ne dépasse pas le montant maximum autorisé ;en faveur de l’apprenti demandeur d’emploi mais seulement durant une période de 180 jours civils ou 270 jours civils selon que l’enfant ait ou non atteint l’âge de 18 ans lors de son inscription comme demandeur d’emploi ;l’enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique à condition qu’aucun salaire ne soit perçu et que l’activité lucrative éventuelle exercée pendant le stage n’excède pas 240 heures/trimestre.L’allocation est payée en priorité au père de l’enfant.
Des allocations majorées sont prévues pour les orphelins, les enfants handicapés, les familles monoparentales, les enfants de chômeurs qui deviennent indépendants, les enfants de travailleurs invalides ou handicapés et les enfants de personnes pensionnées5.
Prestations familiales (barème en vigueur au 1er décembre 2012)
Allocations de base pour enfants handicapés de moins de 21 ans
Allocations supplémentaires pour enfants handicapés de moins de 21 ans
Enfants nés avant le 1er janvier 1993 qui bénéficient encore de l’ancien système d’évaluation :
Tous les enfants :
Allocations forfaitaires pour un enfant placé
Supplément annuel pour la rentrée scolaire (montants valables pour août 2012)
Suppléments d’âge
Malgré une forte évolution des montants ces dernières années, il reste une différence par rapport au régime salarié au niveau de l’allocation du 1er enfant et des suppléments d’âge (aucun supplément d’âge n’est accordé pour l’enfant unique ou pour le dernier enfant du groupe alors qu’il existe un supplément pour chaque enfant dans le régime salarié).
Aucune assurance ne couvre les différences encore existantes mais la vision consistant à considérer le droit de l’enfant implique une suppression à court terme de celles-ci.
La réforme prévue pour 2014 évoque une égalisation du montant des allocations familiales avec les allocations des salariés ainsi qu’une communautarisation de la gestion de ces allocations, ce qui créera plus que probablement une différenciation de montant entre les différentes Communautés de notre pays.
§ 5. L’aide à la maternité
Il s’agit de l’octroi gratuitement de 105 titres-services à la travailleuse indépendante qui vient d’accoucher.
La demande doit être introduite auprès de la caisse d’assurances sociales au plus tôt à partir du 6e mois de grossesse et, au plus tard, à la fin de la 15e semaine qui suit la date de l’accouchement.
Pour pouvoir obtenir les titres-services, l’indépendante doit être en ordre de cotisations sociales pour les deux trimestres qui ont précédé le trimestre de son accouchement.
Cette prestation n’a pas de pendant dans le régime des travailleurs salariés.
§ 6. La pension
Le système de pension des travailleurs indépendants est basé sur un système de répartition. Ainsi, les travailleurs indépendants exerçant leur activité aujourd’hui paient pour les pensionnés d’aujourd’hui.
Le régime indépendant prévoit :
une pension de retraite ;une pension de survie ;une pension de conjoint divorcé et une pension de conjoint séparé.Le texte qui suit sera principalement centré sur la pension de retraite.
A. La pension de retraite
1. L’âge de la retraite
Il n’y a pas d’obligation de prendre sa pension. L’indépendant peut poursuivre sa carrière aussi longtemps qu’il le souhaite.
Dans le régime des travailleurs indépendants, l’âge de la retraite est fixé à 65 ans aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
La pension prend ainsi cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l’âge précité sauf si l’indépendant souhaite ne pas partir à la retraite.
2. Anticiper la prise de pension
Lorsque le travailleur indépendant souhaite prendre sa pension avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, il peut décider de demander une pension anticipée.
En 2012, l’anticipation n’est possible que si les conditions suivantes sont respectées :
la pension ne peut être prise au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 60eanniversaire ;il faut prouver une carrière professionnelle d’au moins 35 années civiles susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou de plusieurs régimes légaux belges de pension6.Pour le calcul des années de carrière, une année est prise en compte si :
deux trimestres à titre principal sont justifiés dans le régime indépendant ;104 jours d’occupation à temps plein ont été prestés dans le régime salarié.Sont également prises en compte les années d’assimilation pour cause de service militaire alors que les années d’assimilation de périodes d’études ne peuvent être utilisées.
La prise de pension anticipée a une conséquence importante sur le montant de la pension qui sera versée au travailleur indépendant. Elle entraîne une réduction définitive du montant de la pension.
Ce malus n’existe pas dans le régime des travailleurs salariés. En 2012, la pension est réduite de manière définitive en tenant compte des pourcentages ci-dessous :
* Pour l’application du coefficient de réduction, il est tenu compte de l’âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.
Il existe toutefois une exception au principe de réduction du montant de la pension en cas de prise de pension anticipée.
La réduction ne devra pas s’appliquer si le travailleur indépendant peut justifier de 42 années de carrière susceptibles d’ouvrir des droits à la pension dans un ou plusieurs régimes légaux de pension, belges ou étrangers7.De nouvelles mesures sont d’application au 1erjanvier 2013.
L’objectif est évidemment d’inciter le travailleur indépendant à poursuivre son activité le plus longtemps possible.
a) Une augmentation de l’âge de départ à la pension anticipée et du nombre d’années de carrière
Deux périodes sont prévues :
une période transitoire de 2013 à 2015 ;une période définitive à partir de 2016.Deux mesures transitoires pourraient toutefois être appliquées :
– Conservation des droits acquis
Tout indépendant qui satisfait à une date déterminée aux conditions en vigueur pour obtenir une pension anticipée conserve cette possibilité à une date ultérieure.
Exemple L’indépendant, né en août 1952, justifiant 35 années de carrière pourra prendre sa pension anticipée en 2013 malgré le fait qu’il ne remplit pas la nouvelle condition des 38 années de carrière. Il entrait en effet dans les critères de 2012 et garde donc le droit à la pension anticipée sur la base des conditions de 2012.
– Règles spécifiques pour ceux qui sont proches de la pension anticipée
Les dispositions légales en la matière ne sont pas encore parues. Ce qui suit doit donc être pris avec réserve.
Les personnes, nées avant le 1er janvier 1956, qui disposent d’au moins 32 années de carrière au plus tard au 31 décembre 2012 pourront prendre leur pension anticipée au plus tôt à 62 ans dès qu’elles pourront prouver au moins 37 années de carrière.
Exemple L’indépendant, né en septembre 1955, justifie 32 ans au 31 décembre 2012. En cas d’application stricte de la réforme, il devrait attendre l’âge de 65 ans pour obtenir sa pension (soit en 2020). Avec l’assouplissement prévu, il pourra en bénéficier dès le 1er octobre 2017.
b) Autre nouveauté en 2013
L’assouplissement du malus à partir de 2013 dans les deux situations suivantes :
la pension anticipée à l’âge de 60 ans et demi en 2013 ou 61 ans en 2014 donnera lieu à une réduction de la pension de 21,5 % ;en 2015, pour la pension anticipée à 61 ans et demi, le taux de reduction est ramené à 15 %.La suppression du malus à partir du 1er janvier 2013 :
pour l’indépendant qui prend sa pension anticipée à partir de 63 ans ;pour l’indépendant de moins de 63 ans qui prend sa pension anticipée avec une carrière d’au moins 41 ans.3. Introduction de la demande de pension
La demande peut être introduite un an avant la prise de la pension.
Cette demande peut être faite via :
l’administration communale ;l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) ;le site www.demandedepension.be.Suite à l’intervention du médiateur Pensions, un examen d’office des droits à la pension est désormais prévu à 65 ans. Ceci afin d’éviter que certaines personnes n’oublient de demander l’octroi de leurs droits.
4. Mode de calcul de la pension du travailleur indépendant
a) Le principe de l’unité de carrière
On ne peut justifier plus de 45 années de carrière. Lorsque l’assujetti dispose d’une carrière professionnelle de plus de 45 ans, seules 45 années (les meilleures) seront prises en compte pour le calcul de la pension.
b) Les années de carrière prises en compte
Il s’agit des années entre le 20e anniversaire et le 31 décembre de l’année qui précède la date de prise de pension.
Dans l’hypothèse de l’exercice d’une activité avant l’âge de 20 ans, les années antérieures à cet âge pourront être prises en compte pour autant qu’un maximum de 45 ans ne soit pas dépassé.
Font partie de la carrière du travailleur indépendant :
la période d’activité en tant qu’indépendant ;la période d’études (assimilée à de l’activité moyennant paiement – contrairement aux travailleurs salariés qui disposent d’un délai de 10 ans après leurs études pour solliciter le rachat de la période d’études, le travailleur indépendant peut introduire sa demande de valorisation quand il le souhaite) ;la période de service militaire (assimilée gratuitement) ;la période d’assimilation pour cause de maladie (assimilée gratuitement) ;la période pendant laquelle l’indépendant a bénéficié de l’assurance continuée (assimilée à de l’activité moyennant paiement) ;la période d’assurance continuée en cas de faillite (en vigueur avant 1997 avec assimilation gratuite) ;les périodes d’activité en tant que conjoint aidant qui ont pu être rachetées (ce paiement n’est plus possible depuis 2009) ;la période de détention préventive (assimilée gratuitement pour autant que le prévenu ne soit pas déclaré coupable) ;les périodes assimilées dans le cadre du plan famille (maladie grave d’un enfant et soins palliatifs).La preuve de l’existence d’années de carrière en tant qu’indépendant est différente selon que l’on se situe avant 1957 ou après cette année.
Pour les années postérieures à 1956, c’est le paiement des cotisations qui est pris en compte. Pour les périodes antérieures, l’indépendant pourra utiliser toutes voies de droit sauf le témoignage (ex : dossier fiscal, inscription au Registre du commerce, etc.).
c) Le principe de calcul de la pension
La carrière du travailleur indépendant est représentée par une fraction dont le dénominateur est d’office 45 (car la carrière maximale est de 45 ans) et dont le numérateur représente les années de carrière valables pour la pension. Chaque trimestre justifié vaut 0,25.
Ainsi un indépendant qui a exercé son activité du 2e trimestre 1980 au 4e trimestre 1990 aura une fraction de 10,75/45.
En raison de l’unité de carrière, la fraction ne peut dépasser 45/45.
Pour chaque année de carrière, il faut utiliser :
un revenu forfaitaire pour les années avant 1984 ;un revenu fictif pour les périodes assimilées à une activité professionnelle (assimilation maladie, service militaire, valorisation des périodes d’études, etc.) ;le revenu qui a servi de base au calcul des cotisations de l’année concernée (exemple : pour l’année 2012, sera pris en compte le revenu indexé de l’année 2009) si nécessaire limité au plafond intermédiaire indexé. Les notions d’indexation et de plafond intermédiaire sont expliquées dans le chapitre relatif au calcul des cotisations sociales.Lorsque c’est le revenu réel qui est utilisé, celui-ci doit se voir appliquer un coefficient.
Ce coefficient correspond :
pour les années 1984 à 1996 au rapport entre le taux de cotisation pour la pension chez les indépendants et le taux de cotisations pension chez les salariés ;après 1996, à un chiffre fixé par arrêté royal.Les revenus utilisés, qu’ils soient réels, fictifs ou forfaitaires, doivent également être adaptés à l’indice des prix à la consommation à la date de prise de cours de la pension.
Enfin, il faudra appliquer soit le taux isolé (60 %) soit le taux ménage (75 %). Le taux ménage est appliqué si le conjoint ne dispose pas d’une pension proper ni d’avantages sociaux ou si le conjoint exerce une activité autorisée.
Exemple Un indépendant qui a cotisé toute l’année 1999 sur la base d’un revenu de 31.035 EUR va voir cette base de calcul adaptée avec un coefficient de 0,405634 (reprenant l’indexation, le taux isolé, le coefficient d’adaptation). Le résultat donne un revenu adapté de 12.589 EUR auquel on applique la fraction de 1/45. La valeur de cette année est au final de ± 279 EUR.
Force est de constater que la pension qui est octroyée au travailleur indépendant sera souvent vraiment insuffisante.
Le régime indépendant a dès lors prévu l’octroi d’une pension minimale, sous condition, lorsque le calcul réalisé donne un montant inférieur à la pension minimale.
d) La notion de pension minimale
Pour pouvoir prétendre à une pension minimale, il faut avoir une carrière d’au moins 30 années (soit 2/3 d’une carrière complète).
La pension minimale des travailleurs indépendants a toujours été inférieure à celle des salariés.
Depuis quelques années, un rattrapage est en cours de réalisation.
Le montant de la pension minimale chez les salariés est actuellement de 16.636,77 EUR par an au taux ménage et de 13.313,61 EUR par an au taux isolé, soit respectivement 1.386,40 EUR et 1.109,47 EUR par mois.
Par rapport aux montants cités dans le tableau ci-dessous, on constate encore une différence qui devrait être comblée dans les prochaines années.
L’égalisation de la pension au taux ménage est prévue au 1er avril 2013.
Pensions de retraite et de survie (barème entré en vigueur le 1er décembre 2012)
Ces chiffres représentent les montants de pension minimale de retraite qui résultent de la justification d’une carrière complète en régime indépendant et qui sont payés au plus tôt à l’âge légal de la pension.
En d’autres termes, les montants ci-dessus sont octroyés si le travailleur indépendant dispose de 45 années de carrière. Il faudra dès lors proratiser ce montant si la carrière représente moins de 45 années.
5. Le bonus de pension
Il s’agit d’un supplément de pension applicable pour les pensions de retraite et de survie.
Ce bonus instauré depuis l’année 2007 doit permettre d’inciter le travailleur indépendant à ne pas trop anticiper sa prise de pension.
Les indépendants qui travaillent au-delà de l’âge de 62 ans ou qui prouvent une carrière professionnelle de 44 ans au moins peuvent bénéficier d’un bonus de 179,20 EUR par trimestre justifié. Le bonus est octroyé pour autant que le montant de la cotisation du trimestre concerné soit au moins égal à celui de la cotisation minimale d’un assujetti à titre principal et qu’elle soit entièrement payée.
Seules les années de carrière à partir du 1er janvier 2006 sont prises en considération pour l’application du bonus.
B. La pension de survie
Lorsque le travailleur indépendant décède, son conjoint peut bénéficier d’une pension de survie pour autant que ce conjoint :
ait atteint l’âge de 45 ans (la pension est possible avant 45 ans lorsqu’il a un enfant à charge ou est atteint de 66 % d’incapacité de travail) ;ait été marié pendant au moins un an avec le travailleur indépendant ;en ait fait la demande (dans les 12 mois du décès pour bénéficier de la pension dès le 1er jour du mois du décès, à défaut ce sera au 1er jour du mois qui suit la demande). Un examen d’office peut également avoir lieu si le travailleur indépendant bénéficiait déjà d’une pension de retraite ou avait déjà introduit sa demande de pension.Sera prise en compte pour le calcul de la pension de survie la carrière du travailleur indépendant entre le 1er janvier de ses 20 ans jusqu’au 31 décembre de l’année du décès.
C. La pension de conjoint divorcé
Pour pouvoir en bénéficier, il faut :
avoir atteint l’âge de la retraite (anticipation possible) ;avoir introduit une demande (examen d’office sous certaines conditions) ;prouver une carrière professionnelle dans le chef de l’ex-conjoint (pendant les années de mariage) ;ne pas avoir été déchu de l’autorité parentale ;ne pas avoir attenté à la vie de l’ex-conjoint ;ne pas s’être remarié ;ne pas déjà bénéficier d’une pension de survie.D. Exercice d’une activité indépendante tout en bénéficiant d’une pension
Le travailleur indépendant peut bénéficier de sa pension tout en exerçant une activité professionnelle pour autant :
qu’il en ait fait la déclaration préalable8. L’absence de déclaration entraîne d’office la suspension d’un mois de pension ;qu’il respecte le montant de la limite autorisée de revenus qui s’applique à sa situation.Lorsque ces conditions sont respectées, l’indépendant dispose d’un taux préférentiel au niveau du calcul de ses cotisations sociales et la base de calcul de celles-ci est limitée au montant de la limite autorisée.
Revenus professionnels annuels autorisés pour l’exercice d’une activité indépendante en 2012
Les revenus à prendre en compte sont les revenus professionnels nets de travailleur indépendant.
Lorsque la limite autorisée de revenus est dépassée :
d’au moins 15 % le paiement de la pension est suspendu pour toute l’année ;de moins de 15 %, le montant de la pension est réduit à concurrence du dépassement ;si c’est le revenu du conjoint qui dépasse le montant autorisé, il y aura réduction de la pension au taux isolé.Lorsque la pension est retirée, l’indépendant se voit également enlever le taux préférentiel au niveau de ses cotisations sociales.
Des assouplissements dans l’exercice de l’activité autorisée sont prévus. Ils sont actuellement en cours de discussion et dépendent des contraintes budgétaires.
Le Conseil des ministres du 11 janvier 2013 a ainsi adopté les mesures suivantes en matière de limites autorisées (les textes légaux ne sont pas encore parus, ce qui suit dans donc être pris avec réserve) :
La suppression des limites au travail autorisé pour les pensionnés de plus de 65 ans qui disposent d’une carrière professionnelle d’au moins 42 années.Des mesures correctrices pour éviter un impact négatif pour l’indépendant pensionné actif en matière de cotisations sociales. Une mesure complémentaire sera mise en œuvre pour que, dans le cadre de la suppression de toutes limites à l’activité autorisée à partir de 2013, les indépendants pensionnés qui ont 65 ans et 42 ans de carrière restent redevables, à revenus équivalents, de cotisations sociales d’un niveau identique et non supérieur à celles d’application jusqu’en 2012. Les modalités restent à définir.L’indexation automatique des limites à partir de 2013. Les nouveaux montants pour une activité indépendante en 2013 sont :Un assouplissement du dispositif actuel des sanctions en cas de dépassement des limites. Si le dépassement de revenus autorisés n’est pas supérieur à 25 % (au lieu de 15 % jusqu’en 2012), la sanction se limite à une suspension partielle de la pension à hauteur d’un même pourcentage.E. La Pension libre complémentaire
Vu les faibles montants de pension octroyés dans le régime indépendant, le travailleur indépendant doit absolument prévoir un complément par une Pension libre complémentaire et une épargne-pension privée.
Il faut rappeler que pour pouvoir déduire fiscalement les cotisations de Pension libre complémentaire, l’indépendant doit être en ordre de cotisations sociales au 31 décembre de l’année concernée.
Les informations sur la Pension libre complémentaire se retrouvent dans l’exposé de Messieurs Thibaut et Dekoker.
§ 7. L’assurance maladie-invalidité
Le régime des travailleurs indépendants prévoit :
une assurance soins de santé ;une assurance indemnités ;un congé de maternité.A. Les soins de santé
Pour pouvoir bénéficier des droits en matière de soins de santé, le travailleur indépendant doit d’abord remettre à sa mutuelle l’attestation délivrée par la caisse d’assurances sociales lors de son affiliation. Cette attestation le couvre jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit la date du début d’activité.
Le maintien des droits est ensuite assuré grâce au paiement des cotisations sociales.
La période de référence est alors la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle on se trouve. Ainsi, pour bénéficier des droits en 2013, l’indépendant doit être en ordre de cotisations sociales pour toute l’année 2011.
Cette information est communiquée à la mutuelle par la caisse d’assurances sociales via un flux informatique.
Cette assurance soins de santé a fortement évolué ces dernières années.
Au départ limitée aux «gros risques» (couvertures de soins en hôpital), elle a été étendue aux «petits risques» (remboursement des visites chez le médecin, kiné, etc.) depuis le 1er janvier 2008.
Depuis cette date, la couverture soins de santé d’un travailleur indépendant est identique à celle d’un travailleur salarié.
Le travailleur indépendant peut donc désormais se faire rembourser ses attestations de soins auprès de sa mutuelle.
B. L’assurance indemnités
Pour bénéficier des indemnités d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit avoir accompli un stage de 6 mois et être en ordre de cotisations sociales. L’incapacité de travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la mutuelle.
Alors que le travailleur salarié en incapacité de travail est d’abord indemnisé par son employeur pendant le 1er mois, le travailleur indépendant obligé d’arrêter son activité ne bénéficie d’aucune indemnité pendant ce 1er mois (mois de carence).
À partir du 2e mois d’incapacité de travail, des indemnités vont être payées par la mutuelle au travailleur indépendant.
Les montants sont identiques en incapacité primaire (jusqu’au 12e mois d’incapacité) et en invalidité (à partir du 13e mois d’incapacité). Toutefois, un supplément est accordé à l’indépendant en invalidité qui bénéfice de l’assimilation pour cause de maladie.
Indemnités journalières d’incapacité de travail (barème entré en vigueur le 1er décembre 2012)
Si l’on compare à la situation du travailleur salarié, il faut noter, outre le mois de carence, une différence encore très sensible au niveau des indemnités.
Ainsi un salarié bénéficiera d’une indemnité journalière de 77,41 EUR pour la période d’incapacité primaire (pas de distinction entre le chef de famille, le cohabitant ou l’isolé) et pour la période d’invalidité respectivement de 83,86 EUR, 70,96 EUR et 51,61 EUR selon que le travailleur salarié est chef de ménage, isolé ou cohabitant.
Afin de compenser ces différences, le travailleur indépendant peut recourir à une assurance «revenus garantis».
C. Le congé de maternité9
Une allocation de maternité est accordée durant la période de repos de maternité à la travailleuse indépendante et à la conjointe aidante affiliée à une caisse d’assurances sociales.
Pour en bénéficier, celles-ci doivent :
avoir accompli au moins 6 mois de stage auprès de la mutuelle ;être en ordre de cotisations sociales ;cesser toute activité pendant le congé de maternité.La durée du congé est de 6 à 8 semaines (7 à 9 semaines en cas de naissances multiples).
L’allocation de maternité s’élève à 440,50 EUR par semaine.
Les démarches pour demander cette allocation doivent être effectuées auprès de la mutuelle.
Du côté salarié, la durée du congé est de 15 semaines et l’indemnité correspond de 75 à 82 % du salaire.
Il faut noter que pendant son congé de maternité, l’indépendante reste assujettie au statut social des travailleurs indépendants et doit donc continuer à payer ses cotisations sociales.
L’indépendante peut prolonger son congé de maternité si son enfant doit rester hospitalisé plus de sept jours à partir de sa naissance. La prolongation est de 24 semaines maximum et sa durée est égale au nombre de semaines complètes d’hospitalisation de l’enfant (après les sept premiers jours).
Elle débute à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire. La période de repos postnatal facultatif ne débutera donc que le premier jour qui suit la fin de la prolongation.
La demande doit être faite auprès de la mutuelle.
Une allocation de maternité de 440,50 EUR sera versée par semaine.
En cas de décès de la mère avant la fin de la période de repos de maternité, la personne qui accueille l’enfant peut bénéficier du reste de la période de repos de maternité.
§ 8. Les droits sociaux après la cessation de l’activité indépendante
Le statut social prévoit des possibilités de sauvegarde des droits sociaux dans le régime indépendant après la cessation de l’activité.
Ces droits ne sont nécessaires que si la personne qui a mis fin à son activité indépendante ne peut bénéficier de droits sociaux dans un autre régime de sécurité sociale.
Même si le statut social ne comporte pas la création de droits à des indemnités de chômage, il faut toutefois signaler que lorsqu’une personne a exercé une activité salariée avant l’activité indépendante, que cette dernière a duré moins de 15 ans, le travailleur indépendant qui cesse son activité peut prétendre, sous certaines conditions, à des allocations de chômage. Ces allocations résultent de l’activité salariée exercée antérieurement et non de l’activité indépendante.
A. L’assimilation pour cause de maladie
Lorsqu’un travailleur indépendant cesse son activité pour cause de maladie ou d’invalidité, il peut demander à sauvegarder gratuitement ses droits sociaux dans le régime des indépendants.
Sa période de maladie sera ainsi assimilée à l’exercice d’une activité indépendante.
Les conditions pour obtenir l’assimilation sont :
en faire la demande auprès de sa caisse d’assurances sociales, qui transmettra la demande à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ;avoir été travailleur indépendant à titre principal au moins 90 jours au moment où l’assimilation peut prendre cours ;que l’incapacité de travail soit reconnue par la mutuelle ;avoir cessé toute activité indépendante ;veiller à ce que l’activité indépendante ne soit pas poursuivie par personne interposée ;ne plus bénéficier de revenus professionnels ;être en ordre de paiement des cotisations sociales.Début et fin de l’assimilation
L’assimilation débute au 1er jour du trimestre qui suit celui de la cessation d’activité.
Toutefois, si la cessation a lieu au cours du 1er mois d’un trimestre, l’assimilation prend cours au 1er jour de ce trimestre. La cotisation ne sera pas due pour ce trimestre alors qu’il y a eu activité.
En cas de reprise d’activité indépendante, la cotisation du trimestre de reprise est due sauf si cette reprise a lieu au cours du 3e mois d’un trimestre. Dans cette dernière hypothèse, la cotisation ne sera pas due et l’assimilation est garantie pour ce trimestre.
B. L’assurance continuée
La possibilité est offerte au travailleur indépendant cessant ses activités et moyennant certaines conditions de continuer à cotiser volontairement, pendant une période limitée, au régime qu’il quitte, en attendant qu’il puisse dépendre d’un autre régime de sécurité sociale et y cotiser.
Si les droits sociaux ne sont pas sauvegardés après la cessation d’activité, le travailleur indépendant peut recourir à l’assurance continuée en vue de conserver ceux-ci. Cette assurance facultative permet de faire la soudure entre le régime de sécurité sociale quitté (le statut social des travailleurs indépendants) et celui dans lequel le travailleur va rentrer (sécurité sociale des travailleurs salariés - statut d’agent de l’État - prise de pension).
Cette assurance peut être prise au maximum pour deux ans sauf si la cessation d’activité intervient dans les 5 ans précédant le 65e anniversaire (sa durée est alors de 7 ans).
Les conditions sont les suivantes :
être indépendant à titre principal depuis un an au moins ;être en ordre de cotisations sociales ;avoir cessé toute activité indépendante ;en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a lieu la cessation d’activité indépendante.Le bénéfice de l’assurance continuée implique le paiement