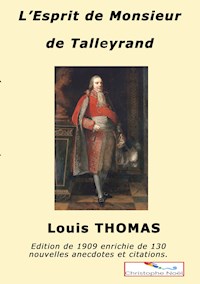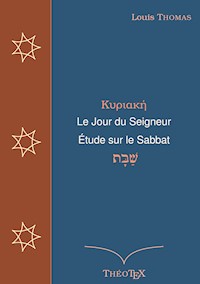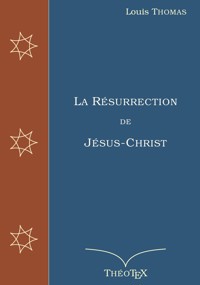
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Pas de vérité alternative, pas de en même temps macronien, pas de fake news, pas de big lie : la Résurrection est un fait ! Le tombeau est vide, non parce que les disciples ont volé le corps, mais parce que, comme il l'avait prédit, Jésus-Christ a vaincu la mort ! C'est à l'examen de ce fait que Louis Thomas (1826-1904) consacre son volume. On y trouvera un examen minutieux des passages des quatre Évangiles, du livre des Actes et de la première Épître aux Corinthiens, qui se rapportent à la mort, à la résurrection et à l'ascension du Seigneur Jésus. D'autres questions, secondaires mais néanmoins significatives, comme la place exacte de sa mort dans le calendrier juif, ou comme la nature de son corps durant les quarante jours de son séjour sur terre après le dimanche de la Résurrection, y reçoivent des réponses convaincantes. Jésus-Christ ressuscité a été vu premièrement par Marie-Madeleine, ensuite par les Apôtres, par plus de cinq cents disciples réunis en Galilée, par Jacques son frère ; quelques années plus tard, il apparaît en gloire au futur apôtre Paul, sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, c'est par l'action surnaturelle de l'Esprit Saint qu'il se manifeste aux âmes qui le cherchent, et qu'il leur donne une assurance de même valeur que celle des témoins de sa résurrection. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1870.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322484430
Auteur Louis Thomas. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Dans une scène justement célèbre, un grand poète a dépeint admirablement la puissance de la foi en Jésus ressuscité.
Il est nuit. Faust est dans son cabinet de travail, il vient de sentir avec accablement tout le néant de ses longues études en philosophie, en jurisprudence, en médecine. Désespérant d'arriver par ces différentes voies à la vérité, et cependant brûlant d'y atteindre et de satisfaire ainsi l'orgueil de la science le plus effréné, il s'adresse à l'alchimie que lui recommandait le souvenir de son père. C'est là qu'il espère saisir enfin le sublime objet de son ardente poursuite. Un moment il se croit au terme de ses désirs. Mais la lumière, qui avait soudainement brillé devant lui, l'enivrant de ses rayons, disparaît aussitôt pour faire place à de nouvelles et plus profondes ténèbres. Faust est plus désespéré que jamais, mais il veut encore arriver à la vérité, qui est pour lui le bonheur, et c'est alors que dans l'excès de son égarement, il conçoit un terrible projet: il veut essayer si la mort elle-même ne serait pas la révélation du grand mystère. Déjà la coupe fatale est préparée, Faust l'approche de ses lèvres, quand tout à coup retentit un son matinal de cloches et de pieux cantiques:
«Christ est ressuscité, chantent les anges! Qu'il se réjouisse, le mortel enchaîné par le péché!»
Faust s'arrête interdit, il reconnaît les chants de Pâques. Bientôt il distingue un second chœur: celui des saintes femmes venues pour embaumer le corps de leur Maître et exprimant leur douleur de trouver le sépulcre vide. Mais après elles, les anges reprennent: «Christ est ressuscité! Heureux celui qui aime, qui a surmonté l'épreuve douloureuse et salutaire!» — «Célestes accents, puissants et doux, se demande Faust, pourquoi me cherchez-vous dans la poussière?» Au nom de son incrédulité, il proteste contre l'attendrissement qui le gagne, il n'ose aspirer à ces sphères, d'où la bonne nouvelle retentit … Et pourtant il se sent irrésistiblement rappelé à la vie. Il se souvient de son enfance et de ses pieux dimanches et de ses belles fêtes de Pâques:
«Oh! retentissez encore, doux chants du ciel! finit-il par s'écrier. Les larmes coulent, la terre m'a reconquis!»
Que cette scène d'une poésie si belle, si profonde, si vraie, soit pour nous un symbole! O puissance de la foi en la résurrection de Jésus-Christ! Qu'elle peut être grande déjà sur l'homme en qui cette foi semble éteinte! Et combien plus grande encore, sur celui qui croit pleinement, du cœur et de l'esprit, — qui croit parce qu'il veut croire, et qui veut croire, parce qu'il sent bien qu'en croyant, il ne fait qu'accomplir son devoir et que rendre hommage à la vérité! L'Apôtre Pierre ne pouvait-il pas dire en toute simplicité de cœur et au nom de tous les chrétiens de l'Église primitive:
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître, en nous donnant, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, une vivante espérance (1Pi.1.3)?
Et si la foi en la résurrection de Jésus-Christ est d'une telle importance pour une vie d'homme, combien n'est-il pas souhaitable qu'elle pénètre et vivifie toute vie humaine collective, la vie de famille tout d'abord, mais aussi la vie nationale et même celle de l'humanité? Que n'a-t-elle pas déjà fait pour le renouvellement spirituel de notre race, et que ne ferait-elle pas encore et toujours plus, à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes, si elle était vivante dans tous les cœurs?
Pénétré, comme tant d'autres, de cette conviction et douloureusement affecté de voir dans ces derniers temps la résurrection de Christ ouvertement méconnue dans son importance ou même niée dans sa réalité, je me sentis pressé de répondre selon mes forces à l'appel que fit entendre une de nos sociétés religieuses, lorsqu'au mois d'octobre 1866 elle ouvrit un concours sur la question de la résurrection de notre divin Maître.
Je me mis aussitôt à étudier la question dans son ensemble, afin d'arriver d'abord à un plan d'études qui répondît aux exigences du sujet tel qu'il se présentait à mon esprit. Cette recherche préalable me convainquit de plus en plus et de l'immensité de la tâche qui s'imposait à quiconque essayait de l'entreprendre, et de l'impossibilité de s'en acquitter sans avoir du temps devant soi, sans entrer dans de vastes développements. Après plusieurs mois de travail et de méditation, j'arrivai au plan suivant, auquel dès lors je me suis arrêté et que l'on me permettra d'exposer sommairement.
Etudier d'abord le fait même de la résurrection de Christ, tel qu'il est exposé dans nos saints Livres, afin de bien définir la thèse à prouver, — puis passer aux preuves qui établissent la réalité du fait, — et enfin aux conséquences qui en découlent. De là trois grandes parties: l'étude du fait lui-même, celle des preuves et celle des conséquences.
Première partie: le fait Lui-même.
Le fait, c'est-à-dire non seulement le moment où Jésus revint à la vie et sortit de son tombeau, mais toute l'histoire du Seigneur depuis ce glorieux moment jusqu'à celui, plus glorieux encore, où il s'éleva dans le ciel en présence de ses disciples. Ainsi toutes les apparitions de Christ ressuscité pendant les quarante jours qui précédèrent son ascension. Et même encore le complément essentiel de ces apparitions: l'apparition du Seigneur glorifié, qui fut le point de départ de la carrière apostolique de St. Paul.
Pour étudier ce fait, ainsi défini, examiner et comparer toutes les données qui s'y rapportent dans les Évangiles, les Actes et les Épîtres; — préciser l'enseignement qui en ressort sur les deux grandes phases de la résurrection et de la glorification du Sauveur; — montrer par là que les diverses données bibliques, loin de se contredire, s'unissent et se complètent admirablement, en formant un ensemble dont la profonde et merveilleuse unité rend elle-même témoignage à la réalité de l'événement.
Seconde partie: les preuves.
D'abord les preuves positives indirectes, puis les preuves positives directes et enfin les preuves négatives.
I. Preuves positives indirectes.
1o Toutes les preuves de la divinité du christianisme, — puisque la foi en la résurrection de Christ, comme il faudrait le faire sentir, est une partie essentielle et centrale de la foi chrétienne, même de la foi chrétienne prise dans son sens le plus large, comme embrassant l'ancienne et la nouvelle Alliance, l'histoire de la préparation et de la fondation du Royaume de Dieu, ainsi que les prophéties relatives aux destinées ultérieures de ce Royaume.
2o Toutes les preuves de la crédibilité du Nouveau Testament, puisque l'enseignement de la résurrection de Jésus occupe manifestement une place plus considérable encore dans ce livre que dans le domaine général de la foi chrétienne.
Chacune de ces catégories de preuves positives indirectes devrait se terminer par l'exposé de la preuve intime fournie par l'expérience individuelle: preuve également accessible à tous et pouvant s'appliquer soit à la foi chrétienne elle-même, soit à l'autorité morale et religieuse du Nouveau Testament.
II. Comme preuves positives directes, il faudrait rappeler:
1o que le sépulcre où le corps de Jésus avait été déposé le vendredi soir, fut trouvé vide le dimanche matin, et que rien ne peut expliquer d'une manière plausible la disparition de ce corps, si ce n'est la résurrection de Jésus;
2o ce que suppose la foi des Apôtres en cette résurrection, surtout si l'on tient compte de la difficulté qu'ils eurent à croire, et de la transformation qu'opéra cette foi chez un Simon Pierre, un Jacques, frère du Seigneur, et un Saul de Tarse;
3o l'événement si considérable et si extraordinaire de la fondation de l'Église chrétienne, fondation reposant, de l'aveu de tous, sur la foi en la résurrection du divin Crucifié;
4o l'institution si antique du dimanche, comme solennisation de l'anniversaire hebdomadaire de la résurrection de Jésus;
5o l'expérience personnelle que font tous les vrais chrétiens depuis plus de dix-huit siècles dans un cercle toujours plus étendu, toujours plus immense: la régénération, la résurrection spirituelle qui s'opère dès ici-bas dans la personne du croyant et qui est pour lui à la fois une conséquence et une preuve intime de la résurrection du Rédempteur.
III. Quant aux preuves négatives ou à la contre-épreuve, il n'y aurait pas à revenir sur l'objection tirée de prétendues contradictions entre les différentes données de nos saints Livres, mais à faire ressortir plus ou moins brièvement:
1o l'inanité des objections générales tirées de la soi-disant impossibilité du miracle ou de sa constatation;
2o l'inanité des hypothèses par lesquelles l'incrédulité a cherché jusqu'à ce jour à expliquer l'existence de la foi de l'Église primitive à la résurrection de Jésus.
Troisième partie: les conséquences.
Il s'agirait ici de mettre en relief quelques-unes des conséquences qui découlent de la réalité de la résurrection de Christ, et de montrer en particulier que, si la divinité du Christianisme prouve la réalité de cette résurrection, cette réalité confirme à son tour, et de la manière la plus éclatante, la céleste origine de l'Évangile.
La première partie du travail devrait donc être surtout exégétique et historique. Le caractère prédominant de la seconde serait successivement dogmatique, critique, apologétique, polémique; elle se partagerait en quatre divisions qu'on pourrait ainsi désigner: la doctrine, les Évangiles, la preuve directe, la contre-épreuve. La troisième partie enfin serait essentiellement apologétique.
Tel est le plan d'études que nous nous sommes proposé. Il est assurément très vaste, mais il nous semble juste et complet. Nous devions le faire connaître d'avance pour expliquer la présente publication. Bien qu'elle puisse être regardée comme formant un vrai tout, il importe qu'elle soit aussi envisagée comme première partie d'un ensemble assez considérable. Elle-même, du reste, s'est développée au delà de nos prévisions.
D'abord, nous avons été conduit à la faire précéder de recherches, qui nous ont coûté parfois beaucoup de travail, soit sur les prédictions que Jésus a faites de sa résurrection d'après les Évangiles, soit sur la date et le lieu de sa mort et par conséquent de sa résurrection, soit sur sa sépulture. Ces recherches nous semblaient indispensables pour éclairer les textes relatifs à la résurrection de Christ et faire comprendre en particulier comment les disciples furent préparés à y croire.
En outre, il nous a paru de la plus haute importance d'étudier aussi complètement et aussi exactement que possible ce que relatent les documents sacrés sur la résurrection du Seigneur. Comme on l'a dit récemment et de plusieurs côtés, il s'en faut de beaucoup que cet incomparable événement, si vénérable et si essentiel qu'il soit pour les chrétiens, ait été déjà étudié comme il aurait dû l'être. Il y a là des champs de vérité qui sont encore en friche, et à certains égards il règne, même entre les théologiens croyants, une grande diversité de points de vue. Nous avons reconnu que plusieurs objections s'évanouissent devant un examen soigneux des textes et qu'à la place de ces objections, il s'élève même une preuve de sentiment, d'une haute valeur, dès qu'on arrive à contempler la réalité magnifique, vraiment digne de Dieu, que l'étude finit par dévoiler.
Cette première partie doit donc avoir déjà en elle-même une grande portée apologétique. A nos yeux, elle doit en avoir plus encore, puisqu'elle posera maints fondements sur lesquels s'appuieront les preuves proprement dites. Si Dieu nous permet de continuer notre œuvre, nous serons souvent appelé dans la tractation de la seconde partie à nous en référer aux résultats constatés dans la première
Sans doute dans cette première partie nous n'avons pas eu constamment pour but de réfuter l'erreur, de combattre en détail les assertions de Strauss ou de Renan. Nous avons plutôt cherché à exposer la vérité. Après avoir consciencieusement étudié, nous nous sommes efforcé de dire ce que nous avons reconnu, et de montrer comment nous y sommes arrivé. Nous n'avons pas craint même de procéder avec une certaine longueur, de mettre sous les yeux la traduction des textes ou les textes eux-mêmes, d'entrer dans des développements qui peuvent paraître excessifs, afin de faciliter la tâche de nos lecteurs et de prouver l'exactitude de nos recherches.
En fait, les lecteurs que nous avons eus surtout en vue, ce ne sont pas proprement ceux qui ne croient point à l'Évangile, mais ceux qui croient un peu et qui voudraient croire davantage, — ceux qui croient davantage et qu'inquiètent cependant certaines objections, — et aussi ceux qui croient pleinement et qui désirent joindre toujours plus à leur foi la science, soit pour leur propre développement spirituel (2Pierre.1.5), soit pour pouvoir mieux édifier leur prochain.
Nous espérons cependant que notre ouvrage sera le bienvenu pour tous ceux qui ont loyalement à cœur le progrès des études bibliques, quel que soit leur point de vue théologique. Nous avons émis en effet quelques idées un peu nouvelles. Le Maître n'a-t-il pas dit que tout scribe qui a été instruit pour le royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui tire de son trésor des choses neuves et des choses vieilles (Math.13.52)?
Mais quel désir n'avons-nous pas de rencontrer des lecteurs patients, sondant avec nous les Saintes Écritures, ne se laissant point arrêter par la simplicité des formes de notre travail, par la longueur de certains développements, par la minutie de certains détails, lisant toujours, relisant, s'il le faut, et surtout lisant jusqu'à la fin! Nous osons penser que ceux qui auront persévéré, n'auront point à le regretter.
La foi ne vient pas, il est vrai, de la science. La foi est tout d'abord un don de la grâce de Dieu et, au point de vue humain, elle est un fruit de la conscience et de la bonne volonté plus encore que de la science ou même de la vue immédiate de la réalité, pour ceux à qui cette vue fut accordée. En principe, telle est notre conviction, bien que nous pensions aussi que le jugement des cœurs doit être toujours laissé à Dieu, et que nous devons être nous-mêmes extrêmement humbles, charitables et prudents dans l'appréciation de nos frères. Il y a le même rapport entre la sainteté et la foi, qu'entre la vertu et le bonheur: en définitive, il y aura pour chacun la correspondance la plus intime entre le bien qu'il aura fait et le bonheur dont il jouira; mais on ne saurait dire qu'à tel moment donné, chacun soit exactement heureux ou malheureux, selon le degré de sa valeur morale. En principe donc et d'une manière générale, pour croire, pour croire véritablement, d'une foi personnelle, profonde, vivante, il faut vouloir croire sous le puissant aiguillon des besoins spirituels, il faut mieux aimer la lumière que les ténèbres, dans le grand sens moral et religieux que Jésus attachait à ces mots (Jean.3.18-21), — il faut vouloir faire la volonté de Dieu, comme Il le disait en prononçant une parole dont l'intelligence semble une des plus nobles conquêtes de notre âge, d'un Pascal et d'un Kant, d'un Schleiermacher, d'un Maine de Biran, d'un Vinet: Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef (Jean.7.17).
Cependant, bien que la foi ne vienne pas de la science, ne méconnaissons pas que la science peut et doit conduire à la foi, et la foi, engendrer à son tour une véritable science, en parfaite harmonie avec toute autre. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, une foule d'objections sont occasionnées par une connaissance incomplète de la vérité, et les disciples de Jésus peuvent redire sans crainte ce qu'Il répondait lui-même aux Sadducéens, en le leur démontrant d'une si admirable façon: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu (Math.22.29). Entendre les Écritures comme elles doivent être entendues, se faire quelque juste idée de la puissance de Dieu et non seulement de sa puissance, mais encore de sa sagesse, de sa sainteté, de son amour, de sa miséricorde, n'est-ce pas voir s'aplanir, comme par enchantement, de rudes et difficiles sentiers, qui menaçaient de devenir toujours plus impraticables? N'est-ce pas être transporté sur un de ces hardis sommets, où la vue du voyageur n'est plus, comme dans le fond de la vallée, gênée et bornée de toute part par une multitude d'obstacles? Sur le sommet de la montagne, le voyageur règne en quelque sorte par la puissance de son regard: il contemple tour à tour et avec la même liberté l'azur du ciel, les hautes cimes du voisinage, les lointaines perspectives d'un horizon sans limites, et aussi les hameaux du fond de la vallée: splendide spectacle, qui est tout empreint de majesté, de grâce et d'harmonie, et qui remplit le cœur de reconnaissance et d'adoration!
Quelque incomplète que soit notre œuvre en regard de notre plan, quelque vif que soit le sentiment que nous ayons nous-même de ses imperfections, nous n'hésitons point à la publier. Tandis que les uns y trouveront des longueurs, d'autres au contraire nous reprocheront de donner trop souvent de simples résumés de nos recherches, de ne point entrer assez profondément dans le cours des discussions. Nous l'avouons, c'est avec ces derniers que nous sympathiserions le plus volontiers, et nous eussions peut-être préféré nous concentrer dans quelque étude de détail, d'une importance évidente. Mais nous savons, d'autre part, que les études d'ensemble sont encore plus importantes que celles de détail, et que le détail lui-même ne saurait être expliqué sans la considération de l'ensemble. Nous savons aussi que le temps est court (1Cor.7.29), et nous avons hâte de sortir de cette première partie de notre travail pour pouvoir entrer dans la rédaction de la seconde. Puisse la voie moyenne que nous avons suivie, répondre aux besoins d'un certain nombre de lecteurs!
Que Celui dont nous avons souvent imploré le secours, veuille accompagner de sa bénédiction nos faibles efforts pour le service de la plus grande et de la meilleure des causes!
Cologny, près Genève, 20 novembre 1869.
Ce titre désigne le sujet principal, mais non exclusif de cette section. En effet, nous nous y occuperons aussi et de plusieurs des prédictions du Seigneur concernant ses souffrances et sa mort, prédictions presque toujours liées à celle de sa résurrection, et du fait de sa transfiguration, cette prophétie en action de la gloire que le Seigneur devait recouvrer en s'élevant au ciel. Nous devrons encore constater l'impression que produisaient sur les apôtres les prédictions de Jésus concernant ses souffrances et sa résurrection, pour nous préparer à comprendre la conduite des disciples pendant la crise si décisive qui s'ouvrit avec l'arrestation du divin Maître et se termina par son ascension.
Les Juifs lui répondirent donc en disant: Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répliqua et leur dit: Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai (ἐγερῶ). Les Juifs lui dirent donc: Il a fallu quarante-six ans pour que ce sanctuaire fût construit, et toi, tu le relèveras en trois jours! Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité des morts (ἠγέρϑη), ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. (Jean.2.18-22)
[Pour le texte du Nouveau Testament, nous nous servirons de la grande édition critique publiée par Tischendorf en 1859 (editio septima), et pour la traduction nous profiterons largement de celle qu'a publiée en 1858 M. Rilliet. Toutes les fois que nous nous écarterons sensiblement du texte de Tischendorf ou du sens de la traduction de M. Rilliet, nous en avertirons le lecteur. Quant à l'Ancien Testament, nous citerons en général la traduction de Perret-Gentil.]
Cette première prédiction de Jésus concernant sa résurrection se place quelque temps après son baptême, dans la première période de son ministère. Jésus était monté à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Il avait accompli dans les portiques du temple un acte d'une haute portée et d'une grande énergie, acte qu'il devait renouveler plus tard peu de jours avant sa mort (Matth.21.12-17; Marc.11.15-18; Luc.19.45-48).
[Comme les trois premiers Évangiles ne relatent qu'un séjour de Jésus à Jérusalem, celui où il fut mis à mort, on comprend comment on a pu identifier et la scène rapportée Jean.2.18-22, et celle décrite par les trois premiers Évangiles aux endroits que nous avons indiqués. Telle est l'opinion d'Ewald, Geschichte des Volks Israël, et de Pressensé, Jésus-Christ. — Nous préférons cependant admettre avec Tischendorf et Godet, qu'il y eut là deux actes analogues de la vie du Sauveur, l'un au commencement, l'autre vers la fin de son ministère — Il serait surprenant en effet que les deux premiers Évangiles n'eussent pas rattaché à leur récit de la purification du temple les paroles de Jésus qui, selon eux, furent tournées contre lui en accusation devant le Sanhédrin, (Matth.26.60-61; Marc.14.57-58) et en ironique outrage lors de la crucifixion (Matth.27.39-40; Marc.15.29-30), si ces paroles avaient été réellement prononcées lors de la purification du temple, qu'ils racontent. — Ici, comme souvent ailleurs, l'Évangile selon St. Jean complète admirablement les trois autres.]
Trouvant dans ces portiques des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que des changeurs, il avait fait un petit fouet avec des cordes, il avait expulsé tous les marchands de brebis et de bœufs, dispersé la monnaie des changeurs, renversé leurs tables et dit à ceux qui vendaient les colombes: Emportez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic! — C'est alors que quelques Juifs et probablement parmi eux des hommes chargés officiellement du soin du temple et, par conséquent, coupables au premier chef des profanations qu'ils toléraient, s'étaient approchés de Jésus et lui avaient dit: Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte, pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? — Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai, répondit Jésus — Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu quarante-six ans pour que ce sanctuaire fût construit et toi, tu le relèveras en trois jours! — Mais Lui, remarque l'Évangéliste, parlait du sanctuaire de son corps, et il ajoute: Lors donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Détruisez ce sanctuaire et je le relèverai dans trois jours, dit le Seigneur. Cette réponse paraît d'abord étrange. Les disciples ne la comprennent que longtemps après, postérieurement à la résurrection de leur Maître, et quant aux Juifs, pour le moment elle leur fait hausser les épaules, comme une véritable folie. Il en est de cette parole comme de beaucoup d'autres que renferment nos Évangiles, par exemple Jean.3.3; 6.51,54,55. Au premier aspect elles paraissent singulières, elles paraissent même à quelques-uns absurdes ou dures, ridicules ou repoussantes; mais plus on y réfléchit avec un cœur bien disposé, mieux on les comprend, plus on découvre sous leur forme étrange destinée à piquer la curiosité, à frapper l'imagination, un sens spirituel aussi bienfaisant pour l'âme que lumineux pour l'intelligence, des vérités profondes, inépuisables, infiniment précieuses, exprimées pour tous les siècles de la manière la plus saisissante.
Détruisez ce sanctuaire, et je le relèverai dans trois jours. En prononçant cette parole, Jésus ne parlait pas seulement du temple de Jérusalem, centre de tout culte, de tout sacrifice, sanctuaire du Dieu vivant, pour un temps déterminé et pour le seul peuple de l'ancienne Alliance. Comme l'Évangéliste le déclare, Jésus parlait encore d'un sanctuaire tout autrement digne de la divinité, tout autrement durable et parfait. Ce sanctuaire, c'était son propre corps, à lui, l'homme saint et juste, réalisant complètement la sublime image du Créateur, — à lui, le Rédempteur, qui venait apporter à la terre la bonne nouvelle du pardon, du salut et de la vie éternelle, et sans lequel nul ne saurait venir au Père, — à lui, le Fils de Dieu, qui seul pouvait dire: Je suis en mon Père et mon Père est en moi; les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est Celui qui fait les œuvres que je fais. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Mon Père et moi nous sommes un (Jean.14.9-11; 10.30).
Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. Dans cette parole prophétique au plus haut degré, Jésus annonçait sans doute la ruine du temple de Jérusalem et de l'ancienne Alliance symbolisée par ce temple, ruine que devait accomplir le peuple juif lui-même en mettant le comble à ses iniquités par le supplice de Golgotha; mais il annonçait encore sa propre mort, sa mort sanglante, ordonnée par les chefs de ce peuple, — sa mort expiatoire dont le sang devait sceller la nouvelle Alliance de grâce conclue pour tous les peuples, — sa mort pour nos péchés, qui devait être suivie de la plus glorieuse des résurrections, gage éclatant de l'acceptation de son sacrifice, légitime récompense du plus sublime des dévouements. Cette résurrection, Jésus l'annonçait déjà et il annonçait en même temps les bienheureuses conséquences qu'elle devait entraîner, — en première ligne l'envoi du Saint-Esprit par lequel il devait fonder au milieu de l'humanité déchue l'Église chrétienne, la Jérusalem spirituelle, constituant au milieu de l'humanité le vrai tabernacle de la nouvelle Alliance (Apoc.21.2-3) et dont chaque membre devait être lui-même un temple de l'Éternel (1Cor.3.16), un temple du Saint-Esprit (1Cor.6.19; comp. Apoc.21.22; 1Cor.15.28).
Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai. Quand les Juifs demandaient ainsi au Seigneur un signe auquel on pût reconnaître son autorité, cette demande faisait déjà connaître les mauvaises dispositions de leurs cœurs, car il n'était pas besoin d'un signe miraculeux pour légitimer un acte qui devait se légitimer de lui-même pour tout pieux Israélite. Jésus leur refuse donc un signe immédiat, mais en leur annonçant sa résurrection, il leur annonce un signe à venir, conditionné, il est vrai, par l'excès de leur iniquité, et n'en devant pas moins manifester avec éclat le divin caractère du Fils de l'homme — Et s'il leur annonce ainsi sa résurrection, il le fait en précisant déjà l'intervalle pendant lequel il devait rester dans le tombeau: et en trois jours, je le relèverai, dit-il.
[L'explication qui vient d'être donnée de ce difficile et important passage est aussi celle que de Pressensé indique en peu de mots (Jésus-Christ, p. 402) et que développe remarquablement Godet (Comm. sur St. Jean).]
On peut s'étonner sans doute de ce que le Seigneur a commencé par annoncer sa résurrection à ses ennemis et non à ses disciples. Toutefois cet étonnement disparaît quand on réfléchit que les disciples n'étaient point encore en état de recevoir de pareilles communications à eux spécialement adressées, et que le Seigneur, voulant dès le début de son ministère annoncer sa résurrection, était dirigé par la plus profonde connaissance du cœur humain quand il comptait plus sur la malveillance et l'aveuglement de ses ennemis que sur l'intelligence et le dévouement de ses disciples, tels qu'ils étaient alors. En fait, dans le jour à la fois si terrible et si béni où Jésus fut condamné par le Sanhédrin et crucifié sur le Calvaire, ses disciples semblaient avoir complètement oublié tout ce qu'il leur avait annoncé sur ses souffrances, sa mort et sa résurrection, bien qu'il leur en eût parlé à plusieurs reprises et en toute clarté. — Mais, devant le Sanhédrin, ne se présenta-t-il pas des faux témoins pour accuser le Seigneur d'avoir dit: Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de main d'homme (Marc.14.57-58; Matth.26.60-61), allusion évidente à la parole que Jésus avait prononcée dans les portiques du temple, mais où cette parole était gravement altérée, puisque Jésus avait dit, non pas: Je détruirai, mais: Détruisez vous-mêmes. — Devant la croix n'y eut-il pas des passants qui hochèrent la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même (Matth.27.39-40; Marc.15.29-30)? — Et le lendemain de la crucifixion, tandis que le corps inanimé de Jésus reposait encore dans le sépulcre et que les disciples étaient dans le deuil et les larmes (Marc.16.10), les principaux sacrificateurs et les pharisiens n'allèrent-ils pas ensemble vers Pilate pour lui dire: Nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait: Je ressusciterai dans trois jours, commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps et qu'ils ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts (Matth.27.62-64)?
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant: Maître, nous voulons voir un signe dont tu sois l'auteur. Mais il leur répliqua: Une génération méchante et adultère réclame un signe et un signe ne lui sera pas donné, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car de même que Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre trois jours et trois nuits. Les hommes de Ninive ressusciteront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi ressuscitera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon. (Matth.12.38-42)
C'est dans ces versets que se trouve de la manière la plus explicite la seconde des prophéties du Seigneur concernant sa résurrection, mentionnées par nos Évangiles.
Nous la retrouvons dans Luc.11.16,29-32, mais en termes plus brefs. Après qu'il a été parlé du signe de Jonas, l'Évangéliste ajoute seulement comme explication: car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera aussi un pour cette génération. Puis, ainsi que Matthieu, mais en ne suivant pas le même ordre que lui, il parle de la reine du Midi et des hommes de Ninive comme devant s'élever au jour du jugement contre les contemporains du Sauveur.
L'explication du signe de Jonas, qui est si nettement donnée dans Matth.12.40, nous paraît clairement indiquée dans le verset Luc.11.30, que nous venons de citer, puisque c'est la personne même de Jonas qui y est indiquée comme ayant été un signe. Il est vrai que les Ninivites ne furent pas témoins de la miraculeuse délivrance du prophète, mais la masse des contemporains du Seigneur ne devait pas davantage le contempler après sa résurrection, et cependant cette résurrection devait être un signe pour elle, comme la miraculeuse délivrance de Jonas avait été un signe pour les habitants de Ninive. Pour les uns comme pour les autres, le miracle devait être un signe, transmis par le moyen du témoignage et appuyé dans le premier cas par la prédication de Jonas, et dans le second par le souvenir de la prédication de Christ et par la prédication des apôtres.
Il nous semble au moins arbitraire de prétendre, comme on l'a fait trop souvent, que Matth.12.40 est une interprétation imaginée par l'Évangéliste ou la tradition, et ne remontant point au Seigneur lui-même. C'est une pure hypothèse qu'aucun fait ne vient confirmer. Nous voyons donc ici une seconde prédiction faite par le Seigneur concernant sa résurrection. Godet et de Pressensé la rapprochent avec raison de la première. Elle lui ressemble en effet sous plus d'un rapport: l'une et l'autre sont adressées directement, non aux disciples, mais aux adversaires; en outre, chacune est une réponse à une question des adversaires demandant à Jésus un signe attestant son extraordinaire mission. Moins riche de contenu que la première, la seconde est déjà plus précise, mais elle est encore figurée. Nous y retrouvons l'indication du temps que le Seigneur devait passer dans le sépulcre, mais ici il est vaguement question de trois jours et de trois nuits, comme dans le parallèle de Jonas, tandis qu'en fait le Seigneur ne devait rester dans le sépulcre que deux nuits et un jour, cet intervalle devant, du reste, être distribué entre trois jours de la semaine en embrassant la fin du vendredi, tout le samedi et le commencement du dimanche.
Nous n'avons point à nous étendre ici ni sur l'histoire du prophète Jonas, ni sur le livre où elle est rapportée. Rappelons seulement que ce livre n'est pas le seul endroit de l'Ancien Testament où il soit question de ce prophète, qu'il est parlé de lui 2Rois.4.25-27, comme ayant vécu sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël, et fait une prophétie qui fut accomplie par ce roi. — Rappelons aussi que le livre de Jonas est remarquable, entre autres égards, par l'élévation de son enseignement: la miséricorde de Jéhovah y est représentée comme s'étendant aussi sur les païens. Si l'histoire de Jonas est une prophétie en action de la résurrection de Jésus-Christ, elle ne l'est pas moins de la pleine révélation de la miséricorde divine que devait proclamer l'Évangile.
Cette seconde prophétie du Seigneur concernant sa résurrection reparaît dans l'Évangile selon Matthieu.16.1-4, mais encore moins développée que dans Luc.11.29-30. La scène est toujours en Galilée, mais à une époque postérieure, après la seconde multiplication des pains. Il est dit seulement dans le passage qu'aucun signe ne sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Mais rien n'implique que Jésus ait été aussi concis; et, s'il a été plus explicite, Matthieu pouvait d'autant plus se dispenser de rapporter toutes ses paroles qu'il avait déjà transmis avec plus de détail des paroles au moins analogues.
Marc.8.14-13 renferme un fragment évidemment parallèle à ce second fragment de Matthieu. Mais là il n'est plus même question du signe de Jonas: Pourquoi cette génération réclame-t-elle un signe? répond Jésus aux pharisiens, après avoir profondément gémi en son esprit. En vérité, je vous déclare qu'aucun signe ne sera donné à cette génération. Marc pouvait ainsi résumer la réponse de Jésus, dès qu'il ne lui convenait pas de parler du prophète Jonas: aucun signe ne devait être, en effet, immédiatement donné en réponse à la demande des pharisiens. L'Évangéliste n'écrivant point comme Matthieu pour d'anciens Juifs et étant souvent d'une extrême brièveté dans ses récits, pouvait juger convenable de ne point parler de l'allusion faite par Jésus à l'antique et miraculeuse histoire du fils d'Amittaï.
Nous n'éprouvons aucune difficulté à admettre que Jésus, ayant à répondre à la même question posée par la même catégorie de personnes, ait fait deux fois la même réponse. Nous comprenons même très bien qu'il ait pu répéter une déclaration prophétique qui devait tarder un peu à recevoir son accomplissement et dont le sens était aussi important que la forme en était impressive.
Mais Jésus connaissant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous veniez à voir le Fils de l'homme montant où il était premièrement… C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien; les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie; mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. (Jean.6.61-64)
Jésus prononça ces paroles après avoir accompli la première multiplication des pains sur la rive orientale du lac de Génézareth et avoir ensuite tenu dans la synagogue de Capernaüm ce mémorable discours où, en réponse à une nouvelle demande d'un signe et d'un signe analogue à celui qu'avait fait paraître Moïse en donnant aux Israélites la manne du désert, il déclara que c'était lui qui donnerait le vrai pain du ciel et que ce pain serait sa chair qu'il donnerait pour la vie du monde. Après ce discours, plusieurs de ses disciples eux-mêmes se disaient: Cette parole est dure, qui peut l'écouter? (v. 60) et c'est alors que Jésus, connaissant en lui-même ce que ses disciples murmuraient, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous veniez à voir le Fils de l'homme montant où il était premièrement…? C'est l'Esprit qui vivifie…
C'est dans ce verset 62 que nous voyons la troisième prédiction faite par Christ sur sa glorification future, prédiction faite à l'approche d'une fête de Pâque (Jean.6.4), c'est-à-dire une année après la première prédiction, si nous admettons avec Olshausen, Wieseler, Neander, Meyer, Lange, Tischendorf, Godet, que la fête dont il est question Jean.5.4 était la fête de Purim — Cette troisième prédiction est d'un tout autre genre que les deux précédentes: il ne s'agit plus des adversaires, mais des disciples. Il n'y a plus là d'image: Jésus ne pouvait pas s'exprimer d'une manière plus directe, mais il ne fait pas proprement une affirmation; il ne dit pas que le Fils de l'homme montera, mais seulement qu'il pourrait bien se faire qu'il montât — Remarquons en outre qu'il est ici parlé moins de la Résurrection que de l'Ascension à laquelle elle devait aboutir — Ajoutons enfin que Jésus ne dit pas: Et si le Fils de l'homme monte…? mais: Et si vous veniez à voir le Fils de l'homme montant? — ce qui implique bien que l'ascension aurait lieu d'une manière visible sous les regards des disciples.
Pour préciser plus encore le sens que nous donnons au passage et en même temps le justifier, qu'il nous soit permis d'emprunter une page, remarquable entre tant d'autres, au beau commentaire de M. Godet:
Les mots ἕαν et οὖν (v. 62) que nous avons traduits par: et si, ne s'appuient sur aucune proposition principale. Il faut en suppléer une. Mais il n'est point nécessaire de faire un détour en sous-entendant: «Que direz-vous alors?» Le résultat de ϑεωρεῖν (voir) peut se formuler d'une manière plus directe: «Votre scandale ne cessera-t-il pas?» ou bien, au contraire: «Ne serez-vous pas encore bien plus scandalisés?» C'est cette seconde question que sous-entendent de Wette, Meyer et Lücke. Il faut alors rapporter l'expression «monter là où il était auparavant» à la mort de Jésus: «Vous êtes scandalisés de m'entendre annoncer ma mort; combien le serez-vous davantage en contemplant réellement ce fait!» Mais ce raisonnement aurait peu de force: un fait n'est pas plus difficile à accepter que la déclaration qui l'annonce. Puis l'expression monter, qui est le pendant de celle de descendre employée dans tout ce chapitre pour désigner l'incarnation, fait bien plutôt penser à l'ascension de Jésus, à son retour dans la gloire, qu'à sa mort. Jésus dit après sa résurrection: Je ne suis pas encore monté (Jean.20.17). Sa mort n'est donc point ce qu'il appelle ici son retour. Lorsqu'il réunit à dessein ces deux notions: la suspension à la croix et l'élévation dans le ciel, dans une expression amphibologique (Jean.3.14; 12.32), il dit ὑψωϑῆναι et non ἀνβαίνειν. Enfin il est difficile, dans ce sens, d'établir une liaison aussi directe entre le v. 62 et le v. 63, que celle que suppose l'aposiopèse qui sépare ces deux versets. La seule explication conforme aux expressions du texte est, comme l'a reconnu Hilgenfeld lui-même, l'ancienne interprétation des Pères qui rapportent ces mots à l'Ascension proprement dite… Dans ce sens, la pensée de Jésus se comprend facilement: «L'idée de manger ma chair vous scandalise? Elle vous paraîtra plus absurde encore quand vous me verrez monter aux cieux. Mais alors aussi votre scandale cessera et vous comprendrez de quelle manducation j'ai voulu parler.» Le v. 63 se rattache tout naturellement, comme nous le verrons, à l'idée du v. 62 ainsi comprise. Lücke, Meyer et d'autres allèguent, contre l'application de ce verset à l'Ascension, que ce fait n'est point rapporté par Jean. Pour qui comprend le plan du quatrième Évangile et le rapport de ce livre aux Synoptiques, il ne résulte pas de là une objection. Jean ne mentionne pas davantage l'institution de la sainte Cène: en résulterait-il qu'il l'ignore ou qu'il la nie?
L'explication du v. 63, en rapport avec celle que nous venons de donner du v. 62, est celle-ci: «En voyant disparaître ma chair, à mon retour dans le ciel, vous comprendrez que le principe vivifiant dont j'ai voulu parler, en disant: Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, — c'est l'Esprit, et non la substance matérielle.» La Pentecôte: voilà donc le grand fait que promettait Jésus dans les paroles précédentes, c'est par l'Esprit que se réaliseront les promesses, v. 53-58. Ainsi s'explique l'analogie singulière des termes du v. 56 (Celui qui mange ma chair… demeure en moi, et moi en lui) avec ceux des ch. 14 à 17.
Lorsque Jésus fut arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, il interrogeait ses disciples en disant: Qui disent les gens qu'est le Fils de l'homme? Et ils lui dirent: Ceux-ci Jean-Baptiste, ceux-là Elie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit: Mais vous, qui dites-vous que je suis? Or, Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répliqua: Heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux…
Alors il prescrivit aux disciples de ne dire à personne: C'est lui qui est le Christ. Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait se rendre à Jérusalem, et beaucoup souffrir de la part des anciens et des grands-prêtres et des scribes, et être mis à mort, et ressusciter le troisième jour. Et Pierre l'ayant pris à part commença à le reprendre disant: Miséricorde te soit faite, Seigneur; certainement cela ne t'arrivera point! Mais lui s'étant retourné dit à Pierre: Va-t'en arrière de moi, Satan, tu m'es une pierre d'achoppement, car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes!
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive; car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera… Car le Fils de l'homme doit venir entouré de la gloire de son Père avec ses anges, et c'est alors qu'il rendra à chacun selon sa conduite. (Matth.16.13-27)
Le même récit se retrouve presque identique Marc.8.27-38, sauf les v. 17-19 que Matthieu est seul à transmettre. Dans Luc.9.18-26 le récit est sensiblement abrégé, bien qu'il renferme un nouveau détail sur ce que Jésus venait de faire lorsqu'il eut avec ses disciples la conversation rapportée: et il advint, pendant qu'il priait à l'écart, que les disciples se réunirent à lui et il les interrogea en disant: Qui dit la foule que je suis? — Ce détail a son importance, nous voyons Jésus prier avant tous les moments saillants de son ministère, et certes le moment auquel il prononça cette quatrième prédiction de sa résurrection, rentre bien dans cette catégorie. Nous sommes en plein dans ce qu'on a appelé: la crise de la foi en Galilée.
Au double point de vue de la chronologie et du caractère même des événements, nous atteignons le milieu du ministère actif du Seigneur. Une première période se termine et une seconde commence.
Jean-Baptiste venait d'être mis à mort par Hérode-Antipas (Matth.14.6-12; Marc.6.21-29), et celui-ci entendant parler de Jésus commençait à se préoccuper de lui, en l'associant au souvenir du Précurseur (Matth.14.1-2; Marc.6.14-16; Luc.9.7-9) — A cette nouvelle Jésus avait quitté la Galilée, sur laquelle dominait Hérode, et s'était réfugié sur la côte orientale du lac de Génézareth (Matth.14.13); c'est là qu'il avait accompli la première multiplication des pains. La multitude qui l'avait suivi, avait alors voulu l'enlever pour le faire roi, et Jésus avait dû aussitôt se soustraire à cet enthousiasme charnel en se retirant momentanément dans la plus complète solitude, après avoir forcé ses disciples à se rembarquer (Jean.6.14-15; Matth.14.22-23; Marc.6.45-46). Le lendemain, lorsque Jésus avait été retrouvé par la multitude à Capernaüm et qu'il avait déclaré dans la synagogue qu'il était lui-même le pain descendu du ciel, que sa chair était véritablement une nourriture, ces paroles avaient semblé trop dures à plusieursa de ses disciples, et dès lors ils l'avaient quitté (Jean.6.66) — Des scribes et des pharisiens étaient venus de Jérusalem pour l'interroger sur la conduite que tenaient ses disciples en n'observant pas les traditions pharisaïques sur les ablutions, et Jésus ne s'était pas borné à défendre ses disciples en posant le grand principe que ce qui souille l'homme vient du cœur, il avait commencé par prendre l'offensive en disant aux Pharisiens: Pourquoi vous-mêmes transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? (Matth.15.1-20; Marc.7.1-23) — Puis il avait de nouveau quitté la Galilée et s'était retiré au nord-ouest sur le territoire de Tyr et de Sidon (Matth.15.21; Marc.7.24) — Peu après il s'était rendu dans une tout autre direction, au milieu de la Décapole, au delà du lac de Génézareth, et c'est là qu'il avait accompli la seconde multiplication des pains. Il avait ensuite repassé le lac et avait reparu dans la Galilée, mais pour la quitter aussitôt, après avoir répondu à la nouvelle demande d'un signe adressée par les Pharisiens, dont nous avons déjà parlé, et avoir dit à ses disciples, en retraversant le lac, cette parole si sévère à l'égard d'Hérode et des pharisiens: Ayez soin d'être en garde contre le levain des pharisiens et contre le levain d'Hérode (Marc.8.15; comp. Matth.16.6) — Il s'était dirigé vers Bethsaïde-Julias, au delà du Jourdain et au nord du lac de Génézareth, puis encore plus au nord, vers Césarée de Philippe, au pied de l'Hermon.
Il était passé sans retour, le temps où Jésus rayonnait de Capernaüm dans toutes les localités de la Galilée, enseignant paisiblement dans le plus grand nombre des synagogues. Maintenant il devait être errant, souvent même sur terre païenne, pour ne pas précipiter le terrible dénouement dont l'heure n'était pas encore venue; il devait se mettre en garde, et contre Hérode, tétrarque de la Galilée, et contre les pharisiens de Jérusalem; il devait encore éviter d'exciter la multitude qui n'était que trop disposée à s'attacher à lui avec un zèle tout charnel; le nombre de ses disciples eux-mêmes avait sensiblement diminué.
Quant à l'entretien cité, il est parfaitement clair et nous n'avons à y relever que ce qui concerne le sujet particulier de cette étude. Aux progrès de l'opposition des adversaires et à la diminution des disciples correspond un progrès de la foi chez ceux qui restent fidèles, progrès bien marqué par la réponse si nette et si ferme de l'apôtre Pierre: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant! — Mais si ferme que fût cette foi, elle était encore peu éclairée, comme le prouvent les v. 22-23. Déjà cependant elle était assez formée pour que Jésus pût commencer à annoncer ouvertement à ses disciples, non seulement les souffrances et la mort ignominieuse qui l'attendaient à Jérusalem, mais aussi sa résurrection, v. 21: Dès lors il commença à montrer à ses disciples — (Marc.8.34: et il commença à leur enseigner) — qu'il lui fallait se rendre à Jérusalem, et beaucoup souffrir de la part des anciens et des grands-prêtres et des scribes, et être mis à mort et ressusciter le troisième jour. — Cette résurrection elle-même ne devait être que le prélude d'un événement tout autrement glorieux: après avoir parlé de la nécessité où se trouvait le disciple de suivre son Maître dans le renoncement et la souffrance, Jésus ajouta, v. 27: Car le Fils de l'homme doit venir entouré de la gloire de son Père avec ses anges, et c'est alors qu'il rendra à chacun selon ses œuvres.
Matth.17.1-9: Et six jours après — (Luc.9.28: or il advint, après ce discours, qu'au bout d'environ huit jours), — Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et il les conduit sur une haute montagne à l'écart — (Luc.9.28: pour prier). Là il fut transformé devant eux et son visage brilla comme le soleil, tandis que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière — (Marc.9.2-3: et il fut transformé devant eux et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'il n'est pas de foulon qui puisse ainsi blanchir. Luc.9.29: et pendant qu'il priait, l'apparence de son visage devint autre et son vêtement blanc comme l'éclair). Et voici Moïse et Elie leur apparurent conversant avec lui — (Luc.9.30-31: et voici deux hommes conversaient avec lui; c'était Moïse et Elie qui, apparaissant en gloire, disaient sa fin qu'il allait accomplir à Jérusalem). Mais Pierre prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je ferai ici trois tentes: une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie — (Marc.9.6… il ne savait pas en effet ce qu'il devait dire, car ils avaient été saisis d'effroi. Luc.9.32-33: or Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil; mais, quand ils se furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint pendant qu'ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus: Maître…, ne sachant ce qu'il disait). Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix sortant de la nuée dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Ecoutez-le! — (Luc.9.34: mais pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et elle les couvrait et ils furent effrayés quand ils entrèrent dans la nuée. Et une voix sortit de la nuée, disant: Celui-ci est mon Fils, l'élu, écoutez-le!) Ce que les disciples ayant ouï, ils tombèrent sur leur visage et furent saisis d'une grande peur. Et Jésus s'approchant d'eux les toucha et dit: Levez-vous et n'ayez point de peur. Et ayant levé les yeux, ils ne virent personne, si ce n'est Jésus seul. Et pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna un ordre, disant: Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts — (Marc.9.40: et ils s'attachèrent à cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait: ressusciter des morts. Luc.9.36: et eux se turent et ne rapportèrent rien à personne en ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu).
[M. Rilliet traduit: «de cette vision,» et il est certain que το ὅραμα doit être ordinairement traduit ainsi. Nous ne pensons pas cependant que cette traduction soit ici la bonne et pour appuyer notre opinion, qui est du reste l'opinion commune, nous ne saurions mieux faire que de citer les lignes suivantes de Bleek, que nous traduisons: «ὅραμα qui signifie proprement et en général: quelque chose de vu, désigne ordinairement dans la Bible des apparitions intérieures perçues dans un état extatique ou en songe, des visions (מַדִאֶה חָזוֹן). C'est ce dernier sens qu'il a souvent dans les Actes. Act.7.31 fait seul exception; toutefois il s'agit dans ce passage d'une apparition miraculeuse, surnaturelle, du buisson ardent que vit Moïse. Il en est de même de Matth.17.9: ὅραμα y désigne ce que les disciples avaient contemplé, sans préciser que ce fût par le moyen d'une vision, mais en impliquant que c'était quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Tandis qu'il y a dans Matth.: το ὅραμα, on trouve dans Marc: ἅ εἶδον, et dans Luc: ὡς ἑωράκασιν.]
On ne saurait comprendre cette scène si mystérieuse et si glorieuse sans la méditer en regard de son cadre historique et particulièrement de Matth.16.13-27; Marc.8.27-38; Luc.9.18-26, où nous avons vu Jésus commencer à annoncer ouvertement à ses disciples ses souffrances, sa mort et sa résurrection, — et de Matth.17.22-23; Marc.9.30-32; Luc.9.43-45, où nous le verrons, le lendemain même de sa transfiguration, répéter à ses disciples la même prédiction.
Au reste, la liaison du récit de la Transfiguration avec la première série des versets que nous venons d'indiquer est clairement signalée par les trois Évangélistes eux-mêmes, qui racontent la Transfiguration immédiatement après la mémorable conversation tenue dans les environs de Césarée de Philippe et en liant l'une à l'autre par ces mots: Et six jours après, Jésus prit avec lui… (Matth. et Marc), ou par ceux-ci: Or il arriva après ce discours qu'au bout d'environ huit jours… (Luc). Il y a plus encore: Luc rapporte expressément que Moïse et Elie conversaient avec Jésus sur la fin qu'il devait accomplir à Jérusalem, et Matthieu et Marc, que Jésus prescrivit aux trois apôtres de ne rien dire à personne de ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts.
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques et Jean, son frère, et il les conduit sur une haute montagne à l'écart.
Jésus ne prit donc avec lui que trois de ses disciples, ceux qui étaient les plus avancés dans la foi, — les mêmes qui l'avaient accompagné quand il avait ressuscité la fille du sacrificateur Jaïrus, — les mêmes qui devaient être les seuls témoins de ses angoisses dans le jardin de Gethsémané, — Pierre, qui par l'ardeur de son zèle devait fonder l'Église au milieu des Juifs et des païens, — Jean, à l'âme si aimante et si profonde, qui devait devenir l'aigle des Évangélistes, en retraçant comme nul autre la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, — Jacques, son frère, qui devait être le premier apôtre martyr de sa foi.
Quant à cette haute montagne, elle n'est point nommée, et bien qu'une tradition ancienne et très répandue suppose que c'était celle du Thabor, dont la pyramide s'élève majestueusement au milieu des plaines et des vallées de l'ancienne Galilée, il est probable, d'après le contexte, que c'était une des montagnes de l'Hermon lui-même, dont la plus haute cime s'élève jusqu'à 2800 m et cette opinion est maintenant toujours plus adoptée.
Pendant que Jésus priait, rapporte St. Luc, l'apparence de son visage devint autre et son vêtement blanc comme l'éclair. — II fut transformé devant eux, dit St. Marc,