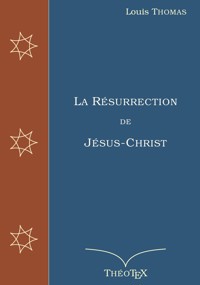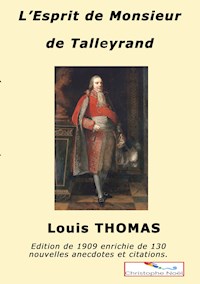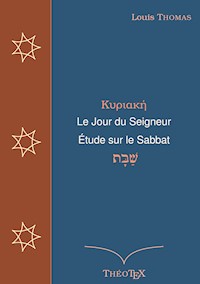
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le Dimanche chrétien remplaçant le Sabbat juif dans l'histoire de l'Église, puis s'étendant à toute la civilisation occidentale, n'a pas été un phénomène sans signification profonde. Le Sabbat primitif donné dans le jardin d'Éden célébrait la Création, le Sabbat mosaïque rajoutait à ce souvenir celui de la sortie d'Égypte, le Sabbat chrétien, au jour de la résurrection, est la fête par excellence qui accomplit et révèle le sens des deux premiers sabbats. Car la victoire de Jésus-Christ sur la mort est plus qu'un retour à la vie, mais le commencement d'une nouvelle création, plus qu'une justification personnelle, mais la libération de tout un peuple. Telle est la thèse de Louis Thomas (1826-1904). A son époque, le respect social du Jour du Seigneur était un thème volontiers traité par les pasteurs évangéliques, surtout au sein des nations anglo-saxonnes. Depuis, tant aux États-Unis qu'en Europe, l'indifférenciation commerciale du dimanche par rapport aux autres jours de la semaine est devenue chose complètement banale. Mettant un sérieux coup de frein à notre frénétique activité, la crise sanitaire aura eu le mérite de nous inviter à réfléchir à la pertinence du sabbat quant au bien-être de l'humanité ; l'étude de Louis Thomas, qui expose ce jour particulier en tant que moyen de grâce, reste ici particulièrement précieuse. Notre réédition ThéoTeX condense en un seul l'essentiel des deux volumes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Notice ThéoTEX
Louis Thomas est né à Genève en 1826; c’est à Cologny, dans le même canton, qu’il a d’abord exercé le ministère pastoral durant une vingtaine d’années, avant de devenir professeur de théologie systématique à l’École de l’Oratoire, comme successeur de César Pronier, de 1874 à 1887. Retiré à Frontenex, en Savoie, il s’est alors consacré à divers travaux littéraires (notamment à la réhabilitation de Jean-Jacques Rousseau dans l’esprit des Genevois), jusqu’au jour de sa mort, le 21 août 1904.
De 1887 à 1890 il avait fait paraître dans la Revue de théologie et de philosophie de Lausanne une série d’articles intitulée le Jour du Seigneur, étude de dogmatiqe chrétienne et d’histoire. Il entreprit ensuite de les publier sous forme de deux volumes. Le premier, d’environ 350 pages, paru en 1892, s’efforçait d’investiguer les traces les plus anciennes du sabbat primitif chez les peuples de l’antiquité, Égyptiens, Chaldéens, Arabes, Perses, Grecs, Romains. . . Il y apportait un luxe d’érudition, de curiosités philologiques, de détails archéologiques qui le rendaient presque illisible pour un non-spécialiste de l’histoire ancienne. Augustin Gretillat s’était d’ailleurs gentiment un peu moqué de ce déluge de savoir dans un compte-rendu de la Revue de théologie de Montauban. Donnons un échantillon de son humour légèrement saugrenu :
«Une jeune personne de ma connaissance racontait une fois que quelqu’un avait eu une attaque. Heureusement, ajouta-t-elle, le médecin passait à ce moment dans la rue; mais quand il arriva chez le malade, il était déjà mort.
Je me suis rappelé le heureusement de cette jeune personne en lisant un malheureusement, page 27 :
L’auteur s’est posé, à la suite d’Ébrard, la question de savoir si la sortie d’Égypte n’aurait point eu lieu un jour du sabbat (si vous saviez comme cela m’est égal !), et il escompte les rapprochements intéressants qui naîtraient de cette supposition une fois vérifiée, mais pour aboutir tout à coup, au bout de deux pages, à ce malheureux adverbe :
«Malheureusement le calcul d’Ébrard suppose que le mois ne comptait pour les Israélites que vingt-huit jours. Or, cela n’est point du tout aussi certain qu’il le dit. »
Je vous l’ai dit, notre auteur a payé la rançon de ses qualités, ce qui est à peu près inévitable ici-bas. Le Jour du Seigneur s’est éclipsé de temps en temps dans l’épaisseur du taillis. Si, dans la composition de son second tome, mon collègue a le courage — car il en faut — de se borner, il ajoutera aux qualités solides de l’érudit une des plus délicates de l’écrivain. . . »
Un siècle après nous ne saurions dire ce qu’il convient de conserver des suppositions de Louis Thomas sur l’origine et la place du sabbat dans les sociétés antiques, d’autant que la science archéologique a sensiblement évolué depuis. C’est pourquoi nous n’avons conservé dans cette édition que les paragraphes du premier tome qui nous paraissaient les plus intéressants, ainsi que les conclusions de l’auteur. Du reste, le fac-similé de l’ouvrage est téléchargeable sur internet, pour ceux qui le voudraient.
Le deuxième tome, d’environ 300 pages, paru en 1893, concernait plus directement l’étudiant de la Bible puisqu’il traitait du Sabbat mosaïque et du Dimanche. Le lecteur y trouvera une conclusion en 58 points des plus stimulantes pour la réflexion théologique.
On pourrait certes s’interroger sur l’intérêt actuel d’un tel sujet, puisque dans nos temps et nos sociétés post-modernes la distinction entre dimanches et jours ouvrables a quasiment disparue. Cependant il est un fait notable que lors des réveils spirituels le peuple de Dieu revient instinctivement à un respect plus marqué du Jour du Seigneur. Bien qu’il soit aujourd’hui de bon ton réformé de nier l’existence d’un millénium à venir, il est indéniable que, dans son essence, l’institution du Sabbat pointe vers un idéal eschatologique, auquel nos âmes feraient bien de se préparer.
Phoenix, le 18 décembre 2021.
Table des matières
Notice ThéoTEX
Introduction
I.
Le sabbat jusqu’au Seigneur Jésus
1.
Le sabbat primitif
.
1.1 — La fondation du sabbat ou Genèse ch. 1 et 2.
1.2—Traces de l’institution du sabbat primitif jusqu’au Décalogue.
1.2.1 — Ancien Testament.
1.2.2 — Documents païens.
1.2.2.1 — Les Egyptiens.
1.2.2.2 — Les Chaldéens.
1.2.2.3 — Les Arabes.
1.2.2.4 — Les anciens Perses.
1.2.2.5 — Grecs et Romains.
1.2.2.6 — Les Chinois.
1.2.2.7 — Les Péruviens.
1.2.2.8 — Les Noirs de l’Afrique occidentale et surtout de la Côte-d’Or.
1.2.2.9 — Conclusion sur ces documents païens.
Appendices I
.
— Couleurs et métaux attribués aux 7 planètes.
— Semaine des anciens Irlandais et remarque générale sur le paganisme.
—Mois et signes zodiacaux en Chaldée.
— Les Saturnales et le Saturne romain.
— La semaine des Hindous.
— La semaine des Germains.
— Le nom de nombre sept
.
— Le serment et le septénaire.
2.
Le sabbat mosaïque depuis le Décalogue
.
2.1 — La loi du sabbat.
2.1.1 — La loi sabbatique fondamentale ou le 4e commandement.
2.1.2 — Autres lois sabbatiques directes.
2.1.2.1 — Les lois elles-mêmes
.
2.1.2.2 — Le contenu des lois
.
2.2 — Le sabbat en Israël après Moïse et jusqu’à Néhémie.
2.2.1 — Royaume d’Israël.
2.2.2 — Royaume de Juda.
2.2.3 — Ezéchiel.
2.2.4 — Néhémie.
2.3 — Le sabbat pharisaïque.
2.3.1 — Le pharisaïsme.
2.3.2 — Prescriptions sabbatiques
.
II.
Le dimanche ou le Jour du Seigneur
1.
Le Seigneur Jésus
.
1.1 — Conduite et enseignement de Jésus à l’égard du sabbat.
1.2 — Fondation du dimanche par le Seigneur.
1.2.1 — Résurrection du Seigneur.
1.2.2 — Première apparition aux disciples réunis.
1.2.3 — Seconde apparition aux disciples réunis.
1.2.4 — La Pentecôte chrétienne.
2.
Les Églises et les apôtres
.
2.1 — Les premières Églises d’origine juive.
2.2 — Les premières Églises d’origine païenne et saint Paul.
2.3 — La destruction de Jérusalem et saint Jean.
3.
Après l’âge apostolique, ou le second siècle
.
3.1 — Lettre de Pline le Jeune à Trajan.
3.2 — Epître d’Ignace aux Magnésiens.
3.3 — Epître dite de Barnabas.
3.4 — La Didachè.
3.5 — Justin-Martyr.
3.6 — La controverse pascale.
3.7—Méliton, de Sardes, et Denys, de Corinthe.
3.8 — Irénée.
3.9 — Théophile d’Antioche.
3.10 — Tertullien.
3.11 — Clément d’Alexandrie et Origène.
Conclusion Générale
— Sabbat primitif.
— Sabbat mosaïque
.
— Dimanche.
3.1 — Sa fondation.
3.2 — Son caractère général.
3.3 — Doctrine du dimanche dans le catholicisme romain et chez les réformateurs.
3.4 — La doctrine du dimanche et la Dogmatique.
— Considérations plus générales.
Appendices II
.
— Rayonnement de la loi sabbatique dans la législation de Moïse.
1.1 — La fête des semaines.
1.2 — Le sabbat des mois.
1.3 — L’année sabbatique.
1.4 — L’année du Jubilé.
1.5 — Durée de la fête de Pâques et de celle des Tabernacles
.
1.6 — Les sept fêtes annuelles de sainte convocation.
— Interprétation des textes bibliques sur le dimanche selon Luther, Calvin et de Bèze.
— Lois de Constantin sur la célébration du dimanche.
— Transfert du sabbat au dimanche.
Introduction
Il conviendrait peut-être de compter dans les moyens de grâce confiés à l’Église, outre la prédication de la Parole de Dieu et les deux sacrements du baptême et de la sainte cène, le Jour du Seigneur. Si nous cherchons, en effet, les caractères communs à ces moyens de grâce, en tant que consistant dans la prédication de la Parole de Dieu et les sacrements, voici ce que nous trouvons :
1. Une institution d’en haut ;
2. Une tâche confiée par le Seigneur à son Église ;
3. Un moyen par lequel l’Église peut étendre ou développer l’action de la grâce divine pour le salut des hommes.
Or, ces trois caractères se retrouvent dans l’institution du Jour du Seigneur :
1. Il est d’institution divine ;
2. L’Église doit travailler à la solennisation du dimanche ;
3. Elle peut ainsi concourir efficacement à l’avancement du règne de Dieu.
Mais le premier de ces caractères du dimanche réclame de notre part des développements assez détaillés. La question n’est pas si simple qu’elle pourrait le paraître. Elle a été résolue assez diversement, et elle l’a été dans les temps modernes dans deux sens très différents. Jamais peut-être elle n’a été l’objet d’une étude aussi spéciale et aussi approfondie, et jamais, semble-t-il, on n’a été plus près d’une solution complète.
Avant d’arriver à cette solution sous forme de conclusion, il convient d’esquisser les grands traits de l’histoire du Jour du Seigneur, car ce Jour a son histoire, comme on l’a si bien dit. Aussi étudierons-nous d’abord la question du sabbat jusqu’au Seigneur Jésus, soit comme sabbat primitif, soit comme sabbat mosaïque, soit comme sabbat pharisaïque, puis la double question du sabbat depuis le Seigneur Jésus, et du dimanche, pour parler, enfin, peut-être de l’éternel sabbat ou éternel dimanche.
Traiter ainsi le sujet du dimanche dans une Dogmatique nous paraît une innovation. Mais, en la faisant, nous ne sommes point complètement sans devanciers : Nitzsch, dans son System der christlichen Lehre, s’occupe successivement de la véritable Église, de la prédication, des sacrements, de la prière de l’Église et du Jour du Seigneur, du pouvoir des clefs ou de la discipline ecclésiastique. D’après Oschwald, l’Église d’Ecosse désigne sous le titre d’institutions (ordinances) de Christ, les sacrements, le Jour du Seigneur et le culte divin. Dans la confession de foi baptiste adoptée à New-Hampshire en 1833, l’article XIV parle du baptême et de la sainte cène; l’article XV, du sabbat chrétien. Signalons encore une parole d’OEhler disant que le sabbat a quelque chose de sacramentel.
A l’appui de cette qualification, nous nous bornerons à indiquer Exode.31.13,16-17; Ezéch.20.20, où le sabbat est appelé un signe que l’Éternel est le Dieu d’Israël, une alliance perpétuelle, un signe qui devra durer à perpétuité. La circoncision était de même appelée un signe de l’alliance entre l’Éternel et son peuple (Gen.17.11) ; le sang de l’agneau pascal, un signe auquel l’Éternel devait reconnaître les maisons des Israélites (Exo.12.13) ; les pains sans levain de la fête de Pâques, un signe et un mémorial de ce que l’Éternel avait fait pour Israël lors de la sortie d’Egypte (Exo.13.8, 9).
Littérature, ou plutôt indication de quelques ouvrages de notre siècle plus ou moins saillants, sur le Jour du Seigneur en général :
Tim.Dwight, deux sermons, trad. de l’anglais : l’un, sur la Perpétuité du sabbat ; l’autre, sur le Changement du sabbat, Lausanne, 1834. — Vinet : Le sabbat juif et le dimanche chrétien, Lausanne, 1877. Lettres écrites en 1837 à l’occasion des traductions susmentionnées. — Rob. Haldane : De l’obligation permanente d’observer le jour du Seigneur, trad. de l’anglais, Toulouse, 1843. — Victor Mellet : Le dimanche n’est pas un sabbat, Lausanne, 1843. Vinet faisait grand cas de cette brochure. (Voir Chrétien évangélique, 1877, p. 351. ) — Neander : Veber die christliche Sonntagsfeier, Deutsche Zeitschrift, 1850. — Oschwald : Die christliche Sonntagsfeier, Leipzig, 1850. Ouvrage couronné en première ligne et à l’unanimité, à la suite d’un concours ouvert en 1847 par un ami du royaume de Dieu. Le professeur Ebrard fut le rapporteur et, dans son rapport, mis en tête de l’ouvrage, exposa les principes qui avaient dirigé le jury. — Liebetrut : Die Sonntagsfeier, das Wochenfest des Volkes Gottes, Hamburg, 1851. Ouvrage couronné en seconde ligne dans la concours. — C. F. Schmid : Die Heilighaltung des Sonntags. Rapport présenté au Kirchentag de Stuttgart, en 1850, dans les Verhandlungen du Kirchentag, Berlin, 1850.—Hengstenberg : Ueber den Tag des Herrn, Berlin, 1852. — Frédéric Godet : Le jour du Seigneur et les meilleurs moyens d’en avancer la sanctification. Rapport présenté aux assemblées de l’Alliance évangélique tenues à Genève en 1861. (Les Conférences de Genève, 1861, 1er volume. ) Nouvelle édition, retravaillée et publiée à part sous ce titre : Le dimanche, Genève. 1889. — Hessey : Sunday. Its origin, history and present obligation considered in the Bampton Lectures, London, lre éd., 1860; 4e éd., 1881. En 1887 l’édition était épuisée. — Bersier : Le dimanche, discours, Paris, 1864 — Rob. Cox : The literatur of the Sabbath question, Edimburgh, 1865, 2 vol. très serrés d’impression et chacun de près de 500 pages. — Ern. Naville : La loi du dimanche au point de vue social et au point de vue religieux, discours prononcé au Congrès sur l’observation du dimanche, 1876, Genève.—Theod. Zahn : Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag, mais avec de savantes notes, Hannover, 1878.—Roger Hollard : Le dimanche, deux discours, Paris, 1884. — Rev. George Elliot : The Abiding Sabbath, an argument for the perpetual obligation of the Lord’s day. The Fletcher prize essay for 1884. American tract Society, New-York. — Henke : Zur Geschichte der Lehre von der Sonntagsfeier, Theol. Stud. und Krit., 1886. — J. N. Andrews : Histoire du sabbat et du premier jour de la semaine, trad. de l’anglais, Bâle, 1886.
I Le Sabbat jusq’au Seigneur Jésus
1. Le sabbat primitif.
1.1 — La fondation du sabbat ou Genèse ch. 1 et 2.
Il est dit, Gen.2.2-3 : « Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite; et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant. »
[Nous préférons pour ces derniers mots la traduction littérale donnée par la Version de Lausanne à celle par trop sommaire de Segond : qu’il avait faite. C’est cette dernière version où nous puiserons nos citations, en indiquant quand nous ne la suivrons pas.]
Il faut entendre dans le verset 2 : « Dieu acheva, » dans le sens de : avait achevé. Cela ressort du contexte, soit de ce qui précède, soit de ce qui suit. Mais il est certain que le repos de Dieu au septième jour n’implique point en Dieu une absence d’activité (Jean.5.17). Il n’implique sous ce rapport que la cessation de l’activité créatrice proprement dite, comme la fin du verset 3 semble l’indiquer nettement : « Il se reposa de toute son oeuvre que Dieu avait créée en la faisant. »
L’idée de repos qui est exprimée aux versets 2 et 3 par le terme encore plus fortement Exo.20.11, où le mot employé est ĞŘĽĚ, et Exo.31.17, où sont réunis les mots (Segond : il a cessé son oeuvre et il s’est reposé. Lausanne : Il s’est reposé et a respiré. ) Evidemment nous ne saurions admettre qu’il y ait eu fatigue en Dieu ni pendant, ni après la création. Mais il ne faudrait pas non plus restreindre l’idée du repos de Dieu dans le 7e jour à l’idée de la cessation de l’activité créatrice. Il faut y joindre, au moins, l’idée de la satisfaction qui suit une oeuvre accomplie et bien accomplie. Il est dit, Gen.1.31 : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait; et voici, cela était très bon. » (Comp. v. 13, 18. )
Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia : évidemment pour ses créatures et tout spécialement pour l’homme, la plus élevée des créatures dont il avait été question dans le récit. Dieu bénit le 7e jour, c’est-à-dire il en fit un jour spécial de bénédiction à côté des six jours qui devaient le précéder, un jour qui devait être une source de bénédiction, de bonheur. Il le sanctifia, non pas proprement : Il le mit à part, comme pourrait le faire penser une étymologie qui nous paraît erronée, mais : Il le déclara saint et il le fit saint, il en fit une source de sainteté.
Selon OEhler, l’opinion la plus vraisemblable est que le verbe apparenté avec , être nouveau (d’où la nouvelle lune), remonte à la racine , d’où vient aussi , verdir, pousser, et qu’il signifie primitivement sortir en brillant (enituit, glänzend hervorbrechen). Delitzsch compare d’une manière analogue le verbe au sanscrit dhûsch, splendidum, pulchrum esse.
[Keil, Genesis und Exodus, p. 457. — Dans l’article de la Real- Encyklopadie, sur la sainteté de Dieu (1879), Delitzsch estime que selon l’étymologie de qui lui paraît la plus vraisemblable, le mot viendrait non d’une racine (Lautverbindung) , mais d’une racine signifiant primitivement « diviser, séparer, » mais que le terme d’opposition sous-entendu ne serait pas directement « ce qui est ordinaire et commun,» mais « ce qui est physiquement défectueux, maladif. » En fait, il arrive ainsi par une autre voie au même résultat que nous. Dieu serait saint en tant qu’il serait, au point de vue négatif, labis expers et, au point de vue positif, parfait. Delitzsch cite à l’appui de son opinion une formule d’incantation suméro-assyrienne, où le mot assyrien kudistua pour équivalent nu-gig, pouvant très bien signifier labis expers (nu =pas, gig=malade ou maladie).]
Il y aurait donc primitivement dansl’idée de la lumière apparaissant avec éclat, et cela serait confirmé surtout par Esa.10.17, passage dans lequel le Saint d’Israël est aussi appelé la lumière d’Israël. Voir aussi 1Tim.6.16 ; 1Jean.1.5, etc.
Dieu serait alors le Saint en tant qu’il est, comme s’exprime un dogmaticien luthérien moderne (Thomasius, Dogmatik) : « Celui qui est absolument pur, la lumière absolue et sans tache. » Déjà Quenstedt avait défini la sainteté de Dieu comme étant « summa omnisque labis expers in Deo puritas. » Le sens fondamental de est bien aussi, selon Gesenius, être pur.
« Il ne faudrait pas rapprocher, dit Diestel de abscidit, pour arriver ainsi à l’idée de séparer, mettre à part; car alors il faudrait rattacher à la même ligne de dérivation sordidus fuit, et , purus fuit.» Dieu sanctifia le 7e jour, c’està-dire en fit une source de sainteté, de pureté morale, de lumière spirituelle.
Dieu sanctifia ce jour et par conséquent il se le consacra, ilen fit pour l’homme une source de consécration à Dieu, car il est clair que pour l’homme, l’idée de la sainteté est essentiellement celle de la consécration à Dieu, de l’obéissance à ses commandements, de la communion avec lui.
Dieu est sa loi à lui-même, tandis que l’homme a sa véritable loi en dehors de lui. Sans doute, en étant appelé à être saint, l’homme est appelé au plein développement de sa personnalité ; mais ce développement même ne saurait s’opérer qu’autant que l’homme se subordonne à la volonté divine. Ce n’est que dans l’obéissance à Dieu, obéissance qui est aussi une communion avec lui, que l’homme devient vraiment libre, en devenant vraiment fort, vertueux, saint. Aussi la sainteté de l’homme est-elle en même temps et même essentiellement une consécration extérieure, bien que profondément intime, un don de soi à un autre et à un autre infiniment supérieur, vraiment parfait. (Voir Exo.13.2 ; 28.36; 39.30; Zach.14.20; Lév.27.14, etc.)
Mais en étant sanctifié, consacré à Dieu, l’homme est ainsi mis à part pour Dieu, et cette mise à part, avant tout spirituelle, est doublement prononcée, elle s’accentue d’une manière toute nouvelle, si le milieu dans laquelle se trouve l’homme sanctifié, est un monde plongé dans le mal (1Jean.5.19). On arrive ainsi par l’idée de la sanctification à celle de la mise à part, toutefois cette dernière idée n’est pas le point de départ, il est tout autrement positif.
Dieu sanctifia donc le 7e jour et par là il en fit pour l’homme une source de sainteté ou de sanctification. Mais, pour que ce jour devînt tel pour l’homme, il fallait évidemment que celui-ci s’y prêtât librement et lui-même sanctifiât le jour en le reconnaissant comme saint, consacré à l’Éternel, et en se conduisant en conséquence.
Si maintenant nous demandons comment l’homme devait précisément sanctifier ce jour, nous ne trouvons aucune réponse biblique directe, et au fond nous ne saurions nous en étonner. La Genèse a été rédigée non pour l’homme innocent, mais pour l’homme déchu; et le commandement du sabbat devait apparaître sous une nouvelle forme très détaillée et à quelques égards fort modifiée, quand les temps seraient venus où Dieu pourrait restaurer en quelque manière l’institution, pour le peuple de l’Ancienne Alliance. Plus tard encore l’institution devait recevoir une lumière toute nouvelle dans l’Alliance définitive et humanitaire. Nous sommes donc réduits pour le commandement paradisiaque à des déductions tirées des termes mêmes de l’institution du sabbat primitif, de l’idée que nous pouvons nous former de l’homme innocent, et aussi des enseignements de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance sur le Jour du Seigneur. Or voici à quoi nous arrivons ainsi :
1. L’homme devait suspendre son travail ordinaire pour se reposer, et cela afin d’accomplir un divin commandement, impliqué, ce nous semble, dans l’exemple donné par le Créateur à celui qu’il avait créé à son image, et dans le caractère sacré qu’il avait tout de suite imprimé au 7e jour.
2. Il devait profiter de ce repos pour commémorer le commandement de l’Éternel en rattachant ce commandement à l’exemple donné par l’Éternel lui-même lors de la création des cieux et de la terre.
3. Il devait commémorer ainsi la toute-puissance créatrice de l’Éternel, le rapport de dépendance spirituelle absolu dans lequel l’homme se trouve constamment vis-à-vis de lui, et tous les devoirs liés à ce rapport.
4. Il devait adorer Dieu. Il devait le prier, soit pour lui rendre grâces, et lui rendre grâces particulièrement au sujet des bénédictions apportées par les six jours précédents, soit pour implorer la continuation de son secours, de nouvelles bénédictions, particulièrement pour la série des jours ouvriers qui allait commencer.
5. Il devait se recueillir, s’édifier, s’efforcer de vivre d’une manière spéciale dans la pensée et dans la communion de l’Éternel.
Comme nous voyons les premiers fils d’Adam offrir à l’Éternel des sacrifices : l’un, une offrande des fruits de la terre, l’autre, une offrande des premier-nés de son troupeau et de leur graisse (Gen.4.3), et que le sacrifice n’est point en soi nécessairement expiatoire, nous pouvons admettre encore que l’adoration au 7e jour dut ne pas tarder à se manifester sous la forme du sacrifice.
Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il le bénit en le sanctifiant. Ce jour ne devait produire toutes ses bénédictions que dans la mesure où il serait sanctifié, et les bénédictions mêmes dont il devait être la source, devaient encore augmenter sa sanctification de la part de l’homme, ainsi que son influence sanctifiante. « Le σαββατισμὸς du Créateur, dit Delitzsch, doit devenir le σαββατισμὸς de la créature. Aussi, en bénissant le 7e jour, en fait-il pour elle une source intarissable de rafraîchissement et, en sanctifiant ce jour, il le revêt d’une gloire particulière pour la nouvelle carrière historique qui commence pour l’humanité. Car signifie approprier la qualité du et le est le saint. »
Il y a donc eu, selon nous, une institution divine primitive d’un jour hebdomadaire de repos, et cette institution fut déjàparadisiaque. Mais, nécessaire et excellente déjà pour la vie d’innocence, elle devait le devenir bien plus encore après la chute de l’humanité. Ce caractère paradisiaque de l’institution du sabbat nous semble ressortir de Gen.2.2-3 et être pleinement confirmé par Exo.20.8-11, qui devra plus tard réclamer notre attention.
Nous ne saurions donc être de l’avis de M. de Pressensé, disant : « Faire remonter le sabbat jusqu’au jardin d’Eden, c’est oublier les conditions de l’innocence, qui n’admet pas le partage de la vie entre le profane et le sacré. »
[Conférences de Genève, I, p. 33. Nous lisons dans le Dimanche, du même
auteur, p. 8 : «A son entrée dans l’existence terrestre, l’âme humaine, cette noble fiancée de l’Esprit saint, a reçu le gage de sa vocation à la vie céleste. Ce gage, cet anneau de fiançailles, si j’ose ainsi dire, c’est le sabbat. Le Dr Capadose a exprimé cette idée dans cette belle parole : « Le premier jour que l’homme a passé sur la terre l’a élevé au-dessus de » la terre ; car ce fut un sabbat. »]
Nous sommes bien plus d’accord avec M. F. Godet, quand il dit : « L’institution du sabbat humain avait deux buts. Le premier se rapportait à la vie et à l’activité naturelles de l’homme. Le corps et l’âme de l’homme n’étant point d’essence divine, un repos périodique leur est nécessaire à l’un et à l’autre en raison de leur débilité et de leur fragilité naturelles. Mais ce but n’était que secondaire, comme les éléments de notre être auxquels il se rapporte. Le vrai but du sabbat c’était de préparer l’homme à la vie supérieure en vue de laquelle il a, dès l’abord, reçu l’existence. Une activité terrestre non interrompue eût fini par absorber l’homme et par étouffer en lui toute aspiration à la vie supérieure et tout pressentiment de son union future avec l’Esprit Saint. Si cela s’applique à l’homme innocent et pur, combien plus à l’homme retenu loin de Dieu par le péché! C’est par cette raison que, au moment même où vont commencer les diverses occupations naturelles renfermées dans cet ordre : « Croissez, multipliez et assujettissez la terre » (Gen.1.28) et résumées dans cette autre expression : « cultiver le jardin » (Gen.2.15), . . . Dieu, par une touchante anticipation, a eu soin de fonder le sabbat et de prescrire ainsi d’avance une interruption périodique dans le cours des occupations terrestres. »
Il y avait donc une intime et admirable correspondance entre le sabbat primitif et la constitution intime de l’homme déjà tel qu’il était sorti des mains du Créateur, et cette correspondance a été formulée par le Seigneur lui-même quand il a dit : « Le sabbat a été fait à cause de l’homme (διὰ τὸν ἄνϑρωπον). » (Marc.2.27)
Mais cette correspondance n’était pas la seule. Il y en avait une autre non moins remarquable, qu’on peut pressentir : N’y a-t-il pas toujours l’harmonie la plus profonde entre le Créateur et toutes ses oeuvres, entre l’homme et la nature au sein de laquelle il a été placé, dont il devait être la couronne. Cette autre correspondance existait entre le repos du 7e jour et l’ordre extérieur de la nature, surtout le cours des astres, spécialement celui de la lune. La lune, en effet, par sa révolution autour de la terre et par ses quatre phases mensuelles, qui durent chacune à peu près sept jours, détermine naturellement et en gros le mois et la semaine.
[Le temps que la lune emploie à revenir à la même étoile, dit F. Arago (Astronomie populaire, 1856, III, p. 875), est ce qu’on appelle la durée de la révolution sidérale. Ce temps était au commencement de ce siècle de 27,32 jours solaires. Ce temps n’est pas le même dans tous les siècles : depuis les plus anciennes observations jusqu’à nous, la révolution sidérale est devenue de plus en plus courte. Mais la théorie ayant fait connaître la cause de l’accélération du mouvement de la lune, on peut affirmer que la durée de la révolution restera renfermée entre des limites assez rapprochées, et qu’à l’accélération actuelle succédera un retardement. Le temps que met la lune à revenir au cercle horaire mobile du soleil, ou la durée de la révolution synodique, est naturellement plus long que le temps de la révolution sidérale; sa valeur est aujourd’hui de 29,53 jours. On voit pourquoi nous disons aujourd’hui, car il est évident que la durée de la révolution synodique doit être variable comme celle de la révolution sidérale. »]
Ce rapport du cours de la lune avec le mois et la semaine nous semble déjà exprimé dans Gen.1.14-16 : « Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel pour séparer le jour d’avec la nuit, et qu’ils servent de signes et qu’ils marquent les temps fixés, les jours et les années, et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. »
Ce rapport devait plus tard être exprimé bien plus nettement dans Psaume.104.19 : « Il a fait la lune pour marquer les temps fixés » et dans Ecclésiastique.43.6-8, où nous suivrons surtout la version de la Bible de Paris, 1850 : « La lune toujours paraît à son moment, faite pour marquer les temps et être le signe du temps. De la lune vient le signe de la fête; elle est un luminaire qui diminue jusqu’à ce qu’il disparaisse. Le mois est désigné d’après son nom; elle croît en son changement d’une façon merveilleuse. . . »
[ἀνάδειξις χρόνων ϰαὶ αἰῶνος, version de Paris : les époques. ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς, Paris : sur la lune est pris le signe d’un jour de fête. φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας, Paris : luminaire qui diminue vers la perfection. J’ai traduit les deux derniers mots grecs comme la version de Genève de 1805, de Wette et Bunsen. En grec μήν signifie mois et μήνη, lune. En hébreu, signifie à la fois nouvelle lune et mois, etc.]
Mais il nous faut revenir sur Gen.1.14, qui est traduit assez diversement et dont il est difficile de se rendre bien compte. Nous n’avons pu traduire, avec Segond et bien d’autres, en subordonnant complètement l’idée de signe à celle de la désignation des temps fixés, des jours et des années, comme si les astres ne devaient servir de signe que pour ces désignations. (Voir, par exemple, Gen.9.12-17; 15.5; Mat.2.1-10; 24.27-30.)
D’autre part, nous ne pouvons pas non plus traduire littéralement, comme le font les Septante, la Vulgate, Luther, etc., en mettant absolument sur la même ligne signes, temps fixés, jours et années. L’idée du signe et celle des temps fixés, des jours et années forment deux groupes distincts. Les astres peuvent être des signes, mais on ne peut pas dire de la même manière qu’ils sont des temps fixés, etc.
Quant à l’expression difficile de je l’ai traduite le moins mal possible par : temps fixés, exactement comme Dillmann (feste Zeiten). Des Marets, Paris 1850, Lausanne 1866 : les saisons. Segond et Bible annotée : les époques. Bunsen, de Wette : Zeiten. Le Bibelwerk de Bunsen voit dans les de Gen.1.14 les temps de fête de la nouvelle lune et du sabbat, et il rapporte la distinction des jours à celle des mois.
, qui vient de fixer, déterminer, signifie, d’après Gesenius : 1o Temps déterminé ; a) époque (Gen.17.21; Jér.8.7; Hab.2.3; Dan.8.19 ; 11.27-35; en particulier, jour de fête. , fêtes de l’Éternel (Lév.23.2,4,37,44) ; plus rarement : b) période (Gen.1.14) ; en particulier, dans le style prophétique, pour l’année (Dan.12.7). 2o Réunion, assemblée. 3o Lieu de réunion. 4o Signe convenu.]
Keil comprend dans les non seulement les temps de fête, mais aussi les temps fixés, sur lesquels seuls insiste Delitzsch, à savoir ceux qu’il est utile de connaître pour l’agriculture, la navigation, etc., comme aussi ceux que révèle la vie des plantes, des animaux, de l’homme. Dillmann distingue dans les d’une part, les jours de fête; de l’autre, les semaines, les mois, les saisons, les temps marqués par les occupations des hommes comme pour la vie des animaux et des plantes. Selon la Bible annotée, le mot « sert probablement à désigner ici les mois et les semaines, qui sont fixés d’après le cours de la lune et d’où dépendent les temps de fête. »
De même que le signe me semble dans le verset se rapporter en particulier, mais non exclusivement, à la désignation des temps fixés, des jours et des années, je serais disposé à rattacher d’une manière générale les idées de semaine et de sabbat à la désignation soit des temps fixés, soit des jours.
Après avoir ainsi traité, d’après Gen.2.2-3, de la fondation du sabbat tout au début de l’histoire de l’humanité, cherchons si, malgré l’effroyable perturbation introduite par la chute, cette institution a laissé des traces dans l’histoire jusqu’à la promulgation du Décalogue. Nous étudierons sous ce rapport d’abord l’Ancien Testament, puis les documents païens.
Mais, comme nous venons de le dire, ce sont des traces, des vestiges que nous allons rechercher. Nous ne pourrions guère espérer davantage dans le cas le plus favorable. On ne sera donc pas étonné si nous relevons des détails qui parfois peuvent être interprétés d’une manière différente et dont la force probante provient surtout de leur ensemble. Nous avertissons en particulier que parmi les traces que nous poursuivons, se trouvent celles de la semaine, de la véritable semaine, celle de 7 jours, bien que si l’existence du sabbat entraîne nécessairement celle de la semaine, l’existence de celle-ci ne suppose pas aussi rigoureusement celle du sabbat.
[Le mot semaine vient du mot latin septimana, qui vient lui-même directement ou indirectement de septem, sept. Il viendrait aussi de mane, matin, s’il faut en croire Isidore de Séville, qui dit (Etym. V, 32) : «Hebdomadem nos septimanam vocamus, quasi septem luces; nam mane lux est. » (Ideler, II, p. 181.) — Les Romains avaient aussi, et antérieurement, emprunté aux Grecs le mot hebdomas, qui correspond exactement à ἑβδομάς et à Hebdomas chez les Romains signifia d’abord septaine. (Voir Ideler, I, p. 89.) — C’est donc par catachrèse qu’on se sert quelquefois et que nous pourrons nous servir nous-même d’expressions comme celle-ci : semaine de dix jours. Littré ne parle pas même d’une semaine autre que celle de sept jours.]
1.2 — Traces de l’institution du sabbat primitif jusqu’au Décalogue.
1.2.1 — Ancien Testament.
§ 1. Genèse 4.3-4, 15, 24.
On lit dans les premiers de ces versets : « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. »
L’expression hébraïque traduite par : au bout de quelque temps, est assez étrange et singulièrement vague, signifie proprement : et il arriva à partir de la fin de jours ou : après des jours. On pourrait être tenté d’y voir une allusion à un sabbat dans lequel les deux fils d’Adam auraient offert simultanément leurs offrandes. Mais il ne faudrait point insister sur cette expression pour appuyer l’idée d’un sabbat déjà observé. Il vaudrait mieux sous ce rapport signaler la triple mention qui est faite du chiffre 7 dans ce même chapitre. D’abord au verset 15, dans une solennelle parole de l’Éternel lui-même, pour rassurer en quelque manière Caïn désespéré : « Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Puis au verset 24, dans le chant si sauvage de Lémec, où il rappelle avec impiété cette parole de l’Éternel et dit de sa propre autorité, c’est-à-dire avec un insatiable désir de vengeance : « Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois 7 fois.» Cette menace ressemble à un de ces sinistres jurons, qui sont aussi condamnables que le serment est en lui-même une chose sacrée.
En tout cas, cette triple mention du nombre 7 montre que dans des temps encore si primitifs, ce nombre déjà connu, même marqué d’un caractère exceptionnel et religieux, et, à cet égard, elle confirme que la semaine ne leur était point étrangère.
§ 2. Genèse ch. 7 et 8.
On peut signaler dans le même sens le fait que le nombre 7 revient plusieurs fois dans le récit biblique du déluge. Gen.7.2 : « Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs. . . sept couples aussi des oiseaux du ciel. . . Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre. . . sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. . . Le septième mois. . . l’arche s’arrêta sur les montagnes de l’Ararat. . . Noé attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. . . Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe. . . »
Il est digne de remarque que le même chiffre reparaît également plusieurs fois dans le récit chaldéen du déluge, récit extrêmement remarquable qui a été fourni par les inscriptions de la bibliothèque d’Assourbanipal. Il y aurait encore à mentionner sous ce rapport, tout au moins, une ancienne tradition de l’Inde provenant, non des Aryas, mais de la population primitive qu’ils subjuguèrent.
[Voici ce que dit Lenormant de cette tradition, dans une page qui ne manquera pas d’intéresser le lecteur (Les premières civilisations, 1874, II, p. 144) : « Il est à remarquer que dans les Pourânas ce n’est plus Manou Vâivasvata que le poisson divin sauve du déluge; c’est un personnage différent, roi des pêcheurs, des Dâsas, nommé Satyavrata, l’homme qui aime la justice et la vérité, ressemblant d’une manière frappante au Sisithrus de la tradition chaldéenne. Et la version pourânique n’est pas à dédaigner, malgré la date récente de sa rédaction, malgré les détails fantastiques et souvent presque enfantins dont elle surcharge le récit. Par certains côtés elle est moins aryanisée que la version du Brâhmana et du Mahâbhârata; elle offre surtout quelques circonstances omises dans les rédactions antérieures et qui pourtant doivent appartenir au fonds primitif, puisqu’elles se retrouvent dans le mythe babylonien, circonstances qui sans doute s’étaient conservées dans la tradition orale, populaire et non brahmanique, dont les Pourânas se montrent si profondément pénétrés. C’est ce qu’a remarqué déjà M. Pictet, qui insiste avec raison sur le trait suivant de la rédaction du Bhâgavata-Pourâna : « Dans sept jours, dit Bhâgavat à Satyavrata, les trois mondes seront submergés par l’océan de la destruction. » Il n’y a rien de semblable dans le Brâhmana ni dans le Mâhâbhârata; mais nous voyons dans la Genèse que l’Éternel dit à Noé : « Dans sept jours je ferai pleuvoir sur toute la terre »; et un peu plus loin nous y lisons encore : « Au septième jour, les eaux du déluge furent sur toute la terre ». Le poème d’Erech (le récit chaldéen) ne précise pas le nombre de jours écoulés entre l’annonce du déluge par Samas et le cataclysme lui-même; mais la construction du vaisseau de Sisithrus y dure sept jours, la force du déluge sept autres jours, et enfin sa décroissance sept jours encore. »]
§ 3. Genèse 21.28-31.
Il y est dit d’Abraham qu’après avoir conclu une alliance avec le philistin Abimélec, roi de Guérar, il mit à part 7 jeunes brebis. «Et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-ce que ces sept brebis. . . ? Il répondit : Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j’ai creusé ce puits (dont s’étaient emparés de force les serviteurs d’Abimélec). C’est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Scheba, car c’est là qu’ils jurèrent l’un et l’autre. »
«Ce témoignage qu’Abimélec consent à donner en acceptant les sept brebis, observe Delitzsch, est égal à un serment, car sept est le chiffre de Dieu se révélant, et , jurer, équivaut à : s’engager par le nombre sept (sich besiebenen), c’est-à-dire soumettre la vérité de sa déclaration au regard de Dieu. De même sept choses, comme, par exemple, chez les Arabes, sept pierres aspergées du sang de ceux qui font alliance, et placées entre eux, peuvent en conséquence jouer dans les contrats le rôle de symbole de la sanction au nom de Dieu, ou de la déclaration par serment. . . Le lieu où se conclut l’alliance entre Abraham et Abimélec fut appelé plus tard , le puits de la septaine ou du serment (Sieben-oder Eides-Brunnen).» Nous aurons du reste à revenir sur ce fait très significatif qu’en hébreu, et dans d’autres langues, le mot jurer est de la même racine que le mot sept.
§ 4. Genèse 17.11-12
Abraham reçut l’ordre de circoncire tout fils qui naîtrait dans la maison, à l’âge de huit jours, c’est-à-dire de sept jours accomplis. Tel devait être l’âge auquel tous les descendants mâles devaient recevoir ce signe de l’alliance. (Comp. Gen.21.4; Luc.1.59; 2.21 ; Philip.3.5.)
§ 5. Genèse 29.27-80.
Dans ces versets, qui nous transportent à Charan en Mésopotamie, où était restée la famille d’Abraham après son départ pour le pays de Canaan, nous trouvons déjà l’idée qui devait être développée plus tard dans la législation mosaïque, d’une semaine d’années, et nous voyons aussi apparaître le nom de semaine appliqué à une série de 7 jours Jacob avait dit (v. 18) : « Je te servirai sept ans pour Rachel.» Laban dit plus tard (v. 27) : «Achève la semaine avec celle-ci (c’est-à-dire Léa), et nous te donnerons aussi l’autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » Il y a proprement : Achève cette semaine Selon Delitzsch et Dillmann, c’est bien une semaine de jours, une semaine de noces 1. Ils citent Juges.14.12, où il est question du mariage de Samson et du festin de sept jours qui eut lieu à cette occasion. Ils citent aussi Tobie.11.16.
§ 6. Genèse 50.3, 10.
Après ce qui précède, nous pouvons encore considérer comme un signe indirect de la pratique de la semaine, les deux données de Gen.50.3,10, en ayant soin de les rapprocher l’une de l’autre. Il est en effet parlé dans ces versets soit d’un deuil de 70 jours célébré en Egypte par les Egyptiens à l’occasion de la mort de Jacob, soit d’un nouveau deuil de 7 jours célébré par Joseph en l’honneur de son père, lorsque la caravane qui se rendait à Macpéla fut arrivée à « l’aire d’Athad. . . au delà du Jourdain. »
La première de ces données est du reste complètement d’accord avec ce qu’on sait par Hérodote (II, 86), de la coutume des Egyptiens de consacrer 70 jours à l’embaumement d’un mort.
§ 7. Job 2.13.
Il faudrait aussi tenir compte de ce verset, où il est dit des amis de Job arrivés pour lui rendre visite : « Il se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire un mot, car ils voyaient combien sa douleur était grande. » Le pays d’Uz, habité par Job paraît avoir eu une population foncièrement araméenne et avoir été situé au sud de Damas et au nord de l’Idumée, à l’est de la Palestine et à l’ouest de l’Euphrate.
En fait, nous venons de voir 7 jours de noces à Charan et chez les Philistins, 70, puis 7 jours de deuil chez les Egyptiens et dans la maison de Joseph, 7 jours de condoléance au pays d’Uz.
Des théologiens aussi différents que Jurieu, OEhler et l’évêque Carlisle, qui n’admettent pas le sabbat antémosaïque, admettent cependant l’existence de la semaine chez les patriarches. OEhler cite à l’appui de cette opinion Gen.29.27; 7.4,10; 8.10,12; 17.12; 21.4; Carlisle, Gen.29.27; Jug.14; Gen.50.10; 7; 8.
§ 8. Institution de la Pâqe.
Au sein du peuple d’Israël, au moment même où sa nationalité allait être affirmée de lamanière la plus éclatante, la fondation de la fête de Pâques semble encore présupposer la connaissance de la semaine et même une solennisation particulière du 7e jour. Dans les prescriptions adressées par l’Éternel à Moïse et à Aaron concernant la Pâque, il est dit (Exo.12.15-20) : « Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n’y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranché d’Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. . . . Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir du vint-et-unième jour. » — Comp. les instructions données au peuple par Moïse, Exo.13.3-7. — Voir encore Lév.23.5-8; Nomb.28.16-25 ; Deut.16.1-8, etc.
Rappelons brièvement les principaux traits de l’institution. Le 14 nisan, au soir, c’est-à-dire, suivant la pratique officielle, vers la fin du 14, dans la seconde partie de l’après-midi, entre 3 et 5 heures de l’après-midi, l’agneau pascal devait être immolé (Exo.12.6). Au commencement du 15, c’est-à-dire peu après l’immolation de l’agneau, il devait être mangé en famille, avec des pains sans levain, ou azymes, et des herbes amères. Telle était la fête de Pâques dans le sens strict du mot (Exo.12.14).
Tandis que cette fête n’embrassait que le 14e jour et la nuit du 15e jusqu’à environ minuit, heure à laquelle tout ce qui était resté de l’agneau après le repas devait être brûlé (Exo.12.10), la fête des azymes commençait avec le commencement du 15, renfermait ainsi la seconde partie de la fête de Pâques proprement dite ou le repas pascal, et durait 7 jours, c’est-à-dire du 15 au 21 inclusivement.
Les deux fêtes, qui sont parfois distinguées (Marc.14.1, etc.), sont parfois identifiées, et alors les deux noms ont le même sens et désignent le même ensemble. Il est dit Luc.22.1 : « Or la fête des pains sans levain, dite la Pâque, approchait. » (Comp. Luc.2.4143, etc.) C’est en vertu de cette identification qu’il pouvait être question de 8 jours de fête, le 14 nisan étant ajouté aux 7 jours de la fête des azymes. (Marc.14.12; Mat.26.17; Josèphe, Antiq. 9.1).
Le 14 nisan pouvait être considéré comme un des jours de la fête, non seulement parce que l’agneau devait être immolé à la fin de ce jour et qu’il fallait se préparer pour cette immolation (2Chron.30.17; comp. Exo.19.10,14; Nomb.11.18; Jos.3.5; 7.13), mais encore parce que c’était le jour où l’on éloignait tout levain des maisons et où l’on commençait à cuire les azymes, pratique exécutée avec le plus grand soin par le judaïsme postérieur 1. Le 14 et le 15 nisan pouvaient donc être envisagés chacun comme étant le 1er jour de la fête : le 15, comme jour du repas pascal et comme 1er jour de la fête des azymes; le 14, comme jour de l’immolation de l’agneau et comme jour de la préparation des azymes. En fait, nous voyons le 15 désigné comme le 1er jour de la fête, Exo.13.3, et le 14, aux passages déjà cités : Marc.14.12; Mat.26.17.
Des 7 jours de fête compris entre le 15 et le 21 nisan, deux étaient particulièrement solennels et devaient être célébrés comme des sabbats : le 15, au commencement duquel on mangeait l’agneau pascal, et le 21 ou dernier jour. Le 15 est même appelé un sabbat, Lév.23.11-15, comme le Jour des expiations, Lév.16.31 ; 23.32.
Il faut encore ajouter que le 16 devait être caractérisé par une cérémonie particulière, dès qu’Israël serait entré dans la terre promise 1. On devait ce jour-là apporter une gerbe de blé au sacrificateur comme prémices de la moisson. Le sacrificateur devait agiter cette gerbe devant l’Éternel en faveur de celui qui l’avait apportée. Celui-ci devait en outre sacrifier un agneau et faire des offrandes de fine farine, de parfum et de vin. Ce n’était qu’après l’accomplissement de ces diverses cérémonies que la moisson pouvait commencer.
Quoi qu’il en soit, dans l’institution de la Pâque, d’un côté, nous voyons la fête des azymes proprement dite durer une semaine; de l’autre, nous la voyons se terminer par la solennisation particulière du 7e jour de cette semaine. De plus, l’ensemble des détails dans lesquels nous sommes entré doit faire comprendre comment Vaihinger a pu dire, en faisant entrevoir une saisissante analogie entre le sabbat et la fête de Pâques, qui ferait de celle-ci comme une reproduction de celui-là : « Le grand jour de la délivrance de la servitude d’Egypte devint une sainte et joyeuse fête de 7 jours, dans laquelle Israël se repose de l’oppression et de l’agitation du monde, et célèbre l’avant-goût du bienheureux repos de Dieu. Par la célébration sabbatique du 1er et du 7e jour de cette joyeuse fête, elle devient tout entière une fête sabbatique, dont le but n’est pas tant le repos que la commémoration de l’oeuvre de la création accomplie par la rédemption de la servitude d’Egypte, création d’où sortit Israël pour une nouvelle existence dévouée à Jéhovah. « Sachez que l’Éternel est Dieu! est-il dit Psa.100.3. C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de sa pâture,» — et Esaïe.43.15-17 : « Je suis l’Éternel, votre Saint, le Créateur d’Israël votre Roi. Ainsi parle l’Éternel, qui fraya dans la mer son chemin. . . .» Mais comme l’ouverture de la moisson coïncidait avec la fête de Pâques et que la vie supérieure est intimement liée avec la bénédiction terrestre, Israël, avec l’offrande de la gerbe des prémices, consacre aussi la nourriture terrestre que lui donne Jéhovah, en confessant que le pain quotidien vient de Jéhovah, et il indique par les sacrifices sanglants ou non sanglants qui s’ajoutent à l’offrande de la gerbe, l’obligation qui lui incombe de fortifier ses membres par la nourriture corporelle pour le service de Jéhovah et afin de devenir saint, comme il est saint. »
§ 9. Exode ch. 16.
Il y a juste un mois qu’Israël est sorti d’Egypte (Exo.12.2,6-12; 16.1), il vient d’arriver au désert de Sin, qui est entre Elim et Sinaï, et il murmure contre l’Éternel, regrettant la nourriture qu’il avait abondamment en Egypte et craignant désormais de mourir de faim. Exo.16.4 :
L’Éternel ditàMoïse : Voici je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve. . . Le sixième jour, lorsqu’ils prépareront ce qu’ils auront apporté, il s’en trouvera le double de ce qu’ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d’Israël : Ce soir, vous comprendrez que c’est l’Éternel qui vous a fait sortir du pays d’Egypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l’Éternel. . . L’Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété. . . Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp; et aumatin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. . . Moïse leur dit : C’est le pain que l’Éternel vous donne comme nourriture. Voici ce que l’Éternel a ordonné : Que chacun de vous en ramasse ce qu’il faut pour sa nourriture, un omer par tête, suivant le nombre de vos personnes; chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi ; ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l’orner. . . Moïse leur dit : Que personne n’en laisse jusqu’au matin. Ils n’écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu’au matin; mais il s’y mit des vers. . . Tous les matins, chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture ; et quand venait la chaleur du jour, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux omers pour chacun. Tous les principaux de l’assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Moïse leur dit : C’est ce que l’Éternel a ordonné. Demain est grand jour de repos, sabbat consacré à l’Éternel 1 ; faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu’au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu’au matin. . . et cela ne devient point infect. . . Moïse dit : Mangez-le aujourd’hui, car c’est aujourd’hui un sabbat pour l’Éternel ; aujourd’hui vous n’en trouverez point dans la campagne. Pendant six jours vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est sabbat, il n’y en aura point. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n’en trouvèrent point. Alors l’Éternel dit à Moïse : Jusqu’à quand refuserez-vous d’observer mes commandements? .. . Considérez que l’Éternel vous a donné le sabbat; c’est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour.
Tel est le premier récit de nos saints Livres où il soit nommément question du sabbat. Ce récit n’est pas aussi clair qu’on pourrait le désirer. Si détaillé qu’il soit sur certains points, il semble fragmentaire sur d’autres. Aussi peut-on comprendre comment, selon certains théologiens, il suppose le sabbat comme étant déjà une antique institution, tandis que selon d’autres, même Hengstenberg, Keil et OEhler, il ne le suppose pas. Kurtz trouve que ce chapitre ne peut pas à lui seul trancher la question, mais qu’elle ne saurait demeurer indécise dès qu’on admet que l’histoire de la création racontée au début de la Genèse repose sur une antique et primitive révélation. Nous ajouterons qu’il faut interpréter le chapitre non seulement en regard de ce qui le précède dans nos saints Livres, mais encore de ce qui le suit, en particulier d’Exo.20.8-11 et de tous les passages subséquents de l’Ancien Testament qui rattachent expressément la loi du sabbat mosaïque au récit génésiaque de la création.
D’ailleurs, pour notre part, plus nous étudions le récit en lui-même, plus il nous semble supposer le sabbat comme une institution déjà connue. L’annonce de ce qui devait se passer au 6e jour (v. 5) apparaîtrait bien brusquement s’il en était autrement. Si lorsque le peuple a recueilli une double provision au 6e jour, tous les principaux de l’assemblée vinrent le rapporter à Moïse, cela peut s’expliquer par leur admiration et aussi, à cause de leur peu de foi, par la surprise dont ils étaient saisis en constatant que, selon la parole de l’Éternel, l’effusion de la manne avait été doublement abondante.
Les caractéristiques du 7e jour (v. 23, 25) : « demain est grand jour de repos, sabbat consacré à l’Éternel, aujourd’hui est un sabbat pour l’Éternel, » sont bien solennelles pour ne pas se rapporter à l’auguste institution du sabbat primitif. La parole du v. 29 : « Considérez que l’Éternel vous a donné le sabbat, » n’est pas moins significative dans sa brièveté, et ce qui suit cette parole : « C’est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours, » fait ressortir que le don du sabbat est antérieur à la largesse extraordinaire de l’Éternel au 6e jour, et que cette largesse n’est qu’une conséquence de ce don.
Mais il faut admettre que l’institution primitive était plus ou moins tombée en désuétude chez le peuple d’Israël pendant son séjour en Egypte, et qu’avant de promulguer dans toute sa plénitude l’institution du sabbat mosaïque, l’Éternel jugea bon d’y préparer le peuple d’une manière prolongée et admirablement miséricordieuse, en ne dispensant la manne que pendant les 6 premiers jours de la semaine et en la donnant au double le 6e. Comme le remarque Kurtz, « jamais Dieu ne commande sans donner auparavant, et ici aussi, Israël avait une promesse et une garantie de fait que la bénédiction de Dieu suppléerait richement à la suspension du travail commandée par la loi du sabbat.»Kurtz remarque encore que la durée extraordinairement longue (7 jours) de la halte du peuple dans le désert de Sin avait un double but : d’une part, accorder à Israël un repos prolongé après tant de fatigues et d’émotions; d’autre part, donner une base historique au renouvellement de la loi du sabbat. Tout cela est bien dans l’analogie de la foi.
§ 10. La sortie d’Egypte et Deutéronome 5.12-15.
Oschwald dit qu’au jour du sabbat Israël devait se rappeler les grandes oeuvres de grâce sur lesquelles se fondait l’Alliance :l’oeuvre de la création de l’univers (Ex.o.31.17) et l’oeuvre de la rédemption de la servitude d’Egypte (Deut.5.15), qui s’accomplit un jour de sabbat, et, à l’appui de cette dernière assertion, il met en parenthèse : « Comp. Exo.12.1-6, avec Exo.16.1,5. .. »
Ebrard, dans son énoncé de principes sur la question du dimanche, émet aussi cette dernière opinion, et il cherche à l’établir avec plus de précision. « Il ne faut pas oublier, dit-il, que lorsque Dieu réintroduisit la célébration du sabbat au sein d’Israël, qui en avait perdu l’habitude dans les années d’esclavage, la série des sabbats (d’après la comparaison d’Exo.12.1-6 avec Exo.16.1,5) comptait en arrière le jour de la sortie d’Egypte, de telle sorte que les sabbats depuis le temps de Moïse ne commémoraient pas seulement la Création, mais aussi la Rédemption typique comme cela est dit expressément Deut.5.16. »
Puis vient cette note explicative : « La sortie d’Egypte eut lieu dans la nuit du 14 au 15 nisan (Exo.12.1-6). Au 15e jour du mois suivant (Exo.16.1), c’est-à-dire, puisque les Israélites avaient le mois lunaire synodique de 28 jours, précisément 4 semaines plus tard, Israël reçut l’ordre de recueillir pendant 6 jours la manne (v. 5) et de se reposer le 7e jour. Les jours de sabbat tombent ainsi dans le mois de nisan sur le 14, le 21, le 28, dans le mois d’isar sur le 7, le 14, le 21, etc. »
En suivant encore avec plus de précision le même raisonnement qu’ Ebrard, on arriverait, ce me semble, à un résultat un peu différent et encore plus intéressant. En effet, d’une part, la sortie d’Egypte eut lieu, si l’on veut, dans la nuit du 14 au 15 nisan, mais plus exactement, d’après la manière israélite de compter les jours d’un coucher du soleil à l’autre, dans le cours du 15 nisan, car si l’immolation de l’agneau pascal tombait sur le 14, le repas pascal tombait sur le 15. D’autre part, en admettant que la parole de l’Éternel à Moïse (Exo.12.5) ait été prononcée, non le jour même de l’arrivée au désert de Sin, mais le lendemain, c’est-à-dire, non le 15 isar, mais le 16, on arriverait à déterminer les sabbats des mois de nisan et d’isar comme ayant eu lieu le 15, le 22, le 1, le 8, le 15, le 22, etc., de telle sorte que le 15 nisan et non le 14, aurait été un jour de sabbat 1.
L’institution du sabbat aurait ainsi reçu une nouvelle et éclatante confirmation, en coïncidant avec le grand jour de la sortie d’Egypte ; le rapport établi dans le Deut.5.16 entre le sabbat et cette délivrance se fonderait même sur une coïncidence chronologique. Malheureusement le calcul d’Ebrard suppose que le mois ne comptait pour les Israélites que 28 jours. Or cela n’est point du tout aussi certain qu’il le dit.
[Riehm, dans l’article Jahr du Handwörterbuch, dit que le mois lunaire synodique (c’est-à-dire d’une nouvelle lune à la suivante) est exactement de 29 jours, 12 h., 44’, 29" et que dans l’usage du calendrier (israélite) il comptait tantôt 29 jours tantôt 30. Franz Delitzsch, dit d’autre part, dans l’article Monate du Biblisches Handwörterbuch : « De très bonne heure, lorsque les hommes observèrent le ciel, on constata que le cours de la lune était chaque fois de 29 jours et demi, et on divisa en conséquence le temps en années lunaires comptant un peu plus de 354 jours répartis en 12 mois lunaires, dont chacun commençait naturellement avec la nouvelle lune. Mais on constata plus tard, et c’est ce que firent surtout les Babyloniens, que le soleil après 12 parcours de lune revenait au même point du ciel. On constitua d’après cela une année de 12 mois de 30 jours chacun, et pour ramener l’accord entre cette année de 360 jours et l’année solaire véritable, astronomique, que les Babyloniens considéraient comme étant de 365 jours et un quart, on ajoutait de temps en temps un mois intercalaire. Les Babyloniens et les Assyriens avaient de tels mois solaires de 30 jours pour la vie civile, et vraisemblablement aussi les Cananéens. Les Israélites, devenus sédentaires, se rattachèrent aussi à la manière de compter des Cananéens. De là vient que les Hébreux admirent dans la vie ordinaire le mois de 30 jours. (Comp. Nomb.20.29; Deut.34.8, à Deut.31.13.) De là vient encore la division du mois en décades, division que nous trouvons fréquemment dans l’Ancien Testament (Comp. Nomb.11.19; Gen.24.55, etc.). Mais à côté de ces mois les Hébreux conservèrent aussi des mois lunaires commençant avec la nouvelle lune. » Lepsius, dans son grand ouvrage sur la Chronologie des Egyptiens (1er vol., Berlin, 1849, p. 220), après avoir établi que chez ce peuple il y eut avant l’année solaire une année lunaire mobile (gebundenes) par opposition à l’année lunaire stricte (ganz freies), dit positivement qu’on ne peut rien dire de précis sur la longueur des différents mois de cette année. Ideler (I, p. 67) définit das freie Mondjahr (que nous avons appelée : l’année lunaire stricte), comme étant l’année lunaire pure, abstraction faite de toute considération du cours du soleil, — et das gebundene Mondjahr (que nous avons appelée : l’année lunaire mobile et que nous pourrions aussi appeler : l’année lunaire mixte ou modifiée), comme étant l’année lunaire déterminée à la fois par le cours de la lune et par celui du soleil.]