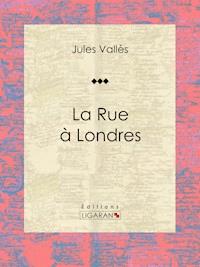
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ah ! ce n'est pas la rue de France ! – cette rue bavarde et joyeuse, où l'on s'aborde à tout instant, où l'on s'arrête à tout propos. On suit les femmes, on blague les hommes ; il y a du tapage, des rires, des rayons et des éclairs ; il y a des pétillements d'ironie, une odeur de plaisir, des souvenirs de poudre."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055122
©Ligaran 2015
Ma chère enfant,
Je vous dédie ce livre non comme un hommage de banale galanterie, mais comme un tribut de sincère reconnaissance.
Vous m’avez aidé à bien voir Londres, vous m’avez aidé à en traduire l’horreur et la désolation.
Née dans le camp des heureux, en plein boulevard de Gand – graine d’aristo, fleur de fusillade – vous avez crânement déserté pour venir, à mon bras, dans le camp des pauvres, sans crainte de salir vos dentelles au contact de leurs guenilles, sans souci du « qu’en dira-t-on » bourgeois. Honny soit qui mal y pense ! suivant la devise de la vieille Albion.
Vous avez fait à ma vie cadeau d’un peu de votre grâce et de votre jeunesse, vous avez fait à mon œuvre l’offrande du meilleur de votre esprit et de votre cœur.
C’est donc une dette que mes cheveux gris payent à vos cheveux blonds, camarade en qui j’ai trouvé à la fois la tendresse d’une fille et l’ardeur d’un disciple.
Vous souvient-il qu’un jour devant un Workhouse, nous vîmes une touffe de roses à chair saignante, clouée je ne sais par qui je ne sais pourquoi, au battant vermoulu ?
Cette miette de nature, cette bribe de printemps faisait éclore l’ombre d’un sourire et un reflet d’espoir sur les faces mortes des pauvresses qui attendaient leur tour. Cela nous donna un regain de courage, à nous aussi, et nous franchîmes, moins tristes, la porte de cet enfer.
Au seuil de mon livre, dont quelques chapitres sont, comme le « Refuge », pleins de douleur et de misère, je veux attacher votre nom comme un bouquet.
JULES VALLÈS.
Paris, 1er Décembre 1883.
Ah ! ce n’est pas la rue de France ! – cette rue bavarde et joyeuse, où l’on s’aborde à tout instant, où l’on s’arrête à tout propos. On suit les femmes, on blague les hommes ; il y a du tapage, des rires, des rayons et des éclairs ; il y a des pétillements d’ironie, une odeur de plaisir, des souvenirs de poudre.
La rue de Londres est ou énorme et vide, – muette alors comme un alignement de tombeaux – ou bourrée de viande humaine, encombrée de chariots, pleine à faire reculer les murs, bruyante comme la levée d’un camp et le torrent d’une déroute. Mais ce sont des bruits sourds, un grondement d’usine, le tumulte animal – point une explosion de vie et de passion.
On entend grincer les roues, hennir les chevaux ; mais on n’entend pas parler les hommes ; ni parler, ni rire !…
Ils vont, ils viennent comme des pistons de machine, ils passent comme des courroies se mêlent, comme des trains se croisent ; ils ne se disent jamais qu’un mot : « Jolie matinée, vilain temps » suivant qu’il fait beau ou mauvais – et ils reprennent leur fonction, court, droit et dru. Allez, le piston !
Tous se ressemblent.
Par esprit de patriotisme, parce qu’ils ont le Derby et la mer, ils ont tous des têtes de cheval ou de poisson. Cette similitude de physionomie, cette monotonie du type, tue d’avance l’originalité de la rue. Pas un visage qui tranche brusquement sur le reste ; quelques-uns ont l’air un peu plus hypocrite ou un peu plus brutal que d’autres, voilà tout !
Les femmes – ce parfum de la rue française – se divisent crûment, là-bas, en deux espèces : celles en sucre et celles en corne, celles qui ont des profils d’anges et celles qui ont des profils de bêtes, celles qui ont seize ans et celles qui en ont cent, des joujoux ou des magots.
Quand elles ne sont pas des jeunes filles, elles sont tout de suite des vieilles – sans transition – elles se gâtent en un clin d’œil comme du gibier. On avait une gazelle hier, on a une girafe demain, et le Français qui fouille la rue ne rencontre que des bébés montés en graine ou des caricatures à cheveux gris et à dents jaunes.
La femme de trente ans, comme nous l’aimons, grasse et blanche, ou souple et dorée, appétissante comme un fruit mûr, irritante comme une odeur sauvage, ou ne la frôle point, on ne la sent pas sur le pavé de Londres.
À partir de 22 ou 25 ans – sauf hasard – l’Anglaise est finie, et, même quand elle est jeune, elle n’a jamais ce je ne sais quoi qui fait qu’une Parisienne vous ramasse le cœur d’un geste et laisse tomber le désir de sa jupe ; soit que la pluie l’oblige à montrer sa cheville, soit qu’elle vire le cou au soleil ; il y a les éclairs noirs des yeux, les traînées de jupons blancs, la cambrure du pied et le jeu des hanches.
Ici, les femmes marchent comme des soldats, ont toutes la taille trop longue, le pied bête, et il y en a des tas qui portent lunettes.
Le jeune garçon, chez nous, est vif, sympathique et crâne. Chez eux, il est vieillot et grave.
Est-il rien de plus affreux, à vrai dire, que ce gamin de douze à quinze ans qui a un col immense, une jaquette toute petite, un gros parapluie et un chapeau tuyau de poêle ? Il ne rit pas, n’ayez peur !
Il ne flâne pas, – ah ! fichtre non ! – il siffle !
À Londres, on siffle partout, sur le trottoir, sur la chaussée, sur la banquette d’omnibus ou la chaise du restaurant, dehors, chez soi, chez les autres, en face des dames surtout.
Quand on ne siffle pas, on fait autre chose…
Ce gamin veut bien se contenter de siffler. Il vient de chercher une lettre de crédit à la Banque, il passe manger un sandwich et va partir pour faire le tour du monde. Il pense que son père sera au bateau, il n’en est pas sûr, il y avait beaucoup à faire hier à l’Office, dans la Cité. Il va raide, muet, grave, gonflé d’argent ; il ne donnera pas un sou à un pauvre en chemin.
Y a-t-il des types qui se détachent, des nez ou des regards qui trouent cette banalité : porte-crochets, vendeuses de fleurs, meneurs de chevaux, des grotesques ou des gracieuses ?… Rien, rien !
Pas de commissionnaires.
Cet Auvergnat ou ce Savoyard, ces favoris gris, ce nez rouge, cette culotte rapiécée, ce qui s’appelle à Paris le père Ugène ou le vieux du coin, qui vous indique votre chemin pour rien et qui, pour vingt sous, sait glisser une lettre, attraper une réponse ; qui cache un bouquet dans sa casquette et un rendez-vous dans son sourire ; qui fait campagne avec vous, sous le drapeau de l’amour ou de la misère ; qui, un jour d’insurrection, vous reconnaîtra et vous prêtera sa veste de velours pour remplacer votre paletot de vaincu plein de sang, ce brave homme-là est inconnu dans ce Londres qui n’a pas pour deux liards de fantaisie.
Les décrotteurs sont ou des voyous à qui on ne peut pas confier un penny, ou des gamins que je ne sais quelle société chrétienne a habillés de rouge, marqués d’un chiffre. Ils n’ont pas le droit de quitter leur sellette – surveillés au nom du Christ.
Les bouquetières sont sales, ont le nez crotté, les souliers crevés, la jupe en lambeaux et des cous pleins de crasse.
Elles portent leur marchandise sur un éventaire, comme les poissonnières portent leur marée, et sentent si mauvais qu’on ignore si leurs fleurs sentent bon.
Presque toutes sont grêlées, il y en a pas mal qui sont borgnes, et j’en ai vu une qui me montrait – avec un sourire mutin – qu’elle était bossue. On semblait bien jaloux d’elle dans cet amas de guenilles.
Elles coupent les tiges frêles et les remplacent par des bouts de bois, puis elles ajoutent des fils de fer. C’est que l’Anglais n’aime un bouquet que s’il est solide, – si le laiton lui entre dans les doigts, s’il peut passer la queue de la touffe, sans qu’elle se casse, dans les ouïes d’un maquereau ou le croupion d’une volaille.
Ô bouquetières de France, au fichu dérangé, au chignon crâne, qui emportez la boutonnière à l’arme blanche, qui êtes plus fraîches que vos roses et avez la voix plus chaude que le parfum de vos œillets ; comme l’on se souvient de vous – avec le frisson de Paris – en face de ces rangées d’oignons humains d’où sortent, salies et empoisonnées, ces fleurs aux yeux bleus, aux lèvres rouges, au cœur d’or !…
Ni commissionnaires pour porter les billets doux, ni jolies bouquetières pour donner du prix au muguet et du ton au désir !…
Les cochers ? – Ils ne s’injurient pas et ne font point claquer leurs fouets ! Ceux des cabs ressemblent tous à Robert-Macaire. Ceux des omnibus visent au gentleman, ont des gants et le chapeau à haute forme.
L’omnibus, bariolé de couleurs criardes, a l’aspect d’une roulotte de saltimbanques. On n’ose pas y monter, quand on n’est pas un phénomène.
Pour arriver à l’impériale, il faut faire des exercices de clowns ; pour pouvoir tenir dans l’intérieur, il faut des poumons de fer, en été.
Les vitres ne s’abaissent pas. Il est défendu d’avoir de l’air !…
Il n’y a pas de bureaux où, par les chaleurs ou les averses, on puisse s’abriter en attendant, prendre son ticket, demander la correspondance.
On monte sa faction sur le pavé, et l’on est forcé de saisir au vol les renseignements que le conducteur jette en se tenant pendu à sa courroie, comme un singe attaché par la queue.
Tant que l’omnibus trotte, ce conducteur se cache des encoffrés ; il ne s’occupe plus que de ceux à cueillir ; il faut qu’on lui tire les pans de son habit et qu’on le bourre de coups de canne ou de parapluie, pour qu’il veuille bien se montrer, répondre aux captifs, lâcher les gens, verser les colis à destination. Il vous regarde et se contente de crier : Bus ! bus ! dans les oreilles des passants, dont il accroche les chapeaux, dont il saisit les poignets.
C’est de l’enlèvement ! Joli garçon, montez chez moi…
Perdu sur la chaussée, bousculé par ce tas de muets sinistres, étonné des grognements, ahuri par la rumeur, menacé par les chevaux, frôlé par les voitures, le Français perd la tête ; il cherche un café, un coin où il pourra s’asseoir, réfléchir, écrire ; mais il n’y a que quatre cafés à Londres, et pas un qui ait l’œil sur la rue, et des tables jaunes sur des trottoirs où il fasse frais et d’où l’on voie rouler la foule.
Pas de cafés, et toutes les maisons fermées ainsi que des tombeaux ! Ni portes cochères ni allées. S’il arrive un orage, qu’on soit éreinté ou malade, pas d’autre asile que le public-house ignoble.
Le long du ruisseau, dans l’entrebâillement des portes, les ivrognes titubent et hurlent. C’est la soûlaison noire, point l’ivresse rose, – l’écume du haut-mal, point la mousse de la gaieté.
Chose horrible ! – Ce sont les femmes surtout qui salissent le pavé de leurs vomissements et qui battent les murs avec leurs têtes ; non pas seulement celles en haillons, mais aussi celles en chapeau frais et en robe neuve ; non pas seulement les vieilles, mais les jeunes. Celle qui vous a heurté tout à l’heure était la sœur d’un avocat ou la fille d’un révérend, elle sortait du temple ou elle y allait ; elle s’est arrêtée à un bar pour siffler du whisky ou du gin – et elle festonne et elle chante. Les seuls éclats de voix humaine qui crèvent le brouillard de Londres sortent des poitrines brûlées par le poison des public-houses. Ce peuple ne parle fort dans les rues que quand il est soûl.
N’est-il donc rien qui, au lieu de blesser le Français égaré dans ce chaos, l’émeuve et le frappe ? – Ah ! certes si !
Les rues n’ont point l’air des avenues d’un camp, comme dans le Paris rayé de garance et étoilé de hausse-cols. On n’entend pas éternellement le taratata des clairons.
C’est un évènement que le passage d’un bataillon, et c’est à peine si l’on rencontre des soldats. En tout cas, ils ont l’air plus comique que menaçant, sous leur petite veste, et leur bonnet de police, rond et rouge avec une frange d’or, comme une tranche de citron sur un grog au vin. Ils sortent sans armes.
Les officiers n’apparaissent jamais en uniforme. Un décoré fait retourner les têtes.
C’est bien ; mais s’il n’y a pas de pioupious en tenue de campagne, ni de capitaines l’épée au côté, il n’y a pas non plus d’ouvriers en casquette et en blouse.
On ne connaît pas la blouse à Londres.
Les artisans n’ont point la fraternité du costume, une livrée de travail, qui peut devenir un drapeau au bout d’un bâton. Ils n’ont pas du bleu sur les épaules, ils passent près de vous sans qu’on les distingue, habillés de tons neutres, dans des vêtements qu’ils portent comme des mannequins portent des frusques.
Le peuple n’a pas sa physionomie à lui, les corps d’état ne se devinent point, les ouvriers n’ont pas leur couleur ; tout au plus ressemblent-ils à ces manœuvres qui traînent seulement des fardeaux, qui n’ont que la force et le courage de la bête, et que nous appelons en France de ce nom navrant : hommes de peine.
Où donc la gaieté du peintre d’enseignes aux cheveux longs, du peintre en bâtiment à bonnet de pêcheur, où donc la barbiche à la chasseur et le pantalon à côtes du charpentier ?
Où donc la chanson du bâtiment, la scie de métier ? C’est triste, vous voyez, une rue de Londres ; on se demande, on cherche quel est le fond d’une nation, quelle est l’âme d’une cité qui fait ce bruit terrible et qui parle si peu ; où rien ne s’accuse en traits nets et logiques, où il n’y a pas de décorations aux revers d’habits, mais où les masques suent la morgue ; où les sergents de ville ont l’air poli et où les gentlemen ont l’air féroce ; où les boueux sont bégueules et les enfants solennels.
N’y a-t-il pas une voie, dans le nombre, sur les murailles de laquelle soit écrite avec de la poudre, telle qu’un tatouage sur le bras d’un marin, quelque devise de liberté ?
Toutes les villes qui ont dominé l’histoire et commandé l’humanité, Athènes, Rome, Paris, ont de ces chemins, par où le sang s’est échappé à pleins flots de leurs veines trop fortes.
C’est par ici qu’a passé Cléon, c’est par là qu’arrivèrent les Gracques, sur cette place est mort Delescluze !
Les peuples à cerveau puissant ont, chaque quart de siècle, de ces apoplexies qu’on nomme des révoltes, et il reste, dans les façades, des trous cernés de rouge, mais par où jaillissent des fusées de lumière.
Oui, il y a White Hall et le souvenir de Charles Ier ; mais des années se sont usées depuis ce matin-là, et la fenêtre est clouée…
On trouve marque de chauvinisme égoïste et violent, mais point trace d’inondation populaire et de convulsions civiles ; ils n’ont pas senti le tremblement social.
Autant la rue d’affaires est bourrée et violente, avec ses trépidations affreuses, comme si un parc d’artillerie courait au secours d’une bataille, avec ses bourdonnements dans l’air, comme si d’un massacre de ruches s’échappait un essaim d’abeilles enragées, – autant la rue de famille est déserte et silencieuse.
Oh ! je n’aurais pas besoin de voir passer ceux qui habitent ces logis pour savoir ce qu’ils valent, et, en pleine nuit, sous la lueur oblique de la lune, aussi bien que sous le rayon louche de leur soleil, je devinerais l’Angleterre. À l’heure où les chaussées sont vides et les trottoirs abandonnés, à Paris de même qu’à Londres, la tournure des bâtisses, l’architecture des rues suffiraient pour m’indiquer ce qu’il y a au fond des âmes, et le caractère de la race sort des murailles comme un crapaud.
Quand le business est fini, quand les offices ferment, c’est dans cette rue qu’on vient se reposer, c’est une de ces maisons qui est l’intérieur, qui est le foyer, le home, sweet home – il y a une chanson là-dessus !
Gardé par des grilles, hérissé de crocs, protégé autant qu’une boulangerie contre les famines de 93, ce home et ce foyer ! Entre la façade et le trottoir, bâille un hiatus sale, un creux profond, un trou grillé, comme pour mettre un loup. Partout du fer noir ou des pierres d’un gris de tombe, semblables aux ossements lavés par la pluie. Au haut des marches, le visage de bois d’une porte qui ressemble à celle d’une prison ou d’un couvent.
De ce côté-ci, une fenêtre – œil terne qui s’ouvre en long, dont la paupière se retrousse et se tord ainsi que celle d’un paillasse ou d’un fou – à guillotine. Il ne faut point passer sa tête là-dessous, le couperet pourrait tomber ! Aussi ne voit-on jamais s’allonger, à travers les fleurs, un cou de jeune fille. Il n’y a, en Angleterre, que les femmes perdues, – de vice ou de misère, – que les étrangers, ignorants ou cyniques, qui osent mettre le nez à l’air, tendre le front et regarder ceux qui vont et viennent…
On dirait qu’il règne une consigne de mort !
Il est tard, c’est le soir ; mais le jour c’est de même ; – c’est toujours ainsi !
Demain, quand le soleil – ce qu’ils appellent le soleil – luira sur cet amas de tristesses, il ne fera pas tomber les barreaux, il n’ouvrira pas les croisées et il ne forcera pas les serrures !
Les gens vivent là-dedans, isolés comme des malades ou des aliénés ; si l’on a besoin de frapper à l’une de ces portes pour demander de l’ouvrage, un conseil ou du pain, on ira avec terreur soulever ce marteau ; – les âmes sont froides quand les murs sont si nus, et les cœurs s’ouvrent mal dans les demeures si bien fermées.
Ce n’est peut-être pas qu’ils soient féroces, ils sont seulement orgueilleux.
Quiconque veut entrer dans ces maisons à tournure d’enfer doit faire une station aussi longue que pour entrer au paradis. – Qu’il attende !
– Je suis chez moi, et je suis Anglais – I am an Englishman – dit entre ses dents le locataire.
Et il ne daignera aller un peu plus vite, que si le battant est manié d’une main hardie, avec une impertinence qui sente son gentleman, une désinvolture qui indique le maître. L’homme se pressera alors, au nom de la servilité nationale qui court lécher le pied des hiérarchies.
Mais voyez le temps que passe devant la porte close, comme un pénitent aplati contre un confessionnal, le visiteur inconnu, modeste ! On l’a entrevu, du fond du creux où l’on peut mettre un loup, et on le laisse se morfondre et piétiner, jusqu’à ce qu’on ait fini de raccommoder un bas ou d’achever le thé à petits coups.
Pays hostile, race murée ! Ces habitations qui s’ouvrent avec tant de crainte et de fatigue, c’est à peine si on peut les découvrir et les distinguer, une par une, dans ce tas de moellons qui s’appelle la rue. L’Anglais vit chez lui – ne va pas chez les autres – et n’a pas besoin d’écrire le nom de ses voies en lettres qu’on puisse lire de loin.
Dans chaque quartier, il y a le tiers des chemins qui n’ont pas leur marque visible sur l’oreille ; ou bien cette marque est noyée et perdue dans le noir de la pierre, ainsi que l’initiale d’un boucher dans le gras d’une toison sale. On ne distingue rien – l’Anglais en rit dans sa barbe jaune – il aime à voir souffrir les gauches et barboter les pauvres.
Il n’a pas même pris la peine de donner à chaque rue un nom particulier. Il y en a vingt qui s’appellent « Charles », trente qui s’appellent « Charlotte » – et il faut chercher le Road, le Square, – que sais-je !
On devine vite qu’il leur manque les habitudes d’amitié, la gaieté de la vie d’échange !
Il importe peu à des gens qui ne se voient point entre eux, qui vivent en ours, qu’à l’angle de l’avenue soit le n° 29, et au milieu le n° 1, – ce qui se présente à chaque instant, au grand étonnement des Français, que ces méthodiques traitent de brouillons, mais qui, au moins, peuvent se reconnaître et se retrouver dans les carrefours de leur pays.
Non seulement le chiffre quitte sa place, joue aux quatre coins, se mord la queue, mais il disparaît totalement et se laisse chasser par un mot. On demeure : Manor Place ou : Hope cottage, sans numéro ; on semble devenu un châtelain, vous comprenez.
C’est de l’orgueil, cette fois, sur toute la largeur d’une façade, cela vous a un air householder – chef de bail – qui fait le bonheur des Anglais.
Avec leurs titres, lisibles ou non, les rues de Londres sont des labyrinthes le soir, car, à part quelques corridors sur les vitres desquels le gaz détache les numéros, il est impossible de démêler les chiffres – s’il y en a – sur la peau des murs ou des portes, que rien n’éclaire.
Ajoutez, en outre, que les voies sont droites, longues, sans fin. Il faut abattre son kilomètre avant de pouvoir s’échapper de côté ; si l’on se trompe à l’entrée, on marche, on marche, comme le Dante ou le Juif errant, entre deux haies de pierres sans jours et sans issues. – Laissez toute espérance, vous qui vous aventurez ici !
Quelle sinistre impression donnent ces rangées de bâtisses, rongées par le brouillard et par la pluie ! Quand les maisons à Londres n’ont pas le reflet lugubre d’un linceul sali, elles ont la couleur du tuffaut de Mazas ou du bois de justice – des tons de prison ou d’échafaud – c’est affreux !… je ne m’en dédis pas : on dirait un peuple de maudits ou de détenus.
Puis il y a tant d’églises ! Toutes les villes qui ont beaucoup d’églises sont mornes. Les temples protestants, – nus sous le ciel noir, sans l’odeur de l’encens, sans les vitraux qui saignent, – paraissent avoir été bâtis avec des blocs arrachés au déluge, boueux de sa fange et roulés à cette place par un troupeau de flagellés.
Quelques petites chapelles semblent faites de cailloux ramassés, au bas des murs croulants, par des mendiants de campagne ; on dirait des cathédrales de coquilles. La religion réformée met sur les monuments, toujours, la marque d’implacable tristesse.
Il n’y a presque pas de soldats, disions-nous, mais, en revanche, le pasteur abonde. On voit, à chaque moment, glisser sa silhouette sombre guillotinée de blanc. Sa cravate couleur d’hostie le signale. Son chapeau rond, à larges bords, continue l’uniforme, et les pans de sa lévite rappellent les vendeurs de bibles qui, en France, courent comme des cafards dans les villages. Ils font moins peur ici, ils portent la barbe, ont des enfants ; mais, tout de même, au nombre de taches noires que je remarque dans la foule, à l’aspect sournois des églises, je devine que le peuple anglais est, lui aussi, cousu par sa morgue ou ses guenilles au surplis du prêtre.
Partout on lit des avis de prêches et des recommandations chrétiennes. – La Bible, la Bible toujours ! Elle est dans la devanture de l’échoppe, dans la vitrine de la gargote, de même qu’à la porte du temple. Le Christ traîne ses pieds meurtris dans la poix et la friture ; les gueux bouchent leurs carreaux avec des feuillets du livre saint.
Les murs sont couverts d’affiches ayant la teinte qui plaît à qui les lance – rouges comme du sang ou blanches comme les placards officiels en France. Et dans des annonces de savon ou de poudre à punaises, on fourre le nom de la reine ; le portrait du prince de Galles s’étale sur une réclame de marchand de bleu. Un magasin de chaussettes a pour enseigne : « Au marquis de Lorne. » Bref, les têtes couronnées sont mises à toutes sauces, ni plus ni moins que de simples têtes de veau, dans la grande cuisine de la publicité. Chez tous les libraires, se vendent des exemplaires de pamphlets qui portent, sur leur couverture, la charge hardie des membres de la maison royale.
Sur la chaussée, se traînent à la file les sandwiches, qui portent, écrit au dos et au ventre :
CE SOIR
MEETING À TRAFALGAR-SQUARE
MANIFESTATION COLOSSALE !
On place souvent l’affiche au bout d’un bâton, et l’on voit avancer, de loin, cet étendard de papier qui, poché de couleurs violentes, prend, entre les mains de ce gueux, l’air d’un gonfalon de révolte.
À Paris, l’homme et l’affiche coucheraient au poste, peut-être bien.
Les pasteurs aussi font promener l’annonce du sermon prochain :
VENDREDI, LE PÈRE IGNATIUS PARLERA
IL PARLERA ! !
ALLEZ-Y ! ! !
Zim malaboum, boum, boum !
L’Angleterre laisse dire, laisse crier, laisse pleurer. Elle ne paye pas des oreilles exprès pour écouter ce que les mécontents murmurent ; elle préfère regarder passer et s’écheveler en pleine place publique les protestations ou les colères.
Mais entendez-vous cette armée en marche ? Voyez-vous rouler l’avalanche ? De tous côtés, les ruisseaux sont venus la grossir. Londres a vomi son contingent du fond de ses cent quartiers, et maintenant le torrent sort de son lit de pierre, où l’avait encaissé le mot d’ordre des chefs, devant les lions de Trafalgar-Square. Il déborde à travers les rues du côté d’Hyde Park. Il y a des bannières et des musiques qui se mettent à jouer toutes ensemble autour de l’Arbre de la Réforme (Reform Tree), le Chêne de la Justice du peuple. Quand le tribun du jour s’avancera pour sa harangue, on emplira le ciel de bruit et l’on poussera des hurrahs furieux.
On peut, ici, se trouver cent mille, avec le vent dans les oriflammes, et gueuler à la gueule des canons, sans que le sol tremble d’un autre poids que de celui de chaque citoyen, sans que la reine ait peur, sans que les télégraphes tressaillent, sans que les généraux galopent, sans que l’Europe regarde. Les affiches ne sont appliquées qu’avec de la colle – jamais avec du sang, – et l’on bat plutôt le rappel sur la bedaine d’une grosse caisse que sur le ventre d’un tambour.
N’importe ! – cette liberté, ce calme, cette tranquillité des fusils, ce fourmillement d’hommes, ce droit d’être cent mille et d’avoir un drapeau, il y a là de quoi frapper l’œil d’un Français et secouer son cœur.
Tout à l’heure, ces gens étaient cloîtrés dans leurs maisons tels que des assiégés : voilà qu’ils envahissent la ville ! – Quelle ville !… toute pleine de contradictions énormes, amas de confusions ! – avec des silences de cimetière, des mines de chemin où l’on tue – et, à deux pas, des grognements d’inondation et des déchirements de tempête !
Et leurs pauvres ! Spectacle dont le brouillard de Londres et sa boue, si épais qu’ils soient, ne parviennent pas à voiler et à noyer l’horreur ! Que dirait-on sous le soleil de France, à Paris, si subitement, en plein boulevard, on voyait passer ces misérables, poux du pavé, araignées de la muraille, crapauds du ruisseau !
Le gueux de France ne peut donner une idée du gueux de Londres !
Il y a bien, chez nous, le mendiant de village porte-loques au sourcil broussailleux, qui ressemble, avec sa face grasse, à un moine chassé du couvent ou, avec son crâne chauve et sa barbe grise, à un saint tombé en enfance ; mais c’est un métier, celui de mendiant, presque une mission, et il est même un peu sorcier. Il a ses rations de soupe, ses relais de viande.
L’indigent de nos villes est maigre. Il fait peine à voir sous sa blouse, dont le bleu a été mangé par le soleil ou la pluie, comme l’expression de son regard a été dévorée par la peine et sa joue creusée par la souffrance. Notre déclassé arrache des larmes, quand il passe, serré dans sa redingote boutonnée dont les revers plus neufs sont marbrés de taches vertes. Mais ils ont raccommodé, le matin, les trous par où l’on pouvait voir la chemise sale ou la chair blanche ; ils ont la pudeur de leur misère.
Le pauvre de Londres n’est pas le même. Chez lui, le vêtement a l’air d’une peau qui s’écaille, d’une lèpre qui tombe. C’est déchiqueté, comme si des rats avaient voulu dévorer l’homme, comme si on avait donné des coups de fourche là-dedans.
Puis il y a sur les visages une telle expression de fatigue et de terreur ! Pour s’en faire une idée, il faut penser au fou qu’on laissait déchirer et mordre ses habits, dans sa cage, et qui s’est échappé, ainsi qu’une hyène de ménagerie ; la crise est finie, il a avalé son écume, et souillé, cassé, il vagabonde, hagard, par les chemins.
Certains m’ont rappelé ces prisonniers que, sur les routes, les gendarmes ramènent de brigade en brigade ; qui vont, entre les deux chevaux noirs, attachés à la selle ; on a coupé de côté, par le haut, leur culotte trop large, afin qu’ils s’embarrassent dedans s’ils veulent fuir ; et ils voyagent ainsi, la nuit, le jour, jusqu’à ce que la prison les recueille : tels les affamés anglais !
À Londres, cette détresse se promène à travers les rues, sans que personne se détourne, avec effroi ou avec douleur.
On en rit parfois ! « Charlie, regardez donc ses pieds, comme ils sont blancs ! »
Blancs, dans la boue de l’automne, comme ceux d’un mort.
Rouges, dans la pâleur de la neige, comme les pattes d’un écorché.
Et le pauvre poursuit sa marche de bête écrasée, il se traîne, se traîne, las de cent nuits passées sur les degrés, au bord de la rivière trouble, ou sur les bancs, au fond des parcs, devant la verdure triste.
Il trouvera du pain, ce soir, s’il en reste de tout celui qu’on gâche dans les maisons pleines d’or !
En attendant, il cherche une épingle pour rattacher ses hardes qui tombent, il a fait des nœuds dans le dos et mis au poignet des liens, comme des menottes, mais le fil était usé et la trame rongée ; il est déjà nu d’une jambe, il va l’être des deux, ou avoir dans les reins une place à vif comme un moxa, ce dépecé de la misère.
En se baissant, il montrera qu’il est un homme à des ladies qui le verront bien ; mais les ladies vont grossir la foule des meetings philanthropiques, et, en rentrant, elles se mettront à faire des caleçons pour les sauvages, – sans oser dire « caleçon », elles ne prononcent pas le mot, c’est shocking. Tout à l’heure, elles coudoyaient pourtant, sans rougir, un homme que la pauvreté faisait obscène.
On ne connaît que quelques coins de Paris où l’indigence soit crapuleuse, où le vice hurle à la face du ciel. Il y avait Paul Niquet, jadis ; il y a encore l’Assommoir des chiffonniers, mais c’est un bivouac qui a ses confins, sa palissade de hottes ; et nous savons où siège Son Altesse l’ivrognerie, à quels endroits et à quelles heures commence la Danse macabre de la guenille.
À Londres, la famine, à l’instar de la Compagnie des Indes, a des comptoirs partout. Elle a ses refuges de prédilection, mais ne s’y retranche pas.
Elle a des succursales de sa Cour des miracles à tous les angles de la ville, elle est collée au flanc des palais dorés : les ruelles pleines de gueux aboutissent, en bouches d’égout, dans les avenues des millionnaires.
On sent tout à coup venir une odeur de drap pourri, de fange cuite ; c’est qu’il y a là une Lane ou une Court, quelque passage infect où grouille une tribu de misérables.
On peut les voir du trottoir, sans entrer, comme on guigne une punaise dans une fente.
On n’aperçoit guère que des femmes et des enfants ; des enfants dans toutes les embrasures des portes, par paquets de quatre ou cinq, avec des bébés pâles ou des poupées habillées de rouge entre leurs bras nus. Beaucoup de grandes sœurs portent leurs petits frères et font les mamans, dans ce milieu de crotte et de désolation. Celle qui a huit ans dorlote celle qui a huit mois, et la berce, la caresse autant qu’une fille de riche. Ils sont précoces dans ce monde-là. Il n’est pas jusqu’à ces têtes guère plus grosses que le poing et gaiement chauves qui n’aient, de bonne heure, leur expression. Cela tient, sans doute, à ce que les rejetons des affamés vivent sur le pavé dès leur naissance, et attrapent vite quelque chose des milliers de grimaces qui se font autour d’eux.
Dans tous les quartiers de détresse, sous tous les ciels, en France comme en Angleterre, les pauvres ne restent pas dans leur taudis sans lumière et sans air, où le lit est grand moins qu’un cercueil, où le charbon du fourneau peut mettre le feu à la paillasse – on descend l’escalier gluant et l’on dégringole vers la porte.
On s’installe sur le seuil, c’est le canapé de la maison, et l’on bavarde, tête nue et poitrail au vent. On prête l’oreille au récit des commères, et l’on tend ce qui reste de sein à une bouche pâlotte qui veut téter. La rue, c’est le salon des misérables, il y fait jour, il y a de la place, la maisonnée peut s’ébattre ; puis il y a la franc-maçonnerie de la maternité, et l’on a soin de la nichée de la voisine, pour que la voisine, à son tour, ait soin de la vôtre.
Mais combien cette rue anglaise, boudoir des mères, jardin des mêmes, diffère de la rue française, de celle où les demeures humbles ont aussi jeté leur monde de femmes et d’enfants !
La rue française, même des plus bas quartiers, a encore l’air d’un atelier et non d’un coupe-gorge ; il y a des bruits de fuseaux, des traînées de laine, en tout cas de grands coups d’aiguilles – on raccommode les hardes, on reprise les bas, on fait un bonnet, on coud un ruban ; la langue n’est pas seule à tricoter, on se dépêche de finir un tablier ou un jupon, la robe de la petite ou la veste du gamin. Tout cela certes ne sera pas brillant, il en résultera des rhinoplasties bizarres, des replâtrages comiques, mais enfin, l’on a soin des débris de la garde-robe, et l’on ne reste pas les bras ballants.
L’Anglaise, elle, ne fait pas œuvre de ses dix doigts.
Et si elle n’était que fainéante ! Mais elle vient cuver là son whisky et vautrer son ignominie sur les dalles.
Dès qu’elle a déterré quelques sous pour boire, elle repart, du côté du public-house où l’on débite le brandy, et elle revient grise et plus méchante. L’enfant est toujours avec elle.
Il y a un Dieu pour les petits d’ivrognes ! Comment ne sont-ils pas écrasés dans ce roulis de saoûlaisons, je ne puis le comprendre… ! Mais, que dis-je ? Ces crânes, ces jambelettes, ces yeux mi-ouverts, tout cela est blessé, meurtri ! L’on s’étonne en face des survivants, parce qu’on n’a pas compté les victimes !
Je n’ai pourtant vu ni estropiés, ni morts !
C’est que le courage m’a manqué pour rester là, quand la femelle hébétée, l’œil rond, la lèvre baveuse, écoutait, de son oreille bouchée par un caillot de sang, s’il restait un brin de vie dans ce corps frêle et si l’on entendait, malgré ce tapage de fauves, battre ce cœur d’oiseau.
Que deviendra l’enfant né dans ces trous, baptisé de gin, qui a ouvert les paupières dans la fumée de ces bouges, qui a bu le lait à cette gourde de chair rincée de poison, qui gigotera dans cette lie, qui grandira dans ces sentines ? Que deviendra-t-il ?
La grâce féminine – don bizarre, chose étrange ! – ne quittera pas la petite fille : si horrible que soit sa mère, si ignoble que soit son père.
Elles ont encore le geste et l’allure naïve, ces gamines crottées que l’on emmène dans les assommoirs, où l’on se bat devant elles, où le sang coule sur leurs menottes, et qui, au milieu de ce tumulte, font mine de donner du sucre à leurs poupées. Et cela vous a des coquetteries de demoiselle avec des gaucheries de vierge !
Il en est ainsi jusqu’à huit ou dix ans, douze au plus. Comment s’opère la transformation, je l’ignore, mais, soudain, l’on a devant soi une prostituée.
Les garçons deviennent plus vite des roughs, c’est-à-dire des voyous ; ils n’en gardent pas moins, les premières années, toute l’espièglerie et l’air charmant de l’enfance.
Ils vous demandent pardon (où ont-ils appris cela ?) quand ils déboulent dans vos jambes, déguenillés, le nez morveux ; le gentleman qui, tout à l’heure, m’a par mégarde marché sur le pied, n’en a pas fait autant. – Quand le gosse sera grand, il ne s’excusera pas non plus, à moins que ce soit pour s’approcher de ma montre, ou de ma gorge, suivant qu’il sera pick-pocket ou garrotter, voleur ou assassin.
Disons qu’il n’y a pas le gamin de Londres, comme il y a le gamin de Paris. Dès qu’il n’est plus un même, dès qu’il peut se culotter seul, le boy devient sérieusement un monsieur ou une gouape, distingué ou vil, tout d’une pièce. Il a eu une enfance, il n’a pas de jeunesse – on n’a pas de jeunesse en Angleterre !
Où sont les hommes ?
On ne voit que des robes lilas, des sarraux de toile jaune, des moutards qui relèvent leurs chemises, des fillettes qui remontent leurs jarretières, des femmes qui rentrent leur gorge.
Que font les pères de ces enfants et les mâles de ces femelles ?
Ils sont portefaix aux Docks ou à Covent-Garden, ou bien costermongers, marchands ambulants, – ils vendent des légumes ou du poisson, des coquillages ou de la vaisselle, ils donnent un coup d’épaule pour enlever une malle ou décharger une voiture, ils font tout, hormis un métier, et ils reviennent vite boire et boxer. Il n’y a pas de bonne partie sans batterie, et il faut qu’il y ait des yeux pochés et des nez fendus.
Ce n’est pas une bande qui est ainsi ; ils sont toute une armée, ils s’appellent LÉGION.
On les compte par centaines de mille ! Il y a des rues qui sont pleines de ces tas de chair et d’ordures ! Le dirigeant, celui qui fait les lois, celui qui les discute, reste à deux pas, demeure en face. Le lord qui passe n’a qu’à baisser les yeux pour voir ces détritus humains fermenter autour de sa voiture.
Nul ne s’en émeut, bourgeois ou aristocrate, banquier ou duc ; et, remarquez bien ceci, nul ne s’en plaint !
Voilà pourquoi il y aura, pendant des siècles encore, l’ignoble misère en bas, la fortune monstrueuse en haut !
Elle commence on ne sait où, elle finit on ne sait comment. Elle n’est pas, ainsi que les autres, inflexible et droite. Ce ne sont pas les Anglais qui l’ont faite, elle est venue au monde telle qu’elle est ; elle s’étirera toujours, comme un serpent galeux, à travers la ville.
Dans cette rue viennent s’engouffrer, à chaque marée qui arrive, des millions en barils et en sacs ; elle rejette elle-même, à chaque marée qui part, des richesses sans fin. Elle vomit du coton, du drap, de l’acier, du fer… Elle s’appelle la Tamise.
Toutes les contrées fameuses ont leur fleuve, le Volga, le Danube, le Tibre, la Seine, avec des rayons de gloire pour dorer leurs flots. La Tamise se contente d’être un chemin ; et, par ce chemin-là, s’avancent, à coups de rames ou voiles au vent, tout l’esprit de la race et toute la fortune de la nation.
En artère énorme qu’elle est, elle coupe Londres en deux branches dont chacune a sa physionomie violente. À droite, la fièvre des affaires et le flamboiement du luxe ; à gauche, les usines tristes, le travail dur, presque la province. Il y a l’autre côté de l’eau, comme chez nous.
Par où entre-t-on dans cette rue ?
Par ici.
Montons sur un de ces omnibus à cheminée, qu’à Paris, où il y a un soleil, ou appelle des « hirondelles », et qu’ici on nomme simplement Penny Boats, bateaux à deux sous.
Le vapeur n’est pas encore là ; je prends mon billet au guichet et j’attends à l’embarcadère.
Les hommes qui font le service ressemblent aux mariniers de Lyon ou de Bercy, mais comme une goutte d’eau de la Tamise ressemble à une goutte d’eau de la Seine. Ils sont encore plus roux, plus muets, plus lents.
Accrochés près d’une corde, j’aperçois de grands ronds jaunes sur lesquels est écrit : – Thames conservancy, – protection de la Tamise.
Le steamer ! En route, les voyageurs pour Woolwich !
Nous sommes au large.
Personne ne parle. Quelques amoureux se content tout bas ce qu’ils ont à se dire.
On n’entend que la voix du call boy, – c’est le moutard de douze à quinze ans qui, placé près du capitaine, suit sa main droite des yeux et, d’après le mouvement des doigts, transmet les ordres à la machine, qu’on peut voir s’essouffler, en se penchant. Le mécanicien a la tête honnête et mâle de tous ceux qui travaillent le feu et qui approchent des brasiers.
Le capitaine, vulgaire d’allures, paraît minable ; pas un galon, pas un bouton qui indique son rang et luise sur un coin de sa redingote râpée. Quand il a le chapeau haut de forme, il ressemble à un clerc en dèche ; quand il a un bonnet de laine, à un conducteur de coucou ; mais il n’a jamais l’allure du marin. Les gens de mer le méprisent et l’appellent land lubber, matelot d’eau douce.
Il s’assied tranquillement sur le pont quand tout va bien, et il aime à tourner ses pouces et à se faire les oreilles. Quelquefois, il descend dans la machine pour grilloter un petit beefsteak sur le grand feu. Tandis qu’il retourne sa viande, le bateau arrive au pier (le débarcadère) et, mal conduit par un des servants du bord, va donner de la tête dans la proue d’un camarade. L’homme remonte lentement (ce ne serait pas anglais de se presser) ; mais dès que tout a repris son petit train, après quelques éclats de sapin et quelques éclats de voix, il descend vers le call boy et lui administre une volée. Et ce n’est rien encore. Gare quand il arrivera à Woolwich !
J’ai vu cette scène hier même, et le call boy beuglait comme un veau ; cela déridait un peu les passagers. Il n’est pourtant pas facile de les faire rire.
Et comment voulez-vous qu’ils soient gais sous ce ciel, sur ce fleuve ?
L’eau de la Tamise est couleur de fange, et le ciel est couleur de tombe.
C’est comique à force de tristesse, vraiment, et si l’on n’était pas forcé de vivre longtemps dans ce pays, qu’on ne fit que passer, on s’amuserait de ces fonds sinistres comme d’un décor bâti par un mystificateur funèbre.
À sa source, la rivière est claire, je l’espère ; ici, elle est trouble et vile comme si l’on avait lavé dedans toute la vaisselle d’une armée, comme si l’on y avait vidé les rinçures de tous les hôpitaux de la chrétienté, les ordures de tous les bagnes du monde.
Elle est sale de toutes les crasses des pauvres qui descendent le soir nettoyer leurs pieds, noyer leurs poux ; elle est sale de la sueur des mâles qui travaillent à pousser les barques ou à emplir les docks.





























