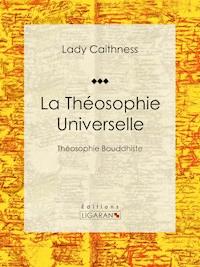
Extrait : "La Théosophie universelle préhistorique n'a laissé d'autres vestiges que d'immenses monuments de pierre et des Mythes hermétiques..."
Das E-Book La Théosophie Universelle wird angeboten von Ligaran und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335028942
©Ligaran 2015
La Théosophie, c’est-à-dire l’esprit intelligent et intime des Religions.
SAINTE-BEUVE.
La Théosophie universelle préhistorique n’a laissé d’autres vestiges que d’immenses monuments de pierre et des Mythes hermétiques. Si l’on doit considérer ce système comme la Religion-Sagesse (Wisdom-Religion) qui donnait une connaissance individuelle de Dieu, il est probable que la Théosophie n’était enseignée qu’aux initiés qui formaient une fraternité universelle, tandis que les masses étaient laissées à l’idolâtrie ainsi que les monuments de pierre semblent l’indiquer. Il en fut de même pour toutes les hiérarchies païennes : Dieu pour le petit nombre et la « lettre qui tue » pour tous.
L’aristocratie hiérarchique telle que nous la retrouvons dans toutes les religions de l’antiquité, et surtout dans les systèmes nationaux, faisait de Dieu un grand Arcane et de la Théosophie un monopole. Lorsque les chefs spirituels des nations, comme Moïse, Manu, Zoroastre, etc., se révoltaient contre un système hiérarchique, ils finissaient toujours par en créer un nouveau qui favorisait leur propre tribu.
Les hiérarchies restèrent de fait inébranlables jusqu’à ce que, au ve siècle avant l’ère chrétienne, un grand mouvement se manifesta, qui fut l’inauguration, d’une nouvelle dispensation spirituelle.
Dans ce siècle-là Pythagore fit résonner une corde dont l’écho fut renvoyé plus tard par Platon et les Théosophes Alexandrins et qui, depuis lors, n’a jamais cessé de vibrer au fond de l’âme humaine. Presque à la même époque Lao-Tse, Confucius, Zoroastre, Daniel, Ezéchiel, Jérémie, Habbakuk, Anaximandre, Héraclite, Xénophane enseignaient leurs différentes doctrines ésotériques ; et ce fut aussi dans le même cycle que le peuple de l’Inde vit une grande lumière manifester l’absolu à travers Gautama Bouddha. Cependant ceux qui, à la même époque que le prophète Hindou, enseignaient leurs Théosophies respectives, se contentaient de professer au point de vue national : ils ne prirent jamais l’attitude de maîtres universels. Ce fut Gautama qui essaya de formuler le premier système général de Théosophie historiquement connu. Ce système d’émancipation morale considère tous les êtres comme égaux, sans acception de race ou de caste, et il est si totalement opposé à l’astuce des bigots, trafiquants de mystères, que celui qui s’est une fois rendu compte de ses principes ne peut plus les abandonner pour retourner à une croyance plus étroite et plus égoïste.
« De même que le soleil luit pour tout le monde, pour les bons aussi bien que pour les méchants, pour ce qui est élevé comme pour ce qui est bas, pour les doux parfums et pour ce qui répand une odeur dégoûtante, et que ses rayons tombent également et non pas inégalement sur toutes choses, ainsi sont tombés les rayons de sa divine intelligence qui possède la connaissance de l’Omniscience ».
(Cf. Le Lotus de la Bonne Loi, chap. v).
Bien avant que Jésus-Christ ne fut venu dire : « Venez à moi vous tous qui êtes travaillés et chargés et je donnerai le repos à vos âmes » (Matt. XI, 1-28), il y avait déjà un Christ enseignant le salut pour tous les êtres humains. Sa semence ne tomba pas sur un terrain stérile. On trouve dans le Bouddhisme un véritable esprit universel que le Christianisme a pu développer, mais non surpasser.
« L’esprit missionnaire qui règne dans le Bouddhisme le distingue de toutes les autres religions qui ont précédé le Christianisme. La religion de Confucius n’essaya pas de faire des prosélytes en dehors de la Chine. Le Brahmanisme n’alla jamais plus loin que l’Inde. Le système de Zoroastre était une religion Persane, celui de l’Égypte resta confiné dans la vallée du Nil et celui de la Grèce à la race Hellénique, mais le Bouddhisme était animé du désir d’amener toute l’humanité à la connaissance des vérités qu’il possédait. Ses missionnaires ardents convertirent des multitudes dans le Népaul, le Thibet, la Birmanie, Ceylan, la Chine, Siam, le Japon, et dans tous ces pays ses monastères sont aujourd’hui la source principale du savoir et des centres d’instruction pour le peuple. Il est insensé de classer cette religion parmi les superstitions qui rabaissent l’humanité. Sa puissance vient de la force de conviction qui inspirait ses apôtres, et celle-ci devait venir de la vue de la vérité et non pas de la croyance dans l’erreur ».
(The Great Religions, p 153, J.-J. Clarke).
L’histoire de la vie de Siddârtha Câkya-Mouni ou Gautama le Bouddha, comme il est généralement appelé, étant maintenant aussi connue que celle de la vie de Jésus, nous ne pensons pas qu’il soit utile d’en parler ici. C’est de la théosophie seulement que nous voulons nous occuper : une théosophie que l’on accuse de n’avoir pas de Dieu à cause de sa conception totalement anti-anthropomorphique de l’Être divin. Dans le Bouddhisme, Dieu n’est pas une réflexion de l’homme, mais il est Dieu lui-même, un être absolu que l’homme ne saurait décrire avec son langage, un état suprême d’existence qui ne peut être connu que par l’expérience. Extérieurement à cette unique chose qui n’est pas une chose, toute chose n’est rien, ce qui matériellement semble le plus réel est spirituellement le moins réel et vice versa. Il y a une si complète différence entre les choses matérielles et les choses spirituelles ou divines qu’il est impossible de décrire complètement ce qui est inconcevable jusqu’à ce que ce soit connu.
C’est en pensant, en étudiant, en méditant sur le chaos de son propre esprit, en s’efforçant de trouver la vérité et d’acquérir la connaissance spirituelle, en vivant selon la justice et la paix que l’on devient un Initié et que l’on arrive graduellement à une véritable conception de l’existence. Le lecteur qui se contente de tourner rapidement ces pages comme celles d’un roman fera mieux de renoncer à cette étude, car ce sujet exige une sérieuse attention.
Mais revenons au Bouddhisme.
Comme le présent est le résultat du passé et que l’avenir sera le résultat du présent, toutes choses sont le résultat du Karma, c’est-à-dire de la somme accumulée de nos actions. Le Karma est la loi de la cause et de l’effet appliquée au caractère moral des êtres humains.
Le règne de la Loi étant absolu nous ne pouvons nous émanciper qu’en vivant non seulement d’accord avec la Loi, mais au-dessus de la Loi, comme cela doit être le cas pour ceux qui sont véritablement un avec Celui de qui vient la Loi.
Depuis le jour de notre naissance physique nous avons développé en nous des perversités qui obscurcissent notre âme et auxquelles nous restons attachés avec toute la ténacité de l’ignorance. Ces choses du temps n’ont qu’une utilité temporaire, et cependant nous y tenons avec un attachement aveugle qui nous empêche de posséder les choses de l’Éternité.
L’Éternité ne contient qu’une seule chose pour nous et c’est « l’Un », la Divinité ou le Dieu qui est au-dedans de nous, en qui nous vivons et nous avons notre Être. Lorsque cet « Un » est complètement manifesté, il nous unit à l’Éternel, car Lui seul est l’Éternel. Pour atteindre ce but le moi temporaire et inférieur doit être annihilé. C’est cette annihilation qui est nécessaire pour atteindre le Nirvana, cet état qui : été si faussement représenté par les savants qui ne se sont occupés que du Bouddhisme exotérique.
Si cette idée du Nirvana n’était qu’un verbiage métaphysique, elle ne se serait pas maintenue à travers les âges, mais c’est un fait d’expérience absolue dont celui qui désire Être parmi les élus pourra se rendre compte.
« Celui dont les sens sont devenus tranquilles, comme un cheval bien dompté par son cavalier ; qui est affranchi de l’orgueil, de la convoitise de la chair, de la séduction de l’existence, de la souillure de l’ignorance est envié même des dieux. Celui dont la conduite est droite demeure, comme la vaste terre, sans tourment ; comme le pilier de la porte de la cité, immobile ; comme un lac limpide, sans ride. Pour celui-là il n’y a plus de naissances.
« Calme est l’esprit, calme les paroles et les actions de celui qui est ainsi tranquillisé et affranchi par la sagesse ».
(Dhammapadda).
Bouddha n’a rien enseigné de nouveau ; il n’a fait que remettre en lumière les anciennes vérités sous une forme simple en même temps qu’il donnait l’exemple d’un véritable Esprit Divin affranchi de tout égoïsme ; et ainsi il a tenté le plus grand effort qui ait jamais été fait jusqu’alors pour la régénération sociale et individuelle, pour émanciper spirituellement l’humanité de l’esclavage de l’ignorance et du sensualisme.
Nous avons dans le Bouddhisme un des plus profonds systèmes de Théosophie. C’est le christianisme de l’orient et, comme tel, il est même mieux conservé que le Christianisme qui est le Bouddhisme de l’Occident.
Ceux qui dédaignent les enseignements du Christ apprendront ce qu’ils valent en les comparant à ceux de Bouddha ; et les Chrétiens qui dédaignent les enseignements de Bouddha apprendront à les apprécier en les comparant à ceux du Christ.
Le Bouddhisme pratique peut se résumer en ceci : Voir, sentir, parler, se conduire, vivre, agir, penser et aspirer avec JUSTICE. C’est la voie absolue qui conduit à l’Absolu.
Il est évident que Christ et Bouddha ne sont que deux manifestations du même Principe Divin. Le Christ de l’Inde a préparé le chemin au Bouddha de la Judée. La différence qui existe entre leurs systèmes est purement ésotérique. Bouddha a contemplé l’état du Nirvana, tandis que Christ parlait du Ciel comme d’un Principe Éternel et radieux, mais les deux idéals sont identiques.
Le Bouddhisme est la philosophie la plus sainte et la plus identique à l’esprit du Christ. Elle est la seule qui n’ait jamais été souillée par le sang et qui soit pure de tout crime ; la seule qui prêche la charité envers les animaux aussi bien qu’envers les hommes et qui inculque un sentiment de tendresse pour toutes les choses vivantes. En fait, elle enseigne un seul sentiment absolu, l’Amour, un Amour sans limites et la Justice pour tous. De même que Christ enseigne qu’il faut aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous méprisent, Bouddha enseigne que le Chemin qui conduit à l’Union Divine est ce Suprême Principe, cet Amour Divin qui seul peut unir l’humain au divin.
Le Bouddhisme ne réclame la foi aveugle et le respect absolu que pour la Vérité et la Justice. Parmi tous les Réformateurs du Monde, Bouddha, le Prince Mendiant est te seul qui n’ait jamais admis la possibilité, encore moins la nécessité, de tirer l’épée pour imposer les Principes Divins.
On demandera peut-être dans quelle relation le Brahmanisme se trouve à l’égard du Bouddhisme et comment ces deux systèmes se concilient ?
Le Brahmanisme est le centre de la Vie Hindoue.
La ligne de conduite d’un Aryas peut se résumer de la manière suivante :
« Purifié par diverses cérémonies des souillures de la naissance, l’Aryas ayant reçu le cordon consacré et la ceinture, entre comme disciple des Brahmanes dans la première phase de son éducation, et, après l’avoir traversée, il célèbre, en offrant son premier sacrifice, la fête de sa nouvelle naissance.
« Il devient alors un chef de famille (grihapati), et après avoir rempli ses devoirs dans cette fonction, il transmet à son fils qui, pendant ce temps, a atteint la même position que lui, le soin de tout ce qui lui appartient et il se retire dans la forêt pour passer le reste de ses jours dans le calme, occupé d’œuvres religieuses et de méditations silencieuses. L’idéal le plus élevé qu’un homme puisse atteindre sur la terre, est de devenir un Yati (vainqueur de soi-même) ou Sannyas (qui renonce à soi-même). Ce dernier n’offre plus de sacrifices, il est élevé au-dessus des choses du monde et des sens et se voue exclusivement à la vie contemplative. Telle est la voie qui conduit à la délivrance finale (moksha) des liens de l’existence sensuelle. »
(Tiele. Histoire de la Religion, p 128).
D’après ce qui précède on pourrait croire que le Brahmanisme fait plus de cas des vertus de la famille et de la vie sociale que le Bouddhisme, mais, lorsque on a pénétré le sens ésotérique de ce dernier système et que l’on s’est rendu compte de sa théorie sur l’Évolution, les deux points de vue se concilient parfaitement.
La différence entre les méthodes qui sont employées par les Bouddhistes et les Brahmanes pour atteindre au bien suprême se résume principalement en ceci : tandis que les Brahmanes considèrent que la répétition de la syllabe Om est une partie essentielle de l’exercice spirituel (Yoga), les Bouddhistes pratiquent l’exercice spirituel (Samadhi) par des moyens purement psychico-mentaux, et repoussent l’idée de la nécessité de répéter n’importe quel mot.
Le Bouddhisme est sans doute dans une certaine mesure dérivé du Brahmanisme. Non seulement ces deux systèmes ont le même objet en vue : humaniser ce qui est animal et diviniser ce qui est humain, en libérant l’âme des passions terrestres et de l’influence du monde matériel, mais pour tous les deux l’état de l’âme libérée est identique, quoique les Brahmines appellent Moksha l’Absorption dans l’Être infini et que les Bouddhistes considèrent le Nirvana comme l’annihilation totale du moi inférieur.





























