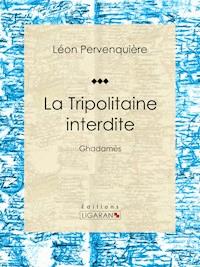
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ghadamès ! Quelle fascination ce nom a exercé sur tous ceux qui ont vécu dans le Sud de l'Algérie et de la Tunisie ! Moi-même, dans mes précédents voyages, j'avais ressenti quelque chose de cette attirance en écoutant les récits de mes chameliers autour du feu de camp ou en causant avec les officiers des Affaires indigènes, après une journée passée à chatouiller de mon marteau l'épiderme des pays désolés qu'ils administrent."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038521
©Ligaran 2015
La délimitation de frontière entre la Tunisie et la Tripolitaine ; les Commissions. – Départ de Gabès. – Ksar Medenine, – Aspect de la Djefara. – Le pays des ksour. – Valeur économique du Sud tunisien. – Foum Tatsouine. – Dehibat.
Ghadamès ! Quelle fascination ce nom a exercé sur tous ceux qui ont vécu dans le Sud de l’Algérie et de la Tunisie ! Moi-même, dans mes précédents voyages, j’avais ressenti quelque chose de cette attirance en écoutant les récits de mes chameliers autour du feu de camp ou en causant avec les officiers des Affaires indigènes, après une journée passée à chatouiller de mon marteau l’épiderme des pays désolés qu’ils administrent. Siegfried, s’élançant pour délivrer la Watkyrie endormie sur son rocher, au milieu d’un cercle de feu, n’avait pas au cœur un désir plus ardent que ces hommes jeunes et audacieux, brûlant de l’espoir d’éveiller à la civilisation cette antique cité, endormie au sein des plaines calcinées et des sables incandescents qui en défendent l’approche. Dame Administration veillait, duègne austère, et il était interdit de dépasser l’Oued Djeneien, de peur de complications diplomatiques avec la Turquie. C’est moi qui devais réaliser le rêve. Un samedi de février 1911, sur le coup de midi, j’appris que j’étais mis pour deux mois à la disposition du ministère des Affaires étrangères et qu’il fallait partir le lendemain soir. Allah akbar ! Le surlendemain, je débarquais à Tunis ou j’apprenais le but précis de ma mission.
Par un de ces phénomènes de mirage, si communs en ces pays, les immenses solitudes du Sud tunisien apparaissaient à certains comme un Eldorado, dont le sol était pavé de nitrates, de même que la chaîne de Gafsa est bourrée de phosphates. Toutefois, comme personne n’y était allé voir, il y avait des sceptiques. À vrai dire, une grande mission commerciale avait été organisée, mais elle avait dû se disloquer, après des péripéties diverses, et son chef mourait du typhus à Dehibat, la veille du jour où j’y arrivais.
Dans ces conditions, M. Alapetite, Résident général de France en Tunisie, jugea opportun d’adjoindre un géologue à la Mission de délimitation de frontière entre la Tunisie et la Tripolitaine, ainsi que le lui proposait le colonel Foucher, alors chef du Service des Affaires indigènes. Qu’il me soit permis de leur adresser ici mes remerciements les plus respectueux pour l’honneur qu’ils m’ont fait en me confiant cette Mission. Si je n’ai pas rapporté de nitrates dans mes cantines, j’ai, du moins, recueilli un ensemble d’observations géologiques et géographiques et pris un bon nombre de photographies, qui ont déjà cet intérêt d’être les premières faites à Ghadamès. Laissant de côté tout ce qui aurait un caractère technique, je me propose de décrire très simplement l’aspect des confins de la Tunisie et de la Tripolitaine ; mais, tout d’abord, il me paraît utile de dire quelques mots de la Mission de délimitation et des faits qui l’avaient rendue nécessaire.
Jusqu’à l’année dernière, la frontière entre la Tunisie et la Tripolitaine était restée imprécise. L’autorité des beys de Tunis n’était pas assez fortement établie pour se faire sentir, de façon sérieuse, jusqu’aux extrémités de la Régence ; de fait, la puissante confédération des Ouerghamma, qui occupe le pays au sud de Gabès, était presque indépendante. Les beys avaient bien envoyé, une fois ou l’autre, une méhalla pour les réduire, mais pas toujours avec succès, et leur suzeraineté était plus nominale que réelle. Comme on ne pouvait obliger cette tribu à payer l’impôt, on l’en avait exemptée, à charge pour elle de défendre le pays contre les incursions et les brigandages des Tripolitains, des Touareg et des Chaannba. Ces marches tunisiennes remplissaient d’ailleurs leur fonction d’une manière satisfaisante et protégeaient les contrées où l’autorité beylicale s’exerçait de façon effective. Les Ouerghamma étaient toujours en guerre avec quelque tribu tripolitaine, quand les fractions ne se battaient pas entre elles ; aussi les anciens auteurs avaient-ils qualifié de « pays de la discorde » la contrée qui s’étend au sud de Gabès. Comme la guerre et le brigandage régnaient de façon endémique, les habitants avaient couvert le sol de villages fortifiés, de ksour, où ils s’enfermaient en cas d’alerte et où ils serraient leurs récoltes. Quelques-uns de ces ksour sont construits en plaine, mais la plupart sont perchés sur des pitons presque inaccessibles. Notre domination a rendu inutiles toutes ces forteresses et la plupart tombent en ruines. Ces ruines, qui impriment à la région un caractère si pittoresque, évoquent invinciblement l’image des châteaux féodaux. Nulle part l’impression ne serait plus vive qu’à Ksar Beni Ikhzer, si le minaret d’une mosquée voisine n’ajoutait une note caractéristique. Les habitants m’ont narré avec orgueil les péripéties du siège qu’ils subirent, en 1875, contre les troupes du bey Mohammed es Saddok. Sidi Selim, qui commandait la méhalla beylicale, dut se replier en abandonnant deux canons. Les défenseurs sont encore fiers de ces hauts faits. Près de l’unique porte du ksar, ils m’ont montré un de ces canons, ainsi que de nombreuses traces grises laissées par les balles qui sont venues s’écraser sur la muraille. Le respect de la vérité m’oblige à déclarer que plusieurs de ces traces de balles m’ont paru être, tout simplement, des taches naturelles d’oxyde de manganèse. Il n’en est pas moins vrai que les Ouerghamma étaient les vrais maîtres du pays où ils exerçaient des droits féodaux dont certains n’ont disparu qu’après notre occupation.
Celle-ci progressa assez timidement dans le Sud. Douirat resta longtemps notre poste le plus avancé ; il fut ensuite remplacé par Tataouine, puis l’on reconnut la nécessité d’en créer d’autres, car le territoire à surveiller était vaste, et nos administrés étaient fort turbulents. Les Ouerghamma renonçaient difficilement à leurs habitudes de rapines, et il était parfois difficile de les maintenir sur leur territoire, de les empêcher d’aller piller leurs voisins. Au surplus, les Tripolitains, surtout les Cianes et les Nouaïls, profitaient de l’immobilité que nous imposions à nos protégés pour venir les razzier en plein territoire tunisien.
Dans le but de mettre fin à cette situation, on résolut de délimiter la Tunisie et la Tripolitaine. Une Commission se réunit à cet effet à Zouara, en 1893, mais elle aboutit à un échec complet, par suite des prétentions des commissaires tripolitains, qui réclamaient tout le territoire situé à l’est d’une ligne allant de la mer des Biban à la petite oasis de Remada. Sur de telles bases, l’accord était impossible, aussi les commissaires se séparèrent-ils après deux mois de vives discussions. Cette tentative eut cependant un bon résultat, en ce sens qu’elle décida le gouvernement français à faire occuper tout le territoire habité par nos protégés. Ainsi fut créée, de 1894 à 1897, une série de petits postes jalonnant la longue dépression d’el Mogta.
Malgré la surveillance exercée par ces postes, les pillards tripolitains réussissaient encore, de temps à autre, à franchir la frontière pour venir molester nos gens, impatients de se sentir retenus sur leur territoire et de ne pouvoir poursuivre leurs ennemis héréditaires. D’autres fois, ceux-ci venaient en Tunisie labourer ou faire paître leurs troupeaux. Il en résultait des contestations, parfois des batailles véritables. Nos officiers des Affaires indigènes s’efforçaient de ramener la paix, mais à maintes reprises ils durent monter à cheval, à la tête des cavaliers du makhzen ou mokhaznia, pour refouler les envahisseurs. L’un d’eux usa de ruse avec plein succès. En 1896, un groupe important de Tripolitains, 200 tentes environ, s’étaient tranquillement installés en Tunisie, près de Sidi Toui, dans le but de cultiver les terres voisiner, au grand dommage de nos administrés. Les officiera de Medenine et de Tataouine réunirent un goum important pour marcher contre eux. Avant d’engager une action qui pouvait entraîner des difficultés, on tenta un stratagème qui n’était pas sans risque. Les mokhaznia de Tataouine avaient pour chef le bach-chaouch Lazloug, homme énergique et plein de ressources. Avec quelques-uns de ses hommes, il s’introduisit de nuit dans le douar tripolitain et réussit à enlever bon nombre de chevaux sans donner l’éveil. Les envahisseurs furent déconcertés par ce trait d’audace et repassèrent d’eux-mêmes la frontière.
Tous les incidents ne se terminèrent pas si heureusement ; à diverses reprises, il y eut des morts. Depuis quelques années, les contestations portaient principalement sur les territoires du Sud. Entre Dehibat et la mer, l’emplacement de la frontière était à peu près connu ; au sud de Dehibat, l’incertitude était complète. Pour éviter toute cause de conflit, une entente avait été conclue en 1900, d’après laquelle les autorités tunisiennes et tripolitaines s’interdisaient d’occuper la zone saharienne et d’y faire pénétrer leurs troupes jusqu’à attribution définitive et délimitation des territoires contestés. Il en résulta une anarchie complète : les caravanes n’osaient plus traverser ces territoires et les nomades hésitaient à y mener leurs troupeaux, puisqu’ils ne pouvaient attendre aucune protection. Si nos officiers observèrent scrupuleusement la convention, il n’en fut pas de même des autorités tripolitaines, dont les zaptiés (sortes de gendarmes) parcouraient l’arrière-pays et faisaient de fréquentes apparitions aux puits de Zar et de Montecer ; ils avaient même construit une petite redoute près du premier. En 1905, une centaine de tentes tripolitaines vinrent se dresser au puits de Montecer ; après un combat où ils perdirent un homme et tous leurs chameaux, nos protégés durent battre en retraite. Cette même année, un officier géodèse était reçu à coups de fusils par les Tripolitains.
Les choses s’envenimèrent encore en 1907 et 1908. Après une tournée dans le Sud, le Résident général avait résolu de doter du télégraphe les postes de Dehibat et de Djeneien ; on décida ensuite de construire une piste entre ces deux postes. Les gens d’Ouezzen, petite bourgade tripolitaine située près de la frontière, voulurent s’y opposer par la force ; ils étaient commandés par un sous-officier tripolitain. Les cavaliers de la poste furent attaqués à diverses reprises sur la piste, où les patrouilles turques venaient constamment molester nos travailleurs. Les faits s’aggravèrent dans les derniers jours de 1909 et les premiers de 1910. Le commandant Donau, commandant supérieur des Territoires du Sud, était venu se rendre compte de la situation ; accompagné du lieutenant Sajous, qui commandait alors le poste de Dehibat, et d’une centaine de cavaliers, il faisait une reconnaissance sur notre piste, lorsque, en face d’Ouezzen, il fut accueilli par un feu rapide effectué par une centaine de soldats turcs, abrités derrière les crêtes. Circonstance aggravante, ces derniers étaient commandés par un officier turc. Nos hommes ripostèrent avec énergie, et on fit avancer les spahis restés à Dehibat, mais on se borna à exécuter quelques feux de salve et on renonça à poursuivre les Turcs sur leur territoire, afin de laisser tous les torts de leur côté. Peu après fut envoyée à Dehibat une forte colonne commandée par le général Desorthès, ce qui suffit à ramener le calme.
Après de semblables évènements, la Porte ne pouvait plus éluder notre demande de délimitation de frontière dont elle avait accepté le principe en 1909. Aussi, à la fin de janvier 1910, un accord fut-il signé entre les Gouvernements français et ottoman pour régler définitivement le différend. Seulement, la Porte n’ayant jamais voulu reconnaître le traité du Bardo, demanda que nos commissaires fussent nommés par le Bey, sans doute pour sauver la face vis-à-vis du parti nationaliste. La Commission française était présidée par M. des Portes de La Fosse, conseiller d’ambassade, délégué à la Résidence générale à Tunis ; elle comprenait le commandant Le Bœuf, auquel de longues années de Sud avaient donné une compétence spéciale, le capitaine Meullé-Desjardins, qui avait dirigé les levers de la carte de la zone frontière, et le cadhi du Djebel el Abiodh : Es Seghir ben el Hadj Mansour et Mokdenini. L’officier interprète Michal leur était adjoint ; il joua un rôle important dans la préparation du formidable dossier sur lequel fut appuyée la discussion. Quant au cadhi de Tataouine, il n’était pas là seulement pour donner un cachet bien tunisien à la Commission ; c’est un homme très renseigné dont les indications ont été plusieurs fois utiles. La Turquie avait envoyé également quatre commissaires : S.E. Rechid bey, conseiller légiste de la Sublime-Porte, S.E. le général Tewfik pacha, inspecteur général des Écoles militaires, Daoud effendi, directeur de l’instruction publique du vilayet d’Alep, et le lieutenant-colonel Djemal bey.
La Commission se réunit à Tripoli de Barbarie en avril 1910. Au début, les commissaires ottomans émirent les mêmes prétentions qu’en 1893, à Zouara, et revendiquèrent toute une partie du Sud tunisien. Nos commissaires répondirent que ce pays dépendait de la Tunisie, qu’il était occupé par nous depuis des années et qu’il ne pouvait être question de l’évacuer. De notre côté, nous reconnaissions aux Turcs la possession des points occupés par eux : Naiout, Ouezzen, Sinaoun, Ghadamès. Nous avons eu la faiblesse autrefois de ne pas nous opposer à l’occupation de cette oasis saharienne, en 1812, et nos commissaires se trouvaient devant une situation acquise sur laquelle ils ne pouvaient revenir.
La discussion se poursuivit pendant un mois sans avancer, étant donnée l’irréductibilité des deux thèses. La nôtre fut particulièrement soutenue par le commandant Le Bœuf, qui apporta une documentation aussi riche que variée. Il avait d’ailleurs en Rechid bey un adversaire avec lequel il fallait compter et qui savait trouver le point faible d’une argumentation ; à l’appui de sa thèse, il apporta jusqu’à des atlas français où la frontière était inexactement tracée. Un jour, les commissaires ottomans abandonnèrent leur point de vue ; après quelques concessions de notre part, un accord fut signé, le 19 mai 1910, réglant, en principe, le tracé de la frontière.
Celle-ci se développe entre la Méditerranée et Ghadamès, sur une longueur de 480 kilomètres. Elle part de la Méditerranée, au Ras Adjedir, remonte deux larges dépressions, connues sous les noms de Mogta et de Khaoui Smeida, atteint le Touil Dehibat, gigantesque borne naturelle qui se voit à plus de 50 kilomètres, passe entre Dehibat et Ouezzen, oblique vers les deux puits de Zar, dont l’un est en Tripolitaine et l’autre en Tunisie, puis se dirige vers le puits de Mechiguig ou d’Imchiguig, qui reste en Tripolitaine. À partir de ce puits, la frontière adopte une ligne équidistante entre les pistes de Djenelen à Ghadamcs et de Nalout à Ghadamès, elle contourne la Scbkhat el Melah et vient finir à 15 kilomètres au sud de Ghadamès, qui demeure acquise à la Tripolitaine.
IL s’agissait ensuite de reconnaître sur le terrain cette frontière tracée sur le papier (sur des cartes plus ou moins exactes) et de la jalonner par une ligne de bornes, après avoir interprété d’après nature le texte de la convention, quand le besoin s’en faisait sentir. Ce fut l’œuvre d’une deuxième Commission, placée sous la direction du commandant Donau, et comprenant le capitaine Meullé-Desjardins et le lieutenant Lecocq ; l’officier interprète Michal remplissait le même rôle qu’à Tripoli. C’est à cette Commission que je fus adjoint in extremis.
Attaché depuis de longues années au Service des Affaires indigènes, le commandant Donau est sans doute l’homme qui connaît le mieux le Sud tunisien ; nul n’était plus qualifié pour diriger la Mission française. De taille moyenne, la figure creusée par des séjours prolongés dans le Sud, les yeux bleus, voilés par le reflet d’un lorgnon à poste fixe sur le nez, la barbe courte, cet officier supérieur est le type du vrai blédard, qui s’est adapté au pays, au bled, et sur lequel les petits ennuis de la vie de campagne n’ont pas de prise ; il en a vu bien d’autres ! La nuit qui a précédé notre départ de Ghadamès a été marquée par un coup de vent terrible, qui a arraché nombre de tentes, dont celle du commandant ; quand je sortis de la mienne, qui avait heureusement résisté, le camp présentait un aspect insolite : le commandant, dans son lit, dehors, lisait le Temps ! Il s’était dit que puisqu’on devait décamper une heure ou deux plus tard, ce n’était vraiment pas la peine de faire remonter sa tente. Au surplus, le commandant Donau n’est pas seulement un officier de grande valeur, c’est aussi un savant : passionné pour l’archéologie, il a fait faire à cette science des progrès marquants ; j’en citerai un seul exemple : c’est grâce à lui que nous connaissons le cadastre dressé par la IIIe légion au début de notre ère. Près de lui, j’étais assuré de trouver l’accueil le plus gracieux : n’étais-je pas un peu un confrère qui s’occupe seulement de pierres plus vieilles ?
Le capitaine Meullé-Desjardins était non moins désigné pour faire partie de la Mission ; comme chef de brigade topographique, il avait dirigé les levés des dernières cartes de Tunisie, cartes dont on chercherait vainement l’équivalent en France. Nature profondément différente de celle du commandant, il apportait le stimulant aux activités attiédies ; son amour de la perfection le poussait à la rechercher en tout, même dans la soupe et dans le café. Avec la plus grande obligeance, il a mis à ma disposition ses documents topographiques, ce qui a notablement facilité mon travail.
Le lieutenant Lecocq appartenait encore à un autre type ; son ardeur juvénile avait besoin de se dépenser et, ma foi, les jours ou elle n’avait pas trouvé un aliment suffisant, l’air vibrait aux accents de sa voix. Quand on est aux Affaires indigènes, il faut avoir de l’allant ! Dessinateur à ses heures et photographe, il m’a aimablement communiqué deux ou trois des photographies qui illustrent ce volume.
L’interprète Michal est le plus joyeux compagnon de voyage qui se puisse rêver ; il rit toujours. Ce grand garçon, solidement charpenté, respire la joie de vivre. Connaissant à fond la langue arabe, il m’a été d’une aide précieuse à Ghadamès, en interrogeant adroitement les indigènes.
À la Mission était attaché le lieutenant Descrouez, qui assumait la double fonction de chef du goum et, chose plus redoutable, de maîtresse de maison ; il s’en tirait à merveille. C’était d’ailleurs un charmant compère, très doux et ne demandant qu’à être agréable aux autres.
Outre une centaine de goumiers à méhari, qui escortaient les convois, faisaient la poste, etc., l’escorte comprenait 55 tirailleurs et 8 spahis, sous le commandement du capitaine Calmon et du lieutenant Keyser (es sultan !), qui furent non moins aimables à mon égard.
En avant de la mission marchaient le capitaine Boué, les lieutenants Lamotte d’Incamps et Vaudein, auxquels incombait la tâche de lever un ruban de terrain de 10 kilomètres de largeur, à cheval sur la frontière présumée ; malgré la rapidité du travail, ils s’en tirèrent tout à leur honneur. Souhaitons que leur travail soit continué ! Leur rôle était difficile et ce sont eux qui faillirent porter le poids des graves Incidents dont il sera question plus loin. J’ai également des obligations au capitaine Boue pour une curieuse photographie qu’on verra par la suite.
À côté de cette Commission de bornage fonctionnait la Commission des titres, composée du capitaine Delom (aujourd’hui commandant), de MM. Bossoutrot, de Chavigny et Pillet. La convention de Tripoli avait pris en considération la propriété collective pour définir la frontière : suivant qu’une tribu payait l’impôt en Tunisie ou en Tripolitaine, son territoire était attribué à l’un ou à l’autre pays. Il se pouvait que des Tripolitains eussent, à titre privé, des droits de propriété sur des terrains désormais placés en Tunisie ; ils n’en étaient pas dépossédés pour cela, à la condition d’établir leurs droits. La Commission des titres eut ainsi à examiner la valeur de centaines de titres, dont beaucoup étaient plus que suspects. On vit se reproduire les mêmes faits qu’en 1893, où la Commission de Zouara avait été submergée sous un flot de parchemins, plus ou moins maquillés. Les Turcs avaient, entre autres, présenté un titre de propriété revêtu du cachet du bey de Tunis ; en examinant l’acte par transparence, on constata que le texte avait été gratté et modifié. Dans ces conditions, ce n’était pas une petite affaire que de mettre à jour la vérité. C’est chose faite désormais.
La Commission ottomane comprenait le colonel Néchat bey, le major Djémil bey et le capitaine Suleïman Chefket bey. D’allure un peu lourde, le colonel Néchat bey est un officier Intelligent et de grande valeur ; c’est lui qui est actuellement l’âme de la résistance et qui, avec 5 000 ou 6 000 réguliers, tient tête aux 100 000 Italiens. Malheureusement, il parle fort mal le français et guère mieux l’arabe, ce qui rendait la conversation difficile. Djémil bey, au contraire ; connaît fort bien notre langue ; il a été attaché d’ambassade à Saint-Pétersbourg et à Téhéran et s’exprime avec facilité ; aussi était-ce lui qui menait la discussion. Grand, très blond, la figure joviale, il était très fort sur le champagne et ne redoutait même pas l’absinthe (il est vrai que le vert est la couleur du Prophète). Suleïman Chefket bey est de plus petite taille ; figure intelligente, il possède de réelles qualités militaires ; c’était le seul qui sût tirer parti d’une carte. L’escorte turque comprenait un demi-escadron (à pied, parce qu’il était trop difficile de faire boire les chevaux), sous le commandement d’un capitaine très pimpant. Il devait y avoir un médecin ; comme aucun n’était disponible, on l’avait remplacé par un vétérinaire. Tels Curent les auteurs de la délimitation tuniso-tripolitaine.
Grâce au chemin de fer et à l’automobile, il ne faut plus longtemps pour aller de Tunis à Gabès. Combien il serait agréable de passer une journée à flâner dans l’oasis ! mais le temps presse et je dois me borner à jeter un coup d’œil sur l’oued où des femmes, des juives surtout, sont en train de laver des étoffes aux couleurs voyantes, qui ne paraissent cependant pas criardes sous ce grand soleil.
Au sortir de Gabès, la route s’élève sur de petites collines qui permettent d’embrasser d’un coup d’œil toute la palmeraie. Quel contraste entre cette végétation luxuriante et le sol qui nous entoure : de jeunes plantations d’oliviers s’efforcent de triompher de la sécheresse ; leur feuillage argenté se détache à peine sur le sol. Teboulbou, Ketena, Mareth défilent successivement, petites oasis verdoyantes où l’œil se repose du gris trop général. Puis c’est Aram avec ses curieuses koubbas, tombeaux des marabouts dont les Mehabel se disent les descendants. Le pays demeure mamelonné, mais rien ne sollicite spécialement l’attention. Le sol est couvert d’une carapace gypsocalcaire, empâtant de nombreuses pierrailles, qui hérissent la surface de ce manteau grisâtre, d’une déplorable uniformité ; les quelques broussailles épineuses dont elle est piquetée affectent elles-mêmes une teinte terne qui les dissimule.
À l’Oued Zeuss, nous pénétrons sur les territoires militaires. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons les vastes ruines de Ksar Koutine (l’antique Augarmi), que les entrepreneurs ont malheureusement transformées en carrière ; de grands travaux hydrauliques assuraient l’irrigation de la vallée fertile d’Oum es Sesser, la vallée « riche en jardins ». Après avoir contourné la taupinière du Tadjera, couronnée par un poste optique qui communiquait avec Gabès, et laissé à droite le petit Ksar Metamer, nous arrivons en vue de Ksar Medenine, où réside désormais le commandant militaire des territoires du Sud. Quelle désolation ! Les oueds, les rivières descendant de la montagne, ont recouvert le sol d’une nappe de cailloutis mal arrondis, qui rendent la marche plutôt pénible. Les Romains avaient qualifié la Crau de campus lapideus ; pour ces champs de pierres de Medenine, ils ont dû employer le superlatif ! Avec cela, pas trace de végétation, en dehors des jardins de Metamer abrités dans un ravin ; c’est qu’en effet la terre végétale fait entièrement défaut. Le vent a arraché toutes les particules sableuses, charriées de la montagne avec les pierres, et les a accumulées plus loin en petites dunes ; quant aux poussières argileuses, elles se sont envolées, parfois jusqu’en Europe.
À Medenine, nous sommes franchement dans la vaste plaine de la Djefara. Que ce soit une plaine, on n’en peut douter : au sud et à l’est, pas la moindre élévation au-dessus de l’horizon ; quant au qualificatif de vaste, qui traduit précisément le mot de Djefara, il est non moins justifié, puisque cette plaine se prolonge en Tripolitaine sans interruption et sans changement d’aspect ni de nom. Dans l’ouest, une haute falaise barre l’horizon de lignes presque horizontales ; jusqu’à Dehibat, nous ne la perdrons pas de vue. Cette muraille naturelle, qui enserre la Djefara et la sépare du Dahar, décrit une demi-ellipse qui se développe sur plus de 600 kilomètres, tant en Tunisie qu’en Tripolitaine. À partir de Gabès, elle s’élève peu à peu et atteint assez promptement 500 mètres, puis augmente lentement jusqu’à 600 mètres, même un peu plus en Tripolitaine ; dès lors, elle se rapproche de la côte et s’abaisse pour venir mourir au niveau de la Méditerranée, sous les ruines de Leptis Magna (Lebda), l’une des trois villes qui ont valu son nom à la Tripolitaine. Ainsi la Djefara se termine en pointe à ses deux extrémités, tandis qu’à Dehibat, ce golfe en terre ferme a 150 kilomètres de profondeur. À partir de la mer, le sol se relève insensiblement, à tel point qu’il faut aller souvent à plus de 50 kilomètres de la côte pour rencontrer une butte de 50 mètres ; au pied de la falaise, le sol se tient encore à 200 ou 300 mètres au maximum ; ensuite s’élève une muraille abrupte qui enclôt la Djefara et qu’on peut franchir seulement en quelques points, là où les oueds ont scié la dalle supérieure. En Tripolitaine, il n’y a pas de lignes de hauteurs intermédiaires entre la mer et cette grande falaise ; à peine voit-on, près de la frontière tunisienne, quelques crêtes basses émerger de la plaine. Il en va tout autrement en Tunisie, spécialement dans la région de Foum Tataouine, où trois lignes de hauteurs, trois plateaux étagés, forment comme les volées d’un perron gigantesque, tel qu’en eût imaginé Gargantua pour monter de la plaine sur le haut plateau du Dahar. Dans ces degrés, le géologue reconnaît les étages successifs du Trias et du Jurassique. Ce dernier est constitué par des alternances de bancs calcaires rigides et de marnes tendres, divisant les versants en une infinité de marches horizontales. Au nord et au sud, ces gradins intermédiaires disparaissent peu à peu et la falaise se dresse d’un seul jet au-dessus de la plaine parfaitement nivelée.
À tout prendre, ces hauteurs occupent une superficie assez faible, au pied de la grande falaise ; tout le reste est bien une plaine, découpée par le lit de quelques rivières ou oueds, qui coulent accidentellement, après les grandes pluies. Quand on s’éloigne de la montagne, leur thalweg est souvent incertain ; il s’élargit et ses bords s’effarent. C’est alors un khaoui qu’accuse un liséré de végétation moins misérable et moins gris qu’ailleurs ; en effet, un peu d’eau se conserve dans le sous-sol formé d’alluvions arrachés à la montagne. Une garaat est une cuvette à pente indécise, dont le fond est également colmaté par des alluvions, parfois même par une terre arable, réellement fertile. Comme les bonnes places de labour sont relativement limitées et que la propriété individuelle n’existe pas pour elles, on se les dispute âprement ; ce fut la source de nombreuses querelles entre les Ouerghamma, d’une part, les Nouaïls et les Cianes, d’autre part.
La Tunisie est mieux partagée que la Tripolitaine. Toute la Djefara ne ressemble pas aux environs de Medenine ; il y a des places fertiles. Dans la région de Ben Gardane en particulier, la production surpasse la consommation, sauf les années où la sécheresse anéantit toute récolte. Dans la partie tripolitaine de la Djefara, les dunes sont beaucoup plus étendues qu’en Tunisie ; elles recouvrent une fraction importante du territoire et laissent peu d’emplacements disponibles pour les labours. Ce n’est pas à dire pour cela que le Sud de la Tunisie puisse être comparé à la Beauce ; un Beauceron tomberait du haut mal en voyant ces quelques carrés de terre, dont la surface paraît avoir été grattée par des poules et qui s’insinuent entre des broussailles, véritables maîtresses du sol. Ailleurs s’étend une terre toute blanche de cristaux de gypse et de sel, comme s’il venait de neiger. C’est par excellence le champ du mirage, champ absolument inculte. Dans ces dépressions à fond salé, ou sebhhat, s’est collecté tout le sel contenu dans le bassin environnant, et Dieu sait qu’il n’en manque pas ! Aucune végétation ne peut se développer sur la croûte saline ; par contre, les bords sont garnis de plantes habituées au sel et dont les chameaux apprécient fort la sève amère. Il est souvent question des plantes salines dans les poésies des Arabes. Ceux-ci qualifient les plantes douces de « pain du chameau », tandis que les plantes salines représentent « sa pitance et sa viande » ; elles aiguisent l’appétit. Le « pain » est souvent garni d’épines acérées, mais peu importe. Je me suis toujours demandé comment les chameaux pouvaient manger, sans se piquer, des plantes qui déchiraient les jambes de mon cheval et contre lesquelles de fortes guêtres n’étaient pas toujours une protection suffisante.
La frontière suit toute une série de ces dépressions salines, enjambant çà et là un dos solide pour passer de l’une à l’autre. La plus connue est la Sebkhat el Mogta, chapelet de bas-fonds, formant un thalweg discontinu, à pente générale extrêmement faible, et n’aboutissant nulle part ; il n’y a pas de communication avec la mer ; c’est précisément pour cela que les sels s’y concentrent. Après les pluies, c’est un bourbier dans lequel il peut même devenir dangereux de s’aventurer, mais, en somme, il n’y a de l’eau que de façon exceptionnelle. En amont lui fait suite un ensemble de dépressions allongées, vaguement reliées les unes aux autres, auxquelles s’applique le nom de Khaoul Smeida. Évidemment, c’est par là que s’écoulerait, en nappe, l’eau qui tomberait en abondance vers Dehibat. En général, l’eau de pluie est bue par le sol bien avant d’avoir atteint le voisinage de la mer. L’érosion a été surprise dans son travail par l’invasion d’un climat subdésertique ; elle n’a pas eu le temps d’activer son œuvre et de relier toutes ces dépressions par un thalweg à pente continue.
Cette vaste plaine de la Djefara est occupée par une population d’origine berbère, autochtone, à laquelle se mêlent des éléments arabes, encore reconnaissables en certains points. Les Accara sont presque à poste fixe sur la péninsule de Zarzis ; les Touazine paissent (oh ! euphémisme) dans les environs de Ben Gardane ; les Khezour habitent près de Medenine ; les Ouderna occupent le Djebel el Abiodh et nomadisent dans la plaine située à l’est de ces hauteurs, ou ils se mêlent aux précédents. Les Djebalia et les Ghoumrassen sont beaucoup plus sédentaires ; ils sont attachés, en quelque sorte, au bord de la grande falaise où ils ont construit leurs ksour. L’ensemble forme la puissante confédération des Ouerghamma, qui compte 99 000 âmes, d’après les évaluations récentes du commandant Delom.
Toutes ces populations vivent la majeure partie de l’année sous la tente, soit pour surveiller leurs terrains de labour, soit pour suivre leurs troupeaux ; à la fin de l’été, elles rentrent dans leurs jardins autour de leurs ksour, où sont emmagasinées les récoltes. L’insécurité habituelle du pays avait contraint les habitants à construire des forteresses où ils serraient leurs richesses et où ils se retiraient en cas de besoin.
Ksar Medenine est le type des ksour de plaine. Du camp, il apparaît comme une muraille grise, irrégulièrement festonnée, que domine seulement le minaret de la mosquée. Une seule porte permet de pénétrer dans le ksar, ce qui rend la défense plus facile. Les voyageurs qui ont décrit ces ksour les comparent à des ruches ; la comparaison se présente naturellement à l’esprit, seulement l’abeille travaille avec une régularité inconnue aux Ouled Medenine. Les alvéoles sont ici remplacés par des rhorfas ov ghorfats, c’est-à-dire des chambres longues et étroites, recouvertes par une voûte semi-cylindrique ; une ouverture basse, placée à une extrémité, tient lieu à la fois de porte et de fenêtre. Accolez cinquante ou cent rhorfas autour d’une place, de telle sorte que la petite porte donne sur la place, le côté aveugle étant à l’extérieur ; entassez ensuite, au hasard, trois, quatre, cinq étages de cellules semblables, puis groupez côte à côte une douzaine de places analogues, communiquant par une étroite ruelle ; vous obtiendrez Ksar Medenine. La vue panoramique, prise du sommet du minaret, permet de se rendre compte de cette disposition. Du haut de cet observatoire, on constate que la muraille festonnée est constituée par le chevet de ces édifices, tandis que les festons sont simplement les voûtes de la rangée supérieure de rhorfas.
Ksar Medenine, Ksar Metamer et quelques autres ksour sont construits en plaine, mais le plus souvent les constructions sont perchées sur un piton presque inaccessible, dont une poignée d’hommes suffiraient à assurer la défense ; tel est le cas de Douirat, de Chenini, de Ghoumrassen. Évidemment ces ksour manquent de confortable, et ce n’est pas une mince besogne que de monter à deux cents mètres tout ce dont on a besoin chaque jour, l’eau tout d’abord. Aussi les habitants se sont-ils arrêtés à mi-chemin ; ils ont remarqué que la falaise offrait une série de couches tendres, dans lesquelles il est facile de se creuser une tanière dont deux bancs durs forment le plancher et le plafond. Ils sont ainsi devenus troglodytes. En temps de paix, ils vivent dans ces demeures souterraines, qui comprennent parfois plusieurs chambres. En cas d’alerte seulement, ils se retirent dans le ksar qui couronne la montagne ; il serait plus juste de dire : « ils se retiraient », car désormais tous ces ksour sont en ruines ; notre occupation les a rendus inutiles.





























