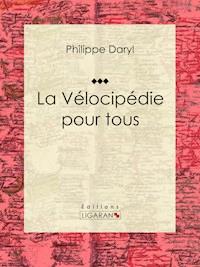
Extrait : "Ce serait une erreur de croire que l'idée de se transporter à l'aide d'une machine actionnée par la force seule de l'homme soit absolument moderne. Il faut remonter très loin pour en trouver des traces et il serait impossible d'en préciser l'origine d'une façon exacte. La première application dont on ait le souvenir dans cet ordre d'idées est la voiture mécanique décrite en 1603 par Ozanam, membre de l'Académie des sciences, voiture montée sur quatre roues..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050554
©Ligaran 2015
Ce serait, une erreur de croire que l’idée de se transporter à l’aide d’une machine actionnée par la force seule de l’homme soit absolument moderne.
Il faut remonter très loin pour en trouver des traces et il serait impossible d’en préciser l’origine d’une façon exacte.
La première application dont on ait le souvenir dans cet ordre d’idées est la voiture mécanique décrite en 1603 par Ozanam, membre de l’Académie des sciences, voiture montée sur quatre roues, et actionnée par deux pédales.
L’inventeur était un médecin de la Rochelle nommé Richard ; sa machine fonctionna à Paris pendant plusieurs années.
En 1703, Stephen Tarfers d’Aldorft construisit un char à trois roues, actionné par des rouages, et qu’il manœuvrait lui-même.
En 1774, l’Universal Gazelle donna la description d’une voiture à quatre roues mise en mouvement par deux hommes.
En 1779, en France, on vit à la cour de Versailles une machine mue par des ressorts que les pieds et les mains mettaient en action. Cette machine fut abandonnée par suite de la dépense excessive de forces qu’elle exigeait. Vers 1770, l’aéronaute Blanchard fit aussi quelques essais dans ce genre.
En 1816, le baron Drais de Savesbrun inventa une machine composée de deux roues égales réunies par un corps en bois sur lequel le cavalier se plaçait à califourchon. Il mettait la machine en mouvement en poussant alternativement le sol qu’il touchait de la pointe des pieds. La direction se faisait à l’aide d’un guidon. Cette machine fut appelée draisienne du nom de son inventeur. On lui donne aussi le nom de célérifère.
Ces machines eurent un moment de grande vogue et une estampe de 1818 a perpétué le souvenir d’une course de draisiennes au jardin du Luxembourg ; mais elles furent bientôt délaissées par suite des moqueries qu’elles suscitaient et de leur manque absolu d’utilité pratique.
En 1830, la Poste et plusieurs autres administrations firent quelques essais nouveaux, mais sans succès, et l’idée fut définitivement abandonnée pour longtemps.
Enfin, en 1855, M. Pierre Michaux, serrurier en voitures, à qui une draisienne avait été confiée en réparation, eut l’idée d’adapter au moyeu de la roue de devant des manivelles coudées munies de pédales, afin de permettre d’actionner la machine sans mettre pied à terre.
Un de ses fils parvint, à la suite de nombreux essais, à se tenir en équilibre sur cette machine et à la faire marcher. Cette fois le vélocipède était inventé.
Toutes les machines antérieures étaient en effet de simples essais curieux, mais non pratiques, et c’est bien l’application de la pédale qui a inauguré le vélocipède moderne et provoqué l’essor qui a suivi dans cette branche d’industrie et de sport. Le vélocipède est donc bien une invention française ; c’est un honneur que personne ne saurait contester à notre pays.
Bientôt ce nouveau mode de locomotion, peu à peu perfectionné, fit de grands progrès. En 1866, le bois fut remplacé dans la construction des vélocipèdes par la fonte malléable ; vers 1867, le bicycle, qui fut le premier type de vélocipède, commença à recruter de nombreux adhérents.
En 1869 eut lieu au Pré-Catelan (Bois de Boulogne) une exposition vélocipédique où l’on vit pour la première fois les roues en fil de fer et l’application du caoutchouc aux jantes.
Cette dernière innovation rencontra des objections qui tombèrent à la suite de la course de Paris à Rouen, en novembre 1869, où les trois premiers avaient des roues munies de caoutchouc et qui n’avaient éprouvé aucune avarie sérieuse.
En 1870, les roues en fil de fer remplacèrent définitivement les roues en bois, et les bicycles, qui mesuraient 1 mètre à 1m,10, diminuèrent sensiblement de poids.
En 1884, après le retour d’Angleterre de M. Charles Thuillier, champion français, les roues des bicycles furent sensiblement augmentées en diamètre, comme cela avait été fait en Angleterre depuis plusieurs années.
En 1870-71, l’essor considérable pris déjà par les vélocipèdes en France fut arrêté par les évènements funestes qui marquèrent cette période, et pendant plusieurs années il n’en fut plus question.
Pendant ce temps la vélocipédie avait beaucoup progressé en Angleterre ; nos voisins avaient monopolisé l’industrie et le sport que la France délaissait.
Vers 1874, un réveil se fit chez nous et la vélocipédie reparut.
En 1875, M. Truffault de Tours employa dans la construction des vélocipèdes les jantes, les fourches et les corps creux, ce qui permit d’abaisser encore beaucoup le poids des machines. Il construisit en effet un bicycle de 10 kilogrammes, qui résista admirablement à l’emploi sur route.
C’est alors que les fourreaux de sabres de cavalerie furent employés par la plupart des constructeurs pour fabriquer les corps et les fourches de bicycles.
En 1879 apparurent les premiers tricycles pratiques. Tous les modèles établis auparavant laissaient beaucoup à désirer. Cette machine, en mettant la vélocipédie à la portée de tous, contribua largement à l’extension croissante du nouveau sport.
En 1884, on construisit des machines dites bicycles de sûreté et ayant pour but de diminuer le danger des chutes. Ces machines, après avoir revêtu de nombreuses formes diverses, furent peu à peu abandonnées.
C’est à l’année 1879 que remonte l’apparition de la bicyclette. Par les perfectionnements qu’elle a subis depuis et qui l’ont rendue éminemment pratique, cette machine a détrôné toutes les autres pour devenir d’un emploi quasi universel.
Pendant ce temps, la substitution des coussinets à billes aux coussinets lisses avait supprimé les inconvénients de ces organes, tout en augmentant notablement la douceur des roulements.
Enfin l’invention des nouveaux caoutchoucs est venue apporter une récente révolution, aussi considérable qu’inattendue.
Ainsi qu’on le voit, trente-cinq ans seulement séparent la draisienne à pédales, lourde, disgracieuse et tapageuse de Pierre Michaux, des instruments légers, élégants et silencieux qui sont en usage aujourd’hui. On ne devait pas moins attendre de l’ingéniosité de l’industrie moderne, qui n’a certainement pas dit son dernier mot et qui nous ménage encore sans doute dans cet ordre d’idées de nombreuses surprises.
Les machines vélocipédiques sont sujettes à deux sortes de subdivision, selon qu’on les considère au point de vue de leur construction en elle-même, ou de leur application quant au nombre de ceux qui doivent les monter.
Au point de vue de la construction, les machines peuvent se diviser en deux catégories générales bien distinctes :
Les machines à équilibre instable ;
Les machines à équilibre stable.
Les premières comprennent les machines à une ou à deux roues, sous toutes leurs formes et toutes leurs variétés.
Les secondes comprennent les machines ayant trois roues ou davantage.
Ces deux catégories générales de machines se distinguent par un élément de la première importance.
Dans la première catégorie, les machines ne pouvant se tenir debout toutes seules, puisqu’elles n’ont qu’un ou deux points de contact avec le sol, il est nécessaire de faire un certain apprentissage pour pouvoir les monter, tandis que, dans les machines ayant trois points d’appui ou davantage, l’équilibre se produisant de lui – même, il est possible de monter dessus sans étude préalable.
On voit du premier coup la différence considérable qui existe entre ces deux types de machines.
Le premier exige une certaine étude et quelque peu d’habileté et d’audace, tandis que dans le second il suffit d’un peu d’attention.
Le premier présente un côté légèrement aventureux, voire même quelquefois acrobatique, tandis que le second se distingue par son caractère exempt de fantaisie gymnastique.
Le premier, par son aspect, par sa variété d’allures, par sa mobilité et sa docilité suprêmes, est un instrument de sport, tandis que le second, par son assiette fixe et son absence de souplesse, est surtout un instrument de transport.
En un mot, et pour rééditer une comparaison qui a été appliquée aux deux instruments qui personnifient le mieux chaque type de machine, le bicycle est le cheval, tandis que le tricycle est la voiture.
On voit par là même à quelle catégorie différente d’hommes s’adressent ces deux types principaux.
La machine à deux roues conviendra surtout aux hommes jeunes, adroits et légers, tandis que la machine à plusieurs roues restera le partage principal des hommes d’un fort poids ou à qui l’âge aura enlevé la souplesse et l’audace.
Il y aura naturellement des exceptions à cette règle, qui n’en restera pas moins exacte dans sa généralité.
Examinons séparément chaque type de machine.
Le monocycle ne figure ici que pour mémoire ; car il n’a jamais été et ne sera jamais qu’un instrument d’acrobatie pure, qui sort complètement du cadre sportif ou pratique dans lequel doit s’enfermer la vélocipédie sérieuse.
La théorie du monocycle a bien des fois hanté l’imagination des inventeurs.
Pendant longtemps, le problème du véhicule à une seule roue sembla impossible à résoudre. On ne voyait pas bien comment on pourrait faire tenir en équilibre et mettre en mouvement une roue unique, ne reposant à terre que sur un point presque idéal et changeant à chaque instant.
Toutefois ce fut précisément cette condition de mobilité qui amena la solution cherchée. Un cerceau trouve bien le moyen de marcher seul, sans tomber, tant qu’il est lancé ; donc il devait pouvoir en être de même d’un cercle portant un cavalier.
Les recherches faites dans ce sens aboutirent naturellement, car la science a trouvé beaucoup d’autres choses plus difficiles ; mais elles donnèrent lieu aux fantaisies imaginatives les plus comiques et les plus compliquées.
On alla même jusqu’à mettre le vélocipédiste au centre de la roue, et les anciens pratiquants de la vélocipédie se souviennent fort bien d’avoir vu fonctionner le monocycle Jackson, dans l’intérieur duquel le malheureux vélocipédiste tenait le rôle quelque peu ridicule d’un écureuil tournant dans sa cage.
D’autres applications plus rationnelles du monocycle furent faites plus tard, et l’on arriva même à le monter avec guidon, selles, manivelles et pédales. On eût dit un bicycle dont on aurait enlevé le corps et la roue de derrière.
C’est dans ces conditions qu’apparut un jour le monocycliste italien Scuri, qui fut le premier à exhiber ce genre de machine.
On se rappelle l’étonnement qu’il causa, soit dans ses représentations publiques, où il exécutait des exercices considérés alors comme extraordinaires, soit au Bois de Boulogne, où il vint plusieurs fois se promener sur sa machine en compagnie d’autres vélocipédistes, à la grande stupéfaction du public qui n’avait jamais vu un semblable instrument.
Depuis ce temps, les exercices de Scuri ont été dépassés de loin par nombre d’autres acrobates, tels que Kauffman, Walter Gautier et surtout l’inimitable Canary, dont la fantaisie imaginative a servi de mine inépuisable à l’imitation de ses confrères, mais dont la grâce personnelle et l’élégance n’ont jamais été égalées.
Canary avait fait de l’acrobatie vélocipédique un art véritable.
Le monocycle continue toujours à être pratiqué ; mais il ne peut donner lieu à des courses intéressantes, sa vitesse étant forcément limitée par la préoccupation constante de l’équilibre, ni servir de mode de locomotion pratique, à cause de son instabilité. Il reste l’apanage des équilibristes de profession qui s’exercent à trouver des combinaisons acrobatiques nouvelles, destinées à prendre place dans les représentations de cirque.
En dehors de ces cas restreints, le monocycle, ne se prêtant à aucune application utile ni sérieuse, ne pourra que servir d’amusement à quelques vélocipédistes audacieux et amoureux de voltige.
Le monocycle étant par lui-même un exercice disgracieux autant qu’antisportif, on ne saurait donc trop conseiller à ceux qui auraient la fantaisie d’en essayer de ne le faire qu’à huis clos et de façon privée, toute exhibition publique devant les conduire à un inévitable ridicule.
On peut en dire autant du dicycle, qui n’a fait que paraître vers 1866, sans laisser de traces.
Le bicycle est la première des nombreuses formes qu’a revêtues le vélocipède. Il a été l’origine des types si variés qui se sont succédé depuis sa première apparition.
Malgré les transformations successives survenues dans la construction vélocipédique, le bicycle a survécu à tous les assauts que lui ont livrés tous les types de machines inventés depuis, et dont un certain nombre n’ont fait qu’une courte apparition, pour disparaître dans l’oubli après une vogue éphémère.
Le bicycle a subi lui-même, il est vrai, de profondes modifications dans sa forme première. Combien d’étapes n’a-t-il pas parcourues, en effet, depuis la primitive machine en bois, aux deux roues égales, réunies par un corps à forme grossière, muni d’ornements d’un goût douteux et peint de couleurs voyantes, constituant un instrument lourd, disgracieux et tapageur, dont l’approche s’annonçait par un vacarme de vieille guimbarde démantibulée !
Et pourtant on monta avec passion sur cet instrument grotesque ; on lui trouva même beaucoup d’attraits et il serait bien difficile de dire si les vélocipédistes d’alors n’éprouvèrent pas plus de plaisir sur leur monture primitive que les vélocipédistes d’aujourd’hui n’en trouvent sur leurs légers et gracieux bicycles.
La chose est au contraire très vraisemblable et peut s’expliquer par l’attraction qu’exercent toujours les nouveautés.
Il faut dire aussi que, dans ce temps, il n’y avait à monter à bicycle que les convaincus, ceux qui bravaient l’opinion publique et les préjugés en les subordonnant à leur propre goût pour le nouveau sport.
Tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un vélocipède leur semblait parfait et ils passaient avec une grande indulgence par-dessus les défauts des machines d’alors, pour n’y voir que le plaisir qu’on en pouvait tirer. On se demande volontiers aujourd’hui quelle jouissance il pouvait y avoir alors à monter en bicycle ; pourtant ce plaisir était très réel ; il n’est pas certain même que les vélocipédistes modernes aiment autant leur machine que les vélocipédistes de la première heure ont chéri leur monture primitive, tout informe et ridicule qu’elle était.
Quelle différence pourtant avec l’élégant bicycle moderne, sobre de formes, sombre d’aspect, exempt d’ornements inutiles, léger et silencieux et dont la roue de devant éclipse par sa dimension celle de derrière, qui paraît minuscule, ce qui lui donne l’aspect majestueux d’une châtelaine de haute taille dont la traîne est portée par un page microscopique !
Il est vrai qu’avant d’arriver à ce degré de perfection le bicycle a subi bien des modifications profondes, qui en ont progressivement changé l’aspect et qu’il est curieux de rappeler.
Le premier bicycle se composait de deux roues égales réunies par un corps au-dessus duquel, comme un pont suspendu, était jeté un immense ressort courbé allant de la fourche à la roue d’arrière et sur lequel était fixée la selle.
À cette époque, les roues des bicycles n’avaient que 80 ou 90 centimètres. Un bicycle à roue d’un mètre paraissait gigantesque.
La caractéristique des machines de cette époque était qu’elles pouvaient être montées par des hommes de toutes tailles, car le diamètre des plus grandes roues était à la portée des hommes les plus petits ; il suffisait d’avoir un ressort moins élevé permettant de rapprocher davantage la selle des pédales.
Bientôt on s’aperçut qu’on perdait une place précieuse en n’utilisant pas l’intervalle excessif séparant la selle des pédales. On commença donc à augmenter la hauteur de la roue de devant en abaissant le ressort. On dut suivre la marche inverse pour la roue de derrière, sous peine d’arriver à faire des machines géantes.
C’était ouvrir la voie qui devait amener peu à peu à la forme actuelle des bicycles.
Le point important en effet était d’obtenir le plus d’espace parcouru par chaque tour de pédales. Or ce résultat dépendait uniquement de la hauteur de la roue motrice.
On peut se figurer quelle répétition extrême de mouvements de jambes il fallait opérer pour marcher à une allure raisonnable avec des roues d’un aussi petit diamètre que celles des premiers bicycles ; aussi était-il très difficile de suivre une voiture marchant à bonne allure moyenne. Ce résultat ne pouvait être obtenu que grâce à des efforts qui ne pouvaient pas se prolonger pendant longtemps.
À mesure que la roue motrice augmenta de diamètre, la vitesse suivit la même progression ; d’autre part, la roue de derrière continua à diminuer de hauteur et finit peu à peu par être limitée à son véritable rôle, qui est simplement de suivre la première et de donner au bicycle son second point d’appui.
À mesure que les proportions du bicycle se modifiaient, la position du bicycliste subissait des transformations correspondantes.
Sur les premières machines, le bicycliste était assis au milieu du ressort et entre les deux roues, à distance égale de chacune d’elles.
L’origine du bicycle se faisait sentir dans sa première application.
Lorsque la roue motrice augmenta, le grand ressort, qui primitivement était indépendant du corps du bicycle et portait directement sur l’axe de la roue de derrière par une fourche spéciale, s’abaissa peu à peu et finit par se modifier complètement. Sa fourche de derrière disparut et le ressort finit par reposer sur le corps même du bicycle.
De son côté la selle se rapprocha de la tête du bicycle, et le bicycliste sembla positivement grimper à la conquête de sa machine, car sa position relative devenait de plus en plus élevée.
La roue de derrière était progressivement soulagée et le poids du bicycliste tendait d’une manière continue à se porter sur la roue de devant.
Cette roue de devant augmentant sans cesse de diamètre, le corps ne tarda pas à se rapprocher d’elle autant qu’il était possible, et finit par n’en être plus séparé que par un espace juste suffisant pour qu’elle pût se mouvoir facilement sans y toucher.
Dans ces conditions le corps suivit strictement la courbe de la roue sur une longueur égale au quart de la circonférence.
La roue de derrière, suivant par contre une diminution progressive, fut réduite à la plus petite proportion et le corps termina la courbe par une ligne perpendiculaire tombant directement sous l’axe de la petite roue qui, par une illusion d’optique assez fréquente, parut entrer sous la grande roue.
C’est ainsi qu’on finit par construire des bicycles dont la grande roue avait 1m,40, tandis que la petite n’avait que 0m,30.
Pendant que la hauteur relative des roues subissait ces importantes modifications, il se produisait un changement parallèle dans la forme des fourches de devant et du guidon et dans la position du bicycliste sur sa machine.
Les fourches, d’abord inclinées en arrière et grossières de forme, s’affinèrent peu à peu jusqu’à la limite du possible, se composant de tubes simples dessinant un ovale et quelquefois de deux tubes accouplés. D’autre part, elles se redressaient et finissaient par devenir perpendiculaires au sol.
Le guidon était au début très haut placé, droit et très court, ce qui donnait aux bras une position disgracieuse et gênante en les forçant à se tenir pliés fortement, ce qui leur enlevait toute leur force et rapprochait les mains, ce qui nuisait beaucoup à la direction.
Le guidon s’élargit, puis s’abaissa vers les extrémités, tout en ménageant au milieu une double courbe permettant aux jambes de se mouvoir sans le loucher. Les poignées furent amenées à la hauteur du bec de la selle, donnant aux bras une position plus naturelle et un meilleur emploi de leurs forces.
La selle elle-même, d’abord placée sur des ressorts de forme variée, finit par être fixée directement sur le corps dans les bicycles de course, afin de gagner le plus d’espace possible.
Bientôt ces modifications allèrent à l’excès ; la chasse, c’est-à-dire l’angle entre la position réelle des fourches et la perpendiculaire, fut supprimée complètement ; la selle, rapprochée le plus près possible de la tête du bicycle, fut même placée en contact direct avec celle-ci, ce qui rendit la machine bien plus dangereuse, le bicycliste se trouvant perché presque sur l’axe de la grande roue et exposé par la moindre secousse à voir son centre de gravité se déplacer en avant de cet axe et déterminer une chute presque certaine dans la même direction. La petite roue réduite avec excès donna des trépidations excessives.
Bientôt tous ces inconvénients apparurent clairement aux yeux des vélocipédistes, et les constructeurs s’empressèrent d’y remédier.
Une étude approfondie de la statique vélocipédique, appuyée sur les données de l’expérience, amena le bicycle à une forme exemple des excès qui l’avaient d’abord rendu presque impraticable, et bientôt on arriva à lui donner l’aspect définitif qu’il a aujourd’hui et que tous les constructeurs ont adopté, n’apportant plus dans son ensemble que des modifications de détail qui n’affectent pas sa forme générale.
On donna aux bicycles une légère chasse ; on éloigna d’une façon raisonnable la selle de la tête du bicycle ; on augmenta notablement le diamètre de la roue de derrière ; on courba sensiblement l’extrémité inférieure du corps vers la petite roue.
Ces dernières dispositions, qui tirent justement attribuer aux bicycles ainsi construits le nom de rationnels, donnèrent beaucoup de douceur au roulement et supprimèrent une bonne partie des dangers de chute en avant, en augmentant la stabilité de la machine.
C’est selon ces données qu’ont été établis tous les derniers modèles de bicycles dont la forme semble définitivement fixée pour l’avenir.
Dans son état actuel, le bicycle semble être en effet arrivé à sa perfection. On peut dire qu’il a été amené peu à peu à son maximum de simplicité, de commodité et d’élégance.
Les seules modifications dont il semble pouvoir être encore susceptible résident dans l’application de caoutchoucs perfectionnés ou dans l’emploi d’un nouveau métal lui conservant la même solidité, tout en réduisant encore son poids.
C’est vers ce double but que sont concentrées désormais les recherches.
Grâce à ces modifications, le bicycle est devenu un instrument pratique, dont les avantages peuvent contrebalancer les inconvénients.
Pour un certain nombre d’adeptes enthousiastes, les premiers dépassent même notablement les seconds, ce qui permet au bicycle de conserver encore et quand même ses fidèles.
De tous les modèles qui constituent les machines comprises sous le nom générique de vélocipèdes, le bicycle est certainement le plus sportif dans le sens strict du mot, au point de vue des courses comme au point de vue du tourisme.
C’est lui qui donne la sensation la plus exacte de la vitesse, le mouvement des jambes étant en proportion directe avec le nombre des tours de la grande roue.
C’est lui qui fournit la perception la plus nette de la lutte, les coureurs pouvant plus que sur toute autre machine s’approcher, se tâter, se sentir les coudes, en un mot.
Ce qui est vrai pour les courses l’est également pour le tourisme.
Ceux qui sont assez vieux dans la vélocipédie pour avoir pratiqué le bicycle sur route savent seuls quels charmes sont inhérents à cette machine.
Le plus grand de tous est l’indépendance absolue qu’elle laisse aux mouvements du bicycliste.
Par suite de la disposition de la grande roue, qui est motrice et directrice en même temps, la direction est d’une facilité extrême et peut se faire aisément sans les mains. Les pieds donnant le mouvement, la machine marche toute seule devant elle, et une légère inflexion du corps à droite ou à gauche suffit à la ramener en cas de déviation.
Il ne faut donc au bicycliste que très peu d’apprentissage pour marcher sans les mains, et tous les bicyclistes un peu exercés ont été capables de fournir de longues étapes, sur des terrains accidentés, sans avoir besoin de se servir du guidon.
Cette indépendance des mains est aussi utile qu’agréable.
Elle permet en effet de lire son guide, de consulter sa carte, de prendre des notes, de se servir de son mouchoir, de fumer, de boire et manger, voire même d’ôter et de remettre un vêtement, et cela sans ralentir l’allure, ce qu’on ne pourrait faire avec une égale aisance, ni même quelquefois sans danger, sur aucune autre espèce de machine.
Un autre grand charme du bicycle provient de la douceur de propulsion, résultat de son mouvement direct, et du mouvement relativement minime des jambes qu’il exige, la longueur des manivelles étant toujours moindre sur le bicycle que sur les autres types de machines, ce qui supprime une dose notable de fatigue.
En promenade, le bicycle permet à celui qui le monte de découvrir, en raison de sa position élevée, bien des choses qui échappent à un vélocipédiste se servant d’une machine basse. Le bicycliste peut saisir au passage, au-dessus d’une haie ou d’un mur, un bout intéressant de paysage ou de jardin dont la vue est interdite à ses compagnons moins haut montés.
Le bicycle présente en outre cet avantage considérable qu’étant de beaucoup la machine la plus simple comme construction, elle est par cela même la plus solide et la moins sujette à détériorations.
Le bicycle est d’ailleurs la machine la plus facile à entretenir en bon état, parce qu’en cas de mauvais temps, elle se salit moins que toute autre, dans ses parties essentielles. Grâce à leur position élevée, les coussinets de la grande roue et les pédales sont à l’abri de la boue ; un petit garde-crotte placé au-dessus de la petite roue protège efficacement le corps et le bicycliste lui-même qui, haut perché sur sa machine, traverse les flaques d’eau et les lacs de boue sans en ressentir les effets.
Il a particulièrement les pieds à l’abri des éclaboussures, ce qui est d’une grande importance et ne peut être obtenu complètement avec aucune autre espèce de machine. Le bicycliste qui n’est pas descendu de machine peut donc traverser les routes les plus boueuses ou les plus inondées, voyager et rentrer les pieds secs, tandis que ses compagnons, montant des machines basses, sont condamnés, malgré toutes les précautions, à avoir les pieds plus ou moins trempés d’eau et de boue, condition toujours pénible et défavorable pour la marche.
Enfin, le bicycle est un instrument dont l’usage n’est pas permis à tout le monde, à cause des qualités d’adresse ou d’audace qu’il exige.
Dans un groupe de vélocipédistes, un bicycliste attire l’attention : il domine ses compagnons ; il a l’air d’un officier à cheval à la tête de ses troupes ; il excite l’admiration des badauds naïfs, et cela d’autant plus que sa machine est plus haute. Tandis que les autres types de machines sont confondus dans la foule, la sienne se détache, au point que, pour beaucoup, le bicycle a gardé le nom de vélocipède par excellence, par opposition aux autres machines qui sont appelées sous leur nom spécial.
Il y a dans tout cet ensemble de petites considérations de quoi satisfaire ceux qui sont sensibles à ce genre de satisfactions d’amour-propre. Le bicycle donne à celui qui le monte une sensation aérienne qui lui est toute spéciale. Grâce à la distance qui sépare le bicycliste du sol, la machine est douée d’une sensibilité extrême et, par suite de sa simplicité, elle est silencieuse plus qu’aucune autre.
On voit venir un bicycliste, on ne l’entend pas. Il arrive sur vous, il passe, il est passé. Un léger zéphyr dans les rayons, un faible bruissement du caoutchouc sur le sol, et c’est tout. On croirait avoir été frôlé par un oiseau. Les coups de pédale et les coups d’aile sont frères.
Ce sont tous ces motifs qui ont tant fait aimer le bicycle par ceux qui l’ont longuement pratiqué et qui lui conservent un groupe encore nombreux de dévots.
Malheureusement ces avantages sont contrebalancés par de nombreux inconvénients qui expliquent les recherches de l’industrie moderne en vue de leur suppression, dussent-elles aboutir à la disparition du bicycle lui-même.
À côté de ces avantages particuliers au bicycle, il existe, en effet, de nombreux inconvénients inhérents à ce genre de machine.
Le premier, et le plus grave de tous, est le danger de chute en avant, qui résulte de la forme de la machine où, le centre de gravité étant très près de la roue de devant, il suffit d’un faible déplacement de ce point pour le faire passer en avant de cet axe et entraîner une chute par-dessus le gouvernail.
C’est ce que les vélocipédistes appellent pittoresquement « piquer une tête ».
En effet, la chute en avant d’un bicycliste ressemble beaucoup au mouvement d’un plongeur.
Ce genre d’accident est malheureusement trop connu des bicyclistes, qui en ont fait l’expérience plus ou moins fréquente, selon leur degré d’imprudence ou de malchance.
C’est une loi universelle qui les frappe tous. Il n’en est, en effet, pas un qui, ayant un peu pratiqué cette machine, n’ait fini, malgré les plus minutieuses précautions et la plus extrême prudence, par rencontrer un jour des conditions défavorables entraînant une chute en avant.
Un second inconvénient du bicycle provient de la difficulté d’y monter ou d’en descendre dans certaines conditions résultant de la nature ou de la déclivité du sol.
Le fait de monter sur un bicycle présente toujours quelque difficulté ou tout au moins un certain effort et beaucoup d’attention de la part de ceux qui ne sont plus ni jeunes, ni légers, ni adroits.
Sur un terrain présentant une descente douce, cette opération est facilitée par l’élan naturel de la machine, qui permet au bicycliste de prendre du temps pour se mettre en selle.
Sur un terrain plat, la chose est encore assez simple, l’élan étant facile à donner.
La difficulté commence quand il s’agit de monter sur un bicycle au milieu d’une côte, et cette difficulté augmente en proportion de l’inclinaison du sol et de la hauteur du bicycle.
Sur une montée, il est assez difficile, et quelquefois impossible, à un bicycliste d’adresse moyenne de donner au bicycle, en le poussant, assez d’élan pour avoir le temps de s’élever sur le marchepied, de se mettre en selle et d’atteindre les pédales.
Dans ces conditions, un bicycliste, qui est descendu de machine au milieu d’une côte pour se reposer, et qui, plus loin, veut y remonter, est exposé à ne pouvoir y parvenir et réduit à achever la côte à pied, à moins qu’il ne demande l’aide de quelqu’un pour se remettre en selle ou qu’il ne monte en machine en descendant la côte, pour virer et repartir à la montée : chose souvent impraticable, à cause de l’étroitesse ou de la trop grande inclinaison de la route.
Beaucoup de bicyclistes ont souffert de cet inconvénient, qu’on peut éprouver sur un sol plat, mais caillouteux ou défoncé, aussi bien qu’à une montée.
Pour descendre de bicycle, une difficulté inverse peut se produire.
De même que, sur une côte, le bicycliste qui voudrait remonter sur sa machine ne peut toujours y arriver, de même, sur une descente, le bicycliste qui essaye de descendre de machine est quelquefois incapable d’y parvenir.
Le bicycle est la machine qui « s’emballe » le plus facilement, et, lorsqu’une descente est dure, il n’est pas toujours facile d’en rester maître. Dans ces conditions, il ne reste d’autre ressource que de descendre, pour éviter un accident ; mais, lorsque la machine a déjà acquis une trop grande vitesse, l’opération devient difficile et quelquefois périlleuse.
On ne peut, en effet, se servir brusquement du frein, qui, en arrêtant la grande roue, entraînerait infailliblement une chute en avant. D’autre part, les pieds, ayant quelquefois de la difficulté à suivre le mouvement déjà trop rapide des pédales, ne peuvent plus y trouver un temps d’appui suffisant pour descendre avec sécurité. Sauter en arrière en abandonnant son bicycle est dangereux ; les autres moyens sont acrobatiques ou impraticables.
La même difficulté d’arrêt ou de descente peut se produire sur terrain plat, lorsque la vitesse est trop grande, dans le cas d’un obstacle se dressant brusquement devant le bicycliste.
Un autre petit inconvénient du bicycle, nullement dangereux, mais simplement agaçant, est la vitesse relativement excessive que le bicycliste est obligé d’imprimer à ses pédales pour suivre, lorsqu’il est en groupe, le train des autres vélocipédistes montant des machines multipliées.
On peut se figurer, en effet, quelle accélération de mouvement doit produire un bicycliste montant une machine de 1m,30 pour suivre un bicyclettiste ayant une machine multipliée à 1m,50. Il perd en moyenne environ un tour sur huit. Dans ces conditions, il a l’air de ne pas avancer et semble faire beaucoup d’efforts, tandis que son compagnon marche avec aisance.
Le bicycle est également assez mal agencé au point de vue du bagage.
Les deux seuls points pratiques où l’on puisse le placer sont le guidon et le corps au-dessous de la selle ; mais, si l’on met un fort poids sur le guidon, on charge trop le devant de la machine, ce qui augmente les dangers de chute en avant. D’autre part, un trop gros paquetage sur le corps rend plus difficile l’opération de se mettre en selle, car on risque d’accrocher le sac au passage avec la jambe.
En résumé, le bicycle est un instrument sur lequel on ne peut commodément porter qu’un bagage limité, ce qui sera toujours un inconvénient important pour un touriste amoureux de ses aises et désireux d’avoir sous la main tout le nécessaire de toilette que peuvent lui imposer les circonstances.
Le bicycle est une machine qui se plie mal à quelques difficultés qu’on rencontre souvent sur route, telles, par exemple, que les trottoirs ou les caniveaux trop profonds.
Lorsque la chaussée est trop mauvaise et qu’un bicycliste veut prendre le trottoir, il est obligé de descendre de machine et doit recommencer la même opération pour revenir sur la chaussée, à moins qu’il ne trouve un endroit moins élevé pour passer sans encombre.
Monter et descendre les trottoirs sur un bicycle est en fait un exercice praticable, mais dangereux, et interdit à la grande majorité des bicyclistes ordinaires.
La même observation peut s’appliquer aux ruisseaux et aux caniveaux trop profonds.
Les caniveaux mal franchis par des bicyclistes inexpérimentés sont la cause d’une bonne partie des chutes sur route.
Enfin, le bicycle est une machine presque impraticable pendant la nuit.
La forme même de cette machine exige en effet que le bicycliste voie continuellement et nettement les obstacles qui peuvent se trouver sur sa route ; car il suffit d’un choc, relativement faible mais inattendu, pour occasionner une chute. Or la lanterne est absolument insuffisante pour mettre le bicycliste en garde contre tous les accidents de la route. Si cette lanterne est fixée à la tête du guidon, elle est trop éloignée du sol qu’elle n’éclaire que faiblement, et, si elle est placée dans le moyeu, elle est affectée d’un mouvement d’oscillation perpétuel qui rend la lumière très indécise. Le bicycliste sera donc condamné ou bien à marcher à une allure funéraire, plus fatigante et plus fastidieuse que la marche à pied, ou bien à entretenir une vitesse modérée, mais trop grande encore pour lui permettre de voir à temps une pierre, une branche d’arbre ou un trou qui lui occasionnera une chute presque certaine.
On conçoit donc aisément que les bicyclistes soient éminemment des promeneurs de jour et qu’ils prennent toutes leurs précautions pour arriver à l’étape fixée avant la nuit tombée.





























