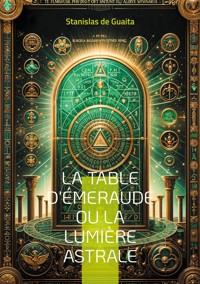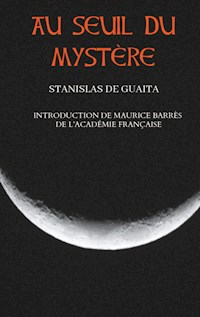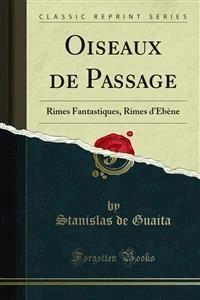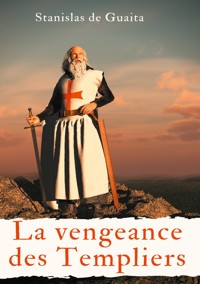
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "La vengeance des Templiers" de Stanislas de Guaita plonge le lecteur dans un univers où l'histoire et le mystère s'entrelacent de manière captivante. Au coeur de ce récit, les Templiers, ordre religieux et militaire du Moyen Âge, se dressent non seulement comme des figures emblématiques de l'histoire, mais aussi comme des symboles de secrets enfouis et de légendes inexplorées. Le livre nous entraîne dans une quête palpitante où les protagonistes cherchent à déchiffrer des énigmes anciennes, révélant au passage des vérités longtemps dissimulées. Chaque chapitre dévoile une nouvelle facette de cette confrérie mythique, explorant leurs rituels, leurs trésors cachés, et leur influence persistante à travers les siècles. L'auteur, avec une plume érudite et précise, parvient à ressusciter l'aura mystique des Templiers tout en tissant une intrigue moderne et haletante. "La vengeance des Templiers" n'est pas seulement une aventure historique, mais aussi une réflexion sur le pouvoir, la foi, et la quête de justice à travers les âges. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Stanislas de Guaita, figure énigmatique et érudite du XIXe siècle, est principalement connu pour ses contributions à la littérature ésotérique et ses explorations mystiques. Né en 1861 à Lorraine, en France, de Guaita s'est rapidement distingué par son esprit brillant et sa fascination pour l'occulte. Auteur d'une oeuvre littéraire riche et variée, il s'est imposé comme un écrivain incontournable dans le domaine de l'hermétisme et de la magie. Ses écrits, souvent imprégnés de symbolisme et de références historiques, témoignent de sa profonde connaissance des traditions ésotériques et de son intérêt pour les sociétés secrètes. Bien que sa renommée soit principalement liée à ses travaux ésotériques, Stanislas de Guaita a également été un poète accompli, enrichissant la littérature française de son style unique et de ses réflexions philosophiques. Sa quête incessante de savoir et sa capacité à mêler érudition et créativité font de lui une figure fascinante de son époque, dont l'influence perdure encore aujourd'hui dans les cercles littéraires et mystiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous sommes au commencement du XIVe siècle : l’Ordre moitié religieux, moitié militaire, établi en Orient vers 1118 par Hugues des Payens, a prodigieusement prospéré. Les Templiers possèdent en Europe près de dix mille seigneuries, et leur opulence, devenue proverbiale, centralise dans leurs mains une puissance presque illimitée.
D’autre part, quoiqu’ils affectent de s’incliner avec respect devant les deux autorités civile et religieuse, on leur prête les projets d’une ambition qui confine à la folie. Héritiers — ils s’en flattent du moins — de cette tradition johannite 1 qui constitue la moelle ésotérique du Christianisme, ils accomplissent, dans l’ombre et le silence de leurs Commanderies, des rites étranges et secrets… Bref, la voix populaire, qui les incrimine de sorcellerie, dénonce également leurs mœurs comme infâmes. Cette dernière accusation ne fut jamais établie sur de bien irréfutables preuves ; mais si les apologistes de l’Ordre ont pu revendiquer équitablement, en faveur des Templiers, le bénéfice du doute, jamais, du moins, n’ont-ils pu les réhabiliter au grand jour de la controverse historique, en lavant leur mémoire de tout soupçon.
Jules Garinet résume ainsi les griefs portés à la charge des Templiers : « On disait qu’à la réception dans l’Ordre, on conduisait le récipiendaire dans une chambre obscure, où il reniait Jésus-Christ en crachant trois fois sur le crucifix ; que celui qui était reçu baisait celui qui le recevait à la bouche, ensuite in fine spine doïsi et in virga virili ; que les Templiers, dans leurs chapitres généraux, adoraient une tête de bois doré qui avait une longue barbe, des moustaches touffues et pendantes ; à la place des yeux brillaient deux grosses escarboucles étincelantes comme le feu 2. On les accusait encore de faire vœu de sodomie, et de ne rien se refuser entre eux…
« En Languedoc, trois Commandeurs de l’Ordre, mis la torture, avouèrent qu’ils avaient assisté à plusieurs chapitres de l’Ordre ; que dans l’un de ces chapitres, tenu à Montpellier, et de nuit, suivant l’usage, on avait exposé une tête ; qu’aussitôt le diable était apparu sous la figure d’un chat ; qu’on avait adoré ce chat, qui parlait avec bonté aux uns et aux autres ; qu’ensuite plusieurs démons étaient venus, sous forme de femmes, et que chaque frère avait eu la sienne 3. »
Quoi qu’on puisse penser de ces stupéfiantes accusations, qui valurent à tant de braves Chevaliers les affres du bûcher, il nous est impossible de ne pas noter, en passant, quelle ressemblance, sinon quelle absolue identité, assimile de pareilles scènes (qu’on les veuille réelles ou mensongères) au sabbat des sorciers d’une part, et de l’autre à ces réunions orgiaques et mystiques tout ensemble, qui furent imputées de tout temps aux sectaires de la gnose dissidente, par les auteurs contemporains qui traitent de leurs rites et de leurs mystères.
Le marquis de Saint-Yves, dans un livre remarquable à tant d’égards, glorifie ce qu’il appelle La Mission des Templiers. En eux, il salue les orthodoxes de l’ésotérisme traditionnel, les mandataires de la paix sociale, les fondateurs et les inspirateurs de ces États généraux — véritable ébauche de synarchie — qui furent, au long de notre histoire, l’organe intrépide et modéré des revendications populaires, et comme une grande voix, ferme et respectueuse, sortie des entrailles mêmes de la nation.
S’il en est ainsi, les États généraux de Tours (mai 1308) se montrèrent parricides en reniant le Temple, et en abandonnant les Templiers à la fureur de leurs bourreaux. Du reste, avec sa loyauté coutumière, M. de Saint-Yves proclame lui-même ce fait irrécusable, qui sera pour les superficiels une des pierres d’achoppement de son hypothèse : « L’unanimité des Trois Ordres tendit à Philippe le Bel le fer et le feu…, » lit-on à la page 216 de la France vraie4 (tome I).
Cela n’importe guère. Il n’est pas sans exemple de voir le fils suivre les traditions du père, après l’avoir condamné ; l’ouvrier revivre dans son œuvre, après être mort par elle. Et sans aller si loin, saint Pierre, qui renia trois fois son maître Jésus-Christ, n’en fut pas moins le premier chef de l’Église chrétienne. Aussi n’est-ce point de pareils arguments que nous opposerons à l’illustre apôtre des Missions.
Si noble que soit la thèse qu’il soutient, nous voudrions, pour qu’elle fût acceptable, la voir fondée en histoire sur quelque fait avéré. Sans aborder la discussion sur ce terrain, nous allons dire pourquoi, sur celui de la métaphysique pure, cette thèse nous paraît au moins hasardeuse.
Les Chevaliers étaient dépositaires d’une doctrine sociale et religieuse. C’est historiquement certain. Reste à savoir de laquelle.
Que le Temple possédât la tradition orthodoxe, voilà qui n’est guère soutenable. Cet Ordre fameux reste dogmatiquement entaché de manichéisme. Mignard notamment a rapproché des preuves accablantes à l’appui de cette opinion. Les figures emblématiques sculptées en relief sur le coffret de pierre d’Essarois, pièce à conviction 5 (entre mille) qu’il détaille avec une compétence et une sagacité parfaites, ne sont de nature à laisser aucun doute. Le caractère de mysticisme obscène qui est le propre de ces symboles dyarchistes semble même d’une précision assez typique, pour servir de trait d’union, dans l’espèce, entre les deux grands griefs stipulés contre les Templiers : la goëtie manichéenne et le vice impur.
Ne retenons que le manichéisme à la charge des Templiers. C’est plus qu’il n’en faut pour réfuter l’attribution qui leur est faite d’une doctrine traditionnelle de syncrèse tri-unitaire, mathétique, ou (comme l’appelle excellemment M. de Saint-Yves) d’une tradition synarchique.
L’antagonisme primordial, absolu, de deux principes incompatibles, telle est l’essence du dogme manichéen ; elle exclut le Ternaire synarchique et la Monade dont émane ce Ternaire.
Le manichéisme est la négation radicale du principe de retour à l’Unité. Allez édifier une synthèse sur une pareille base ! Projet chimérique : autant vouloir restaurer Babel…
Les Templiers, nous l’avons dit, ne passaient pas pour de simples hérétiques.
À part l’imputation de manichéisme — exclusive, selon nous, de l’attribution que leur fait généreusement M. de Saint-Yves de sa propre doctrine, — on incriminait encore les chevaliers de magie noire et de sodomie.
C’étaient crimes capitaux dans la jurisprudence du moyen âge. Si graves d’ailleurs qu’ils semblassent aux juges du XIVe siècle, ils ne furent qu’un trompe l’œil invoqué, une excuse au coup d’État de 1307. Il faut bien le dire. Quelle excellente occasion pour le roi de France et pour le pape, sa créature, d’abolir d’un coup la puissance de ces superbes défenseurs du trône et de l’autel, mille fois plus dangereux que les pires ennemis, et quel prétexte tout naturel de se partager leurs prodigieuses dépouilles !
De longue main déjà, le successeur de Pierre et l’héritier de Hugues Capet avaient préparé ce coup de maître 6 ; on n’attendait que l’heure propice pour agir de concert…
Cette heure enfin sonna. Plusieurs dénonciations formelles, celles entre autres de deux Templiers apostats, permettaient de sévir à l’improviste et d’envelopper tous les Chevaliers dans un même réseau. Le filet fut jeté dans la nuit du 12 au 13 novembre 1307, où tous les gouverneurs et officiers du roi reçurent, sous pli scellé, l’ordre fatal.
Dès le matin, les Templiers sont arrêtés par toute la France et leurs biens mis sous séquestre. — À Paris, cent quarante chevaliers sont dans les fers ; on procède contre eux avec une rigueur insolite. Jamais la question ne fut plus cruellement infligée. Le R. F. Imbert, inquisiteur de la foi, dirige les interrogatoires, assisté de commissaires nommés par le roi. A leur tête figure Guillaume de Nogaret, homme colérique et dont le fanatisme touche au délire.
En province, l’inquisiteur subdélègue des commissaires ecclésiastiques, et les interrogatoires commencent.
De toutes les procédures intentées à ces malheureux, il ne nous reste que huit relations authentiques : celles de Caen (où 13 Templiers sont dans les fers) ; de Pont de l’Arche (10 Templiers) ; de Cahors (7 Templiers) ; de Carcassonne (6 Templiers) ; de Beaucaire (45 Templiers) ; de Troyes (5 Templiers) ; de Bayeux (5 Templiers) ; et enfin de Bigorre (11 Templiers).
À Caen, l’on promet aux accusés grâce entière ; néanmoins, les réfractaires souffrent la torture.