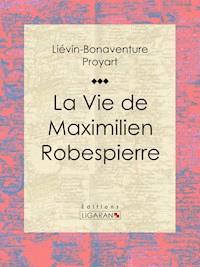
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Maximilien Marie-Isidore-Robespierre est né à Arras le 6 mai 1758 de Maximilien-Barthélémy-François, avocat au conseil d'Artois, et de Jacqueline-Marguerite Carraut. Il fut tenu sur les fonts sacrés de l'église de Saint-Aubert par Maximilien de Robespierre, son grand-père, et par Marguerite Cornu, sa grand-mère du côté maternel, et baptisé par M. G. H. F. Lenglais, curé de cette paroisse."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335040272
©Ligaran 2015
Le 1er mars 1848, le jour de l’installation de M. Frédéric Degeorge, nommé commissaire général du Pas-de-Calais par M. Ledru-Rollin, ministre de l’intérieur, l’Hôtel-de-Ville d’Arras fut le théâtre d’une scène fort émouvante, dont voici les détails, que nous ont racontés des témoins oculaires, et qui ont été conservés par les journaux du pays.
Huit à dix jeunes gens de 18 à 25 ans, sortis de l’école Normale et du Val-de-Grâce, étant venus de Paris avec la mission de faire reconnaître les commissaires désignés pour les départements, le conseil municipal et toutes les autorités, auxquels s’était joint un grand concours de peuple, se réunirent dans la grande salle. L’un de ces jeunes gens prit la parole. Son discours fut goûté. Après lui un de ses compagnons veut aussi parler. Se trouvant dans la patrie d’un homme pour lequel il professait la plus grande admiration, et à qui la ville d’Arras devait être fière, selon lui, d’avoir donné la naissance, il croit devoir en faire l’éloge en présence de l’immense auditoire. Enfin un nom s’échappe de ses lèvres, c’est celui de Robespierre. Aussitôt on se regarde avec étonnement. L’orateur continue ses éloges. Mais voilà qu’un sentiment unanime éclate de toutes parts. On lui crie des divers points de la salle : « Assez ! assez ! assez ! » La tempête devient furieuse, les interpellations s’échangent, vont, viennent de ci, de là ; c’est une vague qui roule, c’est un tonnerre qui gronde. Le jeune homme veut, s’expliquer ; on ne veut plus l’entendre. Un des adjoints lui fait observer que la république nouvelle n’a rien de commun avec celle de 93. L’agitation est à son comble. L’orateur, déconcerté, se met à pleurer. Il comprend qu’il a mis le pied sur un terrain brûlant
Au milieu du tumulte, M. l’avocat Luez s’écrie : Nous applaudissons aux vertus de Robespierre, mais nous éviterons ses crimes. Ce mot calme l’orage. Enfin un autre de ces jeunes gens, le sieur Beulet, élève de l’école Normale, demande à donner quelques explications. À sa voix le silence se rétablit, le calme se fait. Il conjure l’assemblée de ne pas se méprendre sur les sentiments de son collègue. Il exprime les plus nobles pensées sur le bon ordre, le respect dû à la propriété. Il dit que, bien loin de vouloir persécuter leurs concitoyens, ils sont prêts à verser leur sang pour leur bonheur. Les fronts s’éclaircissent, la confiance renaît, et le jeune orateur finit par conquérir toutes les sympathies. Bientôt on l’entoure, on lui presse la main ; chacun veut l’embrasser, le voir au moins, et la foule le place, bien malgré lui, sur la table même où l’on délibère : car il éloigne les souvenirs affreux du passé, il ne fait entendre que des paroles de paix et de conciliation. Son discours, prononcé avec beaucoup de chaleur et de verve, exalte l’assemblée et provoque d’unanimes applaudissements. Alors ces jeunes gens se précipitent dans les bras les uns des autres, et s’embrassent avec effusion, pour faire comprendre qu’ils sont unanimes dans la profession des mêmes doctrines.
Cette scène et plusieurs autres symptômes qui se sont manifestés parmi nous ont fait naître l’idée de remettre en lumière des documents épars de divers côtés, touchant Maximilien Robespierre, et de reproduire des souvenirs qu’il est bon de ne pas laisser tomber dans l’oubli. Le fond principal de l’ouvrage est digne de toute la confiance des lecteurs. C’est le résultat des observations d’un homme qui a particulièrement connu le célèbre Montagnard. Le portrait est parfaitement conforme à l’original.
Naissance de Robespierre. – Sa famille. – Son père quitte le pays. – Mort de sa mère. – Son caractère. – Ses succès dans les classes. – Boursier de Saint-Vaast au collège de Louis-le-Grand à Paris. – Il recommence sa rhétorique. – Son éloignement pour ses condisciples qui pratiquaient la vertu, et pour tous les exercices religieux. – M. l’abbé Asseline, son confesseur.
Maximilien Marie-Isidore-Robespierre est né à Arras le 6 mai 1758 de Maximilien-Barthélemy François, avocat au conseil d’Artois, et de Jacqueline-Marguerite Carraut. Il fut tenu sur les fonts sacrés de l’église de Saint-Aubert par Maximilien de Robespierre, son grand-père, et par Marguerite Cornu, sa grand-mère du côté maternel, et baptisé par M. G.H.F. Lenglais, curé de cette paroisse. Sa maison de naissance fait le coin de la rue des Rapporteurs et de celle des Petits-Rapporteurs, à droite en descendant, sous le numéro 274. Il était l’aîné d’un frère qui le suivit dans sa carrière politique. Il avait deux sœurs, dont l’une mourut en bas âge. Celle qui lui survécut, Charlotte, avait eu l’avantage d’une éducation religieuse dont elle avait profité. Mais, comme la médiocrité de sa fortune la tenait dans une entière dépendance de son frère, elle se vit obligée d’aller vivre auprès de lui à Paris ; et l’on n’a jamais su ce qu’elle a pu devenir à l’école d’un tel maître. Ce qui paraîtrait néanmoins, déposer en sa faveur, c’est que son frère, à l’époque de ses plus grandes fureurs contre ses compatriotes, la chassa de sa maison, et l’obligea d’aller mendier un asile dans la ville d’Arras. Elle mourut à Paris le 1er août 1834, pensionnaire de l’État. La prétendue généalogie qui fait Robespierre parent de Damions, l’assassin de Louis XV, malgré tout ce qu’on a pu dire, est absolument fausse et controuvée.
Le père de Robespierre avait la réputation, dans la ville d’Arras, d’une tête assez mal organisée, surtout très attachée à son sens. Soit bizarrerie de caractère, ou désagrément de profession, à la suite d’un procès perdu il quitta brusquement le pays, où il laissa sa femme et les quatre enfants dont nous venons de parler. On ignora longtemps la route qu’il avait tenue. Mais dans la suite on découvrit qu’au sortir de sa patrie il s’était rendu en Belgique, et que de là il passa en Allemagne et habita pendant, quelque temps la ville de Cologne, où pour subsister il ouvrit une école de français pour les enfants. Dégoûté de sa nouvelle profession, il quitta Cologne annonçant le dessein de se rendre à Londres et de là en Amérique.
Peu d’années après la disparition de son père, Robespierre perdit sa mère, et se trouva orphelin, dès l’âge de neuf ans. N’étant héritier d’aucun patrimoine, il n’avait de ressources pour sa subsistance que celles que pouvaient lui procurer son grand-père maternel et la charité des gens de bien, que sollicitaient assez efficacement deux tantes du même nom que lui, qui vivaient dans une grande réputation de piété. L’une d’elles, dans la vue d’assurer du pain aux pupilles dont elle se voyait chargée, se détermina à l’un de ces mariages qu’on appelle de raison, quoique souvent très peu raisonnables. Elle épousa un vieux médecin qui, outre les secours actuels qu’il pouvait fournir aux Robespierre, s’engagea encore à donner à l’aîné un asile dans sa maison lorsqu’il aurait achevé ses études.
Dès sa plus tendre enfance, Robespierre annonça le caractère sombre et machinateur qu’il conserva toute sa vie. Il ne passa point par le bel âge de l’ingénuité. Dissimulé par instinct avant de pouvoir l’être par réflexion, il avait l’air de toujours craindre qu’on ne lui surprît le secret de sa pensée ; et le moyen de la connaître n’était pas de l’interroger ; on y réussissait mieux en le flattant. Il aimait à être bien habillé, et il cherchait à jeter du ridicule sur les enfants de son âge qui l’étaient mieux que lui. Fier et dédaigneux avec ses égaux, il était d’une dureté tyrannique avec son frère et ses sœurs. Comme il parlait peu, il trouvait mauvais qu’ils parlassent plus que lui. Il ne leur accordait pas le sens commun. Rien de ce qu’ils disaient n’était bien dit. Il ne laissait échapper aucune occasion de les mortifier ou de les humilier ; il leur prodiguait, pour les moindres, sujets, les reproches les plus grossiers. S’il n’aimait point ses semblables, il aimait les animaux.
Des pigeons et des moineaux qu’il avait dans une volière faisaient toutes ses délices ; il était sans cesse autour d’eux dans ses moments de récréation. Il conserva toujours cette prédilection lors même que, lancé dans la politique, il dirigeait à Paris l’opinion publique. Un énorme chien de race dogue, qu’il aimait beaucoup, et avec lequel il jouait sans cesse, était le compagnon assidu de ses courses (de ses promenades solitaires). Ce chien, connu dans tout le quartier, s’appelait Brount… Accoudé sur la table de sa mansarde, la tête entre ses deux mains, seul avec Brount, son fidèle gardien, il travaillait dans le silence des nuits avec une activité dévorante à rédiger son journal le Défenseur de la Constitution
Dans l’état d’indigence où se trouvait le jeune homme à l’époque de sa première éducation, il n’était pas à présumer qu’il dût en recevoir une bien distinguée. Ses tantes lui apprirent à lire ; mais n’ayant pas le moyen de lui donner un maître d’écriture, il s’en passa. Aussi était-il aisé de s’apercevoir qu’il n’en avait jamais eu. Il apprit à écrire, en la manière dont il savait le faire, en copiant les premiers principes de la langue latine. Comme le collège d’Arras offrait la ressource de l’étude gratuite du latin, on s’empressa de l’y envoyer.
Bientôt l’orgueil, seul guide de ses actions, le tint appliqué à l’étude ; et l’on ne fut pas longtemps à remarquer en lui, sinon la facilité du génie, du moins la patience du travail jointe à une grande raideur de caractère. L’état où il se voyait réduit pénétrait son âme hautaine d’un sentiment pénible. L’idée de sa misère le révoltait, et l’on s’empressait encore de lui en présager les tristes suites, de peur qu’il ne ralentît les efforts qu’il faisait pour s’y soustraire un jour. Ainsi des parents inconsidérés sont souvent les premiers à seconder dans la jeunesse des penchants vicieux, dont le développement doit causer sa perte.
Avec de l’application et des dispositions ordinaires, Robespierre se distingua parmi les écoliers de son âge. Ces premiers succès firent concevoir à ses parents l’espoir, dont ils n’oublièrent pas de le flatter lui-même, d’obtenir une bourse qui le mettrait à portée de faire ses études dans l’Université de Paris. Cette perspective, nouvel aliment à son ambition naissante, lui fit faire de nouveaux efforts pour attirer sur lui la faveur à laquelle il aspirait. En effet, à la recommandation de ses protecteurs, et nommément d’un chanoine de la cathédrale d’Arras, il fut pourvu d’une bourse du collège de Saint-Vaast l’un des vingt-huit réunis à celui de Louis-le-Grand.
Ce fut en 1770 que Robespierre arriva à Paris. Il fut admis au collège pour la classe de cinquième. Il paraît que ses inclinations sinistres s’étaient déjà manifestées dans son pays : au moins n’avaient-elles pas échappé à une mère respectable, qui, ayant son fils à Louis-le-Grand, écrivait à l’un des maîtres de cette maison :
J’ose espérer, monsieur, qu’à toutes les bontés que vous avez ; déjà pour mon fils, vous voudrez bien ajouter encore celle de surveiller un peu sa société, et surtout de lui interdire toute fréquentation avec le jeune Robespierre, qui, soit dit entre nous, ne promet pas un bon sujet.
Cependant le désir de se distinguer parmi ses condisciples le suivit sur le nouveau théâtre qui s’ouvrait à son ambition ; et, quoiqu’il eût à lutter d’abord avec des concurrents plus redoutables que ceux qu’il avait laissés au collège d’Arras, il le fit sans se rebuter, et si opiniâtrement, qu’en moins de deux ans il parvint à briller parmi ses égaux, dans un cours à la vérité qui ne passait pas pour brillant, comparé à ceux qui l’avaient immédiatement précédé. N’ayant eu que de médiocres succès en rhétorique dans les compositions de l’Université, il n’hésita pas, pour venger son orgueil humilié, de recommencer cette classe ; et, comme il s’y était attendu, l’application lui assura, cette seconde année, les palmes que le génie lui avait refusées la première.
Pendant son cours d’humanités, content de ce genre de supériorité conquise par le travail, Robespierre n’en ambitionnait point d’autre, et ne craignait aussi rien tant que de la perdre. Conséquent dans la fausse idée qu’il s’était formée de ce qui constitue le vrai mérite, il rapportait tout à l’étude, il négligeait tout pour l’étude ; l’étude était son culte. Quant aux qualités morales, le plus bel ornement de la jeunesse et le seul fruit précieux de la bonne éducation, il n’en parut jamais touché. D’accord avec la philosophie du jour, avant même d’en connaître les principes, il craignait comme l’écueil des talents la vertu, qui seul a le droit de leur imprimer le sceau de la vraie grandeur. Opiniâtrement occupé du soin de parer l’esprit, il semblait ignorer qu’il eût un cœur à régler.
Après avoir ainsi méconnu ou dédaigné pour lui-même le mérite de la vertu, Robespierre finit par le mépriser et le prendre en aversion dans les autres. Contemporain, dans son collège, de cet aimable jeune homme si connu dans toute la France sous le nom de l’Écolier vertueux, et de grand nombre d’autres qui, à des talents plus marqués que les siens, réunissaient l’aménité du caractère et tout le charme de la piété modeste, Robespierre ne leur pardonnait pas de jouir parmi leurs condisciples d’une considération dont il était exclu, et, auprès des maîtres, d’une confiance qu’il ne partageait pas. Censeur sévère et presque toujours injuste de leur conduite, il leur trouvait des crimes dans les moindres fautes, et leur voyait des torts où personne n’en soupçonnait ; tantôt il se plaisait à les ridiculiser par l’ironie, tantôt à les piquer par la causticité ; et, plus souvent encore, à les mortifier par le dédain. Plus un de ses condisciples s’avançait dans la carrière de la vertu, plus Robespierre s’éloignait de lui.
Constant adorateur de ses pensées, il les trouvait toujours infiniment préférables à celles des autres. Il parlait peu, ne le faisait que quand on paraissait l’écouter, et toujours sur le ton décisif et confiant. Quoique avide et insatiable de louanges, lorsqu’on lui en donnait il les recevait d’un air de modestie froide, qui semblait dire : « Je me sens encore au-dessus de vos éloges. » Si, dans sa classe, il était nommé à la première place, il allait s’y asseoir sans empressement, et comme au seul endroit qui convînt à ses talents. Avait-il le chagrin de voir passer devant lui un nombre de ses condisciples, il les saluait d’un rire moqueur qui décelait toute l’impatience de l’orgueil blessé ; et il n’était pas satisfait qu’il n’eût trouvé l’occasion de se venger par quelque trait méchamment lancé, tantôt contre ceux qui avaient obtenu la préférence, tantôt contre le juge qui l’avait décernée.
Avec ces dispositions et cette malignité de caractère, Robespierre se faisait redouter de ses condisciples, et n’était aimé d’aucun. Mais, infatué de sa propre excellence, il se croyait dédommagé de l’affection que lui refusaient ses camarades, en s’aimant éperdument lui-même. Très souvent, pendant les récréations particulières qui se prenaient dans les salles d’étude, on le laissait seul, et il avait la constance de rester ainsi des heures entières. Il eût cru se compromettre en faisant un pas pour s’approcher d’un condisciple, et, dans le délaissement où il se trouvait alors, il affectait de se suffire à lui-même et de trouver tout dans la jouissance de ses pensées.
Dans ses classes inférieures, quelque jeune qu’il eût été, on le voyait très rarement partager les amusements et les jeux qui plaisent le plus à l’enfance. Son cœur, froid et misanthrope, ne connut jamais ces épanchements d’une joie vive et franche, indices naturels de la candeur et de l’ingénuité. De tous les divertissements bruyants et variés à l’infini qui font de la récréation publique d’un collège une scène si animée, aucun ne lui plaisait, et il leur préférait les sombres rêveries et les promenades solitaires. Quelqu’un, dans ces moments, s’approchait-il de lui, il l’accueillait avec une gravité froide, et ne lui répondait d’abord que par monosyllabes. Se mettait-il en devoir de louer son style et ses productions scolastiques, Robespierre lui faisait la grâce de lier conversation avec lui. Biais, pour peu qu’on se hasardât à le contrarier, on devenait à l’instant l’objet de quelque trait dur et virulent. Camille Desmoulins, qui habitait le même collège et dont le caractère impétueux et brouillon s’accommodait peu de la morgue philosophique de Robespierre, avait de temps en temps des prises avec lui. Mais dès-lors, comme depuis, les champions ne combattaient point à forces égales : toujours plus réfléchi que l’adversaire qui le provoquait, et plus maître de ses coups, Robespierre, épiant le moment, fondait sur lui avec tout l’avantage qu’a la froide prudence sur la témérité.
Ce penchant dominateur, et le fonds d’égoïsme qui faisait son caractère, le rendaient ennemi de toute espèce de contrainte ; et il est aisé d’imaginer de quel prix pouvait être à ses yeux l’ordre établi dans son collège : il le détestait. La sage variété des exercices qu’il prescrivait n’était pour lui qu’un joug insupportable. Il s’y pliait néanmoins, parce qu’il craignait plus encore l’humiliation des reproches que la gêne de l’assujettissement. Prudent et circonspect, il évitait avec soin tout ce qui eût pu le compromettre. C’était en silence qu’il rongeait le frein que lui imposait la règle ; ou, s’il se permettait de raconter ses ennuis et de soupirer ses plaintes, ce n’était qu’à l’écart, et dans ses confidences secrètes avec certains sujets à la discrétion desquels il croyait pouvoir se fier. C’était auprès de ceux-là seulement que le collège n’était qu’une prison, les écoliers de malheureux captifs, et les maîtres des despotes oppresseurs de la liberté de la jeunesse.
Mais de tous les exercices qui se pratiquent dans une maison d’éducation, il n’en était point qui coûtassent plus à Robespierre et qui parussent le contrarier plus fortement, que ceux qui avaient plus directement la religion pour objet. Ses tantes, avec beaucoup de piété, n’avaient pas réussi à lui en inspirer le goût dans l’enfance ; il ne le prit pas dans un âge plus avancé : au contraire. La prière, les instructions religieuses, les offices divins, la fréquentation du sacrement de pénitence, tout cela lui était odieux ; et la manière dont il s’acquittait de ces devoirs ne trahissait que trop l’opposition de son cœur à leur égard. Obligé de comparaître à ces divers exercices, il y portait l’attitude passive de l’automate. Il fallait qu’il eût un livre à la main : il l’avait, mais n’en tournait pas les feuillets. Ses camarades priaient, il ne remuait pas les lèvres ; ses camarades chantaient, il restait muet ; et, jusqu’au milieu des saints mystères et au pied de l’autel chargé de la victime sainte, où la surveillance contenait, son extérieur, il était aisé de s’apercevoir que ses affections et ses pensées étaient fort éloignées du Dieu qui s’offrait à ses adorations.
Les retraites surtout que l’on donnait à la jeunesse du collège de Louis-le-Grand, au commencement de chaque année scolastique, ennuyaient cruellement Robespierre. Il ne pouvait dissimuler son aversion pour ces exercices religieux. « À quoi bon cette perte, disait-il à ses condisciples ? Est-ce qu’on ne pourrait pas faire un meilleur emploi du temps ? » Il s’applaudissait, comme d’un trait de sagesse, toutes les fois que, trompant la vigilance de ses maîtres, il avait réussi à substituer la lecture de quelque auteur profane aux pieuses lectures qui lui étaient prescrites ou conseillées. Tant que durait la retraite, on lui voyait l’air embarrassé, ennuyé, dépité quelquefois. Il eût été difficile, en effet, que les grandes vérités dont il était instruit, et sur lesquelles on l’obligeait alors de se fixer malgré lui, n’eussent pas agité son âme de quelques troubles importuns.
La nécessité de se confesser tous les mois fatiguait Robespierre plus encore que tout le reste ; mais la règle était expresse, et il lui eût été impossible de s’y soustraire impunément : il s’y soumettait. Les ecclésiastiques attachés au collège de Louis-le-Grand étaient dans l’usage de confesser les jeunes gens qui voulaient s’adresser à eux, laissant toute liberté aux autres de donner leur confiance à des confesseurs du dehors, sujets choisis, qu’un zèle pur engageait à consacrer une partie de leur temps à l’œuvre importante de la direction de la jeunesse. Robespierre essaya des uns, essaya des autres. Il eut même le précieux avantage d’avoir pendant, un temps pour confesseur M. l’abbé Asseline, qui fut ensuite nommé évêque de Boulogne. Ce prélat, connu par son zèle et ses lumières, était, comme directeur des consciences, un de ces hommes auxquels un pécheur ne saurait échapper qu’en bravant bien des remords. Il n’était pas rare de voir ses jeunes pénitents essuyer des larmes au sortir de son confessionnal. Mais ce qu’on remarquait peu dans les autres parut assez extraordinaire pour qu’on le remarquât dans la personne de Robespierre. Quelques-uns de ses condisciples, un jour, le surprirent fondant en larmes au moment où il se retirait du tribunal sacré, et s’empressèrent de publier dans la maison que Robespierre était converti. L’expérience, qui sait que l’impénitence a eu aussi ses larmes et ses soupirs dans les Antiochus, attendit, pour prononcer, des fruits moins équivoques de conversion, et ces fruits ne parurent point.
Dans toutes les maisons d’éducation bien réglées, on prescrit la fréquentation du sacrement de pénitence comme un des moyens les plus efficaces d’épurer les mœurs de la jeunesse et de la former à la vertu ; mais il n’en est pas de même quant à la communion. Son fréquent usage, fruit des dispositions de l’âme, ne saurait être qu’un objet d’exhortation et de conseil. Robespierre habitait le collège de Louis-le-Grand à une époque où la piété y régnait dans toute sa ferveur. L’usage général était que les écoliers communiassent une fois chaque mois ; grand nombre le faisaient plus souvent, et le vertueux Décalogne n’était pas le seul qui communiât au moins tous les huit jours. Aux grandes fêtes de l’année, le nombre des communiants était tel, que la messe en durait une demi-heure de plus. Quel touchant spectacle que celui d’une pieuse jeunesse qui se levait en masse, pour ainsi dire, pour aller entourer la Table sainte ! Robespierre, dans ces solennités, aurait eu honte de se faire remarquer en ne s’associant point à ses condisciples, et il prenait des arrangements, Dieu sait quels, pour suivre l’exemple général. On se rappelle même un temps où ses communions étaient assez fréquentes ; ce qui, joint à son ardeur pour le travail, lui donnait alors un certain air de régularité parmi ses condisciples. Mais ses maîtres, qui avaient sous les yeux l’ensemble de sa conduite, étaient plus effrayés qu’édifiés toutes les fois qu’ils le voyaient participer aux saints mystères.
Ce qui annoncerait encore que l’hypocrisie et le dessein de se ménager une réputation, beaucoup plus que la religion, conduisaient Robespierre dans cet acte auguste du christianisme, c’est qu’à l’époque d’une révolution dans le collège de Louis-le-Grand qui lui enleva presque tous ses maîtres, et dans un temps où il n’était plus honteux de s’absenter de la Table sainte, non seulement Robespierre n’eut plus de jours réglés pour s’en approcher, mais il alla jusqu’à braver l’anathème de l’Église et abjurer la communion pascale. Il n’en fit plus une seule tout le temps de son séjour dans le collège : autant impie par le mépris d’un devoir sacré que par la profanation même.
Robespierre lit de mauvais livres. – Son horreur de la surveillance. – Son aversion pour ses maîtres. – Il écrit à l’abbé Proyart. – Son ingratitude. – Son orgueil. – Ses maîtres le flattent sans réserve. – Il complimente Louis XVI.– Il fait son cours de philosophie.
À l’époque où il savait le mieux s’environner de certaines apparences de régularité, il avait si peu de part à la confiance de ses maîtres, que dans les fréquentes visites qu’ils faisaient pour écarter de leur collège la contagion des mauvais livres, peu de sujets étaient aussi scrupuleusement recherchés que lui sur ce point. Robespierre, dans ces occasions, était toujours fort piqué des soupçons qu’on paraissait fixer sur lui ; il s’en plaignait amèrement, criant à l’injustice et à la prévention. La vérité était néanmoins, et quelques-uns de ses camarades ne l’ignoraient point, qu’il était possesseur des mauvais livres qu’on lui soupçonnait. Mais, toujours prudent et circonspect, il les déposait dans un lieu neutre, et se rendait pour les lire dans l’endroit de la maison où l’on se croit sûr de se trouver sans témoins. Un jour néanmoins, un préfet, ouvrant brusquement une porte, le trouva méditant sur le siège percé une très mauvaise brochure. Surpris ainsi en flagrant délit, Robespierre se croit perdu, et, oubliant sa fierté naturelle, il tombe aux pieds de l’arbitre de son sort, il descend aux plus humbles supplications. Le maître auquel il avait affaire n’était ni inflexible, ni sévère dans sa morale. C’était un homme qu’on avait entendu plus d’une fois s’écrier au milieu des jeunes gens : « Vive la liberté, mes amis, loin de nous la cagoterie. » C’était l’abbé Audrein, qui mérita depuis, par son apostasie, de devenir le collègue de Robespierre dans l’assemblée des Factieux. Auprès d’un tel juge, l’affaire du mauvais livre se civilisa sans peine, et ne parvint pas même à la connaissance des autres maîtres de la maison.
Qu’ils sont coupables, qu’on nous permette cette réflexion, qu’ils sont coupables, et de quel compte ils se chargent envers le Ciel et la société, ces maîtres faibles et cruellement indulgents qui craignent de sacrifier ce qu’ils appellent la fortune d’un sujet, par son expulsion d’un collège, d’un séminaire, et ne craignent pas de sacrifier toute la jeunesse d’un établissement aux scandales d’un corrupteur, et d’élever encore dans sa personne une peste pour ses concitoyens. Si Robespierre eût été chassé de Louis-le-Grand le jour où il fut prouvé qu’il méritait de l’être, et que, sans ressource alors, comme il l’était, pour continuer ses études, il eût été forcé d’apprendre un métier, que de crimes de moins en France ! que d’innocentes victimes soustraites à la mort ! Si on lui eût rendu la justice de le chasser du collège, il est vraisemblable qu’en lui épargnant les crimes de sa vie publique, on lui eût aussi épargné la honte de l’échafaud. N’est-il pas même possible que, dans cet ordre de choses, l’assassinat du roi n’eût pas eu lieu, puisque ce fut lui qui le proposa le premier, qui le sollicita avec le plus de fureur et le détermina par un sophisme ?
Comme tous les jeunes gens justement suspects, Robespierre, dans son collège, avait horreur de la surveillance, et semblait toujours craindre qu’on ne lui dérobât le secret de sa mauvaise conscience. La présence de ses maîtres le fatiguait : il la fuyait et ne respirait jamais plus à son aise qu’à une plus grande distance de leurs regards. Il n’était pas nécessaire qu’un maître l’eût repris ou humilié, il lui suffisait qu’il fût son maître pour qu’il lui vouât sa haine : en sorte que c’était plutôt encore l’autorité qu’il détestait que celui qui avait le pouvoir de l’exercer sur lui. Le premier soin des jeunes gens, lorsqu’on leur donne un nouveau maître, est de chercher à le connaître, et, pour cela, de s’empresser autour de lui, de le faire parler et de l’étudier. Robespierre, dans ces occasions, promenait sa dédaigneuse indifférence loin de ses camarades, et semblait dire au nouveau venu : « Je ne te connais pas, mais tu dois être mon maître, et pour cela tu m’es odieux. »
Ce n’était pas encore assez pour lui de se conduire par cette affreuse morale, il ne négligeait rien pour la propager, et il s’élevait quelquefois avec une sorte d’indignation contre ceux qu’il ne voyait pas disposés à en partager l’injustice et la bassesse. Il qualifiait de vils adulateurs ceux de ses condisciples dont les sentiments honnêtes et reconnaissants condamnaient son mauvais cœur. Il leur faisait un crime des attentions et des égards dont un jeune homme bien né ne se dispense jamais envers ses maîtres. Si quelqu’un d’eux, par le désir de s’instruire, ou par quelque autre motif louable, se rendait plus assidu auprès du maître pendant les récréations, Robespierre le prenait en aversion, ne laissait échapper aucune occasion de le mortifier, et croyait avoir exercé une bien noble vengeance quand il lui avait dit : « Vas donc faire ta cour au maître. »
Son aversion pour l’autorité était telle, qu’elle n’épargnait pas même ceux de ses supérieurs auxquels il était redevable de bienfaits particuliers. M. l’abbé Proyart, alors sous-principal du collège Louis-le-Grand, était de ce nombre. Robespierre lui avait été recommandé par un vicaire-général de son diocèse, comme un jeune homme qui avait besoin de secours. Témoin ensuite par lui-même de sa misère, qui quelquefois parlait aux yeux, et se produisait par une sorte de nudité, M. l’abbé Proyart demandait pour lui des secours à M. l’évêque d’Arras, M. de Conzié, et le prélat ne les faisait pas solliciter. Un jour seulement il observa qu’il avait souvent ouï parler de son diocésain comme d’un sujet studieux, mais jamais comme d’un jeune homme vertueux. À quoi le patron du pauvre écolier répondit que sans doute les bienfaits constants de la religion inspireraient enfin au jeune homme un goût pour la religion que malheureusement il laissait encore désirer. La charité ne sait point contester avec la misère : M. l’évêque d’Arras continua ses secours à Robespierre. Nous rapporterons à ce sujet une pièce assez curieuse. C’est une lettre de Robespierre à M. l’abbé Proyart, alors retiré du collège de Louis-le-Grand et habitant la ville de Saint-Denis.
Paris, ce 11 avril 1778.
Monsieur,
J’apprends que l’évêque d’Arras est à Paris, et je désirerais bien de le voir ; mais je n’ai point d’habits, et je manque de plusieurs choses sans lesquelles je ne puis sortir. J’espère que vous voudrez bien vous donner la peine de venir lui exposer vous-même ma situation, afin d’obtenir de lui ce dont j’ai besoin pour paraître en sa présence.
Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
DE ROBESPIERRE l’aîné.
Malgré les obligations qu’avait Robespierre à celui qui protégeait ainsi sa misère, il ne lui en témoigna jamais plus d’attachement et de reconnaissance. Semblable à cet animal vorace qui vous suit dans la faim et va ronger loin de vous l’os que vous lui avez donné, il s’approchait de son bienfaiteur dans le besoin et le fuyait dès qu’il avait reçu. Lorsque M. l’abbé Proyart paraissait à Arras, au temps des vacances, Robespierre, le seul de tous les jeunes gens de cette ville élevés à Louis-le-Grand qui lui dût au-delà de ce que tout disciple doit à ses maîtres, était le seul qui le négligeât et ne le vit que par rencontre. On eût dit que lui rendre des services n’était que lui payer une dette. Personne n’était plus attentif à se dispenser de la reconnaissance. Tout le temps qu’il passait à Arras, un chanoine de cette ville, M. l’abbé Aymé, lui donnait sa table par charité : il eût voulu persuader à ses camarades qu’il ne l’acceptait que par complaisance. Le souvenir d’un bienfait, comme la présence d’un bienfaiteur, faisait le supplice de son orgueil.
Cette passion, mobile unique de sa conduite, perçait en tout chez lui. Quoique boursier dans le collège, quoique réduit presque à l’indigence, il ambitionnait de paraître autant que les pensionnaires les plus aisés. La plupart des boursiers savaient se passer de perruquier, Robespierre faisait la dépense d’en payer un, et il n’était pas rare de lui voir, avec une frisure élégante, un habit et des souliers percés. Ce n’était pas assez pour lui d’affecter le ton de la richesse lorsqu’il vivait d’aumônes, il voulait encore singer la noblesse au milieu des témoins de sa roture, et il faisait précéder son nom d’un de que ridiculisaient tous ses jeunes compatriotes. Il est un orgueil qui n’exclut point les dehors de la politesse, qui les affecte même quelquefois ; celui de Robespierre le rendait grossier, au point que, lorsqu’il parlait de ses supérieurs, des hommes en place et des grands, il ne les appelait jamais que par leur nom, sans le faire précéder du titre usité de Monsieur, que la politesse française ne refuse à personne. C’est sur ce ton d’irrévérence qu’il implore les bienfaits de M. l’évêque d’Arras en le qualifiant tout simplement, l’Évêque, dans la même lettre où il signe sottement lui-même, de Robespierre.
Ce qui nourrit un fol orgueil dans tant de jeunes têtes, et ce qui acheva peut-être de rendre ce vice incurable dans Robespierre, c’est cette facilité perfide que trouve la jeunesse à faire excuser auprès des maîtres sa froideur pour la vertu par ses succès dans les sciences. Qui a goûté le plaisir d’être loué pour les qualités de l’esprit méritera rarement de l’être pour les qualités du cœur, et plus rarement encore pour les vertus de l’âme. Les professeurs de Robespierre, qui ne voyaient le sujet que pendant les classes, et lorsqu’il avait à leur offrir plus de preuves de son application à l’étude que de la bassesse de ses sentiments et de la noirceur de son caractère, le flattaient sans réserve, comme si un jeune homme avait rempli tous ses devoirs lorsqu’il a su disposer des mots et compasser des phrases. Mais aucun de ses maîtres ne contribua autant à développer le virus républicain qui fermentait déjà dans son âme, que son professeur de rhétorique. Admirateur enthousiaste des héros de l’ancienne Rome, M. Hérivaux, que ses disciples, en plaisantant, surnommaient le Romain, trouvait aussi au caractère de Robespierre une sorte de physionomie romaine. Il le louangeait, le cajolait sans cesse, quelquefois même le félicitait très sérieusement sur cette précieuse similitude. Robespierre, non moins sérieusement, savourait les compliments, et se savait gré de porter l’âme quelconque d’un romain, fut-ce l’âme atroce d’un Brutus parricide ou celle d’un Catilina conspirateur.
Cette affection particulière, du maître disposa merveilleusement le disciple à profiter plus longtemps de ses leçons, et à faire sous lui deux années de rhétorique. Ce fut à cette époque que Robespierre obtint une faveur bien signalée, dans une circonstance mémorable, faveur dont il était le sujet le plus indigne sans doute, et qui prête à des rapprochements bien frappants. En 1775, Louis XVI, après la cérémonie de son sacre, fit son entrée solennelle dans Paris, accompagné de la reine et de la famille royale. Leurs majestés, en se rendant de l’église métropolitaine à celle de Sainte-Geneviève, s’arrêtèrent devant le collège de Louis-le-Grand, où elles furent complimentées par l’Université en corps. Ce collège, qui subsistait en grande partie des bienfaits de nos rois, devait aussi un hommage spécial de reconnaissance, à Louis XVI ; et ce fut Robespierre que l’on chargea de le lui offrir au nom de ses condisciples, dans un discours en vers qu’avait composé son professeur. Le roi abaissa un regard de bonté sur ce jeune homme qui, élevé dans sa maison, devait un jour lui porter le premier coup de poignard.
Alors préfet des études dans le même collège, et me trouvant dépositaire de quelques aumônes que faisaient annuellement à Robespierre l’évêque et quelques chanoines d’Arras, je l’avais fait habiller, dit l’abbé Proyart, pour qu’il pût se présenter décemment. Parmi tous les jeunes gens qui étudiaient alors dans ce collège à l’aide d’une pension gratuite appelée bourse, je doute qu’il s’en fût trouvé un second réduit à l’état d’indigence où était le jeune Robespierre, et, s’il m’eût été donné de deviner le monstre dans l’écolier, rien ne m’eût été plus facile que de le museler dès lors, en tarissant le cours des aumônes que je recevais pour lui, ressource sans laquelle il lui eût été impossible de s’entretenir et de continuer ses études… J’attribue à ma déportation d’avoir échappé à ses poignards, car il ne paraît pas qu’il ait pardonné à aucun de ceux à qui il devait quelque reconnaissance.
Robespierre, après s’être distingué pendant sa seconde année de rhétorique, ne brilla pas en philosophie. Ce nouveau genre d’étude le dégoûta beaucoup d’abord, et il y eût volontiers renoncé. Mais, comme l’habitude du travail lui en avait fait un besoin et qu’il était jaloux d’ailleurs de se conserver la réputation de bon écolier, il sut triompher de ses répugnances et se commander la mesure d’application nécessaire pour se mettre à l’abri des reproches. À l’étude de ses cahiers il joignit la lecture des philosophes modernes ; et bientôt les brillants sophismes de ces flatteurs éternels des passions humaines lui parurent plus concluants que les arguments de la morale qui confondait son orgueil. Ce fut cette lecture des livres impies commencée pendant sa philosophie, qui acheva d’éteindre en son cœur tout sentiment honnête, et consomma l’œuvre de sa dépravation. Et ce que nous connaissons positivement de Robespierre, n’avons-nous pas le droit de le conclure de ses complices ? Il faudrait vouloir s’aveugler à plaisir, ou ne savoir ni lire ni observer, pour ne pas convenir que ce fut dans cette, même source des mauvais livres que les factieux puisèrent tous les moyens, dont ils avaient besoin pour déterminer la révolution, française ou pour la prolonger. Aussi les principes des ministres de Louis XV et de Louis XVI sur la circulation des mauvais livres, sans en excepter ceux mêmes qui portaient les coups les plus directs à l’autel et au trône, sont-ils une véritable énigme, ou plutôt un mystère d’aveuglement qui ne trouve sa solution que dans les desseins d’une Providence vengeresse, qui voulait que de grands excès fussent punis par des excès plus grands encore, et que l’autorité, complice de tous les crimes de la presse, en devînt elle-même la terrible victime, pour apprendre une fois encore à tous les rois de la terre, à tous les chefs d’État inattentifs, que le premier de leurs devoirs, comme leur plus grand intérêt, est de s’opposer à la perversion de leurs peuples.
Robespierre se livre à l’étude du droit. – Il revient avec le titre d’avocat. – Son début au barreau. – Il se charge de toutes les mauvaises causes. – Ses mémoires. – Sa vanité, réprimée par l’un de ses confrères. – Il entre à l’académie d’Arras. – Sa dureté envers ses proches. – Son isolement. – Sa basse jalousie.
Après avoir terminé son cours de philosophie, Robespierre se livra à l’étude du droit, qu’il faisait aussi marcher de pair avec la lecture des mauvais livres. Toujours guidé par l’ambition, il n’étudiait le droit que secondairement, aimant mieux cultiver l’éloquence du barreau, qui conduit à la célébrité, que d’en approfondir la science, qui rend l’homme de lois vraiment utile à la société ; il lisait les mémoires curieux, il suivait les causes célèbres, il courait au Palais entendre les plaidoyers d’appareil et portait son jugement sur les plus fameux avocats.
Devenu avocat lui-même, il reparut à Arras avec ce titre pour toute fortune. N’ayant ni feu ni lieu, il trouva un asile chez le médecin marié à sa tante dont nous avons déjà parlé ; et, comme s’il eût été de son essence malfaisante de nuire à tout ce qui lui faisait du bien, on s’aperçut bientôt que son commerce n’était rien moins qu’avantageux à celui qui lui donnait l’hospitalité. Sa bonne tante, qui s’était toujours flattée de trouver un jour en lui, sinon la piété qu’elle professait, du moins la religion de l’honnête homme, cruellement trompée dans son attente, ne se consola jamais, et mourut lente victime des chagrins que lui causaient les inclinations sinistres et surtout l’irréligion d’un neveu que peut-être elle avait trop aimé.
Robespierre, comme tous les jeunes gens présomptueux qui ont vu la capitale et copié ses vices, en était revenu plein de vent et vide des connaissances les plus essentielles à la profession qu’il embrassait. Forcé alors, malgré ses répugnances, de se soumettre aux leçons que voulaient bien lui donner ses confrères, après s’être éclairé de leur expérience et de leurs lumières il s’appliquait à déprécier leurs talents.
Son début au barreau ne répondit nullement aux prétentions fastueuses qu’il affichait. Les premiers pas qu’il fit dans sa nouvelle carrière furent obscurs, et les suivants furent scandaleux. Les pénibles efforts d’éloquence par lesquels il mendiait la faveur publique ne lui réussirent qu’auprès de la foule ignorante et frivole. Son style, âcre et imprégné des affections de son mauvais cœur, révoltait les âmes honnêtes. Il eut beau s’assurer des preneurs, intriguer, faire des visites et des offres de service, son caractère perçait à travers toutes les formes dont il voulait le couvrir, et jamais il ne put atteindre le grand but de son ambition, qui était de s’insinuer dans la confiance des grands et des corps ecclésiastiques de la province ; aussi sut-il dans l’occasion se venger cruellement du mépris qu’ils avaient fait de ses talents. On proposait un jour Robespierre à M. le prince, de Ghistelles comme une tête capable d’occuper une place dans son conseil. Le prince, qui avait lu par hasard quelques mémoires sortis de la plume du jeune avocat, répondit aux porteurs de ses offres : « Vous tenez pour Robespierre, et moi pour mon honneur et mes intérêts. » L’on ne pouvait guère en effet employer un pareil agent sans compromettre la meilleure cause.
Cependant Robespierre n’avait de moyens de subsistance que dans son travail, et son orgueil souffrait infiniment d’être toujours à la charge d’étrangers qui ne lui devaient rien. Dans le désespoir de faire agréer ses services aux gens de bien et à quiconque avait une bonne cause ou de grands intérêts à défendre, il se dévoua à tous les genres de bassesses auxquelles peut descendre la profession d’avocat. Il était le conseil de l’injustice, il accueillait les plaideurs de mauvaise foi et se faisait le patron bénévole des causes honteuses dont ses confrères ne voulaient pas souiller leur cabinet. Son cœur gâté trouvait une si agréable pâture en remuant ces sortes d’affaires, que, si on ne lui en apportait pas, il en imaginait à plaisir, qu’il traitait dans des mémoires subversifs de la morale et de l’honnêteté publiques. Aussi écrivit-il contre l’indissolubilité du mariage et pour légitimer le crime politique et religieux du divorce. Ainsi s’érigea-t-il en patron de la licence des mœurs, jusqu’au point de vouloir autoriser en quelque sorte la pluralité des femmes, et de prétendre que le bâtard, même adultérin, devait être admis avec les enfants légitimes au partage des biens de ses auteurs. Contre tous les sages législateurs qui ont cru qu’on ne pouvait accorder trop de respect à l’opinion publique, cette puissante maîtresse des mœurs, qui en maintes occasions supplée dans l’homme vicieux la loi et la conscience, Robespierre eût voulu détruire son empire. Il ne lui pardonnait pas surtout d’attacher de la honte à la mémoire des suppliciés, et, comme s’il eût prévu qu’il dût l’être un jour lui-même, il dénonça à son siècle comme le plus injuste des préjugés un sentiment qui sans doute ne doit pas être exagéré, mais un sentiment pourtant que l’auteur même de la nature a gravé dans nos cœurs : sentiment vraiment précieux pour la société, puisque cette espèce de solidarité devant le tribunal de l’opinion tient les yeux d’une famille entière ouverts sur les déportements d’un sujet vicieux, et que ce sujet lui-même, qu’aucune autre considération n’arrêterait, est souvent contenu par la crainte de flétrir sa race d’un opprobre héréditaire.





























