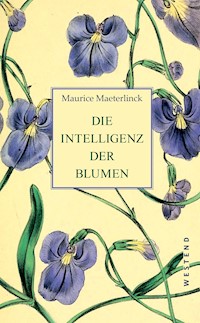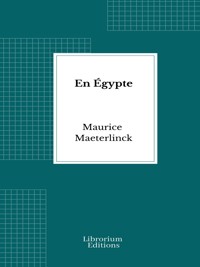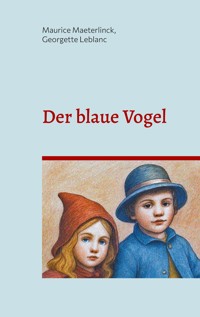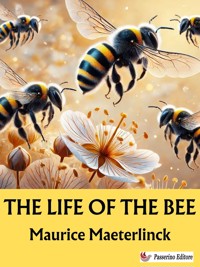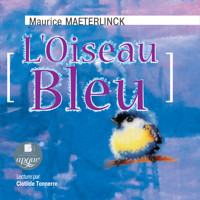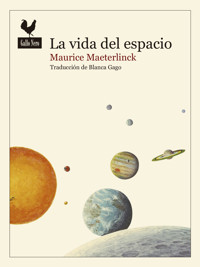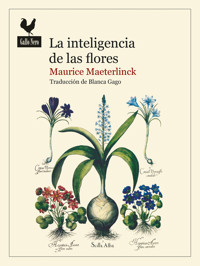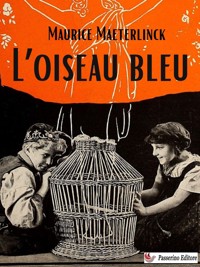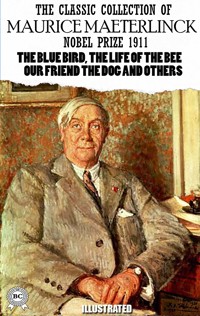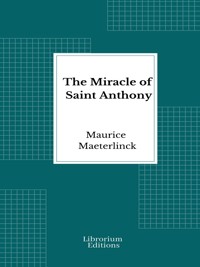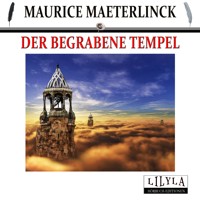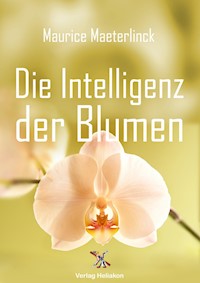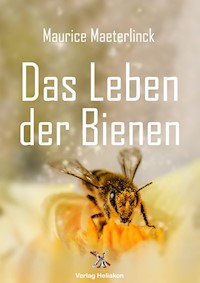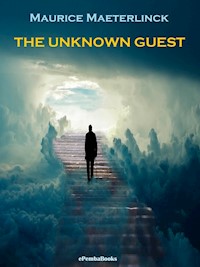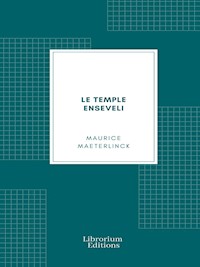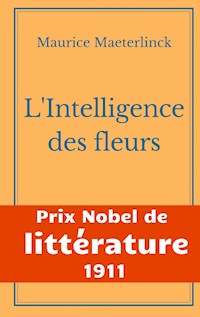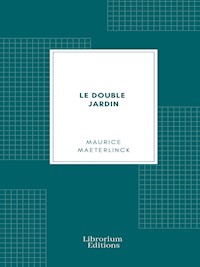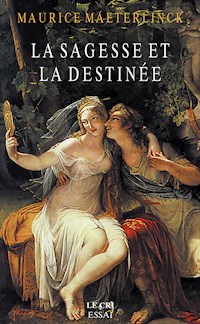0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
De quoi est faite la vie des fourmis? Langage antennal, fourmis fongicoles qui cultivent des champignons pour nourrir leur colonie, fourmis qui savent éteindre des feux, fourmis parasites, Maeterlinck nous présente de nombreuses observations et suppositions. Il pose des questions et surtout réfléchit à la société des fourmis et la compare avec celle des hommes. Il parle de démocratie, d’anarchie organisée, d’intelligence, de morale: des termes très humains qu’il se plaît à appliquer aux fourmis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Maurice Maeterlinck
LA VIE DES FOURMIS
INTRODUCTION
I
On m’a plus d’une fois demandé pourquoi je ne complétais pas le triptyque des insectes sociaux dont les deux premiers volets, La Vie des Abeilles et La Vie des Termites avaient été favorablement accueillis. J’ai longtemps hésité. Je croyais la fourmi antipathique, ingrate et trop connue. Il me semblait assez inutile de répéter à propos de son intelligence, de son industrie, de sa diligence, de son avarice, de sa prévoyance, de sa politique, des notions qui font partie du patrimoine commun que nous acquérons dès l’école primaire et qui traînent dans toutes les mémoires parmi les débris de la bataille des Thermopyles ou de la prise de Jéricho.
Ayant toujours vécu à la campagne beaucoup plus qu’à la ville, je m’étais naturellement intéressé à cet insecte inévitable. À l’occasion, je l’avais même enfermé dans des boîtes vitrées et, sans but et sans méthode, y avais observé ses allées et venues affairées, qui ne m’apprenaient pas grand’chose.
Depuis, revenant sur mes pas, je me suis rendu compte qu’à son sujet, comme au sujet de n’importe quoi sur cette terre, en croyant tout savoir nous ne savons presque rien et que le peu que nous apprenons nous montre d’abord tout ce qu’il nous reste à apprendre.
Il nous montre surtout les difficultés de la tâche. La ruche ou la termitière forme un bloc dont on peut faire le tour. Il existe une ruche, une termitière, une abeille, un termite types ; au lieu qu’il y a autant de fourmilières que d’espèces de fourmis, autant de mœurs différentes que d’espèces. On ne tient jamais son objet, on ne sait par quel bout le prendre. La matière est trop riche, trop vaste, elle se ramifie sans cesse et l’intérêt s’égare et se disperse dans toutes les directions. Aucune unité n’est possible ; il n’y a pas de centre. On n’écrit pas l’histoire d’une famille ou d’une ville, mais les annales ou plutôt les éphémérides de cent peuples divers.
Ajoutez que dès les premiers pas, on risque de perdre pied dans la littérature myrmécophile. Elle est aussi abondante que la littérature apicole qui compte, au bureau entomologique de Washington, plus de vingt mille fiches. L’index bibliographique que donne Wheeler à la fin de son volume intitulé : Ants, couvrirait cent trente pages de ce livre. Il est loin d’être complet et ne mentionne pas les publications de ces vingt dernières années.
II
Il faut donc se borner et se laisser guider par les chefs de files. Sans nous attarder aux précurseurs Aristote, Pline, Aldrovandi, Swammerdam, Linnée, William Gould, De Geer et quelques autres, arrêtons-nous un instant devant celui qui est le véritable père de la myrmécologie : René-Antoine Ferchault de Réaumur.
Il en est le père, mais c’est un père que ses enfants n’ont pas connu. Le brouillon de son Histoire des Fourmis, enseveli parmi ses derniers manuscrits, avait été signalé par Flourens, en 1860, et depuis complètement oublié. Le grand myrmécologue américain, W.-M. Wheeler, le redécouvrit en 1925 et l’année suivante en publia, à New-York, le texte français accompagné de notes et d’une traduction. Cette histoire n’a donc exercé aucune influence sur les entomologistes du siècle dernier, mais elle mérite d’être signalée parce qu’elle peut se lire avec fruit et non sans agrément, car Réaumur qui avait trente-deux ans à la mort de Louis XIV, écrit encore la langue de la bonne époque. On y trouve en germe, et souvent mieux qu’en germe, c’est-à-dire presque à l’état parfait, un certain nombre d’observations qu’on croyait d’avant-hier. Ce petit traité, d’ailleurs inachevé et qui ne compte qu’une centaine de pages, renouvelle ou plutôt instaure la myrmécologie telle qu’on l’entend aujourd’hui.
Il commence par détruire une foule de légendes et de préjugés qui depuis Salomon, Saint Jérôme et le moyen âge embroussaillaient les abords de la fourmilière. Avant tout autre il a l’idée d’observer les fourmis dans ce qu’il appelle des « poudriers », qui étaient, comme il les définit, « des bouteilles de verre telles que celles des cabinets des curieux, dont l’ouverture a presque autant de diamètre que le fond », inaugurant ainsi les nids artificiels qui depuis ont rendu tant de services aux entomologistes. Il constate que la fourmi, comme l’expérience l’a confirmé, peut vivre près d’un an sans nourriture, dans de la terre humide. Il comprend l’importance et la signification du vol nuptial et le premier explique pourquoi les femelles ont des ailes qu’elles perdent subitement après l’hymen, alors qu’on était convaincu qu’elles ne leur poussaient que dans la vieillesse, en guise de consolation, afin qu’elles pussent mourir avec plus de dignité. Précédant W. Gould, il note la manière dont une reine fécondée fonde une colonie. Il s’occupe de la ponte des œufs et entrevoit l’endosmose qui donne la clef de l’inexplicable énigme de leur croissance. Il décrit de quelle façon la larve ou la nymphe commence son cocon dont l’étoffe, comme il le fait remarquer, « faite de plusieurs couches de fils collés les uns contre les autres, est si serrée qu’on la prendroit pour une membrane si on ne sçavoit pas comment elle a été travaillée ». Il n’omet pas la régurgitation, qui est, nous le verrons plus loin, l’acte essentiel et fondamental de la fourmilière. Il a même l’intuition des phototropismes qui jouent un rôle si important dans les premières manifestations de la vie ; et après quelques erreurs vénielles, il n’en commet qu’une assez grave : il confond les fourmis avec les termites ; mais cette confusion était alors presque inévitable et la distinction ne fut définitivement établie qu’à la fin du dix-huitième siècle.
III
Négligeons, à regret, mais il faut abréger, des entomologistes intermédiaires. Leuwenhœck qui s’occupa des transformations, Latreille qui ébaucha les premières classifications, Charles Bonnet, le grand naturaliste philosophe, qui décela la parthénogénèse des pucerons, bétail des fourmis, et plusieurs autres, pour pénétrer tout de suite et de plain-pied dans la myrmécologie contemporaine.
Dès l’entrée saluons Pierre Huber, fils de François, le révélateur des abeilles et tous deux, citoyens de Genève. Leur compatriote, Auguste Forel, qui s’y connaît, puisqu’il est avec Wasmann, Wheeler, Emery et quelques autres, l’un des grands myrmécologues d’aujourd’hui, déclare que Les Recherches sur les Mœurs des Fourmis indigènes, de Pierre Huber, publiées en 1810, sont la Bible de la Myrmécologie. Il n’exagère pas ; c’est une œuvre dont la prolixité charmante a seule un peu vieilli. Elle eut à son apparition un grand retentissement et fut vivement attaquée, mais ses observations minutieuses et presque paternelles sur les Noires, cendrées, les Mineuses, les Amazones qui de son temps portaient des noms familiers et sont devenues les Pratensis, les Rufibarbis et les Polyergus Rufescens de la science, ont résisté à plus d’un siècle de contrôle et n’ont pas été prises en défaut. Il part du reste d’un excellent principe qu’il n’a jamais perdu de vue et qui est devenu la règle fondamentale de l’entomologie. « Plus les merveilles de la nature ont d’attrait pour moi, nous dit-il, moins je suis enclin à les altérer par le mélange des rêveries de l’imagination. »
Si, d’après Forel, Les Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes sont la Bible, Les Fourmis de la Suisse, de Forel, sont la Somme de la myrmécologie. La deuxième édition notamment, parue en 1920, forme la véritable encyclopédie de la fourmi, où rien n’est laissé dans l’ombre, mais qui a les défauts de ses qualités, c’est-à-dire qu’elle est trop touffue, que la multitude des arbres empêche de voir la forêt et qu’on finit par s’y perdre. Du reste rien n’égale la sûreté, l’exactitude de ses observations, l’étendue et la loyauté de son érudition. Il n’est guère possible de parler de la fourmi sans lui devoir le tiers de ce qu’on en dit. Il est vrai que lui-même doit à d’autres spécialistes les deux tiers de ce qu’il nous apprend. C’est ainsi que marche la science qui déborde de toutes parts les jours trop courts de l’homme ; ou, si vous le préférez, c’est ainsi que marche l’histoire, car la myrmécologie n’est au fond que l’histoire d’une peuplade insolite. Comme toute histoire, il faut souvent la reprendre, la remettre au point, et dix existences humaines bout à bout ne suffiraient pas à réunir les observations que nous possédons aujourd’hui et qui sont le fruit de près de deux siècles de travail. Il s’agit de tirer de ces petits faits innombrables, en apparence hétéroclites et incohérents, une signification, une idée générale. Il est plus facile de le tenter que d’y réussir.
Après Forel, nous avons Wasmann, un jésuite allemand dont le nom revient à chaque page de la myrmécologie. Il s’est attaché surtout aux races esclavagistes et a consacré trente ans à l’étude, effarante comme nous le verrons plus loin, des parasites de la fourmilière. C’est un observateur admirable, d’une patience, d’une lucidité exemplaires.
La simple nomenclature de ses livres, de ses brochures et de ses articles de revues prendrait une douzaine de pages de ce volume. Regrettons seulement qu’aux instants où les explications deviennent difficiles, le théologien ou le casuiste se superpose au savant et s’efforce d’excuser ou de glorifier un Dieu qui trop manifestement est celui de son ordre.
Avec William-Morton Wheeler, professeur d’entomologie à l’université d’Harvard, ce n’est plus la théologie mais la pensée humaine qui se mêle à la science purement objective et qui la vivifie. Wheeler, en effet, est non seulement un observateur aussi scrupuleux, aussi fécond que Forel et Wasmann, c’est en outre un esprit qui voit plus loin et plus profondément et sait tirer de ce qu’il a vu des réflexions et des idées générales qui ont plus d’envergure que celles de ses collègues.
Il faut mentionner encore l’ingénieur Charles Janet, dont les innombrables études, recherches, communications, monographies, précises, nettes, impeccables et ornées de planches anatomiques devenues classiques, n’ont cessé, depuis près de cinquante ans, d’enrichir la myrmécologie comme bien d’autres sciences. C’est un de ces grands travailleurs auxquels on ne rend justice qu’après leur mort.
Il ne faut pas non plus oublier l’Italien C. Emery, le grand classificateur qui s’est consacré au travail ingrat, aride, mais nécessaire qui consiste à établir le signalement détaillé et technique, la fiche myrmécologique, si l’on peut dire, de la plupart des fourmis afin qu’on puisse les identifier sans erreur. Il est probable que de bonnes photographies en couleur, avec agrandissements, remplaceront peu à peu ces signalements qui sont aussi décevants que ceux des passeports. D’autres spécialistes, notamment Bondroit et Ernest André, se sont imposé la même tâche. Ernest André est en outre l’auteur de la seule monographie vulgarisatrice et accessible que nous possédons. Malheureusement, elle date quelque peu, puisqu’elle remonte à près d’un demi-siècle, c’est-à-dire à un moment où Forel venait à peine de donner sa première version des Fourmis de la Suisse, et où Wasmann et Wheeler commençaient leurs travaux. Il ignore, entre autres, les fourmis champignonnistes qu’on appelait alors les Coupeuses de feuilles, parce qu’on croyait qu’elles se bornaient à les découper pour en tapisser leurs galeries. Il ignore également les extraordinaires fourmis à navettes, les dernières observations sur les Dorylines Visiteuses, les expériences les plus intéressantes sur le sens olfactif et sur l’orientation, la façon tragique dont se fonde une colonie, etc. D’autre part, il accueille peut-être trop facilement, bien qu’avec des réserves, certaines fantaisies attendrissantes sur les cimetières de nos hyménoptères fouisseurs, sur leur culte des morts, les cortèges funèbres, les enterrements de première classe, les concessions à perpétuité, etc. ; alors qu’ils se bornent à se débarrasser promptement des cadavres qu’ils portent hors du nid et qu’ils ont le tact de ne pas dévorer comme les termites, probablement parce qu’ils ne pourraient pas les digérer.
IV
Mais bornons ici une énumération qui deviendrait fastidieuse. Les autres noms défileront au cours des pages qui vont suivre et on les retrouvera à la fin du volume, dans une bibliographie forcément succincte pour ne pas devenir encombrante, mais comprenant tout l’essentiel.
On se dira peut-être que des centaines d’hommes qui n’étaient pas les premiers venus et auraient pu faire tant d’autres choses plus profitables, ont perdu beaucoup de temps et se sont donné bien du mal pour tâcher d’éclairer l’existence et de pénétrer les minuscules secrets de fort petites bêtes. Mais il n’y a grand ni petit quand il s’agit des mystères de la vie. Tout est sur le même plan, tout a même hauteur et l’astronome travaille au même niveau et dans la même matière que l’entomologiste.
Il n’existe point de hiérarchie dans les sciences et la myrmécologie en est une et qui serre de plus près que bien d’autres les plus subtils contours des plus tragiques, de plus désespérants problèmes. D’un certain point de vue, la plus misérable fourmilière, raccourci de nos propres destins, est plus intéressante que le plus formidable amas globulaire des nébuleuses extra-galactiques où grouillent des millions de mondes, des milliers de fois plus énormes que notre soleil. Elle nous aidera peut-être plus vite et plus efficacement à démêler la pensée et l’arrière-pensée de la Nature et certains de ses secrets qui sur la terre et dans les cieux sont partout identiques.
Afin de nous intéresser comme il est juste et nécessaire, à des vies qui ne sont pas à notre échelle, supposons qu’il s’agisse de l’histoire d’une race préhumaine qui aurait passé sur la terre quelques milliers ou millions d’années avant notre arrivée. Rien ne nous dit qu’il n’y en ait pas eu, comme rien ne nous affirme que ne surgira pas une race post-humaine, quelques milliers ou millions d’années après notre départ. Dans l’infini du temps, le passé et l’avenir sont interchangeables.
NOTIONS GÉNÉRALES
I
Récapitulons d’abord, le plus rapidement possible, quelques notions élémentaires qu’il est bon de remettre en mémoire. Les fourmis sont des hyménoptères aculéates, fouisseurs, vivant en société. On en a décrit à ce jour six mille espèces qui toutes ont leurs mœurs, leurs caractères particuliers. Il est du reste probable qu’on doublera ce nombre dans une classification moins routinière. Mais nous n’entrerons pas dans le maquis de ces classifications entomologiques en genres, sous-genres, espèces, races ou sous-espèces, variétés, familles, sous-familles, sections, tribus, sous-tribus, qui nous entraîneraient trop loin et n’ont du reste aucun intérêt. Contentons-nous, suivant Wheeler, de les diviser en huit séries principales, savoir : les Dorylinæ, les Cerapachyinæ, les Ponerinæ, les Leptanillinæ, les Pseudomyrminæ, les Myrmicinæ, les Dolichoderinæ et les Formicinæ. Les Myrmicinæ et les Formicinæ seules sont cosmopolites ; toutes les autres sont tropicales ou subtropicales. Les ancêtres communes semblent être les Ponerinæ.
Au demeurant, ces nomenclatures qui souvent, comme celles de Forel et d’Emery, sont beaucoup plus compliquées, n’intéressent que les techniciens de la myrmécologie.
Les fourmis et les termites sont par excellence des insectes sociaux. Les abeilles, contrairement à ce qu’on croit, ne sont qu’exceptionnellement sociales. On compte en effet dix mille espèces d’abeilles, dont cinq cents seulement vivent en société, au lieu qu’on ne trouve pas un seul termite ou une seule fourmi solitaire.
Au rebours des termites confinés dans les pays chauds, les fourmis ont envahi à peu près toutes les parties habitables du globe, l’extrême nord et les grandes altitudes exceptés. Géologiquement elles semblent postérieures aux termites dont les aïeux sont les Blattoïdés, animaux encore solitaires, appartenant au Crétacé, c’est-à-dire à l’ère secondaire, descendant eux-mêmes d’ancêtres d’ailleurs hypothétiques, les Proto-blattoïdés, qui vivaient probablement dans le Permien, partie supérieure de la formation de l’ère primaire.
II
Les fourmis sont les insectes les plus abondants dans les dépôts tertiaires. On en trouve dans l’Éocène, le plus ancien de ces dépôts. Elles y sont, il est vrai, assez rares. En revanche, le nombre des fourmis Oligocènes et Miocènes est considérable. Onze mille sept cent onze spécimens recueillis dans l’ambre de la Baltique ont été examinés, ainsi que des centaines d’autres trouvés dans l’ambre sicilien qui appartient au Miocène moyen. Mais voici la constatation la plus déconcertante : au rebours de ce qu’on attendait, on remarque que les fourmis les plus anciennes ne sont pas plus primitives que celles qu’on rencontre dans l’ambre fossile, et que ces dernières, malgré les millions d’années qui les séparent, sont presque aussi spécialisées, aussi civilisées que nos formes présentes. « Plusieurs d’entre elles, nous dit Wheeler, avaient appris à visiter les pucerons, étaient en conséquence « trophobiotiques », comme le montre un bloc d’ambre de la collection de Kœnigsberg, contenant un certain nombre d’ouvrières d’Iridomyrmex Gœpperli, mélangées à un lot de pupilles pucerons. On peut difficilement douter que les fourmis de l’ambre eussent des myrmécophiles dans leurs nids, puisque Klebs mentionne dans sa liste des coléoptères de l’ambre, trois genres de Paussidae. » Et les Paussidae sont, avec les Clavigers, les parasites les plus dangereux qui rendent éthéromanes les ouvrières des nids où ils élisent domicile.
Or, l’élevage du bétail et l’entretien des parasites, surtout des coléoptères de luxe, marquent, comme nous le verrons, le point culminant de leur civilisation actuelle. Quelles conclusions ? De bien étranges si l’on veut, par exemple, que l’évolution est moins prouvée, moins certaine qu’on ne l’affirme, que le progrès n’est qu’une illusion, que toutes les espèces, avec leurs divers degrés de civilisation, datent du même moment et furent, comme le dit la Bible, créées le même jour, que par conséquent la tradition est plus près de la vérité que la science. Remarquons en passant que l’universelle dissémination des termites et des fourmis que l’on rencontre sur toutes les terres des nouveaux comme des anciens mondes, nous rapproche également d’une autre tradition, plus ou moins secrète et antérieure à la Bible, qui prétend que toute civilisation descend des régions boréales et nous parle du pont antarctique, aussi chaud que l’équateur, par lequel communiquaient tous les continents.
Mais sans rien hasarder, sans aller si loin, on peut très raisonnablement soutenir que notre insecte est prodigieusement plus ancien que les plus anciens spécimens géologiques. Il faudrait remonter beaucoup plus haut, jusqu’à des centaines, voire des milliers de millions d’années dans l’effroi du temps, jusqu’au Précrétacé, jusqu’à la fin du Permien qui se caractérise par une température élevée et une grande aridité. Mais à partir du Mésozoïque, dans l’ère secondaire, les fossiles font défaut.
On pourrait encore soutenir que toute évolution est des milliers de fois plus lente que nous ne nous l’imaginons ; si incroyablement lente qu’elle arrivera trop tard, et qu’avant d’atteindre son but, en admettant que quelque chose puisse avoir un but, notre terre aura vraisemblablement disparu.
Néanmoins, selon quelques myrmécologues, notamment selon Wheeler, on découvre une évolution très plausible, dont on suit les traces d’espèce en espèce. D’après eux, les fourmis, poussées par diverses circonstances, auraient passé de la vie terricole, qui était leur vie primitive, à la vie arboricole, et du régime entomophage, où elles étaient avant tout prédatrices et ne se nourrissaient que de la chair d’autres insectes, au régime aphidicole, c’est-à-dire pastoral, et ensuite fongicole, c’est-à-dire agricole et végétarien. Cette évolution qui d’ailleurs n’est pas irréfutablement établie, et dont toutes les étapes coexistent aujourd’hui, ressemblerait étrangement à celle de l’homme, successivement chasseur, pasteur et agriculteur. On y retrouverait également les trois stades de l’histoire humaine reconnus par Auguste Comte, à savoir la conquête, la défense et l’industrie. Il y a là, assurément, de curieuses coïncidences.
III
La population de la fourmilière se compose de reines ou femelles fécondées qui vivent une douzaine d’années, d’innombrables légions d’ouvriers ou ouvrières, sans sexe, qui, moins surmenées que les abeilles, vivent trois ou quatre ans, et de quelques centaines de mâles qui disparaissent au bout de cinq ou six semaines, car dans le monde des insectes, le mâle est presque toujours sacrifié.
Les femelles et les mâles seuls possèdent des ailes que du reste ils s’arrachent après le vol nuptial. Il n’y a pas, comme chez les abeilles et les termites, une reine ou mère unique, mais autant de pondeuses que le juge nécessaire le conseil secret qui préside aux destinées de la république myrmécéenne. Dans les petites fourmilières on en compte deux ou trois, dans les grandes une cinquantaine et dans les nids confédérés leur nombre est indéterminé.
Nous retrouvons ici le grand problème de la ruche et de la termitière. Qui règne et qui gouverne dans la cité ? Où se cache la tête ou l’esprit, d’où émanent des ordres qui ne sont jamais discutés ? Le concert est aussi indubitable, aussi admirable que dans les autres groupes et doit être plus difficile, car la vie des fourmis est, en général, beaucoup plus complexe, plus imprévue et plus aventureuse. En attendant mieux, l’explication la plus admissible est peut-être celle que je propose dans La Vie des Termites, à savoir que la fourmilière devrait être considérée comme un individu dont les cellules, au rebours de celles de notre corps qui en compte environ soixante trillions, ne seraient plus agglomérées mais dissociées, disséminées, extériorisées, tout en restant soumises, malgré leur apparente indépendance, à la même loi centrale. Il est également possible qu’on y découvre quelque jour tout un réseau de relations électromagnétiques, éthériques ou psychiques dont nous n’avons jusqu’ici qu’une très vague idée.
Table des matières
INTRODUCTION
I
II
III
IV
NOTIONS GÉNÉRALES
I
II
III
IV
V
VI
VII
LE SECRET DE LA FOURMILIÈRE
I
II
III
IV
V
LA FONDATION DE LA CITÉ
I
II
III
IV
V
LES NIDS
I
II
III
IV
V
VI
LES GUERRES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
COMMUNICATIONS ET ORIENTATION
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
PASTORALES
I
II
III
IV
LES CHAMPIGNONNISTES
I
II
III
IV
V
VI
FOURMIS AGRICOLES
I
II
III
IV LES FILANDIÈRES
V
VI FOURMIS-RÉSERVOIRS
VII
VIII
IX
LES PARASITES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ÉPILOGUE
I
II
III
IV
V
VI
VII
BIBLIOGRAPHIE
Guide
Couverture