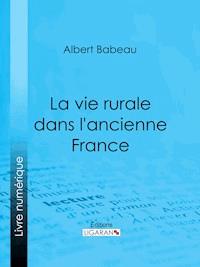
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"""La vie rurale dans l'ancienne France"" de Albert Babeau est un ouvrage captivant qui nous plonge au cœur de la campagne française du passé. À travers une analyse minutieuse et documentée, l'auteur nous dévoile les multiples facettes de la vie quotidienne des habitants des villages et des fermes de l'ancienne France.En explorant les différentes régions du pays, Babeau nous transporte dans un voyage temporel où nous découvrons les traditions, les coutumes et les métiers qui rythmaient la vie des ruraux. De l'agriculture à l'artisanat, en passant par la religion et les fêtes populaires, l'auteur nous offre un panorama complet de cette époque révolue.Mais au-delà de la simple description des activités rurales, ""La vie rurale dans l'ancienne France"" nous invite également à réfléchir sur l'évolution de notre société. En comparant le mode de vie d'autrefois avec celui d'aujourd'hui, l'auteur souligne les changements profonds qui ont marqué nos campagnes et met en lumière les enjeux auxquels elles sont confrontées.
Avec une plume fluide et passionnée, Albert Babeau nous offre un véritable voyage dans le temps, nous permettant de mieux comprendre et apprécier l'héritage rural de notre pays. Que vous soyez passionné d'histoire, curieux de découvrir les traditions d'antan ou simplement en quête d'une lecture enrichissante, ce livre saura vous captiver et vous émerveiller.
Extrait : ""On peut juger de l'aisance, des mœurs, des occupations d'un peuple par la nature de son habitation..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre a pour but de faire connaître la vie privée des habitants des campagnes, dont nous avons étudié la vie publique dans le Village sous l’ancien régime ; il peut en être regardé comme la suite et le complément.
À côté de l’histoire de ceux qui dirigent les hommes, il en est une moins importante par ses actes et ses résultats, mais non moins digne d’attention ; c’est celle des hommes qui sont dirigés. Les guerres, les traités, les révolutions, les lois ont une influence profonde sur le sort de ces derniers ; mais ils n’en existent pas moins par eux-mêmes en dehors des évènements dont ils subissent les conséquences, avec leurs qualités morales et physiques, leurs passions héréditaires ou propres, leur aptitude au travail et au progrès. L’histoire politique a besoin d’être complétée par celle que le publiciste anglais Herbert Spencer appelle l’histoire naturelle de la société. Décrire l’habitation, le vêtement, l’alimentation, les habitudes, les mœurs, les plaisirs, les diverses conditions du travail et du loisir ; pénétrer dans la vie journalière et réelle, en n’oubliant pas l’étude du caractère, du sentiment religieux et du développement intellectuel ; étudier ces manifestations diverses chez les habitants des campagnes de France dans les trois derniers siècles, n’est-ce pas une tâche qui vaut la peine d’être tentée ?
Tâche ardue, dont on ne saurait se dissimuler les difficultés. La lumière de l’histoire n’éclaire d’ordinaire que les sommets, laissant dans l’ombre les profondeurs où le travail s’abrite. Le rayonnement de Versailles empêche de voir, à partir de Louis XIV, le reste de la France. Sur Versailles et la Cour, les mémoires et les documents abondent ; les historiographes en ont retracé les plus petits évènements, et les moindres gestes des princes et des ministres ont été relevés, décrits et commentés. On peut arriver aussi à connaître la vie administrative des provinces et des villes, en fouillant les archives, en allant chercher les histoires locales dans l’oubli qui les enveloppe trop rapidement ; mais la vie intime, la vie de famille, surtout celle des petits et des humbles, n’a point d’historiographes, n’a point d’archives. Si l’on ouvre les histoires des villages, on y lit la plupart du temps la généalogie des seigneurs qui les ont possédés, et s’il y avait une abbaye, la description de cette abbaye et la liste de ses abbés ; sur les paysans, presque rien ; la mention de quelques procès soutenus par la communauté, la nomenclature de quelques syndics, la quotité des impôts royaux et des charges seigneuriales. Rien de plus ; la vie matérielle et morale a échappé aux recherches, tant les documents écrits sont rares, tant les traditions locales disparaissent rapidement !
On peut cependant trouver de précieuses indications sur la vie matérielle du paysan, et particulièrement sur son logement, son mobilier, son vêtement, son train de culture, dans les nombreux inventaires qui furent dressés après les décès des parents, pour sauvegarder les intérêts des mineurs. Au premier abord, rien de plus aride et de plus monotone que ces inventaires, dont il m’est passé sous les yeux des milliers ; mais bientôt de ces paperasses rédigées dans le style le plus plat, avec l’orthographe la plus irrégulière, on voit se dégager des images précises, et peu à peu les objets revêtent une forme et une couleur qui saisissent l’imagination. Nous revoyons le paysan, au coin de son foyer, au milieu de ses meubles, avec les vêtements qu’il portait les jours de fête et de travail ; nous parcourons les diverses pièces de sa maison, ses étables, ses dépendances ; certains ustensiles, certains meubles nous révèlent ses habitudes et ses mœurs. Il y a pour le chercheur des moments qui le dédommagent de bien des heures de travail ingrat ; ce sont ceux où du milieu de textes fastidieux il croit voir la vie du passé renaître à ses yeux.
C’est surtout la vie matérielle que l’on trouve dans les inventaires ; il n’en ressort que de rares lumières sur la vie morale, et ces lumières ont besoin d’être renforcées par celles que fournissent les mémoires locaux, les récits de voyage, les écrits des publicistes et des littérateurs contemporains. Que de difficultés aussi pour dégager les traits généraux de la diversité que présentent les mœurs et les conditions, selon les époques et les régions ! Plus encore que maintenant, il y avait des différences tranchées entre l’homme du nord et celui du midi, entre le cultivateur des plaines et le montagnard. L’aisance qu’on signale chez l’un n’existe pas toujours chez l’autre ; la détresse qu’on rencontre à certaines époques cesse ou s’atténue sous l’empire de circonstances meilleures. J’ai trouvé de nombreux témoignages de prospérité dans une province, dont la pauvreté était proverbiale sous l’ancien régime. Généralement on juge du sort des paysans de l’ancienne France d’après quelques textes ; cinq ou six citations de La Bruyère, de Saint-Simon, de René d’Argenson, de Massillon, suffisent pour les représenter comme les plus misérables des hommes ; grâce à ces citations, que l’on ne contrôle point par d’autres témoignages, on se forme à l’égard des campagnards français du siècle dernier des idées analogues à celles que les Anglais s’en faisaient à la même époque. « Que de singuliers préjugés nous nous formons à l’égard des étrangers », écrivait un agronome anglais en arrivant en France au mois de juillet 1789. « J’avoue que je pensais que les Français avaient une apparence chétive et qu’ils vivaient dans la misère par suite de l’oppression que leur faisaient subir leurs supérieurs. Tout ce que nous avons vu contredit cette opinion. » L’agronome anglais n’avait pas tout vu. La misère est de tous les temps ; elle tient trop souvent à la condition précaire des laboureurs, malgré les modifications plus ou moins lentes, mais incessantes, que leur état social éprouve. Le paysan de l’ancien régime n’est plus le serf du Moyen Âge ; il n’est pas encore le citoyen d’un État démocratique. Sa personne est libre, si elle est soumise à l’autorité royale et seigneuriale ; sa propriété est assurée, si elle est grevée de certaines redevances ; il y a chez lui des traces du passé et des germes d’avenir. Mais alors comme au Moyen Âge, alors comme aujourd’hui, l’homme des champs, exposé à la chaleur comme au hâle, présente cet aspect noir, livide et tout brûlé du soleil, dont parle La Bruyère ; à toutes les époques, il est pressé par l’aiguillon de la nécessité, sans lequel l’homme ne saurait s’astreindre aux plus rudes travaux. Dans tous les siècles, il s’est trouvé des écrivains pour plaindre ou pour louer son sort. À la laideur physique que lui prête La Bruyère, Balzac a de nos jours ajouté la laideur morale ; George Sand l’a peint sous des couleurs plus brillantes, mais non moins flatteuses que celles dont s’est servi Berquin. La vérité cependant ne se trouve ni dans l’idylle, ni dans le drame, et la vie des paysans d’autrefois n’est pas telle à coup sûr que l’ont présentée beaucoup d’écrivains, sous l’empire de sentiments étrangers à la critique historique. La diatribe est aussi blâmable que le panégyrique. On peut même ajouter que ceux qui ravalent le passé dans le but politique d’exalter le présent, ressemblent à ces fils malappris qui se complaisent à mettre en relief les défauts de leurs pères, afin de mieux faire valoir leurs propres qualités. N’éprouverait-on pas un sentiment plus fier et plus patriotique à penser que les hommes de la vieille France n’étaient pas irrémédiablement voués à la servitude et à la misère, et qu’ils ont eu, dans des proportions notables, leur part d’aisance, d’indépendance et de bonheur ?
Dans tous les cas, l’histoire ne doit pas réunir des faits pour arriver à des conclusions préconçues ; elle doit laisser les conclusions se dégager des faits qu’elle réunit. Nous sommes loin de croire que nous avons rassemblé tous les témoignages qui se rapportent au sujet ; le lecteur jugera si les traits qu’il nous a été possible de réunir suffisent à donner au tableau que nous esquissons le degré de vérité relative, qui doit être l’ambition de l’historien. La vérité absolue n’existe en histoire que pour les dates et les grands évènements ; elle ne peut être atteinte pour les détails des faits, des mœurs et des passions. L’exactitude de la ressemblance historique dépend du temps où vit l’écrivain, du point de vue où il est placé ; une même statue, copiée par plusieurs dessinateurs, sera reproduite différemment, selon la position qu’occupent les copistes, selon la direction de la lumière et des ombres ; pour les uns l’aspect sera plus favorable, pour les autres défectueux. La vérité dépend aussi de la nature des documents que l’on rencontre ; car il est aussi difficile pour un historien que pour un juge de recueillir sans exception tous les témoignages à charge et à décharge qui existent ; il est impossible de décrire le passé d’une manière parfaite, lorsque le présent même échappe à des investigations complètes ; mais s’il faut renoncer à la vérité absolue, il en est une qui peut être saisie par les hommes de bonne foi, qui la cherchent sans parti pris, en invoquant les témoignages à leur portée, en les reproduisant, en les contrôlant les uns par les autres, en ne se laissant entraîner ni par l’engouement ni par le blâme systématiques. Poursuivre la plus grande part de vérité accessible à l’historien a toujours été le but de celui qui écrit ces lignes ; ce sera sa plus haute récompense, si l’on juge qu’il l’a atteint.
On peut juger de l’aisance, des mœurs, des occupations d’un peuple par la nature de son habitation. La tente du nomade indique une civilisation toute autre que la maison du laboureur attaché au sol ; la demeure du citadin est différente de celle du campagnard. Pour le premier, elle est un atelier ; pour le second, elle est un abri. L’artisan ou le marchand passe ses journées dans sa demeure, le paysan n’y rentre que la nuit. Tandis que le premier consacre une partie de ses épargnes à embellir la façade de la maison dans laquelle il travaille, le second les emploie toutes à agrandir les champs qu’il cultive ; le premier est fier de son pignon sur rue, le second de ses biens au soleil.
Les habitations rurales, en effet, ne se distinguent point par leur architecture. L’architecture est l’apanage de la richesse, et si le paysan, dans notre histoire, n’a pas toujours été malheureux, il a rarement été riche. Il n’y a d’architecture à la campagne que dans les églises et les châteaux ; il n’y en a point dans les chaumières ; il y en a rarement dans les fermes. Gréées par le besoin, les habitations ne portent point l’empreinte de l’architecture dominante ; l’ancien régime les a souvent trouvées telles que le Moyen Âge les avait élevées, et la plupart de celles qui ont persisté jusqu’à nos jours n’ont pas de date. On les a reconstruites sur les modèles anciens, sans modifications sérieuses ; elles ont conservé pendant des siècles les formes les plus antiques. Sans parler de ces demeures souterraines qui rappellent, sur certains points des bords de la Loire et de la Seine, les habitations de l’époque préhistorique qu’on se plaît à désigner sous le nom d’âge des cavernes, on trouve encore dans les montagnes de l’Auvergne et du Velay des maisons circulaires à toit conique, à cheminée centrale, comme les huttes des Gaulois ; le Languedoc et la Provence nous montrent des habitations rurales qui rappellent les maisons des champs des peintures antiques, et l’on pouvait voir en Normandie, il y a quelques années, des maisons en bois, dont les faîtages, les charpentes et les poinçons décorés offraient une frappante analogie avec certaines constructions de la Norvège, d’où les Normands étaient venus au Xe siècle.
Mais si les types persistent avec une rare ténacité dans certaines régions, les habitations varient selon les cantons et les provinces, suivant les occupations des habitants et les ressources que présente le sol. Le vigneron n’est pas logé comme le laboureur, le pâtre comme le bûcheron. Tantôt agglomérées autour de l’église, tantôt disséminées sur le territoire paroissial, les maisons ont été formées des matériaux que fournissaient les alentours ; ici la pierre, la brique, la terre ; là le bois mêlé à la terre et à la paille ; ailleurs, le bois servant de charpente et de revêtement. Quel contraste entre les lourdes maisons de granit du Morvand aux toitures de pierre plate et les larges chalets des Vosges ; entre les maisons de brique à toits d’ardoises des Ardennes, sombres d’aspect, mais reluisantes de propreté, et les constructions du Midi, en pierres blanches, avec leurs toits aplatis recouverts de tuiles creuses ! Cette diversité, qui dérivait de la nature des matériaux, était rendue plus sensible par le degré d’aisance des provinces et des individus.
Il ne faut pas juger de l’ancien régime par des exemples isolés. Rien de plus variable que les institutions locales ; la prospérité d’une contrée dépendait non seulement des conditions économiques où elle se trouvait, mais de ses impôts, de ses droits féodaux et de l’influence exercée par le seigneur. On a souvent cité comme les types des maisons rurales de l’ancien régime, les maisons « couvertes de chaume et de roseaux » que Jamerai Duval, errant et convalescent, a rencontrées dans une partie de la Champagne. « Elles s’abaissaient, dit-il, jusqu’à terre et ressemblaient à des glacières. Un enduit d’argile broyé avec un peu de paille était le seul obstacle qui en défendait l’entrée. » Notez qu’il s’agissait d’un pays où la pierre, comme le bois, fait à peu près défaut ; notez, en outre, que Jamerai Duval avait parcouru cette région en 1709, à une époque de disette cruelle qui succédait à la période la plus désastreuse pour les campagnes qu’ait traversée la monarchie des Bourbons. C’est à des causes analogues que l’on doit le grand nombre de maisons ruinées et désertées que Vauban signale dans l’élection de Vézelay et que des rapports officiels nous montrent aussi dans l’élection de Mantes. C’est au contraire à des causes locales qu’il faut attribuer l’aspect misérable des huttes de pauvres habitants des marais du Poitou vers 1670. Le voyageur qui les visita en trace le plus triste tableau. « Les murailles, dit-il, le toict et la porte mesme n’estaient que de paille, où le vent dans ces temps d’hiver passe tout outre. » L’émigration est la cause de l’abandon et de la ruine de certains villages de la Haute-Auvergne, que Legrand d’Aussy traversa à la veille de la révolution. « J’en ai vu, dit-il, où les masures en décombres faisaient plus du tiers du village, » Mais ce sont là des exceptions, et le soin qu’on prend de les signaler en est la preuve. Les voyageurs ne racontent pas d’ordinaire ce qu’ils voient journellement, et l’on aurait tort d’ériger leurs observations isolées en généralités.
Un témoin mieux informé que les précédents, c’est Arthur Young, qui parcourut à plusieurs reprises la France, de 1787 à 1790, monté sur sa jument, allant d’auberge en auberge, observant tout sur son passage, notant tout, surtout ce qui concernait l’état de l’agriculture et des campagnes. Il venait d’Angleterre, où l’aisance était plus grande dans les villages, où les maisons se distinguaient par leur propreté et le soin de leur construction ; il ne pouvait leur comparer que d’une manière désavantageuse les habitations rurales de la France ; le tableau qu’il en fait n’est pas toujours flatteur ; mais il n’indique pas un état général de misère. Si, en passant à Combourg, il est frappé de la pauvreté des cabanes construites en boue, à tel point qu’il s’écrie, en parlant du seigneur du lieu : « Quel est donc ce M. de Chateaubriand dont les nerfs s’arrangent d’un séjour au milieu de tant de misères et de saleté ? » s’il nous montre, dans le Dauphiné, des « huttes de boue, » couvertes en chaume, sans cheminées, et dont la fumée sort par un trou pratiqué dans le toit ou par les fenêtres ; en revanche, il nous signale les maisons carrées et blanches du Quercy, qui ajoutent à la beauté de la campagne ; il admire dans le Béarn des chaumières solides et confortables, couvertes en tuiles, entourées de jardins bien tenus et d’étables bien closes. On pourrait en citer d’autres exemples dans les provinces du nord de la France.
Un fait qui frappa singulièrement Arthur Young, lorsqu’il parcourut le Midi, c’est l’absence de vitres, même dans des maisons « fort bien bâties en pierre et couvertes en tuiles et en ardoises. » Dans le Limousin, il cite aussi des bâtiments trop bien construits pour mériter le nom de chaumière, et qui n’ont pas une vitre. La vitre, si précieuse dans les pays du Nord, où l’on se plaît à en entretenir soigneusement la transparence, la vitre était moins utile dans le Midi, où le jour est plus vif et le ciel plus clément. Certaines chaumières du Languedoc et du Limousin n’avaient d’autre ouverture que la porte. Pendant longtemps, les vitres ne furent pas en France d’un usage populaire. Lorsque Montaigne se rendit en Suisse, il remarqua depuis Épinal qu’il n’y avait « si petite maison qui ne fut vitrée. » Au siècle suivant, pour signaler l’heureux état de la Lorraine avant la guerre de Trente ans, on dira que « les paysans avoient des vistres aux fenestres. » Il n’est pas surprenant que les vitres fussent rares dans les campagnes ; c’est à peine si au XVIIIe siècle l’on en voyait dans certaines villes. En 1759, un élève du collège de Limoges, voulant distribuer sa thèse, demanda dans quelles maisons il fallait la porter. – Partout où vous verrez des vitres, lui répondit-on. La plupart des maisons de Limoges, en effet, n’avaient point de carreaux, mais des panneaux de verre enfumé, montés en plomb. Il n’en était pas de même partout, et l’on n’aurait point été frappé à cette époque, comme du temps de Montaigne, du défaut de vitres dans les régions de l’Est.
La diversité que l’on signale entre les régions se retrouvait entre les localités mêmes. Ici, les maisons étaient serrées les unes contre les autres, comme dans une petite ville ; là, dressées au milieu d’un enclos verdoyant. Parfois, les paysans avaient éprouvé le besoin de se grouper ; ils avaient même entouré leur village de murailles, pour résister aux violences des gens de guerre, à tous les dangers qui pouvaient venir du dehors. Mais dans ce cas, la maison perdait son caractère rural pour se rapprocher du type de celle des villes. La véritable demeure de l’homme des champs dans le Nord est la chaumière, la masure normande, dont l’aspect trop souvent misérable est pourtant pittoresque sous les arbres du verger qui l’entoure et l’ombrage. Dans le pays de Caux, les villages sont des agglomérations de maisons entourées d’enclos boisés, dont la réunion forme, au milieu des champs cultivés, un bosquet du centre duquel s’élance le clocher. Il n’en est pas là, comme dans les villes, où rien ne voile la nudité de la maison du pauvre. À la campagne, la nature pare la misère ; elle pose ses festons, elle répand ses ombres, elle fait grimper ses lierres sur « la chaumine enfumée » de l’indigent ; elle forme un cadre riant à un tableau dénué de beauté par lui-même.
Ce tableau, le tableau de la maison rurale, il faut essayer de le peindre, sans artifice de lumière et d’ombre. Le modèle que je prendrai ne sera ni la demeure du riche cultivateur, ni celle du pauvre manouvrier, encore moins celle de l’homme de loi ou du gentilhomme ; c’est celle du laboureur, propriétaire, fermier, métayer ou colon, de l’homme qui gagne sa vie à la sueur de son front, et qui, sans jouir du superflu, possède le strict nécessaire. Cette maison se présente à nous, avec ses dépendances souvent plus importantes que la demeure de la famille elle-même, sous un aspect patriarcal qui rappelle les civilisations primitives. Le paysan peut être considéré comme un nomade qui s’est arrêté sur un point déterminé du sol avec ses bestiaux ; il se suffit à lui-même ; pour vivre il n’a pas besoin d’autrui, comme l’homme des villes, qui doit recourir journellement au boucher, au boulanger, au maraîcher ; le laboureur vit de ses récoltes ; son grain lui fournit la farine dont il pétrit son pain ; il a toujours sa huche et souvent son four ; il a ses granges où il entasse ses gerbes ; il a ses hangars et ses étables. Sa maison, quelque humble qu’elle soit, a besoin d’espace pour s’étaler avec ses dépendances.
Ces caractères de l’habitation rurale, je les trouve au XVIe siècle, en Bretagne, dans le logis d’un « prud’homme rustique bon vilain, » que Noël du Fail décrit avec beaucoup de précision et de charme dans le langage de son temps. Après être entré dans la cour, close de beaux églantiers et épines blanches, « il aperçoit en un coin un beau fumier amassé, » spectacle qu’il est encore donné de voir à tous ceux qui approchent d’une maison de village. À côté s’élèvent des « tects (ou toits) çà et là bâtis en forme carrée, hauts environ de trois pieds et quelque poucée, » qui forment, les uns l’étable aux vaches, les autres le « tect des brebis, clos de gaules de coudres enlacés subtilement. » Près de l’entrée, se trouve « un petit appentis sous lequel étaient force charrues, essieux, timons et limons. » La maison du vilain n’est pas grande ; elle a « dix-sept pieds en carré, et vingt-huit de large et non plus, à raison, dit l’auteur, que le villageois disait le nid être assez grand pour l’oiseau. » La paroi est « formée de belle terre détrempée avec beau foin, » placée entre quatre poutres perpendiculaires ; « au-dessus force sablières et chevrons, dont était enlevé le beau pignon vers le soleil couchant ; » l’autre était garni d’une lucarne. La couverture était de paille et de joncs entremêlés ; car l’ardoise aurait coûté à amener… mais « le tout si proprement agencé qu’un excellent couvreur confessa que de mieux était impossible… et au-dessus du faîte force marjolaine et herbe au charpentier. « La fleur cultivée ou sauvage décore la cabane, comme la chaumière anglaise, si bien décrite par le poète Crabbe, qui voit grimper le chèvrefeuille vers le faîte de son chaume.
Deux siècles après Noël du Fail, Cambry trouvera dans la Basse-Bretagne des maisons d’un aspect analogue. Presque toujours elles sont situées dans un fond, auprès d’un courtil. Un appentis couvert de chaume abrite les charrues et les instruments de labourage. Point de granges ; les blés dans les greniers et « en mulons ». L’aspect riant des vergers qui entourent ces habitations contraste malheureusement avec la saleté des paysans qui les habitent. La saleté est un des vices de la campagne ; vice d’autant plus invétéré que le paysan ne s’en aperçoit point et ne sent point le besoin de s’en corriger. Dans le Roussillon, les villageois, non seulement mettent leur fumier devant leur porte, mais ils gardent leurs cochons sous leur propre toit. Dans le Périgord, porcs, chèvres et volailles vivent avec les paysans dans des chambres basses, humides et malsaines. Pour beaucoup d’entre eux, la propreté est un luxe que l’aisance seule permet d’acquérir ; elle leur est aussi rendue difficile par la vie qu’ils mènent au milieu des animaux domestiques.
C’est surtout dans le centre de la France que la famille rurale vit avec ses bestiaux. En Auvergne, son habitation est partagée en trois : à droite, l’étable ; à gauche, la grange ; au milieu, la maison communiquant directement avec la grange et l’étable. Quand l’hiver vient, la famille entière passe dans l’étable ; elle y vit, elle y couche. L’air, que la température animale échauffe, y devient étouffant ; les émanations malsaines, qu’exhale une épaisse couche de fumier, engendrent des maladies ; on n’en persiste pas moins dans les anciennes coutumes. Dans le Rouergue, les maisons couvertes en chaume, dénuées de vitres, étaient abritées du froid par les étables qui les entouraient. Souvent, à côté des étables, se trouvaient des constructions légères et grossières servant de poulailler ou de « soue à porc. » Une barrière à claire-voie pouvait fermer la cour, où picoraient le coq et les poules.
La maison villageoise recherche d’ordinaire le soleil ; toutes les fois que le terrain s’y prête, elle ouvre sa porte et ses étroites fenêtres vers le midi. Au nord, son toit s’abaisse parfois jusqu’au sol, pour mieux la garantir de la bise. Surtout dans les pays vignobles, elle est surmontée d’un étage ; le rez-de-chaussée sert de vinée ou d’écurie pour l’âne, la chèvre ou la vache. Mais le plus souvent, elle n’a qu’un rez-de-chaussée, à coup sûr insalubre, lorsque sans carrelage ni plancher il se trouve au niveau ou en contrebas du sol, et ce rez-de-chaussée ne contient qu’une chambre à feu. Celle-ci communique avec un cabinet, une autre chambre où peut se trouver le four. Que l’on y ajoute un cellier en contrebas, que dans le centre de la France on appelle basse-goutte, au-dessus un grenier où l’on pénètre par une échelle, et l’on aura le type le plus fréquent de la chaumière rurale. Habitation exiguë, plus que modeste, mais à laquelle le paysan attache un prix infini, parce qu’il en est d’ordinaire le propriétaire et qu’elle est pour lui le siège de la famille.
Presque partout, surtout en Champagne, le laboureur et le manouvrier sont propriétaires de leur maison. Tantôt ils l’ont reçue en héritage de leurs parents ; tantôt elle a constitué leur dot ou elle a été le premier acquêt de leur mariage. Le prix a suivi les variations de la valeur de l’argent, de la prospérité locale, de l’importance de la propriété ; il est en rapport avec le prix des denrées et le taux de la main-d’œuvre. La maison la plus modeste vaut de 3 à 400 1. à la fin du siècle dernier. Il est peu de ménages qui n’ait la sienne, car elle est pour chacun d’eux l’abri nécessaire, le domicile qui distingue l’habitant du vagabond et lui donne un rang dans la société communale.
Si l’on peut comparer la commune à une ruche, la maison en est la cellule. Cette cellule ne renferme pas un individu, mais une famille. C’est une famille qui se groupe sous le même toit, autour du même foyer, et les légères colonnes de fumée qu’on voit s’élever vers le soir au-dessus des maisons indiquent l’existence et le nombre des familles que renferme l’agglomération communale. Dans les recensements officiels comme dans les décisions relatives à la répartition des tailles entre les localités, on ne comptait pas la population par têtes, mais par feux. Le mot de feu resta toujours employé dans le langage administratif pour désigner le groupe de famille que renfermait la maison ; et comme on estimait au siècle dernier que chaque feu correspondait à quatre ou cinq habitants, on peut se former une opinion approximative de la quantité moyenne des membres de chaque famille. Aux élections de 1789 même, le nombre des députés aux assemblées bailliagères accordé à chaque paroisse, fut calculé d’après le nombre des feux et non d’après celui des électeurs. La famille, la maison est donc le premier élément de l’agglomération communale, et les droits communaux ne sont reconnus, le plupart du temps, qu’aux chefs de familles, chefs de maisons ou chefs de feux. Aussi, le paysan ne s’attache-t-il pas seulement à sa demeure comme à l’abri matériel qui garantit son repos contre les intempéries de l’air ; il y voit le gage de ses droits communaux ; il y voit la propriété que l’héritage et l’épargne lui ont acquise ; il y voit le sanctuaire de la famille ; il y voit son domaine propre, dont il est, pour ainsi dire, le seigneur. – Charbonnier est maître chez lui. – C’est un vieux dicton que le paysan peut répéter à son profit, lorsque sa porte est close et que son chien veille à l’extérieur ; il a une pioche, au besoin un fusil, pour repousser le maraudeur qui voudrait forcer sa demeure. Rien ne saurait la violer, si ce n’est le sergent de justice et l’employé des gabelles, qui, sur un simple soupçon de fraude, peut pénétrer chez lui et s’y livrer à des perquisitions vexatoires ; c’est pour cette raison qu’il hait d’une haine profonde et tenace le sergent et le gabelou, tandis qu’il contemple d’un œil confiant les cavaliers de maréchaussée qui parcourent deux à deux depuis le XVIe siècle les routes et les chemins, répandant la terreur parmi les malfaiteurs et rassurant les campagnards paisibles.
Il éprouve aussi le sentiment de la propriété héréditaire depuis que le servage a disparu dans presque toute la France. J’ai rencontré l’inventaire rédigé, vers la fin du XVe siècle, après le décès d’un homme de corps assujetti à la main-morte. C’était un vieillard considéré et d’une aisance au-dessus de l’ordinaire ; il avait marié sa fille à un homme de loi, au mayeur du village voisin ; il possédait une maison qu’on qualifiait d’« hostel, » et qui était composée de plusieurs corps de logis désignés sous le nom de « frestes de maison ; » il avait des vaches dans ses étables et à cheptel ; cinquante-trois « bestes à laine » étaient réunies dans sa bergerie ; il avait enfin quarante arpents de terres labourables ; mais tous ces biens, fruits de son travail et de son épargne, devaient revenir après sa mort au chapitre d’une cathédrale, qui possédait la seigneurie de son village et dont il était l’homme de corps. Le paysan du siècle dernier pouvait envisager l’avenir avec plus de sécurité ; il savait qu’il pouvait transmettre à l’un de ses enfants la maison, tout humble qu’elle fût, où souvent il était né et dans laquelle sa famille avait grandi et vécu.
Entrons dans cette maison que nous avons essayé de dépeindre. La porte étroite et basse n’est souvent fermée que par une serrure de bois. – Tirez la chevillette, la bobinette cherra. – C’est la description d’un loquet, que Charles Perrault a tracée pour faire sourire les enfants, et qui peut, dans le cas présent, nous instruire.
La porte nous introduit dans une salle, qui est le plus souvent la seule de la chaumière. L’aspect en est sombre, parce que le jour n’y pénètre qu’à travers d’étroites et de rares ouvertures. Le soleil n’y entre guère que par la porte, lorsqu’elle est entièrement ouverte. La salle est d’ordinaire très basse, sans plancher, ni plafond ; sous les pieds, le sol battu ; au-dessus de la tête, des poutres surbaissées et noircies. Si par hasard, dans une de ces expéditions triomphantes que faisait Louis XIV en sa jeunesse, une princesse du sang couche dans une de ces salles rustiques, il faudra creuser le sol pour que son lit puisse y tenir. C’était en 1674, aux environs de Dole ; la reine et mademoiselle de Montpensier suivaient le roi et l’armée ; une nuit, elles furent forcées de coucher dans un village ; on trouva pour la reine une chambre de paysan pourvue de vitres et de planchers ; mais la grande mademoiselle dut se contenter d’une salle basse, aérée par deux fenêtres sans vitres, et dans laquelle la pluie filtrait à travers le toit couvert de planches. Abri médiocre, qui suffisait au paysan, dont la chambre n’a pas besoin d’être vaste ; c’est à peine s’il y demeure ; la pluie, le froid ou la nuit seuls l’y font rentrer ; dans la semaine, il travaille dans les champs ; le dimanche, il assiste aux offices religieux, aux assemblées, aux adjudications, et quand il est jeune, il se livre au jeu ou à la danse.
Si l’extérieur des maisons diffère, leur intérieur présente de singulières similitudes ; c’est que l’aspect extérieur dépend des matériaux dont on dispose ; l’aspect intérieur, des besoins, des ressources, des mœurs de l’habitant. Or, du seizième au dix-huitième siècle, ces besoins, ces ressources, ces mœurs ont peu varié. Si l’on compare la demeure d’un paysan breton du XVIe siècle, telle que l’a décrite Noël du Fail, avec celle d’un paysan champenois du XVIIIe, on y trouvera les mêmes meubles que les générations successives se sont transmises, la table, les coffres, le lit, ainsi que les ustensiles de ménage et de travail disposés sur les dressoirs ou suspendus le long des murs. On signalait dans les maisons rurales du Rouergue au commencement de ce siècle des meubles du temps de la Ligue : armoires, couchettes, bancs sculptés, en bois dur si solide qu’on pouvait dire qu’ils avaient « usé plusieurs « maisons ». Fait particulier, et qui rappelle quelque peu la vie nomade, où la richesse est entièrement mobilière : les meubles ont souvent plus de valeur et de durée que l’abri où se réfugie la famille, et surtout si l’on fait entrer en ligne de compte les bestiaux, le contenu de l’habitation rurale est estimé plus cher que le contenant.
Lorsqu’on a pénétré dans la chambre de la chaumière, on est d’abord frappé par la vue du foyer : le foyer, lieu sacré, que révéraient les anciens, parce qu’il était le siège du feu et le centre autour duquel se groupait la famille. La large cheminée à laquelle s’adosse l’âtre est pour ainsi dire la pierre angulaire de la maison ; c’est elle qui en forme le point de résistance, et lorsque l’incendie ou la ruine a passé sur elle, sa masse noircie se dresse encore comme le dernier témoin de son existence. La cheminée est aussi l’indice de la fixité du domicile ; dans les huttes ou les tentes des peuples primitifs, le foyer est situé au centre et la fumée s’échappe à travers une ouverture pratiquée dans la toiture mal jointe, comme dans les cabanes de Franche-Comté, que l’on pouvait voir encore à une époque peu éloignée de la nôtre. Mais presque toujours, dans la maison du paysan français aux deux derniers siècles, le foyer se présente, sous le large manteau de la cheminée, avec ses lourds et solides accessoires de fer ou de fonte ; les chenets ou « chiennets » de fer à tête recourbée ou terminée en boule ; l’indispensable crémaillère, destinée à suspendre la marmite de fer ou d’airain ; et chez quelques-uns, la broche, qui indique qu’on ne met pas seulement la poule au pot, mais qu’on la fait rôtir. C’est que la cheminée n’est pas seulement le lieu où la famille, au retour du travail, vient se sécher, se réchauffer et se réjouir à la flamme des ramées ; le coin où les parents sur les escabeaux de bois passent les veillées d’hiver ; où le vieillard malade dégourdit ses membres glacés par l’âge et dicte son testament ; c’est l’endroit où chaque jour, dans la chaudière ou la marmite, se préparent et cuisent les aliments qui servent à la nourriture de la famille. Aussi de toutes parts, aux abords de la cheminée sont accrochés ou posés les divers ustensiles de cuisine : le gril, qu’on appelle au XVIe siècle le rostier, la poêle et le poêlon, les pots de terre, les marmites et les chaudrons de fer, de cuivre et d’airain.
Lorsque le fagot flambe, sa lueur suffit à éclairer la chambre ; mais il ne flambe pas toujours, et il faut recourir à d’autres moyens pour y répandre la lumière. Si dans les provinces reculées comme la Bretagne, on se sert de torches dont la fumée épaissit la couche noire qui recouvre les poutres du plancher supérieur, en Champagne on emploie depuis le XVIe siècle les lanternes, les chandeliers et les lampes. La lanterne « à corne, » à carcasse de cuivre ou de fer blanc, peut être emportée sans danger dans les étables et les greniers. Les chandeliers de cuivre, de bois et de fil de fer, ne sont pas toujours usités pour supporter des chandelles, et ce n’est que par exception que l’on trouve des mouchettes ; quelquefois les chandeliers sont destinés à recevoir une lampe. Les lampes se trouvent partout, et à toutes les époques, depuis le XVIe siècle : lampes de cuivre ou de potain, à queue de fer ou sans queue ; lampes à un, à quatre ou à cinq feux ; lampes qu’on transporte et qu’on suspend. Lampes et chandeliers, en effet, se placent d’ordinaire sur la saillie supérieure du manteau de la cheminée ou s’accrochent à ce manteau même.
C’est également au-dessus de ce manteau que l’on suspend le mauvais fusil qu’un grand nombre de paysans champenois conservent chez eux. Le fusil n’est pas toujours en bon état ; tantôt il consiste en un vieux canon long de trois pieds ; tantôt c’est « un fusil monté » et garni de sa platine. En général, la valeur vénale de l’arme est médiocre, et il serait peut-être plus dangereux de s’en servir que d’en affronter les coups. Chez l’un, une vieille épée, un mauvais pistolet accompagnent le fusil ; chez un autre, un fusil propre à tirer des canards, estimé 15 l., est pendu près d’une carnassière et non loin d’une « paire de bottes de cuir fort à canardière. » Malgré les ordonnances sur le port d’armes et la chasse, on trouve dans beaucoup de maisons des armes à feu destinées à la défense et peut-être au braconnage.
Au XVIe siècle même, le paysan s’en était servi pour repousser les violences des gens de guerre. Pour montrer quelle sécurité lui fut assurée sous Louis XII, on disait qu’à cette époque, les armes des campagnards étaient
Lorsque, sous Henri III, il y avait des battues au loup, les manants accouraient au rendez-vous, non seulement avec des épieux, des fléaux, des faux, des leviers, mais aussi avec des hallebardes, des vieilles épées et même des arquebuses. Certaines coutumes féodales obligeaient même les paysans à avoir des armes. Jusqu’en 1787, les manants et habitants de Thiais, « en reconnaissance de l’affranchissement de leurs auteurs, » comparaissaient périodiquement devant le juge tenant ses assises, « habillés honnêtement et décemment, avec armes offensives et défensives, selon l’usage ordinaire. »
Près de la cheminée, où est pendu le fusil, l’on apporte les escabeaux ou escabelles, quelquefois un vieux fauteuil de bois noirci par l’usage, et à partir du XVIIe siècle, les chaises à fond de paille ; dans certaines provinces on y place le siège à sel, sorte de meuble à base carrée où l’on enferme la provision de sel de la maison ; mais les sièges les plus usités, ce sont encore les coffres rangés le long des murs, et les bancs ou bancelles de bois attachés à la table ou placés à sa proximité.
La table, longue, étroite et rectangulaire, était tantôt posée sur des tréteaux, tantôt assise sur des pieds solides. C’est à l’un de ses bouts qu’au XVIe siècle, en Bretagne, on mettait la « touaille ou nappe, » sur laquelle on servait le dîner. Beaucoup de paysans possédaient aux siècles suivants plusieurs nappes et des serviettes dans leur coffre. Quoiqu’ils en eussent parfois plus d’une douzaine, il est peu probable qu’ils s’en soient servis tous les jours. L’excès de propreté n’est pas le défaut des chaumières. L’on mangeait souvent dans des écuelles de terre ou de bois. Outre les plats et les écuelles de poterie, qu’on qualifie avec un certain dédain de « terrasse » ou de « terrasserie, » les campagnards possédaient des plats et des assiettes d’étain ; ils étaient fiers de les étaler sur leurs dressoirs et sur leurs tablettes ; ils y mettaient aussi des pots, des « potagers » ou soupières, des brocs à bec, des gobelets d’étain. L’étain avait précédé l’argenterie et la faïence chez les bourgeois, et même chez les dignitaires de l’église. La faïence n’apparut chez les paysans que sous Louis XV. À cette époque, les ménagères étalent sur leur buffet ou dans leur « vaisselier » dix à douze assiettes avec un saladier et quelques plats de faïence. Fabriquées spécialement pour elles, ces pièces de céramique populaire, avec leurs fleurs, leurs coqs et leurs personnages peints en couleurs crues sur un émail brillant, éclairent de leur aspect gai l’intérieur sombre de la chaumière.
Comme les bouteilles, les verres sont rares ; Jamerai Duval, de retour en Champagne, se trouva un jour dans un hameau habité par des sabotiers ; comme il faisait chaud, il demanda à boire ; on lui apporta de la mauvaise eau dans un grand gobelet de bois. S’il s’était adressé à un laboureur ou à un vigneron dans l’aisance, on aurait pu lui servir du vin dans un gobelet ou dans une timbale d’argent. Les timbales d’argent étaient cependant plus difficiles à rencontrer que les gobelets de bois. Il y avait peu d’argenterie dans les campagnes. Outre les timbales, on trouve dans beaucoup de pays des tasses d’argent, qui servent particulièrement à goûter le vin et qui sont quelquefois façonnées en forme de gondole. Le nom ou les initiales du propriétaire y sont gravés. Mais d’ordinaire les cuillers sont d’étain ; les fourchettes sont d’acier ou de fer. Il y a des manouvriers qui ont 23 fourchettes et 15 cuillers. Peu ou point de couteaux ; chaque convive sans doute apporte le sien. On ne trouve de couverts d’argent, et encore en petit nombre, que chez les gros fermiers, les curés qui ne sont pas à la portion congrue, et quelques juges seigneuriaux d’ordre supérieur. L’argenterie est enfermée avec les objets précieux dans le bas d’un buffet ou dans un coffre en cuir bouilli. On la mettait aussi dans une armoire, dans un bahut ou dans un de ces cabinets de bois de chêne, à deux battants, où le cultivateur enfermait sous clef ses titres de propriété ; on la serrait dans le « buffet ferré » que surmontaient les deux ou trois tablettes du dressoir, couronnées d’une crête ou d’une sorte de fronton, désigné sous le nom de « chapeau. »
Les cabinets et les buffets, surtout lorsqu’ils sont sculptés et à quatre battants, ne se rencontrent pas partout. Il n’en est pas de même de la huche, que dans certaines provinces on appelle la met. Que son couvercle soit plat ou en dos d’âne, elle est faite d’ordinaire en bois de chêne, et sa longueur est de quatre ou cinq pieds. « La met de chesne propre à faire du pain » est l’indice caractéristique de la nourriture la plus usitée ; elle se rencontre dans les chaumières comme dans les maisons bourgeoises sous Henri IV. Le pétrissage domestique, qui peut être regardé comme un des symptômes de la vie patriarcale, se suffisant à elle-même, persista dans les campagnes, où les boulangers étaient rares. Les pains que la ménagère pétrissait étaient cuits au four banal, et plus fréquemment dans le four de la maison même. La plupart des maisons rurales de Champagne contenaient un four dont la porte close avec un « bouchoir de fer », s’ouvrait fréquemment sous le large manteau de la cheminée. Le four était aussi placé dans une chambre spéciale, qui servait de buanderie et de débarras. Les pains étaient ensuite renfermés dans la huche, et s’y desséchaient jusqu’au moment où la ménagère en coupait de larges tranches, soit pour le repas, soit pour l’aumône. « Chez les paysans, la huche et le fruitier sont toujours ouverts, » a dit Jean-Jacques Rousseau.





























