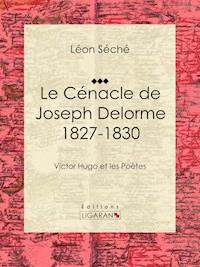
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce livre fait suite au Cénacle de la Muse française, et je le crois tout aussi neuf. On m'a demandé de divers côtés, pendant que j'y travaillais, pourquoi je lui donnais le nom de Joseph Delorme. La raison en est bien simple. D'abord le mot Cénacle, pour n'avoir pas été inventé par Sainte-Beuve, n'en fut pas moins appliqué par lui, le premier, dans une poésie fameuse de Joseph Delorme, au groupe littéraire de Victor Hugo."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054934
©Ligaran 2015
CARISSIMO
LUDOVICO BARTHOU
CUI DULCES ANTE OMNIA MUSÆ HUNC LIBRUM GRATUS EX IMO CORDE DEDICAVI
L.S.
Ce livre fait suite au Cénacle de la Muse française, et je le crois tout aussi neuf.
On m’a demandé de divers côtés, pendant que j’y travaillais, pourquoi je lui donnais le nom de Joseph Delorme. La raison en est bien simple. D’abord le mot de Cénacle, pour n’avoir pas été inventé par Sainte-Beuve, n’en fut pas moins appliqué par lui, le premier, dans une poésie fameuse de Joseph Delorme, au groupe littéraire de Victor Hugo. Ensuite Sainte-Beuve joua dans ce Cénacle le même rôle qu’Émile Deschamps dans celui de la Muse française, avec cette différence pourtant à son avantage que, tout en étant, comme son devancier, le lien entre les membres de ce cercle un peu disparate, et le ciment de l’édifice, Sainte-Beuve fut seul à y représenter la critique proprement dite. Or, c’est précisément la critique qui, au regard de l’historien, caractérise le Cénacle de Joseph Delorme et le distingue du Cénacle de la Muse française, lequel fut exclusivement poétique. Je ne considère pas, en effet, comme de la critique les manifestes d’Alexandre Guiraud ni les brillantes passes d’armes du jeune moraliste que fut Émile Deschamps.
Sainte-Beuve s’en rendait parfaitement compte, quand il écrivait dans ses Cahiers :
« … En général, dans cette École, dont j’ai été depuis la fin de 1827 jusqu’à juillet 1830, ils n’avaient de jugement personne, ni Hugo, ni Vigny, ni Nodier, ni les Deschamps ; je fis un peu comme eux durant ce temps ; je mis mon jugement dans ma poche et me livrai à la fantaisie. Au sortir d’une École toute rationaliste et critique, comme l’était le Globe, au sortir d’un commerce étroit avec M. Daunou, ce m’était un monde tout nouveau, et je m’y oubliai, savourant les douceurs de la louange qu’ils ne ménageaient pas, et donnant pour la première fois carrière à certaines qualités et facultés poétiques et romanesques que jusqu’alors j’avais comprimées en moi avec souffrance. Je sentais bien par moments le faux d’alentour ; aucun ridicule, aucune exagération ne m’échappait ; mais le talent que je voyais à côté me rendait courage, et je me flattais que ces défauts resteraient un peu le secret de la famille. Hélas ! ils n’ont que trop éclaté depuis à la face de tous. Je m’efforçais, cependant, sous forme indirecte (la seule qui fût admise en ce cercle chatouilleux), d’éclairer, de rectifier la marche, d’y apporter des enseignements critiques, et dans la manière dont je présentais mes amis poètes au public, je tâchais de leur insinuer le vrai sens où ils devaient se prendre eux-mêmes, se diriger pour assurer à leurs talents le plein succès. Et puis, au milieu de tout cela, et quoi que ma raison pût tout bas me dire, un charme me retenait, le plus puissant et le plus doux, celui qui enchaînait Renaud dans le jardin d’Armide.
« Depuis 1830, ce dernier charme a continué de régner en moi durant plusieurs années, et en même temps ma raison était complètement éclairée sur les défauts des hommes de cette École. De là une lutte bien pénible et bien de la contrainte dans l’expression de ma critique. Enfin elle s’est fait jour. »
Tout en se défendant ainsi d’avoir exercé sur ses camarades une influence efficace, il n’en est pas moins vrai que Sainte-Beuve fut, par son Tableaude la Poésie française au XVIesiècle et par les Pensées de Joseph Delorme, le théoricien quasi officiel du Cénacle de Victor Hugo et qu’il leur montra à tous la route à suivre. En d’autres termes, et pour me faire mieux comprendre, je dirai qu’il fut, dans l’École de 1827, ce que Joachim du Bellay fut dans celle de 1550. Et les lettres qu’il écrivit à Victor Hugo, à propos de Cromwell, d’Hernani et de Notre-Dame, prouvent qu’en dépit de toutes ses complaisances il avait avec lui son franc-parler.
Mais là ne se bornèrent pas son rôle et ses services. Comme le Cénacle n’avait pas d’organe attitré, il lui en procura un de premier ordre dans le Globe, où il écrivait régulièrement. Jusqu’à la liaison de Sainte-Beuve avec Victor Hugo, le journal de Dubois hésitait entre les classiques et les romantiques, bien qu’il inclinât vers ces derniers. Du jour où fut constitué le groupement littéraire de la rue Notre-Dame-des-Champs, Sainte-Beuve, qui se reprocha plus tard d’avoir trop poussé à l’idée du Cénacle, s’efforça de conquérir aux idées nouvelles les principaux rédacteurs du Globe, et Charles Magnin fut un des premiers à s’y rallier derrière lui.
Il n’est donc pas étonnant que Victor Hugo, qui sentait tout le prix d’une critique à sa dévotion, ait prodigué tout de suite à Sainte-Beuve les marques de confiance et d’amitié. Au bout de quelque temps, avant même d’avoir publié son Tableau qui devait lui faire dans le Cénacle une figure à part, Sainte-Beuve devint son confident, son alter ego. Victor Hugo ne pouvait faire un pas sans lui. Après lui avoir ouvert la porte de l’Arsenal, il le conduisit partout où il y avait quelque chose à voir ou à apprendre. Ils allèrent ensemble visiter Béranger dans sa prison, et le chansonnier comprit dès le premier jour toute l’étendue et toute la finesse de l’esprit de Sainte-Beuve. Mais il n’y avait pas grand mérite à cela, car tous ceux qui à cette époque approchèrent notre Joseph Delorme furent émerveillés de ses connaissances, de son goût, de sa perspicacité. C’est au point que, dans l’espace de quelques mois, David d’Angers, Lamartine et Lamennais lui offrirent de remmener avec eux à Weimar, à Athènes et à Rome. Mais Sainte-Beuve, tout flatté qu’il était de ces marques de confiance et de sympathie, déclina ces offres, ne pouvant se décider à quitter son ruisseau de la rue Notre-Dame-des-Champs, et il vient de nous dire quel charme le retenait dans la maison de Victor Hugo. Il y était comme chez lui, un peu trop même, mais en ce temps-là, quand on se donnait à quelqu’un qui en valait la peine, c’était corps et âme, sans restriction aucune, avec une sorte de frénésie. Le dévouement n’avait pas de limites ; l’amitié ressemblait à de l’amour. Et voilà qui nous explique pourquoi Sainte-Beuve, en ces années de fièvre littéraire et de camaraderie sans pareille, fit pour Victor Hugo ce qu’il ne fit jamais pour personne. Non seulement, en effet, il lui amena du camp opposé de précieuses recrues, non seulement il s’efforça de le réconcilier avec certains adversaires de marque, Stendhal entre autres, mais il devint en quelque sorte le secrétaire de ses commandements, son cornac, son héraut d’armes. Et si, dans un moment de mauvaise humeur où perçait le dépit amoureux, il refusa, la veille de la représentation de cette pièce, d’emboucher la trompette en faveur d’Hernani, nous verrons qu’il dédommagea le jeune triomphateur du 25 février 1830, en rédigeant lui-même ses bulletins de victoire.
Il me semble que tout ce que je viens de dire justifie amplement le titre général de ce livre. Qu’on le veuille ou non, le Cénacle de Victor Hugo fut, en grande partie, l’ouvrage de Sainte-Beuve, et c’est pour cela qu’il ne survécut pas à leur rupture.
L.S.
Paris, 26 février 1912,
anniversaire de la naissance
de Victor Hugo.
P.-S.– Je dois des remerciements tout particuliers à Mme la baronne de Croze, née Guiraud, à Mmes Marie Dauguet et Léonce Détroyat, ainsi qu’à MM. Louis Barthou, Paul Bellamy, Dominique Caillé, J. Dumas, le Comte d’Haussonville, René Paul-Huet, P. Lefèvre-Vacquerie, Jules Macqueron, Aristide Marie, Jules Troubat et G. Vauthier, pour les documents précieux qu’ils ont bien voulu me communiquer et que j’ai mis en œuvre dans les deux tomes de cet ouvrage.
I.– Les prétentions nobiliaires de Victor Hugo. – Ses armoiries. – La légende et l’histoire. – Petit-fils d’un menuisier de Nancy. – L’adjudant-major Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo en Vendée. – Ses Mémoires. – Son rôle au conseil de guerre du château d’Aux et dans les massacres de Bouguenais. – Son humanité envers les vaincus.
II.– Sophie Trébuchet, mère de Victor Hugo. – Ses origines nantaises. – Le petit bourg d’Auverné. – Les Trébuchet et les Le Normand. – Une famille d’hommes de loi. – Les voyages au long cours du capitaine Trébuchet. – La traite des nègres à Nantes à la fin du XVIIIe siècle.
III.– Le mariage civil du major Hugo avec Sophie Trébuchet. – Sophie fut-elle une brigande de la Vendée ? Fausse légende répandue sur son compte. – Edmond Biré et les erreurs du « témoin » de Victor Hugo raconté.
IV.– Lettres du chef de bataillon Hugo et de sa femme au général Lahorie à l’occasion de la naissance de leur fils Victor. – Laurent Pichat publie ces lettres dans les Poètes de Combat, et Mme Victor Hugo les reproduit en les défigurant. – Pour une devise. « Je meurs où je m’attache. »
V.– Volney et Victor Hugo. – Pourquoi le grand poète espérait à vingt ans devenir pair de France. – Volney pamphlétaire à l’approche de la Révolution. – Explication de son séjour à Rennes. – Son pamphlet de la Sentinelle du Peuple. – Ce que Victor Hugo devait à sa mère et à sa famille maternelle. – Source de l’épisode du combat de Gilliat et du Poulpe dans les Travailleurs de la Mer. – Le pseudonyme de V. d’Auverney pris par Victor Hugo dans le Conservateur littéraire sert plus tard à son fils Charles. – Le capitaine Léopold d’Auverney de Bug-Jargal. – Les derniers représentants du nom de Trébuchet au pays nantais.
On lit à la page 3 de l’Enfance de Victor Hugo, par M. Gustave Simon :
« Était-il de noble lignée ? N’avait-il, au contraire, comme ancêtres que des cultivateurs et des menuisiers ? Ceux qui se passionnent pour ces recherches archaïques ont fouillé consciencieusement les archives afin de fixer cette botanique d’arbres généalogiques. Ils n’auraient peut-être pas mis tant d’ardeur à interroger les vieux parchemins, s’ils avaient connu le dédain de Victor Hugo pour ces sortes de controverses… »
Dédain est ici de trop ; car, si Edmond Biré prit tant de plaisir à nous prouver que Victor Hugo n’était que le petit-fils d’un menuisier de Nancy, c’est que le grand poète s’était vanté jusqu’à soixante ans de descendre de la cuisse de Jupiter, autrement dit de Pierre-Antoine Hugo, né en 1532, conseiller privé du grand-duc de Lorraine, qui épousa la fille du seigneur de Bioncourt.
Auguste Barbier raconte qu’un jour, dans un dîner chez Bonnaire, de la Revue des Deux Mondes, Victor Hugo disait qu’il s’estimait, lui, simple vicomte, bien meilleur gentilhomme que tous les princes en in ou en ki de la Russie. – Il faisait alors figurer au-dessous de son nom, dans les annuaires de la noblesse et dans les articles qu’on lui consacrait, tantôt les armes des Hugo de Lorraine : d’azur à un chef d’argent, chargé de deux merlettes de sable, tantôt celles que le roi d’Espagne, Joseph, avait octroyées à son père : écartelé au 1er d’azur, à l’épée en pal d’argent garnie d’or, accompagnée en chef de 2 étoiles d’argent ; au 2ede gueules au pont de 3 arches d’argent maçonné de sable, soutenu d’une eau d’argent et brochant sur une forêt de même ; au 3ede gueules à la couronne murale d’argent ; au 4ed’azur au cheval effrayé d’or.
Et, en 1853, étant à Guernesey, il écrivait à un ami de Jules Troubat (M. Soulas), qui lui avait communiqué divers documents généalogiques trouvés par lui à la Bibliothèque de l’École de médecine de Montpellier, et dans lesquels se rencontrait le nom d’Hugo :
« Votre lettre, Monsieur, m’arrive, peut-être même intacte. Notre siècle de virilité répudie ces enfantillages héraldiques, mais n’est pas insensible aux filiations de famille. »
Lui-même y était alors si peu insensible que, dans un exemplaire de ses œuvres illustrées, parues en 1855, chez Hetzel, – gros volume massif de 1460 pages offert, le 1er janvier 1856, à sa filleule Anna-Alice-Adèle Asplet, fille du centenier de Jersey qui, à son arrivée dans l’île, lui avait offert l’hospitalité la plus généreuse, – il avait intercalé, entre autres choses intéressantes, une page blanche sur laquelle il avait écrit de sa main ces deux dates :
1531-1856,
suivies de quatre cachets à la cire dont trois rouges et un noir, et puis de ces vers sibyllins :
VICTOR HUGO.
Que plus tard, dans une lettre à M. Albert Caise, du 20 mars 1867, il ait déclaré « n’attacher aucune importance aux questions généalogiques et que, s’il avait le choix de ses aïeux, il aimerait mieux avoir pour ancêtre un savetier laborieux qu’un roi fainéant », cela s’explique sans peine. En 1867, après le retentissement des Misérables, qui avait fait pénétrer son nom jusque dans les dernières couches de la société, Victor Hugo avait plutôt intérêt à montrer avec fierté au peuple – tels Murat et le maréchal Ney – le modeste atelier d’où son père était parti. C’est toujours la veille chanson. Quand on est obscur et qu’on veut attirer sur soi le regard des grands, on se fabrique volontiers des quartiers de noblesse. La renommée vient-elle à vous prendre, on n’a plus besoin d’aïeux, et l’on dit, comme Alfred de Vigny dans l’Esprit pur :
Encore Victor Hugo fit-il sonner très haut toute sa vie qu’il était fils d’un général de l’Empire, en quoi, d’ailleurs, il eut grandement raison, – car ce général était, lui aussi, le fils de ses œuvres, et il n’avait pas volé la gloire dont son nom était couvert. Il avait même donné à Victor une belle leçon de modestie en écrivant en tête de ses Mémoires qu’il devait le jour « à d’honnêtes gens, dont rien n’égala mieux les vertus que l’excellente réputation qu’elles leur méritèrent ».
Engagé volontaire en 1788, à l’âge de quatorze ans, Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo arriva, en 1793, en Vendée avec le grade d’adjudant-major. Pour en imposer davantage aux représentants en mission, il s’était affublé du prénom de Brutus et signait de la sorte ; mais ce Brutus de contrebande était loin d’être sanguinaire. Partout où il passa, il se signala au contraire par sa bravoure et son humanité envers les vaincus. À la bataille de Vihiers, qui dura trois jours, il arrêta, pendant quelques heures, avec cinquante hommes, un corps ennemi fort de 6 000 hommes. À Montaigu, le 21 septembre 1793, il eut deux chevaux tués sous lui, et lorsque Muscar prit, comme chef de bataillon, le commandement de l’arrondissement du château d’Aux, composé en partie de la légion nantaise, il devint son chef d’état-major. C’est lui qui, après l’exécution sommaire de deux cent soixante-dix hommes arrêtés chez eux à Bouguenais, se vanta d’avoir sauvé la vie à vingt-deux jeunes filles de ce bourg. Mais cela n’est rien moins que prouvé.
« J’ai beaucoup fait la guerre, disait-il, j’ai parcouru de vastes champs de batailles, jamais rien ne m’a tant frappé que le massacre de ces victimes de l’opinion et du fanatisme. »
Je pense donc que la bonne réputation dont il jouissait au pays nantais ne fut pas étrangère à son mariage. Où, comment, dans quelles circonstances ce brave soldat fit-il la connaissance de Sophie Trébuchet ? C’est ce que je n’ai pu établir d’une façon précise, malgré des recherches aussi longues que minutieuses. Au moins sais-je et puis-je dire ici, le premier, tous les tenants et aboutissants de la famille maternelle de Victor Hugo.
Sur Sophie Trébuchet, on ne savait rien, jusqu’à ce jour, ou pas grand-chose. On savait seulement par le « témoin » de Victor Hugo raconté qu’elle était fille d’un « armateur nantais » nommé Jean-François Trébuchet et d’une demoiselle Renée-Louise Le Normand. Encore ignorait-on leurs lieux d’origine et la qualité de leurs pères et mères. Il est même étonnant qu’Edmond Biré, qui habitait Nantes, ne nous ait pas apporté, dans son Victor Hugo avant 1830, des informations plus exactes et plus étendues sur les origines maternelles du grand poète. Sans avoir un flair exceptionnel, après une enquête sérieuse et bien conduite, il lui eût été facile de mettre la main sur les sources où j’ai puisé les documents qui servent de base à ce chapitre. Cela lui eût procuré le plaisir de relever quelques erreurs de plus dans le Victor Hugo raconté, et lui eût évité, du même coup, le désagrément d’en commettre lui-même quelques-unes – ce qui est toujours fâcheux sous la plume d’un redresseur de torts et d’un coupeur de fils en quatre.
Mais Edmond Biré n’avait pas l’habitude de courir après les documents originaux. Il attendait patiemment qu’ils vinssent le chercher dans son cabinet d’étude et se contentait ordinairement de dépouiller les journaux et libelles de toute couleur et de toute nature dont il s’était fait une riche collection. De là, le peu d’inédit qu’il a mis en œuvre. Ce n’est pas tout à fait ma méthode.
Des actes de baptême et de mariage que m’a très obligeamment communiqués M. Paul Bellamy, greffier en chef du tribunal civil aujourd’hui maire de Nantes, il appert que les parents de Sophie Trébuchet n’étaient pas originaires de cette ville.
Jean-Joseph Trébuchet était natif d’Auverné, petit bourg de l’arrondissement de Châteaubriant ; Renée-Louise Le Normand était native de Saint-Fiacre, petite commune sise à trois lieues de Nantes sur un coteau qui domine le cours de la Sèvre et de la Moine, et dont le vin blanc n’a d’égal, au pays nantais, que le muscadet de Vertou et de Château-Thébaud. L’église de Saint-Fiacre, qu’on a rebâtie dans ces dernières années et dont le clocher de granit a la forme d’une tiare sans les couronnes, fut fondée par les seigneurs de Goulaine qui avaient en cette paroisse leur juridiction des Cléons, laquelle dépendait du marquisat de Goulaine. C’est même à cette circonstance que Mlle Renée-Louise Le Normand dut d’y naître, le 28 août 1748, son père, René-Pierre le Normand, sieur du Buisson, étant procureur fiscal du marquisat de Goulaine, en même temps que sénéchal de juridiction en Château-Thébaud, alloué de la juridiction de Bourgon en Couëron, procureur fiscal de plusieurs autres juridictions et procureur au siège présidial et comté de Nantes.
Ce Le Normand était, comme on le voit, un assez gros personnage. Cependant il n’était pas de noblesse et il n’avait pris le titre de sieur du Buisson que pour se distinguer de ses frères, qui signaient Le Normand de la Noë et Le Normand du Pâti.
Marié deux fois, il avait eu d’un premier lit avec Renée-Pélagie Brevet, qui mourut en 1761, trois garçons et une fille, dont Renée-Louise, et du second, René-Pierre, qui devint procureur au Parlement de Bretagne et épousa, comme tel, le 19 novembre 1779, Marie-Thérèse Rousseau, fille d’un notaire et procureur au marquisat de la Galissonnière. Ce n’étaient pas, du reste, les seuls hommes de loi de la famille. Le procureur fiscal du marquisat de Goulaine avait pour beaux-frères Me Pouponneau et Me Mourain, ses collègues au présidial de Nantes, et pour cousin germain Étienne-Joseph Garreau, avocat au Parlement. J’ajoute qu’il était lié avec Me Louis-Maurice Trébuchet, avocat à Nantes, et que ce fut par le canal de ce dernier que Jean-François Trébuchet, son frère, épousa Renée-Louise Le Normand du Buisson.
Ce mariage fut célébré en l’église paroissiale de Saint-Fiacre le 22 septembre 1767.
Aussitôt après, les nouveaux époux s’établirent à Nantes, où ils habitèrent tour à tour la rue des Carmélites, la rue Saint-Laurent, la place Saint-Pierre et la Haute-grand-rue, proche la cathédrale, et sur la paroisse de Saint-Laurent dont l’église, aujourd’hui disparue, s’élevait au bout de l’impasse de ce nom.
C’est dans une maison de la Haute-grand-rue que, le 19 juin 1772, naquit Sophie-Françoise Trébuchet, mère de Victor Hugo. Voici son acte de baptême :
« Le 19 juin 1772, a été baptisée dans l’église paroissiale de Saint-Laurent de Nantes, par nous recteur soussigné : Sophie-Françoise née de ce matin à cinq heures en cette paroisse, Haute-grand-rue, fille de noble homme Jean-François Trébuchet, capitaine de navire, et de dame Renée-Louise Le Normand, son épouse. Ont été parrain, noble homme René Le Normand, fils, oncle maternel de l’enfant, et marraine, demoiselle Renée-Françoise Robin, cousine germaine de l’enfant du côté paternel, lesquels signent avec nous, le père absent. »
Le Père absent ! Notre capitaine de navire était donc en mer quand sa fille vint au monde. Cela lui arriva trois ou quatre fois dans l’espace de douze ans durant lesquels sa femme lui donna trois filles et quatre garçons. La dernière fois qu’il revint à Nantes, ce fut pour assister coup sur coup à la naissance de son septième enfant et à la mort de sa femme que ses couches successives avaient épuisée. Étienne-Constant Trébuchet était né le 21 juillet 1780 ; le 13 août suivant, sa mère mourait dans la trente-deuxième année de son âge.
Trébuchet fut-il armateur, comme le prétend le « témoin » de Victor Hugo raconté ? Non, car il n’eut jamais pour cela l’argent nécessaire. D’abord, ses parents, qui avaient eu à élever six enfants, ne lui avaient pas laissé grand-chose. Ensuite ses premiers voyages en mer lui avaient rapporté si peu, tout capitaine qu’il était, qu’ayant voulu cesser de naviguer, après la mort de sa femme, il tomba dans un état voisin de la misère, et force lui fut de reprendre du service.
Il résulte, d’ailleurs, des renseignements que j’ai puisés aux archives de la Marine, à Nantes, qu’il débuta comme matelot, à l’âge de dix-huit ans, chez M. de Seigne, armateur en cette ville.
Du 10 avril 1749 au 27 mars 1760, il fit trois voyages comme pilotin sur le Philibert et le Thiercelin, appartenant à la Compagnie des Indes.
Nommé, en 1763, lieutenant de la Nouvelle-Société, il fut reçu, le 3 janvier 1767, capitaine à l’amirauté de Nantes, avec dispense d’un voyage.
Il commanda alors la Sèvre et la Duchesse-de-Duras, appartenant à M. Louis Drouin, armateur à Nantes.
J’ai lu les premières lettres qu’il adressait à sa femme, de Saint-Marc (Haïti) ; elles sont écrites dans un français d’écolier – ce qui prouve qu’il n’avait reçu aucune instruction.
La Duchesse-de-Duras, qui faisait le commerce de Guinée, fut prise par les Anglais en 1779. Mais Trébuchet ne la commandait plus depuis 1776, époque à laquelle, faute d’un registre-matricule disparu des archives de la Marine de Nantes, on perd sa trace. Cependant il n’est pas douteux qu’il ait navigué jusqu’en 1780, puisqu’il est encore désigné comme capitaine de navire sur l’acte de décès de sa femme. Et j’ai appris d’une autre source qu’à la fin du mois de juin 1782, quand il reprit la mer après son veuvage, il partit sur le Comte-de-Grasse, pour l’Île de France, où il mourut le 1er septembre 1783.
Voilà donc les états de service du capitaine Trébuchet. Nous venons de voir qu’un de ses anciens bateaux faisait le commerce de Guinée. On appelait ainsi la traite des nègres. À la fin du XVIIIe siècle, les armements de la place de Nantes pour la Guinée étaient aussi considérables que ceux de toutes les autres places du royaume, et l’on estimait à deux cents le nombre des armateurs nantais qui faisaient ce honteux trafic. C’est de là que dataient les fortunes scandaleuses dont témoignent encore aujourd’hui les maisons magnifiques qui bordent la Fosse et les deux rives de l’île Feydeau. Il ne faudrait pas croire pourtant que le commerce de « bois d’ébène » fût sans risques et de tout repos. Outre que le prix des esclaves était parfois assez élevé, il était bien rare qu’il ne mourût pas quelques nègres en cours de route, et il suffisait d’une petite épidémie pour perdre le bénéfice de toute une cargaison.
Trébuchet fit-il le commerce de Guinée ? Je ne saurais le dire au juste. En tout cas, ce ne fut pas pour son compte, et, s’il le fit, il appert de ce qui précède qu’il ne lui en resta rien aux doigts.
Dix ans après sa mort, la Terreur régnait à Nantes. Mais les guerres civiles n’ont jamais empêché les tourtereaux de faire l’amour. Pendant que fonctionnaient la guillotine et les bateaux à soupape de Carrier, le major Hugo se liait avec la famille Le Normand et tombait amoureux de Sophie Trébuchet. Comment cela se fit-il ? Si j’interroge le « témoin » de Victor Hugo raconté, il me répond :
« … Ce Trébuchet était un de ces honnêtes bourgeois qui ne sortent jamais de leur ville ni de leurs opinions. Il était resté royaliste et catholique et confondait dans sa religion Dieu et le roi. Comment le soldat de la Convention était-il entré chez le fidèle de Louis XVI ? Je l’ignore. L’armateur veuf avait trois filles, dont une, Sophie, n’était qu’à moitié dans les idées de son père. Elle avait cette indépendance d’esprit et cette personnalité décidée des filles sans mère obligées d’être femmes plus tôt que les autres.
« Elle n’avait la ferveur de son père qu’en politique et elle n’était dévote qu’au trône. C’était encore trop contre le major… »
J’arrête ici la citation : ce n’est qu’un tissu d’inexactitudes. Nous savons déjà que Trébuchet était depuis dix ans dans l’autre monde. Quant à sa fille Sophie, je doute qu’elle ait embrassé avec cette ardeur la cause de Mmes de Bonchamps et de La Rochejaquelein et qu’elle ait fui comme elles à travers le Bocage, en brigande de la Vendée. D’abord les hommes de loi qu’étaient ses oncles Le Normand et Trébuchet, tout catholiques et royalistes qu’ils étaient, faisaient plutôt figure de libéraux à Nantes, et puis, si elle avait été vraiment Vendéenne, Sophie Trébuchet ne se serait pas contentée, quelques années après, de se marier civilement. Tout cela, ce sont des histoires imaginées après coup dans un intérêt qu’on devine, et Victor Hugo, qui s’en est fait l’éditeur responsable, n’aurait pas osé nous dire, au temps de ses odes sur Louis XVII et laVendée, que sa mère, en se mariant, « tenait médiocrement à la bénédiction du curé ».
Pour moi, j’ai la conviction, pour ne pas dire la certitude, que Sophie Trébuchet ne joua aucun rôle à Nantes sous la Terreur et qu’elle n’eut à faire aucun sacrifice, du côté des idées, pour devenir la femme du major Hugo. Son oncle, Louis-Maurice Trébuchet, avait à Saint-Herblain, près la Hérissière, une maison de campagne où sa demi-tante maternelle Rose Le Normand du Buisson s’était retirée avec ses frères et sœurs, pendant la tourmente révolutionnaire. Qui sait si ce n’est pas là qu’eurent lieu la première rencontre et les premiers entretiens de Sigisbert Hugo avec Sophie ? Il était, comme nous l’avons vu, greffier d’une commission militaire qui siégeait au château d’Aux et qui n’était pas tendre aux royalistes traduits devant elle. Or, du château d’Aux à Saint-Herblain il n’y a guère que la traversée de la Loire. Trébuchet eut peut-être l’occasion de porter, comme avocat, la parole devant ce tribunal militaire. En tout cas, il n’est pas possible qu’il ait ignoré, si le fait est vrai, la part prise par Sigisbert Hugo dans la délivrance des vingt-deux femmes de Bouguenais, qu’on s’apprêtait à passer par les armes, car cela fit grand bruit alors dans toute la région.
Je pense donc que les sentiments humains de ce brave soldat lui facilitèrent l’accès de la maison de l’oncle Trébuchet, et que sa belle prestance acheva de lui conquérir le cœur de Sophie.
« Elle était petite, mignonne, des mains et des pieds d’enfant, dit Victor Hugo ; elle avait quelques traces de petite vérole, mais qui disparaissaient dans l’extrême finesse de sa physionomie et dans son regard intelligent. » – C’était plus qu’il n’en fallait pour le toucher, lui aussi, au bon endroit.
Cependant les choses n’allèrent pas toutes seules, et quand le major Hugo demanda la main de Sophie, il semble qu’il ait éprouvé du côté des siens une certaine résistance. Il faut dire qu’il venait d’être rappelé à Paris et que la tante Le Normand, qui avait la garde de la jeune fille, n’était pas fâchée de mettre son amour à l’épreuve.
Victor Hugo prétend que tout s’arrangea, grâce à l’intervention de Pierre Foucher, son futur beau-père, qui était du pays nantais comme les Trébuchet, et que le major avait rencontré, en 1796, à Paris, au conseil de guerre, dont lui-même était rapporteur. C’est fort possible, mais je crois bien que le meilleur avocat fut encore l’amour. Ce qu’il y a de sûr, c’est que Sophie Trébuchet était majeure quand elle épousa Sigisbert Hugo. Cela résulte des affiches mêmes de son mariage :
« Du 13 brumaire an VI de la République Française.
Il y a promesse de mariage :
Entre Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo, adjudant-major du 1er bataillon de la 20e demi-brigade, âgé de vingt-quatre ans, fils de Joseph Hugot (sic) et de Jeanne-Marguerite Michaud, natif de la ci-devant paroisse Saint-Evre-Ville-Vieille, de la commune de Nancy, département de la Meurthe, et domicilié en celle de Paris, département de la Seine, IXe arrondissement, d’une part ;
Et Sophie-Françoise Trébuchet, rentière, âgée de vingt-cinq ans, fille de feu Jean-François Trébuchet et Renée-Louise Le Normand, native de la ci-devant paroisse Saint-Laurent de cette commune et y domiciliée, section de l’Humanité, rue Maupertuis, d’autre part,
Publié et affiché lesdits jour et an. »
Cet acte, que je donne ici pour la première fois, rectifie de lui-même trois erreurs plus ou moins graves qu’Edmond Biré a commises en acceptant comme exacte la version du « témoin » de Victor Hugo raconté. Il établit : 1° que le mariage de Sophie Trébuchet eut lieu, non pas en 1796, mais à la fin de 1797 ; 2° que son père était mort ; 3° que lorsqu’elle se rendit à Paris pour la célébration de son mariage civil, si son père l’accompagna avec son frère, comme le raconte Mme Hugo, ce ne fut que du haut du ciel, sa demeure dernière.
Et voilà comment on écrivait l’histoire de sa famille au foyer du grand poète.
Je ne suivrai pas les nouveaux époux dans leurs pérégrinations militaires à travers la France, l’Italie et l’Espagne, pas plus que je ne parlerai de leur brouille et de leur séparation. Mais je me reprocherais de ne pas dire un mot ici d’une petite découverte que j’ai faite tout récemment dans un livre de Laurent Pichat, qu’on ne lit guère et qui est intitulé les Poètes de Combat. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle a trait à la naissance de Victor Hugo. Si vous ouvrez le tome I de Victor Hugo raconté, vous pourrez lire, pages 26-27, deux lettres du chef de bataillon Hugo et de sa femme au général Lahorie pour lui demander et le remercier de bien vouloir servir de parrain au troisième enfant qu’ils attendaient. Ces lettres, datées de Besançon, 4 pluviôse et 14 ventôse an X, auraient été retrouvées, si l’on en croit Mme Hugo, au ministère de la guerre dans les pièces du procès de Lahorie. Ne les aurait-on pas trouvées plutôt dans les Poètes de Combat qui parurent en 1862, un an avant le Victor Hugo raconté ? Laurent Pichat nous dit, page 367, que ces pièces appartenaient à un ami fidèle qui lui avait permis de les copier, « pensant comme lui que le poète recevrait cette surprise avec plaisir et lirait ces lettres avec joie ». Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’elles ne figurent pas au dossier du procès Lahorie qui est conservé aux Archives nationales. D’où je conclus que le « témoin » de la vie d’Hugo les avait empruntées tout bonnement au livre de Laurent Pichat. Mais pourquoi s’en cachait-il ? Je ne le sais pas, mais je m’en doute : c’est évidemment pour mieux dépister les chiens, que Mme Hugo et son mari imaginèrent la trouvaille du ministère de la Guerre et tronquèrent et truquèrent gauchement le texte de ces deux épîtres. Lisez plutôt la description que Laurent Pichat nous a faite de la lettre écrite au général Lahorie par la mère de Victor Hugo, cette description est aussi intéressante que suggestive :
« La lettre, écrite sur un papier grenu, verdâtre, qui a été tachée de jaune par le temps, était pliée en carré ; à un coin, la poste avait mis le timbre de Besançon en long. Il y avait un cachet assez étrange : il était fait de cire rouge ; au centre, un médaillon portait deux initiales entrelacées ; au-dessus, deux colombes voletaient l’une vers l’autre sous un bonnet phrygien qui couvrait tout ; au bas de l’écusson, un chien était accroupi, et à l’entour couraient des brins de lierre. La devise circulaire était celle-ci : JE MEURS OÙ JE M’ATTACHE. »
N’est-ce pas charmant, et pouvait-on figurer d’une manière plus exacte et plus symbolique les circonstances terribles dans lesquelles s’était accompli ce mariage d’amour ? N’était le bonnet phrygien, on croirait voir une vignette galante du temps de Marie-Antoinette. – Oui, mais quel souvenir douloureux ne devait pas évoquer aussi à l’esprit de Victor Hugo la devise circulaire ! Ce « Je meurs où je m’attache » (quand on se détacha si vite !) fut probablement cause que l’auteur de Victor Hugo raconté se garda de renvoyer le lecteur au livre de Laurent Pichat. Il ne faut jamais, voyez-vous, parler de corde dans la maison d’un pendu !
Quoi qu’il en soit, voici le texte intégral de la lettre de la « femme Hugo » au général Lahorie. On trouvera en regard les changements que le « témoin » crut devoir y apporter.
En tête de cette lettre le général Lahorie avait mis de sa main ces deux mots : « Répondu, accepté. » Or, au commencement de mars de la même année, il reçut cette autre missive dont je donne également le texte et les variantes :
À présent que nous connaissons les origines maternelles de Victor Hugo et les circonstances qui entourèrent sa naissance à Besançon, je vais essayer de déterminer la part des dons qui lui vint du côté des Trébuchet et des Le Normand du Buisson.
Et d’abord il faut que je tranche définitivement une question qui préoccupe depuis longtemps tous ceux qui étudient l’histoire des commencements de la Révolution en Bretagne.
Il y a quelques années, parlant du pamphlétaire d’occasion qu’avait été Volney en 1788, je m’élevai de toutes mes forces contre la légende que M. Barthélemy Pocquet avait accréditée de bonne foi dans un de ses livres et qui représentait l’auteur de la Sentinelle du Peuple comme ayant joué à Rennes le rôle « d’agent supérieur et distingué » des ministres Necker et Brienne.
Je savais déjà que Volney était allié à la famille maternelle de Victor Hugo et qu’en cette qualité il avait offert à la mère du poète de lui léguer, sous la Restauration, son siège de pair de France. Mais j’étais à cent lieues de penser que Victor Hugo et Volney étaient cousins du deux au trois, comme on dit chez nous, par René-Pierre Le Normand du Buisson, procureur présidial de Nantes, et par son fils, le procureur au Parlement de Rennes.
Si je l’avais su, au lieu de m’évertuer à établir que Volney était trop fier de sa nature, et trop indépendant de son caractère, pour s’être vendu jamais à un ministre quelconque, j’aurais dit à M. Barthélemy Pocquet : « Ne cherchons plus les raisons qui amenèrent Volney à Rennes en 1788, et ne nous étonnons plus que la Sentinelle du Peuple fût si documentée et frappât si juste. L’homme qui avait attiré Volney à Rennes au moment des troubles, celui qui lui mit à la main la plume de la Sentinelle du Peuple ne fut autre, évidemment, que Le Normand, procureur au Parlement de Bretagne, lequel habitait, en 1788, place du Palais, à Rennes, c’est-à-dire sur le théâtre même des évènements. »
Voilà donc ce point d’histoire enfin éclairci. Quant au tempérament de Victor Hugo, il n’est pas besoin de mettre des lunettes pour voir qu’il était moins lorrain que breton et plus nantais que bisontin. « On est, disait Alfred de Vigny, du pays où l’on est né et où l’on a remué dans son premier berceau. » Pas toujours, car on naît où l’on peut, suivant le mot d’un homme d’esprit, et l’on est bien davantage du pays de son père et de sa mère, quand on n’a fait que traverser le coin de terre où l’on a vu le jour. Or, si Victor Hugo, qui connaissait à peine Besançon, sa ville natale, avait hérité de son père le culte de Napoléon, l’amour de la gloire, le sens des choses épiques et ces mouvements généreux du cœur qui, à vingt ans, tout royaliste qu’il était, et au risque de perdre la protection du roi, le faisaient offrir un refuge à son ancien camarade Édouard Delon, condamné à mort par contumace pour avoir pris part à la conspiration de Saumur, et toute sa vie le portèrent au-devant des proscrits et des vaincus, – il tenait certainement des Trébuchet et des Le Normand, c’est-à-dire du sang maternel, les merveilleuses qualités d’esprit et d’imagination, sans parler du tempérament de plaideur et de l’entente des affaires, qui ont fait de lui le poète le plus grandiloquent de son siècle, en même temps que l’homme le plus pratique, le plus ordonné, le plus soigneux de ses intérêts.
Du reste, un jour que je dînais chez lui – et Dieu sait si j’étais fier ce jour-là ! – il me dit, en apprenant que j’étais du pays de sa mère : « C’est mon pays de prédilection ! » Il se souvenait, à ce moment, s’il l’avait jamais oublié, que la terre de Bretagne lui avait donné les trois créatures de Dieu qu’il avait le plus aimées en ce monde : sa mère, sa femme et la belle Mme Drouet, qui, après avoir été la muse de son âge mûr, fut la fidèle amie de sa verte vieillesse. Je laisse de côté les deux hommes de génie qui eurent le plus d’influence sur son imagination et sur son âme, à savoir : Chateaubriand et Lamennais.
Peut-être se souvenait-il aussi, quand il me parlait de la sorte, des heures charmantes qu’il passa dans sa jeunesse au bord de la Loire, soit à Saint-Herblain dans la maison de campagne de son grand-oncle, soit dans la compagnie de son cousin germain, le poète Ad. Trébuchet, à qui il ne manqua, pour arriver à la réputation, que de vivre à Paris, et qui, de 1823 à 1825, publia, dans une revue nantaise intitulée le Lycée armoricain, deux fragments de l’Énéide, traduits en vers par Victor Hugo, que recueillit quarante ans après le « témoin » de sa vie. Qui sait même – car nous portons toujours en nous les images dont fut amusée notre enfance – si, lorsqu’il fit à Guernesey, les Travailleurs de la Mer, il n’avait pas dans les yeux les voiles des bateaux de son grand-père qui avaient sillonné la « grande bleue », et s’il ne puisa pas dans ses aventures de voyage racontées par sa mère l’épisode du combat du Gilliat et du Poulpe qui illustre ce livre. En tout cas, il était si bien instruit de ses origines bretonnes, qu’il signa, dans le Conservateur littéraire, quatre ou cinq poésies du pseudonyme de V. d’Auverney, pays natal de son grand-père Trébuchet, et qu’il donna le nom du capitaine Léopold d’Auverney au héros de son roman de Bug-Jargal.
Au surplus, si Victor Hugo avait gardé un bon et fidèle souvenir de Nantes, cette ville l’a payé largement de retour. Elle a donné son nom à un boulevard qui relie la Sèvre à la Loire. Il n’est pas jusqu’au nom de Trébuchet qui ne soit porté encore, comme pour perpétuer la mémoire de sa mère, par une maison à Saint-Fiacre, par des moulins à vent du côté de Saint-Herblain et, dans Nantes même, par des parents éloignés, très fiers de se dire de son lignage. La maison Trébuchet à Saint-Fiacre sert aujourd’hui d’école, les moulins à vent de Saint-Herblain tournent je ne sais pour qui, mais ce n’est pas pour les Trébuchet, car les derniers représentants du nom sont dans une situation qui fait moins envie que pitié, et j’en ai connu deux en cheveux blancs à qui, de loin en loin, Victor Hugo faisait passer un petit secours. On a beau être avare et ménager de sa bourse, il y a tout de même des cas où richesse oblige presque autant que noblesse.
Victor Hugo fut-il appelé ainsi par Chateaubriand ? – Sainte-Beuve dit oui et Edmond Biré dit non. – Le pour et le contre. – M. Ch. de Loménie dément les propos que l’on prêtait à son père. – « L’enfant sublime » cité par Tissot et Alexandre Guiraud. – Les rapports de Chateaubriand avec Victor Hugo après 1830. – L’Hymne aux morts de Juillet mis en musique par Hérold. – La démolition projetée de Saint-Germain-l’Auxerrois. – Chateaubriand proteste à ce sujet contre le silence gardé par Victor Hugo. – Il attaque encore les romantiques dans son Essai sur la littérature anglaise (1836). – Le retour des Cendres de l’empereur. – Lettres échangées à cette occasion entre Victor Hugo et Chateaubriand. – Les Mémoires d’Outre-Tombe et Lamartine. – L’ascendant de Victor Hugo sur ses camarades. – Ce que Lamennais aimait surtout en lui. – Du pouvoir de la volonté. – Curieuse expérience de Victor Hugo chez Bertin l’aîné. – « L’ange Victor » de Sophie Gay. – Opinion de Victor Hugo sur la virginité de l’homme au moment de son mariage. – Il ne veut pas que l’on appelle sa femme par son prénom d’Adèle. – Lettre inédite de Sainte-Valry à Jules de Rességuier sur la précocité en tout de Victor Hugo. – Le revers de la médaille. – Défauts du caractère de l’enfant sublime. – Un mot du Globe en 1825. – Bonaparte et Victor Hugo.
Une légende, qui remonte à 1820, veut que Chateaubriand, après avoir lu l’ode de Victor Hugo sur la mort du duc de Berry, ait exprimé son admiration pour le jeune poète en le qualifiant d’enfant sublime. Ce mot était trop glorieux pour n’être pas recueilli comme un trophée par celui auquel il s’adressait. Le « témoin » de Victor Hugo raconté





























