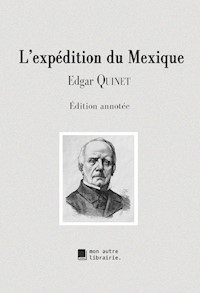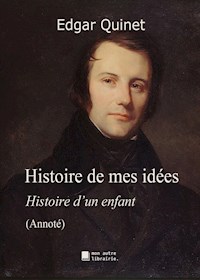Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "Une année nouvelle s'ouvre devant nous ; elle réclame de nous un esprit nouveau. C'est une condition particulière à l'homme qui paraît dans ces chaires, que son auditoire rajeunit et se renouvelle constamment autour de lui. Dans toutes les autres assemblées, le temps pèse presque également sur celui qui parle et sur ceux qui écoutent ; on vit et on vieillit ensemble..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049732
©Ligaran 2015
Il manquerait à ce livre une chose importante pour moi si je ne vous le dédiais pas, à vous, mon ami et mon frère de cœur et de pensée. Depuis le premier instant où nous nous sommes connus, par quel hasard est-il arrivé que, séparés ou rapprochés, nous n’ayons cessé au même moment de penser, de croire, et souvent d’imaginer les mêmes choses sans avoir eu besoin de nous parler ? Cet accord de l’âme a toujours été pour nous la confirmation du vrai ; depuis vingt ans ce combat nous réunit, et c’est le combat éternel qui ne finira qu’en Dieu.
Vous le savez comme moi ; cet ouvrage est la suite du plan que j’ai conçu en commençant d’écrire, et dont les parties précédentes sont : le Génie des religions, l’Essai sur la vie de Jésus-Christ, une moitié de notre livre des Jésuites, l’Ultramontanisme. Dans cette carrière non interrompue, j’ai traité de la Révélation et de la Nature, des traditions de l’Asie orientale et occidentale, des Védas et des Castes, des religions de l’Inde, de la Chine, de la Perse, de l’Égypte, de la Phénicie, du Polythéisme grec. J’ai suivi, à travers leurs principales variations, le Mosaïsme, le Christianisme des apôtres, le Schisme grec, l’Islamisme, la Papauté au Moyen Âge, la Réformation, la Société de Jésus, l’Église gallicane, les rapports de la Révolution française et du Catholicisme ; en sorte que ces ouvrages, différents de formes, mais semblables par le but, tendent à composer une histoire universelle des révolutions religieuses et sociales.
Si dans cette marche vers un but aperçu de loin, j’ai fini par rencontrer avec vous des adversaires ardents, ils n’ont exercé aucune influence sur la nature et le caractère de mes idées non plus que sur les vôtres. Je me suis appliqué à suivre d’une manière imperturbable le projet que j’avais formé, dans le temps où je ne comptais pas un seul ennemi. Déterminé seulement à ne pas dévier devant les difficultés qui surgissaient, je ne les ai combattues qu’autant qu’elles se liaient à cette grande polémique que chaque siècle soutient contre ceux qui l’ont précédé. Sans nulle haine contre les personnes, je pense même que l’opposition qui m’a été faite m’a été utile, lorsqu’elle n’a pas dégénéré en violence. Pour vaincre ces contradictions systématiques, j’ai dû veiller plus attentivement sur moi-même, ne rien avancer qui ne fût, de ma part, une conviction profonde, m’entourer de preuves, d’évidence, me passionner pour la vérité seule, certain que tout le reste, artifices de langage, ornements de style, futiles parures, me serait disputé sur-le-champ.
Si j’eusse écrit pour une académie, dans le fond de la retraite, sans qu’aucun ennemi épiât mes paroles, j’aurais dit au fond les mêmes choses ; mais peut-être ne les eussé-je pas assez trempées dans le plus intime de mon cœur ; j’aurais pu m’amuser à parer ce qui doit être nu. Au lieu qu’obligé, chaque jour, de porter moi-même ma parole en public, à la face de mes ennemis déclarés, je tiens pour assuré que cette sorte d’épreuve morale et immédiate m’a forcément ramené à ce qui est le nerf de mon sujet.
Dans nos mœurs modernes, l’écrivain retiré dans sa bibliothèque, sans contradicteur, ne court qu’un seul péril, qui est de se donner trop aisément raison ; cette volupté l’énerve. Un moment d’une lutte à outrance est nécessaire dans ce métier, le plus dangereux de tous, pour la santé de l’âme. Je remercie donc le ciel de m’avoir enlevé à une volupté redoutable. Quand les inimitiés se sont prononcées, loin d’éprouver aucun ressentiment, j’ai accepté de grand cœur l’occasion de lutter avec moi-même et de m’avancer dans la vérité, par le besoin même de m’y fortifier. Temps étrange que celui où toute élévation morale passe aisément pour un commencement de sédition !
En traçant ces mots, je sais d’avance, mon ami, que j’exprime votre propre pensée. Le témoignage de notre intimité m’a toujours paru la meilleure partie de notre enseignement. Si quelqu’un se trouve touché par ce livre, je désire qu’il se dise : Voilà deux hommes qui ont été constamment occupés des mêmes choses ; et leur amitié n’a fait que s’accroître jusqu’à la mort.
E. QUINET.
Paris, ce 23 juillet 1845.
Introduction. – Deux systèmes : un Dieu mort, un Dieu vivant. Principe de la critique littéraire : rapports des littératures et des institutions religieuses. – Aperçus du sujet. – Pourquoi la révolution d’Espagne est stérile. – Accord de la servitude religieuse et de la servitude politique. – École des nouveaux Guelfes en Italie : idéal de liberté, fondé sur la censure. – Les deux papes du dix-neuvième siècle. – Rome et la Russie. – De la famine morale chez un peuple.
MESSIEURS,
Une année nouvelle s’ouvre devant nous ; elle réclame de nous un esprit nouveau. C’est une condition particulière à l’homme qui paraît dans ces chaires, que son auditoire rajeunit et se renouvelle constamment autour de lui. Dans toutes les autres assemblées, le temps pèse presque également sur celui qui parle et sur ceux qui écoutent ; on vit et on vieillit ensemble. Ici, au contraire, les jours ne s’accumulent que d’un côté ; la jeunesse, l’âge mûr, la vieillesse, à son tour, se succèdent chez l’orateur. De votre côté, au contraire, le printemps de l’année reverdit chaque saison ; avec lui, la curiosité de l’esprit, l’espérance, l’audace de la pensée demeurent ce qu’elles étaient ; en un mot, la vie, qui coule pour moi, reste inépuisable pour vous ; quand je ne serai plus, vous aurez la même jeunesse qu’aujourd’hui ; en tant qu’auditoire renouvelé d’année en année, de génération en génération, vous ne périrez pas.
Ce partage, serait trop inégal si, tandis que vous jouissez d’un présent permanent, le passé qui se creuse derrière moi était perdu pour moi ; je dois au contraire supposer que les paroles que j’ai prononcées ne sont pas mortes, que l’âme que j’ai cherché à répandre vit encore, ne fût-ce que dans un petit nombre d’entre vous. Et par là seulement peut s’établir la continuité de l’enseignement, qui est l’image de la vie elle-même. Ils sont loin d’ici, dispersés selon les vues de la Providence, ceux au milieu desquels j’ai commencé, à Lyon, la carrière d’idées que je poursuis ici ; d’autres les ont remplacés qui à leur tour ont disparu. Aujourd’hui, je suis nouveau pour un grand nombre d’entre vous ; et pourtant je dois supposer que vous me connaissez tous, et que, malgré le changement des années, il reste ici debout un esprit qui garde au moins un souvenir de ma pensée. Autrement, quelle serait ma tâche ? Refaire ce que j’ai déjà fait, redire ce que j’ai déjà dit, tourner dans un cercle sans issue.
Cet auditoire, je l’ai toujours considéré comme un être moral qui conserve la mémoire et me permet ainsi de faire chaque année un pas nouveau au-devant de la vérité. D’un côté, ce qu’il y a de durable dans la parole sincère germe dans quelques esprits qui représentent pour nous ici les années écoulées ; de l’autre, des auditeurs nouveaux qui ne font qu’entrer dans la vie, appellent avec impatience une nouvelle phase dans notre enseignement. Laissons donc l’ancien rivage, les anciens sujets, aspirons avec cette génération nouvelle d’auditeurs à une autre génération de faits et d’idées ; surtout élevons et agrandissons de plus en plus notre pensée.
Cette méthode est celle de la nature elle-même ! Le flot marche et reflète un autre ciel ; l’ancienne sève circule dans les plantes rajeunies ; l’esprit de l’homme restera-t-il immobile ? Cela serait plus facile, mais cela serait déchoir au-dessous de la nature morte. Je ne sais si nous avons fait quelque chose, mais je le compte pour rien auprès de ce que nous avons à faire ; ne nous amusons pas à recommencer notre passé ; au lieu de nous réjouir dans nos œuvres en commun, comme dans un pécule amassé, prenons plutôt pour devise le mot d’un grand penseur américain : Le vieux est fait pour les esclaves !
Toutes les luttes, tous les systèmes religieux, politiques, philosophiques, littéraires, qui agitent aujourd’hui le monde, se réduisent nécessairement à deux. Dans l’un de ces systèmes on pense qu’à partir d’un certain moment tout est fini dans la nature et dans l’esprit, que la Bible est close, que l’éternité n’y ajoutera pas une page, que le souffle de Dieu ne se promène plus dans l’infini, que certains siècles ont usurpé toute la sagesse, toute la beauté d’un peuple, d’une race d’hommes, et qu’il ne reste plus qu’à les contrefaire, en un mot, que la terre déshéritée, orpheline, est un sépulcre divin, où chaque génération vient écrire à son tour de son sang et de ses larmes l’épitaphe d’un monde.
D’autres pensent, au contraire, que chaque jour, chaque instant renferme une création, que le soleil qui a lui dans la Genèse se lève sur vos têtes avec sa splendeur immaculée, que si quelques hommes sont las, Dieu n’est pas découragé comme eux, qu’il n’a pas fermé au Moyen Âge les portes de son Église, qu’il n’est pas fatigué de tourner les pages du livre de vie, qu’il n’est pas perpétuellement assis, immobile sur l’escabeau de David, mais qu’il se promène à travers les créatures, évoquant à chaque instant par leur nom, des choses, des faits, des peuples, des générations nouvelles.
Sans entrer aujourd’hui au fond de ces systèmes de découragement ou d’espérance, je demanderai seulement si tout est fini, si l’action divine est arrêtée, pourquoi cette génération nouvelle vient-elle frapper à la porte de vie ? Pourquoi est-elle sortie du néant ? Où était-elle il y a moins de vingt ans ? Que vient-elle faire ici ? Que demande-t-elle sous le soleil ? Pense-t-on qu’elle arrive sans mission, sans vocation ? Pour moi, je pense que qui la considérerait bien trouverait qu’elle porte sur le front la trace d’une pensée qui surgit avec elle, pour la première fois dans le monde.
Que ces nouveaux venus nous disent s’ils sont las des années qu’ils n’ont pas vécu ! Qu’importe que l’antiquité, le Moyen Âge, la féodalité, les temps modernes, Napoléon, les invasions de 1814 et de 1815, aient précédé leur berceau ! Le fardeau des temps passés les empêche-t-il d’entrer la tête haute dans la vie nouvelle ? Pourquoi leur sang courrait-il moins vite dans leurs veines qu’au temps de la chevalerie ou de Louis XIV, ou des armées de la république ? Chaque génération avant eux a fait son œuvre ; ils ont aussi la leur, dont ils portent le type sacré en eux-mêmes. À leur arrivée sur la terre, les vieillards leur disent : « Faites comme nous, le monde est vieux. Rome, Bysance, l’Égypte pèsent sur nos fronts ; le siècle de Louis XIV a tout écrit. L’Église de Grégoire VII a muré ses portes ; tout est consommé ; vous arrivez trop tard au lendemain des jours de vie ; nous ne connaissons qu’un Dieu mort ; asseyez-vous avec nous dans la tombe éternelle. »
Mais eux, au contraire, sentant l’impulsion encore neuve de celui qui les envoie, donnent intérieurement un démenti à cette prétendue lassitude de l’esprit créateur. Le moment où ils s’éveillent à la vie de l’âme, de l’intelligence, ce moment est, en soi, aussi fécond, aussi sacré qu’il l’a été dans aucune époque ; il contient le même infini que nos pères n’ont ni épuisé, ni diminué. Écoutez en vous-même ! le réveil de l’âme sous l’arbre de la science est aujourd’hui aussi plein d’avenir qu’il a pu l’être au commencement des choses. La terre n’est pas fatiguée de se mouvoir ni la sève de monter ; pourquoi l’esprit de l’homme serait-il fatigué de chercher, d’aimer, de penser et d’adorer ? Les générations ont beau passer, la coupe de vie ne diminue pas pour les abreuver les unes après les autres ; tout homme qui arrive en ce monde est fait pour être le roi, non pas le serf du passé.
Ah ! si l’histoire en s’accumulant sur notre Occident, si cette érudition qui pèse sur notre Europe, si la lecture et l’étude de ce qui a été imaginé, exécuté avant nous, devaient nous dispenser d’agir, de penser et d’être à notre tour ; si nous acceptions cet héritage comme un fils de famille qui se repose dans les actions de ses ancêtres, je croirais que toute cette science n’est qu’un don trompeur et empoisonné, puisque son premier résultat serait de nous faire oublier de vivre ; et je craindrais que le Midi, en particulier, ne finît par s’ensevelir sous un fardeau de rites, de formes, de livres et de souvenirs immobiles. Mais, en considérant les choses de plus près, je vois comment l’individu peut porter en soi l’histoire du genre humain sans en être accablé.
Les naturalistes ont trouvé que l’homme physique, avant de naître, traverse l’échelle des formes inférieures de la vie, jusqu’à ce qu’il ait, pour ainsi dire, conscience de la nature entière. Il en est de même de l’homme qui naît à la vie morale ; il passe à travers toutes les formes, toutes les régions de l’histoire ; et le chef-d’œuvre de son éducation, qui ne finit qu’à la mort, est de représenter dans cette ascension de vie l’humanité accumulée et développée dans son esprit. Il a un âge dans lequel il ressemble, traits pour traits, sur les genoux de sa mère, à l’humanité orientale, sommeillant en Dieu ; il en a un autre, où, dans l’élan de l’adolescence, il personnifie la Grèce ; puis, avec la maturité, apparaît chez lui l’homme moderne. Plus il rassemble en lui-même de ces traits divins, disséminés dans la constitution du genre humain, à travers le temps, plus sa vie est puissante.
Imaginez un homme qui, suivant les époques de sa carrière, aurait senti la grandeur de la nature comme Moïse sur l’Oreb, qui aurait eu l’amour désintéressé de la gloire comme un artiste grec, qui aurait aimé son pays comme un Romain, l’humanité comme un chrétien, qui aurait senti l’enthousiasme de la foi comme Jeanne d’Arc, l’enthousiasme de la raison comme Mirabeau, et qui, sans se laisser arrêter sur aucun de ces degrés du passé, continuerait de développer en lui la sève de l’esprit ; cet homme-là, vrai miroir de l’humanité, en mourant pourrait dire : J’ai vécu.
Si nous voulons nous-mêmes nous conformer à ces idées, quel sujet choisirons-nous pour l’occupation de cette année ? Il ne faut pas que nous le choisissions ; il faut qu’il nous soit donné par la nature des choses, c’est-à-dire, qu’il soit d’un côté plus vaste que ceux que nous avons traités, et que de l’autre il tienne plus intimement encore au génie des sociétés que nous devons représenter ici.
Ma situation à cet égard est particulière. La chaire que j’occupe est nouvelle ; personne ne m’y a précédé, d’où il résulte que mon devoir est surtout d’en poser les fondements : je ne puis descendre trop avant dans le principe de la civilisation de l’Europe du Midi. Il ne me suffit pas d’avoir parlé isolément de l’esprit de certains peuples de l’Italie, de l’Espagne, de la Grèce, d’avoir remué les noms et les œuvres de Dante, de Machiavel, de Camoëns, du Tasse, de Bruno, de Campanella : il faut encore montrer le lien, l’âme qui rassemble ces hommes et ces peuples, établir le rapport du Midi avec la France, avec le Nord, et marquer la condition et la mission de l’Europe méridionale dans le monde moderne.
Or, rien de cela n’est possible, et l’on se condamne à flotter toujours à la surface des choses, si l’on n’embrasse, une fois, dans une même vue, les révolutions religieuses, dont les institutions politiques, les littératures et les arts sont une conséquence. Ces révolutions religieuses, ces orages qui, a de certaines époques, s’élèvent dans le dogme et semblent d’abord tout bouleverser, c’est l’esprit de vie qui recommence à souffler sur la mer stagnante. L’homme qui s’est fait son abri recule devant cette tempête ; ses cheveux se hérissent de peur ; il croit que l’orage divin va tout emporter ; mais peu à peu l’abîme se tait, les haines s’apaisent. Du sein du dogme agrandi sort une création, c’est-à-dire une époque nouvelle ; un nouveau fiat lux a été prononcé ; des institutions, des poèmes, un autre idéal social jaillissent de cette lumière de l’esprit.
Quand j’ai eu à parler d’Homère et de Platon, il a paru indispensable de remonter à la mythologie ; comment, en parlant des poètes, des historiens, des législateurs chrétiens, pourrais-je m’abstenir de parler du christianisme ? Retranchez-moi l’église, dans sa plus grande acception, l’âme de mon sujet disparaît. Que voulez-vous que je vous dise de l’Italie sans la papauté, de Caldéron sans le catholicisme, de la philosophie espagnole sans Louis de Grenade et sainte Thérèse, de l’Amérique sans les dominicains, de l’Alhambra sans l’islamisme, de Bysance sans la religion grecque, des institutions d’Alphonse sans les conciles, de Philippe II sans la réforme, de l’Orient sans Mahomet, du monde sans l’Évangile ? Ce serait prendre le corps et abandonner l’esprit. Dans les derniers temps, nous avons traité du jésuitisme, puis d’un système plus vaste, l’ultramontanisme. Aujourd’hui, poussé par la nature des choses, notre sujet s’accroît encore ; nous parlerons des révolutions religieuses dans leurs rapports avec la civilisation et les lettres du Midi en particulier, et de la France en général.
Je veux toucher, dans sa sublime innocence, cette église primitive, et la comparer à ce qu’elle est devenue ; je veux voir de près cet idéal qui se lève sur les berceaux des sociétés modernes, mesurer jusqu’à quel point chaque peuple l’a réalisé dans ses pensées écrites et dans ses entreprises ; car, chaque peuple chrétien, en naissant, est un apôtre qui a sa mission particulière ; tous cheminent en semant la parole ; quelques-uns finissent par le martyre.
Comment l’évêque de Rome est-il devenu le chef de la catholicité ? Par quelles phases a passé ce pouvoir extraordinaire, qui a été si longtemps toute l’âme du Midi ? Comment cette dictature du royaume de l’esprit a-t-elle été acceptée et brisée ? Pourquoi l’église grecque s’est-elle si vite séparée, et quelles destinées cette scission a-t-elle préparées à la Grèce moderne et à la Russie ? Comment l’œuvre accomplie dans Bysance a-t-elle son retentissement dans Moscou et dans Saint-Pétersbourg ? D’autre part, je veux voir naître du judaïsme et d’une hérésie chrétienne la puissance du Coran. Le choc et souvent le mélange de l’islamisme et du catholicisme, me montreront l’Espagne dans sa langue, dans ses lois, dans sa politique ; je me rappellerai que j’ai lu ses poètes dans l’Alcazar de Séville et dans le Généralife de Grenade. Je m’arrêterai avec joie dans cette Arabie chrétienne. Mais nous ne connaîtrions pas le Midi si nous ne l’opposions au Nord. Le grand divorce du Nord et du Midi éclate dans la réformation ; l’Espagne et l’Italie nous seront alors expliquées par leurs opposés, l’Allemagne et l’Angleterre. Nous suivrons ainsi le grand flot des choses divines et des révolutions religieuses, jusqu’à ce que nous arrivions à la révolution française, où nous trouverons l’abrégé et le sceau de toutes celles qui l’ont précédée ; arrivant enfin à nous-mêmes, nous chercherons s’il n’est pas des indices de réconciliation dans le genre humain, après tant de discordes divines. Telles sont, résumées en un mot, les choses dont nous nous occuperons, ce sont, pour ainsi dire, les idées nourricières de l’humanité moderne.
Ne vous effrayez pas de la grandeur de ces objets ; plus ils sont grands, plus ils sont simples. Je les aborde avec plaisir, pensant qu’ils nous serviront à nous élever nous-mêmes. Laissons, dépouillons les petites préoccupations ; entrons ici sans fiel, comme des hommes libres de haine, qui ne cherchent rien, ne demandent rien, que le joug de la vérité.
Avant de nous engager dans ce vaste passé, jetons un regard sur le système actuel des peuples du Midi de l’Europe. Que fait l’Espagne ? Ce qui m’a le plus étonné en l’étudiant, en la parcourant, a été de me convaincre qu’au milieu d’une révolution qui devait tout changer, l’ancienne intolérance religieuse est restée debout dans la loi. L’intolérance du Moyen Âge est demeurée la religion de l’état nouveau ; on a déplacé les noms, on a renversé des murailles, ou a châtié des pierres ; mais, dans l’esprit du dogme sur lequel repose l’Espagne nouvelle, rien n’a changé. Encore aujourd’hui, à l’heure où je parle, nul ne peut écrire un article de journal, sur un sujet religieux, sans avoir le consentement du clergé. Et de là qu’arrive-t-il ? On a cru pouvoir détruire la servitude politique en laissant subsister la servitude religieuse ; la première renaît nécessairement de l’autre.
Vit-on jamais pareil spectacle ! Un peuple se jette témérairement dans l’avenir, il menace de tout renouveler ; et il commence dans le préambule de ses institutions nouvelles, par se refuser l’examen ! De là, dans ce chaos, malgré son élan héroïque, il ne trouve pas une idée, une pensée, dont il puisse, en se sauvant, aider le genre humain. L’Espagne, aujourd’hui, a des poètes pleins de fantaisie, mais elle attend encore qu’il lui soit permis de penser. Douleurs infécondes ! sang versé qui ne produit que des larmes ! on s’agite en aveugle, on tourne dans l’enceinte d’un dogme immobile, sans pouvoir découvrir une issue, et toujours, comme dans un vertige, on retombe sous la même conséquence, l’ancien despotisme politique, ombre inséparable du despotisme spirituel. Là où le prêtre peut dire à un peuple entier : Donne-moi ton esprit sans examen ; le prince, par une logique infaillible, redit aussitôt : Donne-moi ta liberté sans contrôle.
D’autre part, que se passe-t-il en Italie ? Depuis Dante jusqu’à Ugo Foscolo, l’esprit avait toujours réagi là contre ses liens ; l’histoire de la philosophie italienne est l’histoire de l’héroïsme de l’intelligence. Aujourd’hui un assez grand nombre d’écrivains, sans plus combattre, las de chercher, se réfugient dans le sein de Rome ; le peuple s’étonne de la retraite précipitée de ces hommes ; il ne comprend rien aux espérances que leurs livres contiennent. Là on promet aux Italiens la couronne du monde s’ils veulent être le peuple sacerdotal par excellence, c’est-à-dire que l’on remonte, par amour du progrès, jusqu’aux castes des Indiens. Mais c’est le génie du découragement qui parle, au lieu de l’accent de l’espérance ; il y a je ne sais quoi de brisé dans ce rêve de la philosophie des nouveaux Guelfes ; c’est le rêve de la philosophie enfermé dans le Spielberg, et l’on y sent les traces, non pas des chaînes, mais des idées autrichiennes. Le plus libéral, le plus audacieux de ces esprits, fonde sa charte ultramontaine, sa chimère de liberté, sur quoi ? sur la censure.
Illusion des ruines chez ces esprits trompés par le mirage du passé ! l’Italie se cherche aujourd’hui dans le fantôme de Grégoire VII, comme au Moyen Âge elle se cherchait dans le fantôme de César. Les Gibelins n’ont pas ressuscité César, les nouveaux Guelfes ne ressusciteront pas Grégoire VII. Il faut se réveiller de ce songe de mille années, et, s’il est un salut, le chercher en soi-même, dans ce qui est, et non dans ce qui fut, dans le moindre cœur qui bat plutôt que dans l’urne de César, de Pompée ou d’Hildebrand.
Je vois aujourd’hui l’esprit du Midi et du Nord, à demi dominé par deux théocraties, deux papautés de formes diverses ; l’une, ancienne, qui essaie de renaître et qui a son foyer dans Rome ; l’autre, nouvelle, qui se prépare en silence et a son Vatican dans Pétersbourg. Dans le principe de toutes deux, l’autorité temporelle et l’autorité spirituelle sont identifiées, puisque le pape et l’empereur se confondent dans le souverain de Russie. D’un côté est un vieillard auquel on essaie de rendre l’ambition et l’espérance perdues ; au bruit des hymnes du Moyen Âge, il attend de nouveau que le monde se soumette. De l’autre est le pape slave, soldat et prêtre, qui, debout sur le front de son clergé, créant et imposant des liturgies, livrant un peuple entier à ses autodafé, convoite aussi, au nom de l’esprit, la suprématie universelle.
Pourquoi ces deux figures de l’absolutisme spirituel recommencent-elles à paraître ? pourquoi le Midi et le Nord nous pressent-ils, l’un de son passé, l’autre de son avenir ? Pourquoi ces immenses, ces colossales ambitions se dressent-elles autour de nous ? Pourquoi les morts viennent-ils redemander l’héritage intellectuel et libre des vivants ? Il faut bien le dire, – parce que nous ne vivons plus d’une vie assez forte, parce que nous semblons languir de cœur et d’âme, parce que nous ne faisons pas tout ce que nous pourrions faire, parce que nous ne sommes, ni comme individus, ni comme peuples, tout ce que nous pourrions être, parce que nous ne portons plus assez haut ni avec assez d’audace le drapeau de l’esprit.
On voit de loin, sous un souffle néfaste, pâlir le génie de la France ; alors au Nord et au Midi on croit déjà que tout est fini, et d’étranges héritiers se lèvent pour enlever, pendant la nuit, la couronne de la civilisation au chevet de la France endormie.
Combien de fois n’a-t-on pas dit et répété, qu’après tout nous n’avions rien à redouter de l’esprit du Nord, parce qu’il est pauvre et que, nous, nous sommes riches ? là-dessus nous avons travaillé presque unanimement à nous enrichir encore. Mais la Providence veut nous donner de nouveau un grand avertissement. Elle vient d’ouvrir sous nos yeux à cette Russie qu’on disait si misérable, si incapable de solder une armée, dans l’Oural, des mines d’or plus riches que les mines du Pérou ; ce n’est donc pas notre argent tout seul qui pourra nous sauver ni nous relever, ni nous maintenir arbitres entre le Nord et le Midi. Ne jouons pas l’avenir, à croix ou pile, dans une partie de bourse dont le pape et l’empereur seraient les partenaires. Rien n’est changé pour nous ; ce qui nous fera gagner la partie, c’est ce qui nous l’a fait gagner hier : c’est notre pensée, notre vie morale, notre liberté, notre attente de l’avenir, notre âme française. Puisez dans cette source sans crainte, elle est plus profonde et plus riche que les puits de l’Oural.
Certes, ils sont bien inspirés ceux qui, frappés des infirmités et de la misère physique du plus grand nombre, cherchent à apaiser autour d’eux la faim du corps. Chaque jour voit naître sur ce sujet un nouveau système, et c’est là un des traits les plus nobles de notre temps. Ceux que la pitié laisserait tranquilles, sont réveillés dans la nuit par l’esprit de précaution, car tous savent que lorsque le cri de famine surgit du fond d’un peuple, c’est le signal d’un grand changement pour les États. Mais la faim de l’âme, la faim de l’esprit, n’est-ce rien de redoutable ? Lorsqu’elle commence à travailler une nation, c’est aussi là une chose qui devrait empêcher de dormir.
La France est trop accoutumée à la grandeur pour mendier dans la rue sa vie morale. Aucun cri ne sort des entrailles de ce peuple ; il marche la tête droite et en silence, et pourtant je jure qu’il a faim, qu’il a faim du pain de l’âme, que depuis longtemps il n’a pas été nourri de vérité, de loyauté, d’espérance, d’honneur, de sympathies et de cette pure gloire qui apaise ou qui trompe sa soif. Ce n’est pas tout que d’avoir pitié du corps, l’esprit aussi finira par crier si trop de gens s’entendent pour le laisser mourir.
Quand la tribune était un grand enseignement politique et moral, distribué à la France et au monde, on n’avait pas besoin de dire de pareilles choses ; mais les temps sont changés, et il faut bien qu’elles éclatent quelque part.
Toute la question, au point de vue le plus philosophique, est de savoir ce que l’on attend, ce que l’on demande, ce que l’on espère de la France. Si l’on pense que ce pays n’a plus rien à faire dans le monde qu’à thésauriser dans sa vieillesse, à reproduire par le droit divin de l’or les inégalités du passé, à rejeter la révolution comme une fausse monnaie, alors, il est juste, il est sage, il est conséquent de vanter, d’imposer à cette France humiliée l’humiliation de la raison humaine ; il est convenable, si l’on se repent de la révolution, de déclarer l’esprit humain révolutionnaire et factieux ; pour de semblables résultats il faut de semblables théories. Mais si l’on pense, au contraire, que la France doit continuer et étendre son œuvre, qu’elle doit tôt ou tard relever la tête, que sa mission n’est pas finie ; qu’elle doit réconcilier un jour l’esprit du Nord et l’esprit du Midi ; alors, il faut aussi continuer, non pas recommencer la vie spirituelle, il faut compter sur les énergies de l’âme, il faut croire à une nouvelle ère de l’intelligence ; il faut chercher, tous ensemble, de nouvelles sources morales.
Je sais bien que la société qui vous entoure a peine à croire à l’espoir, à l’avenir : elle vous décourage à chaque pas, elle vous contredit ; elle voudrait, en vous communiquant sa vieillesse prématurée, vous ôter le droit de vivre. Résistez dans ce premier combat ; c’est dans cette lutte que vous devez grandir. Vous êtes la source nouvelle, ne la laissez pas souiller dès le premier contact. Ah ! si chacun de vous savait ce qu’il possède en lui-même, ce qu’il a fallu de siècles, de sang versé dans les batailles, de courage, de lumières, de génie, de vérités, pour former et tremper dans son sein son âme française, il ne la rendrait pas aisément prisonnière, dès le premier conflit. Ceux qui vous précèdent du moins ont quelque raison de vouloir s’arrêter ; ils ont vu de grandes choses, la révolution, l’empire, et leur attente est satisfaite. Mais nous, messieurs, pour la plupart, qu’avons-nous vu ? trois jours de juillet. Ah ! trois jours de vérité dans une vie humaine, cela ne suffit pas.
Objections préliminaires. – De la tactique en matière de philosophie et de religion. – Un danger pour l’esprit français : les habitudes parlementaires appliquées aux affaires de l’esprit. – Conditions imposées à l’éclectisme par ses origines. – Fausse capitulation qu’il propose entre la science et la foi. – Il faut une religion pour le peuple : les privilégiés de la lumière, les prolétaires des ténèbres – La fin du monde moral. – Quelque chose se meurt : l’idéal doctrinaire.
Dans la voie où nous entrons, une chose inévitable est que nous rencontrions de nouveaux adversaires ; ils serviront à marquer notre progrès. Nous devons, tôt ou tard, rassembler contre nous presque également, ceux qui veulent l’immobilité dans la foi ou dans la science, dans l’Église ou dans la philosophie. Sans vous en étonner, ni vous en plaindre, déjà pour peu que vous ayez prêté l’oreille dans ces dernières années, vous avez pu entendre une voix qui, prenant des accents différents dans des bouches différentes, nous répète un certain nombre d’objections, dont le sens équivaut à ceci : « Arrêtez-vous ! les questions sont effrayantes ; le cœur nous manque. Votre ligne est trop droite ; vous n’usez d’aucune tactique, d’aucun stratagème. Imprudents, qui voulez porter la philosophie dans la vie, au cœur des difficultés de notre temps ; elle ne peut vous y suivre ; elle doit se réduire à subsister au centre d’une formule, sans entrer dans l’âme des peuples et des générations. Jusqu’ici, nous nous sommes contentés de vous renier ; faites un pas de plus au-devant de la vérité, et nous vous jetterons à notre tour l’interdit philosophique par toutes nos bouches. » Cette voix, n’est celle d’aucun individu de notre temps. C’est la voix d’un système, le cri de l’éclectisme.
Pour que tout le monde soit à son aise dans une pareille affaire, nous devons, dès notre premier mot, nous expliquer sur nos relations avec cette doctrine, et sur les objections qu’on en déduit contre nous. On tend, depuis des années, sous nos pas, l’éclectisme comme un lacet ; arrêtons-nous un instant pour le dénouer ; nous marcherons plus sûrement, quand nous aurons foulé l’embûche.
Plus j’y pense, plus je me persuade que le plus grand danger pour l’esprit de la France serait de prétendre appliquer aux questions immortelles dont nous nous occupons, la tactique, les habiletés souterraines qui deviennent de plus en plus la règle des assemblées politiques de notre temps. Là, pour obtenir un triomphe d’une semaine, une vérité d’un jour, on feint de s’entendre, lorsqu’en secret on ne cherche qu’à se supplanter ; on forme des coalitions de haines ; l’un renonce à une moitié de sa croyance, l’autre l’abandonne tout entière, et bien souvent l’alliance se consomme dans le néant.
Cet art de lier les volontés sans posséder les convictions peut être un résultat nécessaire des institutions nouvelles. Qu’arriverait-il si, chaque jour, au grand soleil, cet exemple, entrant peu à peu dans les mœurs des peuples nouveaux, était appliqué aux affaires de l’esprit et de l’intelligence pure ? nous tomberions fort au-dessous de Byzance. À mesure que d’un côté, la tactique, le stratagème, l’habileté négative menacent de tout absorber, de l’autre, le philosophe, le penseur moderne, celui qui aspire à ce nom, doit montrer plus de véracité, moins d’ambages que ses devanciers, moins de voiles, plus d’inflexibilité dans le vrai. Oui, sauvons des embûches des fausses trêves, de la honte des vaines et frauduleuses réticences, la sainte politique des idées ; que celle-là succombe, tout est perdu. Qu’elle se maintienne droite et haute, tout est sauvé et réparé.
Mais en disant trop franchement la vérité, vous perdrez des alliés qui vous auraient suivi, si vous aviez pris des voiles ? – Eh ! qu’importe ? avez-vous peur de n’être pas assez nombreux ? les vérités vivantes que nous cherchons, que nous sentons, ne s’obtiennent pas, de la réticence, de la complaisance des esprits, comme une boule blanche ou noire, qu’il est possible de cacher dans le creux de la main. Elles jaillissent avec splendeur, du fond de l’âme ; il est impossible de ne pas en être responsable. Soyons vrais avant tout, nous serons suffisamment habiles. S’il le faut, je préfère être seul ici, avec ma conscience, plutôt que d’avoir toute la complaisance du monde avec moi, en portant au-dedans un esprit divisé.
Nul ne peut faire un pas nouveau dans la vie morale sans rencontrer la résistance de la doctrine qui le précède ; nous n’avançons qu’à la condition de montrer que nous avons assez d’âme, de vie morale pour franchir l’obstacle. Quand l’éclectisme a paru, il a trouvé pour adversaire la philosophie de la sensation ; il est juste qu’à notre tour, nous trouvions dans l’éclectisme la barrière qui veut se refermer sur nous. Joignez à cela une raison particulière, tirée des origines de cette doctrine ; c’est son malheur, on ne peut lui en faire un reproche, d’avoir été, dès le commencement, une capitulation. La fatalité a voulu qu’elle datât des calamités et de l’esprit de 1815 ; cette date, qu’elle s’est elle-même donnée, elle doit la porter jusqu’au bout. Peut-être ce fut une nécessité que cette capitulation de l’esprit philosophique de la France, sous les Fourches Caudines de l’Europe. Je ne l’examine pas ; il est certain que ce caractère est tellement empreint dans la doctrine dont nous parlons, qu’il en est, pour ainsi dire, toute l’âme. D’abord, capitulation avec la philosophie écossaise et allemande ; le génie spontané de la France y disparaît presque en entier. Capitulation avec la politique ; on s’identifie d’esprit avec la Restauration, et l’on s’enferme dans la Charte de 1814, comme dans un absolu immuable. Capitulation avec tout le passé de la philosophie ; on cède, pour ainsi dire, tout le droit du présent à penser pour son compte. Enfin, de nos jours, capitulation avec l’Église, telle qu’elle est ; on est bien loin de vouloir s’immiscer dans l’examen de ses traditions ; sans songer un moment à lui demander raison de l’héritage de vie, on tient seulement à rester en paix, dans une immobilité semblable à la sienne ; on s’abrite près d’elle, à son ombre, et l’on dit : que la paix soit sur vous et sur moi. Ainsi, de capitulation en capitulation, cette doctrine, qui a répondu au caractère d’un temps, est, aujourd’hui, véritablement prisonnière ; de quelque côté qu’elle regarde, elle a laissé toute issue se refermer sur elle ; tout ce qu’elle peut faire aujourd’hui, c’est de nous convier à l’imiter, en nous parquant comme elle, dans la même enceinte murée. Mais, vous le savez, c’est une règle dans le droit militaire, de ne prêter l’oreille, de n’obtempérer à aucun ordre, à aucun message, à aucune sommation qui part d’un corps d’armée prisonnier de guerre ; en rendant les armes, il a perdu le droit moral de se faire écouter. Or, la doctrine qui, depuis deux ans, nous conseille de nous rendre, est prisonnière de l’Église et du monde. Libres, nous renvoyons, sans y répondre, de quelque part qu’ils viennent, les mains liées, ses messagers de captivité.
C’est, en effet, se tromper totalement, que de prétendre arrêter les générations nouvelles sous le drapeau blanc de la philosophie de la Restauration. Toujours capituler, même dans ces libres régions de l’idéal, avec le premier adversaire qui se présente ! toujours transiger ! et pourquoi cela ? Qui peut nous obliger à signer le traité avec ce qui nous paraît ou faux, ou trompeur, ou stérile ? ne vivre jamais que de concessions, de calculs, même dans le monde intérieur, dans le fond de la conscience, dans cet abîme de liberté, de vérité, qu’on appelle l’esprit ! d’où nous viendraient ces chaînes ? si elles ont existé pour d’autres, elles sont rompues pour nous, puisque nous n’en avons pas accepté l’héritage. C’est bien assez que les faits accomplis, les concessions pèsent sur le monde politique ; ne les consacrons pas dans le monde moral. Notre roi, dans le royaume de l’intelligence, celui devant lequel nous nous courbons ici, c’est la vraie vérité, la vérité sans mésalliance, sans complaisance ; sinon, NON. Que nous parle-t-on de diplomatie dans la guerre sainte des principes ? notre diplomatie est toute nouvelle, en effet ; dans ce libre royaume de l’esprit, chacun de nous a déjà rompu en lui-même, avec le faux, son traité de 1815.
Il y a longtemps que ceux qui veulent empêcher le développement du monde religieux, savent qu’en amenant un homme à une transaction, à une capitulation, dès l’entrée de la vie morale, c’est le désarmer pour toujours. Cette histoire-là est aussi vieille que le monde. Ouvrez l’Évangile. Au moment où le Christ va commencer sa mission, l’esprit du passé lui apparaît dans le désert ; il ne lui demande qu’une chose, presque rien : se baisser le visage contre terre, capituler avec les vieilles doctrines, reconnaître le passé pour roi, ne fût-ce qu’un instant ! Qu’est-ce que cela ? Une prudente transaction, un sage éclectisme, envers les sacerdoces établis. Oui, sans doute, c’est peu de chose que de baisser un instant son esprit contre terre ; et cependant, cette capitulation consentie, c’était l’abdication du Christianisme ; jamais il n’eût relevé la tête. Je ne doute guère que grâce à cette prudence à l’égard des doctrines officielles, le fils de Marie ne fût devenu gouverneur, préfet, intendant de quelque village de Judée ; mais tenez pour certain aussi, que ni vous, ni moi ni personne, nous n’eussions jamais entendu parler de Jésus Christ de Nazareth.
Or, ce qui s’est montré au Christ à l’entrée de sa mission, apparaît à chaque homme, dans le fond de son cœur, au moment où il veut choisir sa destinée ; de nos jours cela est plus frappant qu’à aucune époque. À peine entrez-vous dans la vie, c’est-à-dire, dans votre mission, que l’esprit du passé, l’esprit qui craint l’avenir, prenant mille formes diverses, murmure, au seuil du monde moral, qui s’entrouvre devant vous, sa même formule séculaire : que t’en coûte-t-il ? Abaisse un moment ton cœur et ton visage. Ne porte pas si haut ton idéal religieux et philosophique. Transigeons, capitulons, une seule minute, à ce moment fatal, où tu construis dans ton cœur ton plan de vie. Si tu es philosophe, cesse de penser, et je te fais académicien ; si tu es prêtre, laisse là l’Évangile, prends la sagesse des politiques, et je te fais évêque ; si tu es soldat, rends-moi un instant, un seul instant, ton épée ; prends une âme bourgeoise, et je te fais général !
Eh bien, non ! Nous ne capitulerons pas à de si belles conditions. Plus le désordre est frappant dans la société civile, plus nous devons, dans cet empire de l’âme que nous habitons ici ; maintenir notre pensée haute et désintéressée. Au milieu de cette mêlée d’intérêts mercenaires, il faut du moins que le drapeau de l’esprit reste absolument sans tache. Les transactions pusillanimes se feront ailleurs, dans la vie réelle ; nous ne pouvons l’empêcher. Mais ici, dans le monde de l’âme, nous pouvons n’adorer que ce qui est adorable, ne flatter, ne couronner que ce qui est divin. Avec cela, il est fort possible que vous ne deveniez jamais ni gouverneur ni intendant de votre village ; mais vous serez des enfants de Dieu ; vous serez des hommes de la vérité ; c’est encore aujourd’hui la dignité la plus rare sur la terre.
On a exposé, il y a une vingtaine d’années, comment les dogmes périssent. Observez ce qui se passe sous vos yeux. Vous verrez comment s’y prend une doctrine, une école, pour mourir. Quel spectacle étrange et instructif que celui d’une philosophie qui a perdu la foi en elle-même ! Comme elle se retire peu à peu de toutes les questions vitales ! Comme le mouvement l’effraie ! Quelle appréhension de la lutte ! Quelle circonspection, quel tempérament de vieillard ! Si, par hasard, elle aperçoit une formule encore vide, elle va silencieusement, à l’écart, s’envelopper de ce suaire. Est-ce bien là cette puissance, tour à tour bienfaisante et terrible, qui sous le nom de philosophie avait la renommée d’ébranler le monde à sa guise ? Que ceux qui la craignaient autrefois, la regardent ; ils souriront en la voyant, telle qu’elle est devenue. Elle prétend désormais être sage ; vous savez ce que de nos jours on entend par ces mots. Assez longtemps elle a donné l’impulsion au monde politique et réel ; elle veut maintenant se régler sur lui, c’est-à-dire, le suivre de loin, s’il marche encore, s’arrêter s’il se lasse, mourir s’il défaille ; destinée, amusement d’une ombre qui s’obstine à durer quand elle a perdu sa raison d’être.
La conséquence la plus manifeste de cette défaillance de ce qu’il faut bien appeler l’idéal doctrinaire, l’éclectisme, c’est qu’il n’ose plus regarder l’Église en face. Ou se sent placé sur un terrain vide, hors d’état d’accepter la discussion dans les questions où la vie et la mort sont engagées. De là, une première nécessité : il faut nous accuser de soulever de trop grands problèmes, de toucher aux mystères, d’attirer sur nous des périls qu’on ne veut pas partager ; car il est certain que nous contrarions une fausse paix, qui ne ressemble en rien à la trêve de Dieu. De là, en second lieu, tantôt on déclare que le moment de penser n’est pas encore arrivé ; tantôt on patronne le créateur ; on prend sous sa protection les cieux de l’Évangile. Le plus souvent, enfin, pour couper court à toute difficulté, passant de l’excès d’orgueil à l’excès d’humilité, on établit que la philosophie n’a rien à voir dans la religion, que ce sont là deux mondes parfaitement différents, qui ne peuvent se connaître. On imagine ainsi deux puissances officielles qui n’auraient entre elles que des rapports diplomatiques ; une sorte d’étiquette respectueuse, des égards, du silence, un langage de protocole, tout ce que veut la politesse extérieure, une espèce de fiction parlementaire, d’après laquelle l’Église et la philosophie, s’engageraient chacune à accepter un rôle ; mais du reste, jamais un accent qui trahirait l’âme, nulle question d’où jaillirait une lumière imprévue, nul effort pour atteindre, les uns et les autres, à une pensée plus haute, où la réconciliation peut du moins s’espérer.
Ah ! que viens-je de dire ! Mais cette trêve dont ils parlent, c’est la guerre des morts, qui, éternellement placés chacun dans sa fosse, n’auraient éternellement rien à se communiquer, rien à faire, rien à tenter pour s’unir dans une pensée vivante ! Comprenez-vous un moment ce silence sans fin, qui laisserait le philosophe et le prêtre, dans sa tombe de glace, hors de toute espérance de se rapprocher jamais ! Pour moi, cela me passe ; cette fiction constitutionnelle, s’introduisant jusque dans le dernier repli du cœur de l’homme, m’épouvante comme la vision d’un mensonge éternel.
Gardez pour vous votre semblant de trêve ; j’aime mieux, pour ma part, cent fois les attaques à outrance, les violences, les déchaînements habituels de mes adversaires. Dans ces mouvements de passion, je reconnais, au moins, l’homme, fait comme moi, partant d’une autre idée, mais ayant comme moi une poitrine, un cœur, plein aujourd’hui de haine, et qui demain ou dans un siècle peut changer (qui le sait ?) cette haine en amitié. Au contraire, dans ce système de fictions, dans ce silence de diplomates, dans cet arrangement de chancellerie au milieu des choses éternelles, dans ce langage de protocoles, appliqué à ce qui tire des yeux des vivants les plus tièdes larmes, non, je ne trouve plus l’homme semblable à moi ; je cherche un frère irrité, haineux, peu importe, en résultat, un homme ; je trouve une formule surannée. Cette paix fictive, signée dans le néant, je la repousse également, et pour l’honneur de l’Église, et pour l’honneur de la philosophie.
Quoi ! la philosophie, l’amour de la vérité, n’a plus rien à voir dans ce qui, en ma qualité d’homme, me touche et m’intéresse presque uniquement, c’est-à-dire, dans ces dogmes, ces mystères, ces cultes, ce monde religieux qui m’entourent et me promettent la vie ! Je ferai de la pensée mon instrument, ma profession, à condition de ne l’appliquer jamais à la chose qui, encore une fois, si j’ai des entrailles humaines, doit me parler plus haut que toutes les autres ! Depuis quand la philosophie est-elle donc descendue à tant d’humilité et de terreur ! A-t-elle peur que les voûtes des cathédrales ne s’écroulent sur sa tête ? quand elle croyait à elle-même, elle se sentait la force de réparer tout ce qu’elle ébranlait. Si elle eût été prise de ce tremblement il y a trois siècles, nous serions encore dans la scolastique de Pierre Lombard. Où est, dans le monde moderne, le penseur qui ne soit pas entré dans l’abîme de Pascal ? Malebranche a-t-il craint de remuer le christianisme dans ses Méditations ; Leibnitz, dans sa Théodicée ; Spinosa, dans sa Théologie ; Rousseau, dans son Vicaire savoyard ; Kant, dans son Traité de la Religion ; Schelling, Hegel, Schleiermacher, tous enfin, dans leur enseignement ?
En soulevant des questions qui ne peuvent plus s’arrêter, la pensée a contracté une dette envers le monde ; elle s’est engagée implicitement à rendre à l’homme, sous une forme supérieure, tout ce qu’elle a paru lui ôter ; elle a promis de ne pas se reposer qu’elle n’ait contenté la faim qu’elle a elle-même excitée. Et maintenant, que la curiosité, le désir, la soif, la misère morale vous obsèdent, et que l’âme demande sa pâture, vous déclarez qu’il faut laisser là ces questions, que l’on vient de s’apercevoir qu’elles sont dangereuses, inopportunes, que l’on ne croyait pas que le monde les prendrait autant au sérieux ! Dangereuses ! oui elles le sont, et le péril est plus grand que vous ne pensez vous-même ! Inopportunes ! elles grossissent, sans intervalle, depuis trois siècles. Qu’est-ce donc que cette panique toute nouvelle ? Qu’est-ce que ce cri de sauve qui peut jeté dans le monde de l’intelligence ? On a contracté, ai-je dit, une dette de l’âme envers l’humanité moderne ; et, le moment venu de faire le compte, on vous propose simplement de vous payer de formules et de mots ! Qu’est-ce que cela encore une fois ! il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. On vous propose la banqueroute spirituelle et morale.
Oui, tout cela se tient et s’enchaîne. Dans chaque ordre de choses, dans l’étude de la nature, dans les mathématiques même, nulle philosophie n’est féconde qu’à condition de montrer un certain héroïsme (mens heroica). Depuis que l’Église prend la sagesse du monde, il faut que les penseurs maintiennent la folie de la croix ; je veux dire par là qu’une philosophie, une âme à la recherche de la vérité n’est vivante, n’est puissante, que si elle marche sans s’inquiéter de savoir si cela plaît, oui ou non, à ceux qui règnent sur la terre, dans le présent, sur l’opinion, si elle est suivie par un petit ou par un grand nombre, si elle a de son côté les complaisances ou l’inimitié du monde. En un mot, dans le dur chemin où nous marchons, quiconque se retourne en arrière, pour compter ses amis ou ses adversaires, perd incontinent sa force ; il est changé en statue. Ne nous amusons pas à chercher si nous sommes conformes ou non à la Charte de 1814, ou à tel ou tel établissement, soit qu’il nous plaise, soit qu’il nous contrarie. La politique que nous avons à suivre ici est la politique sacrée qui mène les peuples tous ensemble depuis dix-huit cent ans ; elle n’a rien à faire avec d’étroits calculs ; cherchons donc seulement la charte éternelle ; si les conventions intéressées, humaines, semblent d’abord la contrarier, soyez sûrs que tôt ou tard elles lui obéiront.