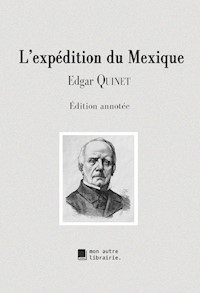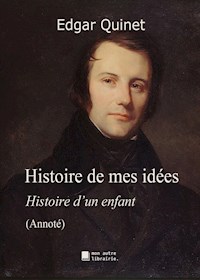
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Plutôt que de nous présenter de la façon classique le récit de ses premières années, l'auteur choisit de nous faire assister à la naissance et aux premiers développements du monde de ses idées, nourries de ses réflexions profondes devant une société en plein bouleversement. Au lecteur de s'émerveiller en voyant cette merveilleuse intelligence résister au hachoir d'une "éducation" cruellement contre nature, aujourd'hui difficilement imaginable. (Édition annotée.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Histoire de mes idées
Histoire d’un enfant
Edgar Quinet
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Hachette, Paris, 1878
Couverture : E. Quinet par Sébastien-Melchior Cornu
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-96-6
Table des matières
Préface générale
Première partie
1 – Qu’ai-je voulu faire ?
2 –Comment s’élever à des conclusions qui ne soient pas imaginaires ?
3 – Quelle règle suivre ? Réponse de J.-J. Rousseau à cette question. Y a-t-il des vérités indifférentes ?
4 – [Sans titre]
5 – Comment inculquer à l’enfant le respect de la nature humaine ?
6 – Certines. Le mal du pays. Méthode pour apprendre à lire et à écrire. Les contes de fées. La magie.
7 – L’éducation avant la Révolution française.
8 – Comment j’appris le nom de Voltaire avant celui de Napoléon. Croyance absolue à la puissance de la volonté chez les hommes de la Révolution.
9 – Une date morale. L’éternité des peines. Passion de la justice.
Deuxième partie
1 – Première idée de la patrie et de la vie publique. Un prisonnier de l’île de Cabrera.
2 – Un conventionnel. Le prêtre marié. L’éducation sous l’empire.
3 – J’apprends à souffrir pour une cause morale. Comment la langue de la liberté s’était perdue.
4 – Première impression du théâtre. Que l’âme s’éveille dans l’éternel amour.
5 – L’épopée de l’empire et l’invasion de 1814 dans une petite ville. Figure du Pauvre sur les ruines de la France. Comment on a cessé en France d’avoir la vie légère.
6 – Retour à la barbarie. Un journal d’éducation. Le maréchal Ney. Explication des sentiments d’une foule.
7 – Les Cent-Jours dans une bourgade.
8 – Révolte d’un régiment. La cocarde tricolore.
9 – Une vision. Le revenant.
10 – Histoire de la légende. Influence d’un grand homme sur un enfant.
11 – Waterloo. Seconde invasion. En quoi elle a différé de la première.
12 – Méditations sur le système du monde au milieu des Cosaques. Pourquoi certains hommes restent ignorés avec des facultés qui eussent dû les rendre immortels.
13 – Pourquoi je devenais un disciple de la force et du hasard. Deux éducations opposées. Premier débrouillement de l’intelligence. Comment les hommes perdent la capacité de comprendre. Le dix-neuvième siècle dupe d’Ossian.
14 – Éveil de l’imagination par la musique. Impression de la terreur blanche de 1815. Premier sentiment de la fragilité des choses et des hommes. Influence de la chute de Napoléon sur la destinée privée de chaque homme. Révolution dans l’éducation.
Troisième partie
1 – Premier contact avec la société réglée.
2 – La Jardinière de Raphaël. Différence réfléchie entre les paysages.
3 – La première communion. Réconciliation de deux Églises dans la pratique d’un enfant.
4 – Délices de la vie bienheureuse. Pourquoi cet état n’a pas duré. Différence entre l’art et la foi.
Quatrième partie
1 – Changement de tempérament de tout un peuple.
2 – Les cours prévôtales. Danger de la rhétorique dans les affaires d’État. Suite de l’histoire morale de la légende. Deux voies : celle du peuple, celle des esprits cultivés.
3 – Comment se marquent les différentes saisons de la vie. Première vision de la beauté.
4 – Simple histoire.
5 – Premier regard sur le monde des esprits. Première révélation de l’histoire. L’antiquité et l’adolescence. Influence des invasions de 1814 et 1815 sur l’éducation intellectuelle des hommes de notre temps. Que la vue des barbares a donné à notre temps l’intelligence des époques de barbarie.
6 – Lecture de la Bible dans l’église. Qu’en résulte-t-il ? Comment la forme historique devient la méthode du dix-neuvième siècle.
7 – La philosophie et la poésie des mathématiques. La Muse Uranie. Si les mathématiques tarissent l’imagination. Aversion pour les paradoxes.
8 – Premières compositions en vers. Puissance du mètre pour rendre l’équilibre à l’âme.
9– Amitiés.
10 – Derniers jours de quiétude.
11 – Lutte contre la nature environnante. La mauvaise Bresse et les Dombes. Nos marais Pontins.
12 – Premiers essais en prose. Difficultés particulières à notre génération. Son caractère. Tableau de la France avant sa renaissance littéraire et politique. Deux siècles aux prises. Le dix-huitième et le dix-neuvième. Isolement moral.
13 – Le choix d’un état. Préjugés contre l’enseignement et les lettres. Conclusion.
Documents inédits
Préface générale
Ce volume renferme un ouvrage inédit, l’Histoire de mes idées. Il est destiné à tenir la place de ceux que je n’ai pu faire entrer ici.
Je me suis proposé de raconter sous une forme individuelle l’histoire morale de la génération à laquelle j’appartiens. Qu’on la blâme ou qu’on la loue, personne ne lui refuse d’avoir fait quelque chose.
Il s’agit non pas seulement de moi, mais des autres, c’est-à-dire de l’esprit qui a soufflé sur nous tous, au commencement de la vie. C’est ce qui me décide à laisser paraître ces pages que j’étais tenté d’ajourner après moi.
Je n’ai pas dépassé les vingt premières années de ce siècle ; elles suffisent pour montrer en quoi il se sépare du précédent. La plante est visible dans son germe. Et qui ne voudrait, s’il le pouvait, voir un monde dans l’embryon ?
Lecteur, je te donne ici ma vie dans ces ouvrages semblables d’esprit, différents par les sujets, par la forme, et réunis pour la première fois. C’est à toi de juger si de leur ensemble ressort pour toi une force morale, une lumière, une vie, une âme dont tu puisses profiter. Quant à moi, il serait trop tard aujourd’hui pour en parler.
Je n’en dirai qu’une chose ; c’est qu’ayant traité des sujets bien différents, à des époques plus différentes encore, je n’ai pas eu à rétracter une seule de mes idées.
La vie qui a souvent changé ma fortune ne m’a point condamné à changer de pensée. J’ignore le supplice d’être en désaccord avec soi-même. Le sentiment de cette unité au milieu des convulsions de notre temps est le plus grand bien que j’aie reçu ; et y a-t-il un seul jour où je n’en reçoive de considérables ?
Une pensée qui illumine l’existence, voilà le meilleur don que les cieux puissent faire à l’homme. Qu’ils m’accordent ce bienfait pour mon lot, à la fin de ma vie, je les tiens quittes du reste.
« Il y a, a-t-on dit, des pensées belles et fécondes qui donnent éternellement naissance à une lignée de pensées belles et fécondes comme elles. Il y en a de stériles et de difformes qui stérilisent la vie et enlaidissent la beauté. Il y a des pensées printanières qui ont une vertu de régénération ; à leur contact, notre esprit refleurit et reprend la vigueur du printemps de l’année.
« Il y a des pensées douées d’une force prodigieuse d’attraction. Celles-là rayonnent comme un foyer, elles vous entraînent dans les cieux de l’intelligence ; elles vous ouvrent l’éternité sereine. Les mots eux-mêmes sont quelquefois héroïques ; ils ont une puissance qui ressuscite les âmes ensevelies. »
J’ai passé mes jours à entendre les hommes parler de leurs illusions, et n’en ai point éprouvé une seule. Déceptions, chimères, tromperies, qu’est-ce que cela ? Je l’ignore.
Aucun objet de la terre ne m’a menti. Chacun d’eux a été à l’épreuve tel qu’il m’avait promis d’être. Tous, même les plus chétifs, m’ont tenu exactement ce qu’ils m’avaient annoncé. Ceux qui m’ont blessé m’avaient averti d’avance. Les fleurs, les parfums, le printemps, la jeunesse, la vie heureuse dans le pays natal, les biens désirés et obtenus, s’étaient-ils engagés à être éternels ?
Le monde m’a-t-il tendu une embûche ? Non. Cent fois il m’avait averti de ce qu’il est, et je l’avais compris. Quelle plainte puis-je élever contre lui ? Aucune.
Il en a été de même des hommes. Aucune amitié ne m’a manqué de celles sur lesquelles je comptais véritablement, et la mauvaise fortune m’en a donné auxquelles je ne devais point m’attendre. Personne ne m’a trompé, personne ne m’a livré. J’ai trouvé à l’occasion les hommes aussi constants à eux-mêmes que les choses. Tous portent l’enseigne qui les fait reconnaître. Il n’y a de pièges que parce qu’on veut résolument être trompé.
Où est la déception, si je suis justement à la place que je m’étais toujours assignée ? Où est l’illusion, si tout ce que je craignais est arrivé ? Où est l’aiguillon de la mort, si je l’ai tant de fois senti par avance ?
Ce que j’ai aimé, je l’ai trouvé chaque jour plus aimable.
Chaque jour la justice m’a paru plus sainte, la liberté plus belle, la parole plus sacrée, l’art plus réel, la réalité plus artiste, la poésie plus vraie, la vérité plus poétique, la nature plus divine, le divin plus naturel.
Ah ! s’il me restait assez de temps pour aller au fond des choses que j’ignore, je sais bien que les contradictions qui m’étonnent encore finiraient par disparaître. Là où l’inquiétude me saisit, l’énigme se dénouerait d’elle-même. Je me reposerais dans la lumière.
C’est plutôt éblouissement que ténèbres, si nous avons tant de peine à discerner et atteindre le vrai. Il faut accoutumer lentement nos yeux à sa splendeur ; voilà pourquoi le soir de la vie vaut mieux que le commencement.
Presque toujours la destinée des ouvrages des exilés est d’être dispersés à tous les vents, et bientôt on a peine à en trouver quelques vestiges. Cette amertume m’a été épargnée. Plusieurs personnes, en mon absence, se sont réunies pour veiller aux détails de cette édition.* Je croyais avoir le temps de leur témoigner à loisir ma vive reconnaissance. La mort est arrivée plus vite que moi. Déjà il est trop tard pour m’acquitter envers Daniel Manin et Ary Scheffer.
Que mes amis, Auguste Marie et Alfred Dumesnil, sans lesquels cette publication eût été impossible, me permettent de placer ici leur nom, à l’endroit où elle s’achève. Ces noms signifieront toujours Abnégation et Dévouement.
Edgar QUINET
Bruxelles, 25 mai 1858
* Cette Préface aux Œuvres complètes (édition de 1858) se trouvait en tête du volume qui renfermait des brochures politiques et l’Histoire de mes idées. (Note des Éditeurs 1878)
Consors rerum divinarum et humanarum.
Première partie
1 – Qu’ai-je voulu faire ?
Qu’ai-je voulu faire ? qu’ai-je fait ? quoi ! est-ce bien là une vie d’homme ! si rapide, si éphémère !
Où sont tant de poèmes imaginés, tant d’ouvrages conçus, tant de beaux plans qui n’ont pas laissé de trace ?
Voilà mon obole, lecteur ! Telle qu’elle est, je te la donne. Reçois-la du même cœur que je te l’envoie.
Je crois voir aujourd’hui d’un œil impartial les œuvres sorties de mon cœur. Ah ! combien elles m’ont coûté de puériles inquiétudes, de plus vaines attentes, lorsque je les ai publiées pour la première fois ! Et maintenant je les regarde de sang-froid, comme si elles m’étaient étrangères. La plupart de ceux qui m’ont encouragé dans mes commencements ne sont plus. Ceux qui accueillaient ces ouvrages avec amitié, ou comme une espérance, sont morts ou ils ont changé. Le temps du jugement est venu pour nous tous ; temps de glace, de silence, où il reste peu de choses à espérer. On se sent dégagé de la crainte par l’indifférence du monde.
Dans cet intervalle, j’ai appris une chose dont je voudrais te convaincre. Le plus grand bonheur de l’homme, le seul qui résiste à l’épreuve, c’est de donner un gage à ses convictions. Tout le reste est éphémère. Les mots les plus éloquents sont écrits sur le sable, quand ils ne sont pas soutenus par la vie.
Ce que j’ai dit dans ces volumes, je veux le réaliser dans les jours qui me restent, car il m’a toujours semblé que c’est anticiper sur la mort et sur la dissolution, que de parler dans un sens et d’agir dans un autre.
Occupé chaque jour à ma tâche, j’ai vécu comme ceux qui sont courbés sur leur ouvrage. Ils n’ont pas le temps de s’informer de ce que les autres en pensent. Ils vont, ils continuent jusqu’à ce que l’ouvrage tombe de leurs mains. Malheur à eux si à ce moment ils s’arrêtent pour demander l’opinion du monde ! C’est alors que leur sérénité se perd pour toujours. Leur récompense était leur œuvre, le développement moral de leur être dans toute sa plénitude. N’ont-ils pas joui par avance de la profondeur des cieux ? Qu’ont-ils besoin d’une autre récompense ?
Si quelque chose mérite de subsister dans ces ouvrages, j’ai gagné ma journée. C’est à eux maintenant, non à moi, de plaider leur cause. C’est leur affaire ; qu’ils s’en acquittent avec honneur. Sinon, il est juste que tout périsse d’un seul coup.
Et quelle bonne consolation que la justice !
Que puis-je attendre de ma vie d’écrivain, qui ne m’ait été déjà pleinement accordé ? J’ai profité des jours, des années qui m’ont été donnés pour vivre dans la familiarité des grands esprits de tous les temps.
Ces bons génies qui ont illustré le monde ne m’ont point dédaigné. Sans me demander mes titres, qui j’étais, d’où je venais, ils m’ont admis dans leur compagnie. Ils m’ont ouvert leurs volumes ; ils m’ont laissé lire dans leurs pensées, dans leurs secrets ; ils m’ont laissé m’abreuver de leur douce science ; j’ai oublié dans cette occupation les mauvais jours qui s’étendaient sur moi.
Bien plus, j’ai osé marcher sur leurs traces, et ils ne m’ont point repoussé. Voyant leur indulgence, j’ai imité d’abord en balbutiant et plus tard avec un peu plus d’assurance leurs audaces. J’ai osé moi aussi vivre de leur vie, de cette vie ailée, magnifique, toute-puissante par laquelle ils disposent en souverains de la réalité. Comme eux j’ai osé faire profession de penser. J’ai joui de l’intimité des choses. J’ai conversé avec les idées, embrassé le possible ; car dans ces moments, je m’oubliais moi-même, et en suivant le beau cortège des intelligences qui m’ont précédé, j’ai joui comme elles de l’univers moral dont elles m’avaient ouvert l’entrée. Le monde ne m’a pas souri, mais elles ont eu pitié d’une si grande soif de vérité, de lumière, de beauté ; elles m’ont jugé sur mon amour et non sur ma puissance.
Voilà comment j’ai vécu, et quand les temps d’isolement sont venus pour moi, quand, relégué parmi des étrangers, tout ce que j’aimais parmi les choses, les lieux, les hommes, les souvenirs, a disparu à la fois, je ne me suis point trouvé seul. Les mêmes compagnons immortels qui avaient embelli pour moi les beaux jours ont tempéré les mauvais. Puissances vraiment hospitalières qui ne refusent jamais leur foyer à celui qui les implore avec sincérité ! Je les ai retrouvées les mêmes par delà les frontières ! Il est donc vrai que ces invisibles sont plus fortes que toutes les dominations du monde.
Quel silence s’est fait autour de moi ! Il est plus grand que je n’eusse jamais imaginé. À peine un voyageur franchit le seuil de ma maison en une année. Si ma pensée arrive encore aux oreilles de quelques hommes, c’est ce que j’ignore entièrement. Les voilà donc arrivés ces jours décolorés, nus, sans écho, sans lumière, tels que je les avais pressentis depuis si longtemps ! Mais je serais ingrat si je disais que ces jours-là sont stériles pour moi. Au contraire, une joie intérieure, secrète, inexplicable, inconnue, me possède. À n’envisager que moi, ces temps sont assurément les meilleurs, les plus remplis, les plus heureux de ma vie.
Si j’en veux trouver la raison, je vois d’abord que je n’ai point cherché le bruit, la fumée dans les lettres ; mais les ayant cultivées pour elles seules, elles m’en récompensent aujourd’hui par la douce compagnie qu’elles me font. Voilà une première explication. Il y en a d’autres, et celles-ci me touchent de plus près.
Ce silence, en effet, cette nuit profonde qui m’enveloppe, il dépend de moi d’en tirer avantage. Et déjà que ne leur dois-je pas ? En premier lieu, l’affranchissement de toutes les vaines occupations dans lesquelles se consume la vie. Plus de simulacres d’affections ! Plus d’amitiés de hasard, ou trompeuses, ou éphémères. Celles-là se sont envolées au premier souffle, plus légères que la poussière dans le van du vanneur ! Les seules affections solides, éternelles sont demeurées au fond, et la fortune a fait ainsi pour moi le choix que peut-être je n’eusse jamais su faire. Que d’aimables sourires je ne reverrai plus ! Mais pour ceux-là, comme ils ont été fugitifs ! Si je revoyais la France, que de tombeaux, hélas ! je retrouverais ! Que de places vides déjà ! Je ne pourrais faire un pas sans me sentir le cœur saigner. Où sont ceux qui étaient pour moi ma vie même ? Je les chercherais en toute chose et je ne les trouverais plus. Mes amis me reconnaîtraient-ils, tant l’homme change en peu d’années ! La fortune a bien fait ce qu’elle a fait, et je l’en remercie.
D’ailleurs comptons ce qui me reste. Le silence, ai-je dit. Ajoutons-y la paix, la sérénité, la joie de la conscience, tout ce que l’on dit être le privilège d’une mort bienheureuse. J’en jouis dès à présent.
Irais-je volontairement changer tous ces biens contre une vie informe qui n’aurait que l’apparence ? N’attendant plus rien de personne, je jouis d’une indépendance que je ne connus jamais. D’ici je vois à travers une mort anticipée, tout ce que j’ai quitté. J’aperçois comme sur une autre rive lointaine des hommes, des choses auxquels je ne puis plus me mêler autrement que par la pensée. Dans cet éloignement tout prend sa place légitime. On m’a affranchi des petites choses. Les grandes seules se montrent et apparaissent encore par leurs cimes. Je suis libre. Ce que jamais je n’eusse pu gagner par la philosophie, je le dois à la nécessité.
Quelle meilleure occasion attendrai-je pour jeter un regard sur ce peu de jours troublés que j’ai parcourus si vite ? Ne dois-je pas à ceux qui m’ont suivi jusqu’à ce moment de leur dire au moins en traits généraux comment j’y suis arrivé, par quelles différentes époques j’ai passé (car l’insecte lui-même a les siennes) ? Quelle sorte d’éducation j’ai reçue des choses, des événements, comment s’est formée en moi cette pensée telle quelle qui me tient lieu du monde à mesure qu’il m’échappe ? Et si cela n’intéresse personne, si nous sommes devenus tellement étrangers les uns aux autres que la formation, l’éducation d’une âme soit chose parfaitement indifférente à toutes les autres, au moins cela m’intéresse, moi ! Il me plait de tourner la tête en arrière et de regarder en face les temps d’orage, aujourd’hui que je suis arrivé dans ce beau port de l’exil, où toute ma vie, je le reconnais à présent, me poussait voiles déployées.
Et si par hasard (ce qu’à Dieu ne plaise !) je m’abandonnais à mon tour, si moi-même, enseveli vivant, je ne m’intéressais plus à moi, Tu les lirais ces pages, Toi à qui je les adresse, parce qu’elles ne renferment pas un mot qui ne soit la vérité ; Toi à qui je dois de vivre, Toi qui m’as donné dans l’adversité mes meilleurs jours, ceux que je voudrais éternels !
2 –Comment s’élever à des conclusions qui ne soient pas imaginaires ?
Une crainte m’a longtemps arrêté, celle du reproche banal d’amour-propre, à quiconque parle de soi. Je n’ai passé outre qu’après avoir mis ma conscience en règle sur ce point, et voici une des réflexions qui m’y ont le mieux servi. Tous les jours on analyse, on étudie dans leurs commencements les créatures les plus infimes, un insecte, une fourmi, un ciron. Ne veut-on pas savoir comment ils sont éclos, sous quel souffle créateur leurs membres engourdis se sont développés, comment leurs instincts se sont produits au monde ? Pourquoi ne ferions-nous pas pour nous-mêmes, sans une forfanterie trop insigne, ce que nous faisons pour le moindre vermisseau ?
Bel orgueil, en vérité, de se chercher si près de terre, non pour publier sa propre apologie, mais pour se rendre compte de son existence, pour se découvrir soi-même dans sa nudité d’âme et d’esprit et dans son imperceptible origine !
Je voudrais que tout homme qui s’est communiqué au public entreprît un travail analogue sur lui-même. De toutes ses œuvres, j’en suis convaincu, ce serait la plus utile aux autres. Quelle importance n’aurait pas pour l’éducation un certain nombre de ces simples histoires, dans lesquelles chacun montrerait avec sincérité et, s’il se peut, avec ingénuité, sous quelle forme le monde s’est révélé à lui dans le paradis de ses premiers jours (et chaque homme a eu le sien), par quels côtés la création lui a apparu d’abord, pourquoi telle petite cause a produit chez lui de grands effets, comment l’histoire humaine s’est trouvée réfléchie et enveloppée dans son horizon de ver de terre ! Peut-être est-ce le seul moyen de s’élever plus tard à des conclusions qui ne soient ni imaginaires, ni systématiques. Car enfin qui nous apprendra ce que les choses, les hommes, la nature, la vie, ont été pour nous à l’origine, si nous ne voulons pas le dire nous-mêmes ?
Autant que possible nous interrogeons chaque être autour de nous quand il arrive à la lumière. D’où sort-il ? Par quel chemin s’est-il introduit jusqu’à nous ?
Presque tous sont muets et nous n’en tirons aucune réponse. Ah ! si un insecte pouvait parler et nous dire : « Voilà par quels efforts je me suis débarrassé des langes et du linceul où j’étais renfermé. Voici ce que j’ai appris dans mon âge heureux de chrysalide ; puis voici de quelle manière le monde, la vaste capacité des cieux, et vous-mêmes, m’êtes apparus, sitôt que j’ai commencé à ouvrir mes mille yeux et à ramper sur la terre ! » Prendrions-nous cet aveu pour un triomphe de vanité ? Ce serait la nature des choses qui parlerait sous l’herbe. Insensé qui refuserait de l’entendre.
Et nous, ne répondrons-nous rien à qui nous interroge ? Mais qu’avons-nous à répondre si nous ne pouvons nous expliquer nous-mêmes ? Or cette explication est dans les premiers événements qui nous ont fait ce que nous sommes.
Je puis sentir, il est vrai, du plaisir à revenir sur mes premiers commencements, puisque je ressaisis une partie des jours qui m’échappent ; mais je ne puis sentir en conscience aucun orgueil de me voir si chétif dans ma faiblesse, dans mon ignorance première, et comme je suis certain de ce que je viens de dire, je m’enhardis à continuer.
3 – Quelle règle suivre ? Réponse de J.-J. Rousseau à cette question. Y a-t-il des vérités indifférentes ?
Quelle règle suivrai-je en recueillant mes souvenirs ?
La réponse1 que J.-J. Rousseau a faite à une question semblable a été pour moi une triste découverte. Quelle n’a pas été ma surprise lorsque je l’ai vu appliquer son génie à rechercher en combien de cas il lui a été permis de déguiser la vérité dans ses récits ! Et les cas où il admet ces déguisements comme licites sont si nombreux, que l’on ne sait plus quelle place il laisse à la réalité. Il admet que l’on peut sans mentir donner comme vrai ce qui ne l’est pas dans tous les cas qui suivent :
Pour broder les circonstances ;
Pour les exagérer, les amplifier, les outrer ;
Pour remplir par des faits controuvés les lacunes des souvenirs ;
Pour prêter à la vérité des ornements étrangers ;
Pour dire les choses oubliées comme il semble qu’elles ont dû être.
Les raisons qu’il allègue contre un reste de scrupule sont : le plaisir d’écrire, le délire de l’imagination ou ce qui s’appellerait plus exactement le besoin de produire de l’effet. Quant à la théorie dont il couvre ces motifs, elle se réduit à dire qu’il y a deux sortes de vérités, les utiles et les indifférentes.
Le devoir qui engage envers les premières n’engage nullement envers les secondes. Déguiser celles-ci n’est point mensonge, mais fiction, d’où la possibilité de rester vrai tout en débitant une foule de faits controuvés que l’on donne pour des réalités.
Où s’arrêter dans cette permission effrayante de mettre le faux à la place du vrai ? Sacrifier la vérité à l’effet ; que peut-il sortir de ce principe nouveau porté dans la société, dans la vie ? Je me le suis souvent demandé, au point de vue général. Il s’agit pour moi aujourd’hui de faire à cette singulière question une réponse pratique.
Userai-je de la permission de mêler le vrai et le faux, si bien qu’il n’y ait plus ni vérité, ni mensonge ? M’autoriserai-je d’un grand exemple pour inventer des détails, faire des additions, broder les circonstances ? Je ne ferai rien de cela parce que ce mélange me déconcerte et me glace d’avance. À peine si je conçois qu’on y puisse trouver le moindre contentement.
Je m’attachais aux choses que vous me racontiez en me les présentant comme véritables. Depuis que je sais qu’une partie est controuvée, je m’occupe de discerner le vrai du faux sans pouvoir trouver la limite de l’un et de l’autre ! Je crains d’être dupe. Je sens même que je le suis infailliblement. Cela m’ôte toute sécurité et la moitié au moins de mon plaisir.
Qui me dit que la broderie ne l’emporte pas sur le fond ? Dans une histoire privée je tiens aux circonstances autant qu’aux événements eux-mêmes. Ce sont elles qui donnent à ces faits leur caractère, leur esprit. Quand j’apprends que ces circonstances sont de pure invention, je ne sais plus à quoi me prendre. Il me semble que la vie et la nature même s’exhalent en rhétorique.
Je ne parle pas de la conscience si évidemment blessée par cette facilité ouverte au mensonge. Qui vous garantit, en effet, que ces vérités que vous me déguisez me sont indifférentes ? Y en a-t-il de telles dans le monde ? Vous vous croyez en droit de me mentir, parce que cela, pensez-vous, ne me nuit en rien. Qui vous l’assure ? N’est-ce pas me nuire que m’introduire dans un monde faux où je ne puis m’armer d’aucune défiance ?
Quand vous écrivez un roman et que vous me le présentez comme tel, je le lis dans l’esprit où vous l’avez conçu. J’ai sous les yeux une fiction ; je le sais et ne puis en être dupe que si je veux bien l’être ; il n’en est pas ainsi quand vous écrivez l’histoire de votre vie ; si vous y mêlez des faits controuvés que vous me donnez pour véritables, vous me faites un tort réel. Je vous suis avec confiance, les yeux fermés, et vous abusez de cette confiance pour me tromper. Vous aveuglez, vous altérez mon intelligence, en l’asservissant à des choses dont je n’ai aucun moyen de reconnaître la fausseté. Vous m’asservissez à vous-même. Je deviens votre jouet. Vous faussez en moi l’esprit, l’imagination, la raison. C’est le plus grand mal que vous me puissiez faire. Les seuls livres dangereux pour moi sont ceux où l’on me donne comme réel ce qui ne l’est pas.
Telle est la réponse que j’ai trouvée en moi en commençant ce récit. Je l’écrirai donc sans aucun ornement étranger, sans broder aucune circonstance, à bien plus forte raison sans en inventer une seule. Dans ces conditions, ce que nous appelons l’art est-il possible ? Nous avons contracté un tel besoin de faux, que nous voulons être trompés, même dans les choses qui n’ont de valeur que par la véracité. Est-il possible d’intéresser par un récit qui ne contienne que la vérité exacte sans aucune invention de détail ? Je l’ignore. Et qu’importe ? Je puis bien en faire l’essai, puisque je n’écris plus guère aujourd’hui que pour moi-même.
En quoi la fiction même la plus belle pourrait-elle me plaire dans un pareil sujet ? Ne vaudrait-il pas cent fois mieux se donner carrière dans un roman, un drame, un poème ? Si je reviens à ce passé, c’est pour revivre de ma propre vie. Veux-je donc me tromper moi-même pour le plaisir de me tromper ? Non, je veux me donner le plaisir de la vérité. Tout ce qu’on va lire sera d’une exactitude scrupuleuse. J’en écarterai même la forme du dialogue, car il est trop difficile de se souvenir de chaque parole après tant d’années, et je veux qu’ici les paroles soient aussi sincères que les choses.
4 – [Sans titre]
Je suis né à Bourg en Bresse2 le 17 février 1803. Un magnifique jardin, celui de Fenille, plein des arbres les plus rares, s’étendait sous nos fenêtres ; il m’apparait aujourd’hui comme un Éden. J’étais si chétif, en venant au monde, surtout si pâle, qu’il ne semblait pas que je pusse vivre. Ma mère, quoique calviniste, me laissa baptiser dans le catholicisme, seul culte pratiqué dans le pays. L’ignorance de nos provinces, qui confondaient les juifs et les protestants, lui avait été intolérable.
Mon premier chagrin date de ma deuxième année. Ma bonne Catherine se fiança. Je l’adorais. Mes cris, mon désespoir ne purent la retenir, ni même obtenir un sursis. Elle se maria et me quitta. Je faillis en mourir. On crut que peu de jours calmeraient mon désespoir, et rien ne fut épargné pour me distraire. Les jours, les mois, se passèrent ; ma désolation ne faisait qu’augmenter. Le mal en vint au point que ma mère ne pardonna jamais à mon infidèle de ne s’être pas laissée fléchir par une si belle passion. Quoiqu’elle l’aimât beaucoup, elle ne voulut la revoir de sa vie ; après quelques années nous faisions encore de grands détours pour éviter de passer à sa porte.
Mon père était alors commissaire des guerres à l’armée du Rhin. Il fut décidé que nous irions lui faire visite. J’étais dans ma troisième année. Nous partîmes pour ce long voyage avec la fidèle Madeleine. Fidèle, ai-je dit ; en effet, cette constance dure encore après cinquante ans.
Dans les premiers jours de mon exil à Bruxelles, je fus reçu par une dame inconnue. « Votre plus vieille amie, me dit-elle, en entrant. Ne la connaissez-vous pas ? Je suis Madeleine. » Ce nom me ramena en un clin d’œil à ce passé d’un demi-siècle. Pendant que j’écris, elle est ici près de moi, mon témoin pour ces jours éloignés, et mon guide là où ma mémoire hésite.
Nous passâmes tout le printemps de 1806 à Paris. Chaque matin, ma mère me conduisait du quartier des Tuileries au Jardin des Plantes, sous le grand cèdre ; nous y restions une partie du jour. Aucun souvenir ne me reste de cette première vue de Paris. Mais j’ai le sentiment assez distinct du voyage, lorsque blotti au fond de la voiture, tout à moi-même, je jouais avec un affreux poupart rembourré de son, en carrick à galons d’argent, dont notre vieux tailleur boiteux m’avait fait présent au départ et que je mettais cent fois au-dessus de tout ce qui s’offrait à mes yeux. Nous traversâmes Bruxelles où je devais être confiné un demi-siècle après.
Mes souvenirs se réveillent à Cologne. Nous y fîmes notre entrée par une pluie battante, et le timon de la voiture se brisa dans le faubourg. Ma mère et moi nous nous mîmes à la recherche d’un abri ; tout était encombré par je ne sais quel synode ecclésiastique ; nous errions, sans pouvoir nous faire comprendre. Ayant perdu mes deux souliers dans la pluie, je marchais pieds nus sur le pavé, avec de l’eau à mi-jambe. Ma mère était au désespoir, ma bonne humeur dans cet ouragan la soutint. Enfin, le domestique se retrouva et nous eûmes un gîte.
Wesel était la ville où se trouvait mon père. Nous y arrivâmes, je ne sais comment. Ce que je me rappelle fort bien, c’est la vie toute nouvelle que j’y menais, très à mon gré. Nous habitions un palais du prince de Prusse, et dans ce palais, on ne voyait que des soldats traînant des sabres. C’étaient des cavaliers revenus d’Austerlitz, qui me prirent en grande estime, aussi ne pouvait-on plus me séparer d’eux. Je mangeais avec eux leur soupe, à la gamelle ; quand ils allaient au fourrage, j’y allais avec eux, à mon rang. Car j’avais deux grands moutons bridés, harnachés, qui me servaient de chevaux. Pour chacun d’eux, on me distribuait deux bottes de foin, deux bottes de paille, que je liais et accommodais avec le plus grand soin en travers de mes montures. Après quoi, les tenant par la bride, au son de la trompette, je revenais avec le régiment ; je faisais la litière, je garnissais le râtelier, j’étrillais les bêtes, puis je rentrais le plus tard que possible.
Combien de temps dura cette vie, c’est ce qui m’échappe entièrement. Cependant elle finit à mon grand regret et à celui de notre vieille portière, bonne Allemande, dont je vois encore les larmes au moment où nous partîmes. Nous revînmes par le Rhin dont les grandes eaux me frappèrent, par Strasbourg et par Colmar, où nous nous arrêtâmes quelques semaines chez le général Puthod. Nous rentrâmes à Bourg au commencement de 1807. Sans attendre le printemps, nous allâmes nous établir à la campagne, dans notre rustique, inaccessible, incomparable Certines.
5 – Comment inculquer à l’enfant le respect de la nature humaine ?
Certines était assurément alors un des points les plus retirés, les plus cachés qui fussent en France, et peut-être en Europe. J’imagine que l’Irlande seule, ou l’Écosse, renferme de ces sortes le déserts. Au couchant, de vastes forêts de chênes, où nous nous perdions quelquefois des jours entiers, de grands étangs qui me semblaient des lacs, enveloppés d’ombre ; au levant, à trois quarts de lieue au plus, un rideau de montagnes qui me paraissaient inaccessibles, le Revermont, premier gradin du Jura et des Alpes ; entre les forêts et la montagne, des bruyères, des taillis, des vernets, des verchères, des savanes, de petits pâturages, de vastes plaines de blé ; un horizon de paix, de silence éternel ; un air, celui des maremmes, plein de langueur ; au-dessus de cet océan de genêts, de bruyère et de seigle, sur un monticule, notre maison ombragée de cerisiers dont les branches tendaient leurs fruits jusque dans l’intérieur des chambres, et principalement dans la mienne. La maison, très vieille, appartenait à ma famille depuis le seizième siècle. Mon père y avait ajouté deux pavillons aux toits d’ardoise, à colonnes et à plein cintre, qui égayaient le fond triste, gothique du corps de logis. Au milieu des acacias, des peupliers, des pommiers, des noyers, cette maison était cachée comme un nid. Deux fermes en dépendaient, et comme le sol avait peu de valeur, on s’était donné le plaisir d’accroître l’héritage d’une grande étendue de terrain, dont une partie même était en friche.
À Wesel, j’avais vu les vainqueurs d’Austerlitz. À Certines, quel changement de vie ! Et comme je m’y accoutumai vite ! Ma joie suprême était d’aller au soleil levant moissonner avec les moissonneurs dans les vastes étangs changés en terre de blé ou d’avoine au milieu des grands bois. On craignait pour moi l’ardeur du soleil et la fièvre presque inévitable dans nos maremmes. On crut d’abord agir très sagement de ne pas me réveiller à l’heure où partaient les moissonneurs. Quand je vis qu’ils étaient partis, que le travail se faisait sans moi, que le mal était irréparable, j’en éprouvai une telle désolation, je devins si pâle, je fus si mortellement, si profondément anéanti, que ma mère jugea que mal pour mal, il valait encore mieux affronter la fièvre, et elle fit bien.
Depuis ce jour-là, je menai exactement la vie d’un paysan. Avec ma petite faucille, je moissonnais dans mon sillon ; on ne me permettait pas d’emporter ce que j’avais moissonné. Je ne devais regarder comme mien que ce que j’avais glané. Mais de ces glanures, je faisais des gerbes qui m’appartenaient. Je dressais moi-même mon aire ; je battais mon blé. Je l’enfermais dans un sac ; je l’envoyais au moulin. Et quel moment, lorsque je recevais en retour une blanche farine ! Je la pétrissais en gâteaux, et je les faisais cuire dans un petit four que j’avais construit avec de belles briques sur une moitié de cerceau, pour dessiner et soutenir la voûte.
Dans cette liberté des champs, il y avait autre chose qu’un amusement. Je faisais un travail véritable, exténuant même, qui me rendait sacré le travail d’autrui. Combien je respectais le sillon couvert d’épis de seigle, les prés rares, jonchés de fleurs, et à plus forte raison le bouvier qui le soir ramenait sa charrue ! Car ma mère ne perdait pas une occasion de m’inculquer le respect de la nature humaine, dans le laboureur, dans le moissonneur, le semeur, le faucheur, auquel j’étais si loin de pouvoir atteindre ! Quelquefois même le résultat dépassait de beaucoup son intention. En voici un exemple.
J’avais pour compagnon inséparable un petit paysan, nommé Gustin, plus âgé que moi de trois ou quatre ans et beaucoup plus fort. Malgré cette différence d’âge et de force, Gustin se soumettait à toutes mes volontés, comme s’il eût été né pour m’obéir. Cette habitude de commander sans raison me dénaturait. J’ordonnais pour le seul plaisir d’être obéi. Ma mère résolut de mettre fin à ce despotisme en herbe. Elle nous fit comparaître tous les deux devant elle, pour donner à Gustin une leçon de fierté, et à moi d’équité. Après m’avoir réprimandé sur ma manie de faire perpétuellement le maître, elle nous dit gravement que Gustin n’était pas né pour obéir à mes fantaisies ; il était mon égal, mon ami, non mon serviteur ; elle entendait bien que nous changerions entièrement de conduite à l’avenir.
Le barbare ne la comprit que trop ; le lendemain, comme nous étions au bois, et qu’il se sentit fatigué, il ôta ses sabots et m’ordonna de m’en charger.
J’avais quatre ans ; j’obéis. Nous arrivâmes ainsi devant ma mère, moi portant humblement les deux sabots de Gustin (et ils n’étaient pas légers), Gustin, tout fier de me voir essoufflé et rendu sous le faix ; et pourtant c’était le plus honnête, le plus doux garçon du village. Ainsi cette première leçon d’égalité n’avait fait que déplacer le tyran ; combien de fois de grands événements m’ont forcé de me la rappeler !
Sitôt que je fus assez grand, ma première ambition fut de garder les bœufs, en compagnie des carats, dans les verchères, puis bientôt les chevaux, dont j’appris à nouer et à dénouer les entraves de fer. Pendant ces longues heures nous apprenions à distinguer de loin, au vol, à leur manière de se poser dans les haies, les roitelets, les mésanges, les rouges-gorges, les tia-tia, nos compagnons ordinaires ; et nous nous trompions rarement. Cela m’est toujours resté. Nous distinguions aussi le sifflement des couleuvres, très nombreuses, d’avec le chant des cigales. Cette vie de pasteur dura, je pense, deux ans ; après quoi j’aspirai ouvertement au labourage. J’y parvins à la fin.
Mon père, toujours en quête d’inventions, avait introduit et acclimaté des buffles dans ses fermes. Mais leurs figures rébarbatives, leurs anneaux de fer dans les narines me repoussaient. Je me consacrai de préférence aux bœufs. J’avais les miens qui me connaissaient, Bise et Froment, le premier tout blanc, un peu paresseux, il est vrai, le second, roux, maigre de l’échine, en revanche rude travailleur. Je les avais choisis parmi les plus robustes ; et quel orgueil de se faire obéir de ces grands animaux, qui au moindre geste suivaient mes pas dès que j’appuyais ma longue gaule sur le joug !
Ils ne pouvaient faire un pas sans moi. Je les menais ainsi à l’abreuvoir, au tombereau, à la crèche, surtout à la charrue. Car c’est là que je pouvais le plus facilement et le plus longtemps régler mon pas sur le leur, et marcher à côté d’eux, fièrement, sans courir. Et quelle patience ils me montraient ! Quoique j’abusasse assurément de leur douceur, jamais elle ne se démentit un seul instant. Aussi en étaient-ils bien récompensés au bout de chaque sillon. J’allais cueillir des trèfles verts qu’ils mangeaient dans ma main, en me regardant de cet œil profond où je croyais voir tout l’amour qu’ils avaient pour un si bon maître. Combien de fois j’ai conduit ainsi le labourage jusqu’à la dînée ! car tout mon plaisir eût été gâté si mes bœufs eussent obéi à d’autres qu’à moi. Tout au plus permettais-je au bouvier de les appeler par leur nom, de loin à loin ! Je m’étais réservé à moi seul le droit de l’aiguillon.
Au retour de la charrue, ma mère m’attendait sur la galerie pour me faire réciter le personnage d’Éliacin. Elle jouait elle-même celui d’Athalie avec un sérieux terrible :
Comment vous nommez-vous ?
J’étais forcé de baisser les yeux pour répondre :
J’ai nom Éliacin.