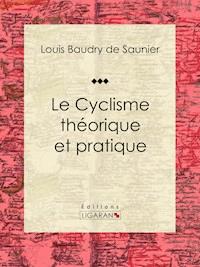
Extrait : "Le cyclisme est devenu tout d'un coup en France, et par suite dans le monde entier ainsi qu'il en est l'habitude, une question si volumineuse qu'un écrivain ne peut guère être certain de posséder des bras assez larges pour l'envelopper tout entière. En deux années, la vélocipédie a pris de telles proportions qu'un nom nouveau lui est désormais nécessaire : elle change d'habit, en prend un plus large, plus sérieux et plus élégant, celui de cyclisme!"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335066920
©Ligaran 2015
THE NEW INVENTED SOCIABLE.
Caricature anglaise de 1820.
À tous les cyclistes de France
À tous mes camarades de la pédale connus ou inconnus
Hommage de l’auteur.
Le propre du vulgarisateur c’est d’entrevoir. Sa vie n’est qu’un long rêve, et il meurt le plus souvent, après trente ou quarante années d’attente, sans avoir eu la consolation d’assister au triomphe de ses idées. Dès qu’il a plongé dans le néant par exemple, les effets qu’il avait prédits sortent de terre comme par enchantement. Il partage cette infortune d’un genre tout particulier avec l’inventeur, dont il est le petit-cousin.
Mais à cette règle, comme à toutes les autres règles, il y a des exceptions qui la confirment. Ainsi le signataire de cette préface, n’a rien inventé, Dieu l’en garde, mais qui a passionnément vulgarisé la bicyclette, n’a pas attendu longtemps pour assister à l’épanouissement du cyclisme vainqueur. Il y a deux ans et demi qu’il ouvrait « les yeux à la lumière ». C’était en février 1890. Nous voici a la veille de 1893 et déjà tous les emplois de la bicyclette qu’il a entrevus, prédits, prévus, sont devenus autant de réalités.
L’emploi du plus formidable organe de presse qu’il y ait au monde a été pour beaucoup dans la diffusion de ces vérités, avant 1890, il faut bien le reconnaître, restaient lettre morte.
– Aussi quelle satisfaction vous devez éprouver, me demande-t-on parfois, en voyant l’essor qu’a pris sous votre impression la vélocipédie en France !
C’est vrai.
Chaque fois que je rencontre un bicycliste, que ce soit sur la route départementale silencieuse, au fond des villages pittoresques ou sur le macadam du bois de Boulogne, je me dis :
– Voilà encore un de mes petits… Il ne s’en doute pas ; pourquoi s’en douterait-il ? Peu lui importent les causes finales, à cet homme heureux, qui pédale avec ivresse. En voici un autre, deux autres, dix, quinze, vingt autres, des escadrons entiers qui roulent à travers la France, de Nice à Brest et de Dunkerque à Bayonne. Si je les interrogeais et s’ils voulaient me répondre, je trouverais dans leurs réponses à tous le pourquoi de leur conversion à la bicyclette. Et ce pourquoi ce serait toujours le même : la poussée formidable de la petite feuille à un sou, qui a fait entrer le cycle dans les mœurs des Français.
Mais si je suis des yeux toutes ces roues tournantes avec la satisfaction du vulgarisateur qui eut raison d’entrevoir un bienfait universel dans ce que les initiés anciens n’appelaient qu’un sport ou un plaisir, je n’y mets aucun orgueil. On a bien voulu me demander une préface pour ce livre édifié à la gloire du cyclisme. Je la donne volontiers, en déclarant qu’elle sera mon dernier écrit sur la matière, mon intention étant de rentrer désormais dans le silence, comme ces hérauts qui ont fini leur tournée.
Non, le vulgarisateur n’a pas, c’est un fait à noter, de vanité en lui : il ne saurait en avoir, car à vulgariser il n’a aucun mérite.
En faisant comprendre aux foules ce qu’une élite seule a compris jusqu’à lui, le vulgarisateur subit une loi physique dont il n’est pas responsable. Il résonne comme un violon sous l’archet.
Qu’une idée le hante, qu’une nouveauté l’électrise et le fasse vibrer, voilà qu’il ne peut plus vivre sans la répandre avec des cris autour de lui, sans en parler toujours, sans en écrire, car il est écrivain, point, quand ce ne serait que pour multiplier à l’infini les idées qui sortent de sa chantrelle.
Le vulgarisateur est un homme suscité. Telle invention est devenue populaire parce qu’elle a trouvé un jour son vulgarisateur à point nommé, comme une religion qui rencontre un bon prophète. J’ajouterai que la qualité du dogme est pour beaucoup dans l’affaire.
Il y a quinze ans, j’ai vulgarisé le téléphone et le phonographe, qui apparaissaient alors aux Parisiens comme des bêtes de l’Apocalypse. Le besoin de répandre des poignées de vérités me prit tout à coup. Livres, brochures, articles de journaux, conférences, expériences, que ne fis-je pas en 1877-78 pour acclimater en France ces inventions nouvelles ? Elles nous semblent toutes simples aujourd’hui. Mais en 1878 le téléphone était comme la bicyclette en 1890 : la foule n’y croyait pas. Je l’y fis croire, puis je repris mon modeste sillon, ayant crié ce qui me troublait et fait des conversions par centaines de mille.
De même j’ai rencontré un jour la bicyclette. Ç’a été un fameux plaisir pour moi, et, paraît-il, une vraie chance pour elle. On l’a dit, redit, écrit et récrit. C’est encore longuement et laudativement expliqué dans le beau livre que vous allez lire, par M. Baudry de Saunier. Eh bien, si vous m’en croyez, cyclistes, rien parlons plus.
Aussi bien les années, en se superposant, feront oublier bien des choses. Déjà de fiers paladins se sont levés qui demandent avec humeur pourquoi l’on rappelle encore ces détails. Ils voudraient déjà les voir oubliés, en quoi ils se montrent bien de leur temps. Mais ils ont raison ; n’en parlons plus. Amoureux passionné, et pour la vie, des charmes de celle que j’ai baptisée la Reine Bicyclette, j’ai bien le droit, n’est-ce pas, de redevenir pour mon compte le plus humble des bicyclistes ? La vélocipédie a franchi la période des débuts, celle où l’idée avait besoin d’un apôtre. Je l’ai tenue sur les fonts ; c’est bien. Point n’est besoin qu’elle encombre une existence et qu’un homme se rive à la sienne. Ah ! les joueurs de flûte ne lui manqueront pas.
Puisqu’elle compte aujourd’hui assez de courtisans pour régner sans conteste et atteindre, sans qu’on ait plus besoin de la soutenir, à toutes les perfections prédites par ses prophètes, rien ne s’oppose à ce que je lui dise, en manière d’adieux historiques :
– Va, ma fille, cours, vole et oublie ton parrain !
Et maintenant lisez ce livre, cyclistes. C’est toute son histoire.
PIERRE GIFFARD.
De même que c’est au seuil de sa maison que l’hôte a coutume de faire des politesses à ses invités, de même c’est à l’entrée de son volume qu’un auteur doit serrer publiquement la main à ses collaborateurs.
Un ouvrage de l’importance de celui-ci – (et je suis assez modeste pour n’attacher le mot importance qu’à la somme énorme de pages et de gravures que contient le livre, et à l’intérêt des sujets qu’il traite) – est une œuvre de patience, de recherches et d’études ininterrompues où, à chaque pas, l’on glane auprès d’autrui un souvenir, une date, une appréciation, une idée.
Collaborateurs ont donc été pour moi, d’abord les principaux journaux cyclistes, que voici par ordre de date : le Vélocipède Illustré, sans lequel nous ignorerions la période étincelante de la vélocipédie primitive sous Napoléon III et dont l’amusante lecture des années 1869-1870 est un régal de curieux ; la Revue des Sports, aux gravures superbes, qui m’a autorisé à prendre dans ses cartons toutes les photographies et tous les croquis nécessaires à mon volume et à utiliser son admirable outillage d’illustration ; la Revue du Sport Vélocipédique, qui renferme des documents rares sur la vélocipédie d’il y a dix ans et est riche, comme tout journal ancien peut seul l’être, de souvenirs et d’anecdotes ; le Véloce-Sport, dont la grande autorité traite depuis 1885 toutes les questions concernant notre sport et qui constitue une mine de renseignements précis ; le Cycle, jeune d’âge, déjà vieux de poids et de documents, où j’ai repris les études d’anatomie cycliste que j’y avais écrites.
J’ai parcouru ces journaux d’un doigt chercheur, et, ce que disait le bruit de leurs feuilles en tournant, je l’ai redit. Merci à ces grands collaborateurs de papier !
Je dois encore une poignée de remerciements à chacun de ces aimés et savants collaborateurs de chair fraîche qui sont MM. Mousset, l’érudit sportsman ; Danvin, l’intelligent ingénieur de la maison Rochet ; Faucanié, l’adroit dessinateur technique ; Vélodor, le touriste consommé ; X…, un des plus compétents officiers de notre armée ; etc…
J’espère que mon volume contribuera pour sa petite part à prêcher l’amour de la sainte vélocipédie dans le monde. Si, par lui, quelques incrédules sont touchés de la foi, nous aurons fait ensemble une belle œuvre.
L’AUTEUR
Importance de la question cycliste. Définition du cyclisme. – En quoi il est un art. – En quoi il est une révolution. – Réfutation de quelques erreurs sur la nature du cyclisme. – Le cycle et le cheval. – Le cyclisme est mieux qu’un sport : c’est un mode nouveau de locomotion. – Les véloces-voies de M. Berruyer. – La révolution sociale, morale et commerciale produite par le cyclisme.
Le cyclisme est devenu tout d’un coup en France, et par suite dans le monde entier ainsi qu’il en est l’habitude, une question si volumineuse qu’un écrivain ne peut guère être certain de posséder des bras assez larges pour l’envelopper tout entière.
En deux années, la vélocipédie a pris de telles proportions qu’un nom nouveau lui est désormais nécessaire : elle change d’habit, en prend un plus large, plus sérieux et plus élégant, celui de cyclisme !
La vélocipédie était autrefois pour beaucoup de gens une forme ingénieuse de la gymnastique, un passe-temps réservé, il faut l’avouer, à la partie débraillée de la société. Le cyclisme est aujourd’hui pour tout le monde un mode de locomotion nouveau, des plus sérieux et des plus économiques, bientôt un instrument de révolution des rapports sociaux, analogue à celui des chemins de fer et des transatlantiques. « Le sport vélocipédique, écrit le Dr Morrache, regardé d’abord avec quelque dédain par les gens qui font profession d’être “sérieux”, s’est imposé maintenant par les services qu’il rend tous les jours, par ceux qu’il est appelé à rendre. Il fait partie de cet ensemble de moyens à l’aide desquels nous poursuivons la culture physique de notre jeunesse, culture sans laquelle, j’ose le dire, le seul progrès intellectuel est incomplet, sinon dangereux parfois. »
Le cyclisme s’est présenté à la porte des plus sévères maisons et est entré en vainqueur : le ministère de la guerre l’a accueilli, lui qui autrefois par la fenêtre criait au vélocipède qu’il n’était qu’un joujou ! Le cyclisme a pénétré dans tous les pays, dans toutes les sociétés, dans tous les commerces, dans toutes les familles et partout il a fait la bombe ! Le feu a couvé plus d’un siècle : le cyclisme éclate aujourd’hui, et les plus rétrogrades des conservateurs sentent un vent de révolution frôler leur joue. Les vieillards le maudissent, car leurs jambes se refusent à se ployer aux exigences d’une pédale : le cyclisme hausse les épaules et leur répond qu’il n’est pas fait pour eux, qu’il est trop vert ! Les rares jeunes gens qui considèrent encore la petite selle cycliste comme une liaison mauvaise s’avouent, aux heures de pleine franchise, que la conscience s’octroye de jour en jour, que leurs os sont trop faibles, que leur poitrine manque de ces bons soufflets de vie qu’on nomme des poumons sains, ou que leur porte-monnaie est plat et qu’on lui sent trop le fermoir sous la peau pour affronter jamais le catalogue d’un marchand de cycles !
La faiblesse physique ou la faiblesse pécuniaire sont donc désormais les deux seuls ennemis du sport vélocipédique. Dans toute conversation qui met en pièces le cyclisme, cherchez, vous découvrirez l’une ou l’autre infirmité.
Qu’est-ce donc que ce sport nouveau dont tout être humain qui a deux bonnes jambes à son service se fait l’esclave inaffranchissable ?
Le cyclisme est l’art de se transporter soi-même sur roues, par un mouvement simple et sans efforts pénibles.
C’est un art parce que les dons naturels d’adresse et de sang-froid y jouent le grand rôle et qu’aucune règle précise et mathématique ne pourra jamais en régir l’exercice : la médecine est un art parce que le diagnostic est une faculté qu’aucune étude ne donne guère ; le cyclisme est un art parce que la parfaite adaptation des muscles au cycle est un don de naissance. Tel sportsman essaye chaque jour de s’assouplir à la bicyclette par un entraînement sévère et raisonné, qui ne fera jamais qu’un médiocre cycliste ; tel autre, le célèbre Charles Terront par exemple, qui ignore de l’entraînement scientifique les règles primaires, semble avoir été fabriqué par la nature à l’usage exclusif du cyclisme et nous a donné, instinctivement, le grand coureur que l’on sait.
Le cyclisme est l’art de se transporter soi-même sur roues, car se faire transporter par une autre force que la sienne n’est pas un art, mais une science. Il faut donc protester hautement contre ces étiquettes de « vélocipédie » que certains constructeurs de moteurs à pétrole ou de moteurs à vapeur veulent attacher à leurs voitures. Toutes les roues ne sont pas des cycles, et les locomotives routières ne sont que des locomotives, quand bien même on les débaptiserait. Le cycliste ne prend d’aide que de ses jarrets, et c’est précisément la conscience qu’il a de se mouvoir seul, de ne devoir qu’à son énergie la vitesse avec laquelle il fend l’air ou la lenteur avec laquelle il passe devant un joli paysage, qui lui donne le meilleur et le plus pur de son bonheur. Ôtez du cyclisme ce travail raisonné des muscles : vous ne véhiculerez plus dans une voiture légère qu’un homme qui bâille et s’ennuie devant les sites les plus merveilleux, qu’une sorte de malade d’activité qui demandera la permission de descendre après dix kilomètres et de faire la route à pied, pour ne redevoir plus qu’à soi-même son excursion et son plaisir. Le cyclisme est donc l’art de se transporter soi-même, parce que le caractère humain veut qu’il en soit ainsi : le cyclisme, mieux que tout autre récréation peut-être, prouve la haute philosophie de ce dicton qui court le monde : « Le travail est la liberté ; travaillez, vous serez heureux ! »
Le cyclisme est l’art de se transporter soi-même sur roues par un mouvement simple, parce que, s’il eût été compliqué, le cyclisme se fût mis en travers des lois immuables de la nature qui recherche les causes les plus simples pour produire les plus grands effets, et que, en travers des lois naturelles, le cyclisme eût été brisé dès les premiers jours. Le cyclisme est donc, au point de vue mécanique, l’application la plus simple qu’il soit possible de trouver des forces musculaires de la jambe. Non seulement le mouvement cycliste n’est pas plus compliqué que le mouvement ambulatoire, mais il est plus élémentaire encore. Dans la marche, des prodiges d’équilibre sont nécessaires, que la longue habitude nous a rendus tellement familiers qu’il nous est difficile de ne plus les accomplir et, par exemple, de nous laisser tomber à terre ; dans le cyclisme, plus grande est la vitesse, moins grand est l’effort d’équilibre : un cerceau qui roule est influencé par cent fois moins de forces diverses et contraires qu’un enfant qui fait quelques pas. Loin donc d’être une amélioration aux machines cyclistes, toute complication qui a essayé de mêler le travail des bras ou le poids du corps au travail des jambes, a tiré en arrière le progrès. Grands inventeurs ont toujours été les simplificateurs. Grand parmi les grands sera le constructeur qui fera un cycle léger et rapide sans chaîne, sans écrous, sans boulons et qui posera une selle sur deux roues presque nues !
Le cyclisme est l’art de se transporter soi-même sur roues par un mouvement simple et sans efforts pénibles, parce que l’effort, physique aussi bien qu’intellectuel, est une joie, mais que la peine est une douleur. Le travail exigé du cycliste sera donc modéré ou le cyclisme n’existera pas. Cette théorie condamne d’un seul coup les officiers traitant de vélocipédie militaire, par exemple, qui donnent au cycliste le sac, le fusil et tous les impedimenta de guerre ; les inventeurs de machines embrouillées où les leviers montent et descendent dans des engrenages inexpliqués ; les cyclistes eux-mêmes qui s’imaginent que gravir à pied une côte trop escarpée est un déshonneur et qu’il vaut mieux se rompre les veines du cou à faire effort que de poser le pied à terre. Trois types d’individus, pour ne prendre que ceux-là, qui n’ont du cyclisme qu’une notion fausse et irraisonnée !
Les erreurs sur l’essence du cyclisme et ses besoins sont d’ailleurs péchés quotidiens chez la plupart des hommes. Une des plus ordinaires et que, par vanité, certains cyclistes eux-mêmes se plaisent à commettre, consiste à comparer le cycle au cheval.
Et pourquoi chercher des comparaisons entre un animal et une mécanique ? L’un mange de l’avoine, beaucoup ; l’autre, de l’huile, très peu. Tous deux vont sur la route ; c’est leur seul terrain de rencontre. Mais sur la route les piétons aussi circulent, les chiens galopent, les voitures se traînent et les phaétons à vapeur se ruent ! Comparerons-nous tous ces éléments de vitesse ?
Le cheval, s’il est bon, coûte plus cher que le cycle le plus perfectionné. Il mange, dans une année, en picotins et en soins, en palefrenier et en écurie, en vétérinaire et en maréchal ferrant, autant que son prix d’achat ; mais il passe partout avec son cavalier sur le dos, dans les terres labourées et dans les rivières. S’il pleut, c’est lui qui patauge ; s’il fait chaud, c’est lui qui sue ; si la fatigue est excessive, c’est lui qui meurt. Tous avantages appréciables, reconnaissons-le.
Le cycle, qui n’est qu’une mécanique, une façon de marcher vite, rondement, – et c’est bien ici le cas de le dire – n’a de vie qu’autant que son cavalier en possède. Il ne passe pas partout, s’embourbe dans les terrains détrempés, coule à pic dans les rivières et, si la fatigue est excessive, se répare d’un tour de clé anglaise, tandis que son maître peut en penser mourir, – mais il ne mange pas, n’a pour vétérinaire, palefrenier et maréchal ferrant que son propriétaire. Il est économe de temps, d’argent et de soins.
L’homme, au moyen du cycle, est arrivé à marcher aussi vite que court le cheval ; mais pourquoi rapporter et surtout mettre en opposition, ainsi que plusieurs en ont la fureur, deux modes de locomotion aussi opposés ? À cheval, l’homme pense à sa bête, pense à la direction qu’il lui donne, lutte avec elle ; en cycle, il ne pense qu’à ce qui l’entoure et non à ce qui le porte ; il ne dirige pas sa monture autrement qu’instinctivement, comme on marche, car la pratique du cyclisme assouplit à ce point les muscles et la volonté de l’homme que peu à peu le cycliste en arrive à rêver et à dormir même sur sa machine et qu’il n’est plus différenciable d’avec elle ; c’est un homme transformé, d’une belle monstruosité, dont les jambes sont des roues comme les pieds des satyres étaient des pattes de boucs. L’équitation donne deux individualités ; le cyclisme n’en donne qu’une seule. Et, pour résumer cette discussion, je dirai, et les vrais sportsmen qui savent goûter dans la vélocipédie sa merveilleuse adaptation aux muscles humains, me diront que j’ai raison : le cyclisme est l’art de vivre sur des pédales.
Le cyclisme est-il un sport ? Si l’on entend par ce mot un exercice de longue et savante étude qu’il n’est donné qu’à quelques organisations d’élite de bien pratiquer, il faut courageusement répondre que non. Il peut devenir sport, dans la plus belle acception du mot, et nos grands coureurs sont là pour me servir d’exemples, mais il n’en est généralement pas un.
Le cyclisme est mieux qu’un sport ; c’est un mode de locomotion. Tout être humain, ou à peu près, peut l’utiliser, comme tout être humain, ou à peu près, peut marcher. Si donc on veut la vélocipédie grande, universellement adoptée et partout fêtée, il faut lui laisser jouer son rôle populaire, démocrate même, et ne pas lui donner comme enceinte les superbes mais étroites limites du mot sport.
De son extension à la presque totalité des hommes dépendent en effet son libre cours et l’amélioration de sa situation. Le jour où tous les employés, tous les commerçants, tous les rentiers et même tous les badauds auront un cycle dans un coin de leur appartement, une colossale révolution de voirie s’imposera. Lorsqu’en 1883 M. Berruyer, de Grenoble, s’avisa de proposer la construction, le long de toutes les routes départementales de France, d’un chemin vélocipédique, protégé par une haie et gardé par des cantonniers spéciaux, d’une véloce-voie, les pouvoirs établis se contentèrent de rire à son nez : la vélocipédie ne poussait pas encore dans le public et l’idée était tombée en terrain resté inculte. Mais qui prétendrait, à l’allure dont roule la vélocipédie depuis vingt mois, que dans vingt ans, la superbe conception de M. Berruyer n’occupera pas l’école des Ponts et Chaussées ? Qui affirmerait que le service des postes ou du transport des petits paquets ne se fera pas un jour par des cyclistes marchant à quarante kilomètres à l’heure sur des voies unies comme des pistes ?
Je n’écrivais donc pas un mot exagéré lorsque je posais, en débutant, que le cyclisme constitue une révolution dans la locomotion humaine. Révolution de rapports sociaux, révolution de mœurs, révolution de commerce, le cyclisme, dont quelques gens peu perspicaces se raillent encore, accomplira tous ces bouleversements.
Déjà, tout innocemment, il a ruiné de petites industries jadis prospères. – « La bicyclette aura beau scintiller et faire la belle, ai-je écrit dernièrement, jamais ses reflets doux de nickel ne dompteront les ennemis féroces dans la cage desquels je suis entré, les commerçants qu’elle ruine ! Qu’elle colore ses tubes, au goût du jour, en vert, en rouge, en noir fileté d’or, jamais les industriels dont elle écrase la patente dans ses engrenages ne verront en rose cette assassine ! Ainsi cette petite mécanique à moudre les kilomètres réduit en farine et poussière des métiers d’apparence ineffritable ! Aucune élévation ne se produit sans marchepied : le cyclisme montant sur le trône se fait un socle gémissant des professeurs de gymnastique et d’équitation.
Si l’on secoue le Bottin, des fruits desséchés tombent à terre, des maisons que le cyclisme a piquées. Tel maître de manège avoue que ses clients, désespérément, un à un, lâchent l’étrier pour la pédale. Chez lui, dans les mangeoires rongées au bord, sa femme serre son linge : demain peut-être on plantera des légumes dans le manège, il faut vivre ! et les rares élèves feront le saut des baies par-dessus les choux ! Les chevaux se sont télescopés les uns dans les autres ; de vingt, ils se sont résorbés à dix ; de dix, à cinq : dehors, les chevaux de fer, des chevaux à roulettes, monsieur ! hennissent en passant, narquois, de toutes leurs cornes !
Au gymnase, les barres parallèles se déforment d’inaction ; la sciure leur monte aux jambes. Le professeur au bureau compte et recompte ses cachets de carton que les pouces des élèves ne graisseront plus, et se demande par quel prodige d’équilibre son budget famélique fournira désormais à ses moustaches pointues d’ancien moniteur leur pitance de pommade hongroise ! Le nouvel instrument lui a volé sa spécialité d’exercices physiques en chambre. En cinq tours de roue, en plein air, une bicyclette vous étire et développe les bras, les jambes, le torse et le cou mieux qu’un masseur nègre en dix heures ! Concurrence déloyale !
L’escrime seule résiste, en ce qu’elle est un art et une finesse, autant qu’un exercice. Mais mon interview, lâchée dans la plaine du commerce, m’a fait cette prise inattendue, que les libraires à tempérament eux-mêmes crient au krach lorsqu’ils aperçoivent un vélocipède dans une rue ! Il paraîtrait que les employés, les petits économistes, qui donnaient vingt francs par mois pour acquérir un Balzac ou un Dumas, écoutent aujourd’hui plus leur corps que leur esprit et placent leurs économies dans l’acier et non plus dans le papier. S’ils brûlent de la bougie, ce n’est plus dans leurs chandeliers, à lire des romans, mais dans la lanterne de leurs bicyclettes, à courir les routes et à rafraîchir leurs poumons !
À côté des maussades, les satisfaits sourient : les mécaniciens, les caoutchoutiers, les restaurateurs des environs des grandes villes envoient des baisers au moindre cycle qui passe ! Le progrès tourne ainsi constamment comme une roue de moulin, plonge dans la rivière et noie ceux qui tiennent les palettes du bas, exulte au soleil et porte ceux qui s’accrochent en haut !
La révolution cycliste, reconnue aujourd’hui par le plus rétrograde des hommes, enfonce ainsi son coin dans nos mœurs, exproprie de vieux propriétaires de métiers productifs et donne un balcon sur rue à des modestes qui végétaient à l’ombre.
La petite bicyclette joue chaque semaine la tragi-comédie que voici, du répertoire des marionnettes : le dimanche, à onze heures du matin, tandis que le ventre creux du professeur de boxe, en rut de clients, se profile au seuil de son gymnase, de son gymnase où les araignées, sans prendre de leçons, tissent entre les haltères leurs dentelles indéchirées ; là-bas, à cinq lieues, à la campagne, la bedaine rieuse du gargotier bombe sur le pas de sa porte qui envoie dehors une haleine chaude de rôti ; et le bonhomme, sifflant dans ses lèvres de Rabelais une marche triomphale, rêve aux cyclistes, sa manne quotidienne de midi, et hume, à nez plein, l’air frais du matin qui va leur avoir, comme une lime, aiguisé les dents ! »
Sur combien de métiers aujourd’hui ne pourrait-on pas relever la trace de la roue de la bicyclette ? Combien qui végétaient sont devenus prospères, grâce aux cyclistes ? Combien par eux sont déjà presque morts ?…
Le cyclisme enfin est plus encore qu’une révolution de commerce et de rapports spéciaux. À notre époque, où il faut se tirer soi-même de la vie à force de courage et de volonté, ce merveilleux exercice enseigne l’initiative, l’endurance et l’opiniâtreté. Sa plus belle gloire encore est de moraliser !
FAC-SIMILÉ D’UNE CARICATURE ANGLAISE DE 1819 SUR LES HOBBY-HORSE.
Dans l’antiquité ! Essais des XVe, XVIe et XVIIe siècles. – Le vitrail de Stoke Poges. – Le célérifère de M. de Sivrac. – Les premières caricatures. – L’invention du baron Drais : la draisienne. – Le hobby-horse anglais. – Les caricatures anglaises. – Le facilitator. – L’alléopode. – Le pédocaèdre. – La draisienne presque abandonnée pour la difficulté de son emploi. – Un perfectionnement génial est attendu, mais qui l’apportera ?
Le mode de locomotion nouveau et révolutionnaire qu’est le cyclisme a ses racines dans l’histoire ancienne ! Sans prétendre, ainsi que quelques archéologues, trop amoureux des vieilles pierres, l’ont avancé, que le cyclisme était connu des Égyptiens et des Latins – (et, sous prétexte que les hiéroglyphes de Louqsor et les fresques de Pompéi, dûment grattées, montrent de petits génies ailés à cheval sur un bâton porté par deux roues, M. de Champlieu a supposé « que les anciens avaient au moins l’idée vélocipédique ») ; sans prétendre certes que la jeunesse dorée d’Athènes sortait sur des cycles de bois le dimanche pour aller à Corinthe déjeuner à l’auberge de la belle Lysistrata, il est certain que, presque de tout temps, les hommes ont symbolisé dans le cercle, dans la roue, l’idée de la vitesse, et qu’ils ont cherché par quels moyens leurs corps, portés sur roues, se déplaceraient rapidement d’un point vers un autre. Quels expédients avaient-ils trouvés ? Aucun document ne peut nous répondre.
Les XVe et XVIe siècles nous ont, les premiers, laissé l’indication de quelques essais de locomotion automobile. Mais ces tentatives, qu’aucun dessin informe n’essaye d’expliquer, consistaient seulement en de lourdes voitures que l’expérimentateur déplaçait au moyen de cordes entourées sur l’essieu et mues par de longs bâtons.
Le XVIIe siècle n’est guère plus bavard : il nous raconte qu’en 1625 un jésuite, du nom de Ricius, voyageait en Chine. Un jour que ce prédicateur avait manqué le départ du bateau qui faisait le service sur le Gange, il fut à ce point vexé de sa déconvenue qu’il résolut de faire, par terre, et par un moyen rapide, la route de Chinchiamfu à Chequian Hamceu. Il agença, au moyen de barres et de traverses – (mais comment ? L’anglais Henry Fetherstone, rapporteur du fait, se garde bien de se perdre dans les détails) – trois roues inégales sur lesquelles il s’installa, et continua de la sorte son voyage interrompu.
Un curieux vitrail du XVIIe siècle existe en Angleterre dans l’église de Saint-Gilles à Stoke Poges. L’idée cycliste, à en croire cette extraordinaire et authentique verrière, existerait, comme je le disais plus haut, de toute éternité.
Ce vitrail, en effet, décrit dans l’Athenœum de 1869 et dans les Notes and Quieres, représente un ange à cheval sur un vélocipède de bois !
Le journal Wheeling en parle en ces termes : « Dans la vieille chapelle se trouvent huit fenêtres renfermant des vitraux, et au premier abord, le visiteur s’étonne de voir les sujets les plus disparates réunis dans la même fenêtre… L’ange est nu et sans ailes. Il représente un jeune homme robuste, aux cheveux bouclés ; il tient une longue trompette et paraît sonner un appel vigoureux. La roue de devant est très petite : celle de derrière beaucoup plus grande… Les autres parties de la fenêtre contiennent des figures bizarres, un jeune homme jouant du violon, un autre fumant sa pipe. Les costumes sont ceux de l’époque de Cromwell. »
À la fin du même siècle, en 1693, un membre de l’Académie royale des sciences, Ozanam, nous parle d’une voiture mécanique qu’un de ses amis, médecin à La Rochelle, vient d’inventer. « Un laquais, dit-il, monté derrière, la fait marcher, en appuyant alternativement sur deux pièces de bois qui communiquent à deux petites roues qui actionnent l’essieu du carrosse. » Un croquis, que nous reproduisons ici, est joint à cette sommaire description, et c’est tout : le verso du folio traite de la grandeur de Dieu !…
Que ne traitait-il de la fertilité des cervelles d’inventeurs ! Un constructeur que nous rencontrons au commencement du XVIIIe siècle, Stephan Tarflers d’Aldorft, lui eût donné sujet à méditations ! Celui-là, mécanicien vers 1703 et pieux personnage, s’était bâti « un petit char à trois roues qu’il faisait marcher seul pour se rendre à l’église ». Les cordes du XVIe siècle et les leviers du XVIIe étaient là remplacés par des rouages de bois ! – Un jour de pluie, les engrenages se gonflèrent, tant que l’invention en creva !
Est-ce tout ? L’érudit Bachaumont relate encore des mécaniciens de l’époque de Stephan Tarflers, qui, persuadés d’avoir, au moyen de pédales et de barres adaptées à une charrette légère, porté un coup droit aux diligences, sollicitent du Régent la faveur, qu’on ne leur accorde d’ailleurs pas, de lui exhiber leur merveille au Palais-Royal ! Mécaniciens convaincus, dont aucun échec ne perça les illusions et de qui les fils, sous Louis XVI, obtinrent enfin de montrer à la cour de Versailles les grands jouets paternels…
Ce n’est qu’en pleine Révolution, en 1790, que la nouvelle révolution, celle-là pacifique, de la locomotion humaine, la vélocipédie, devait montrer sa première roue au soleil !
En 1790 seulement un homme comprit que la simplicité était la cheville d’assemblage d’une machine destinée à faciliter la locomotion de l’homme par lui-même. M. de Sivrac mit, dès sa première conception, le doigt sur le plus puissant moteur du corps humain, la jambe, et n’employa que ce moteur à la propulsion de sa machine. Aussi bien son invention, rudimentaire comme une poutre de bois qu’elle était, ne mérite-t-elle pas le nom pompeux de machine ! La pensée seule de la merveilleuse descendance qu’elle enfanta retient notre haussement d’épaules à la vue de la rustique invention du bon monsieur ! Poutre respectable cependant, et dont certes aujourd’hui un exemplaire authentique se marchanderait au poids de l’argent !
L’instrument qu’avait imaginé M. de Sivrac et baptisé de célérifère (celer, vite ; fero, je porte, lat.) se composait de trois éléments de bois : une poutre solide et deux roues. La poutre était munie à l’avant et à l’arrière de deux sortes de fourches entre lesquelles tournait une roue. Une selle, un coussin sur le dos de ce cocasse animal, et en avant ! Le cavalier, cramponné à la tête de la poutre, se poussait en pesant du pied contre terre : il faisait un mouvement assez semblable à celui qu’en gymnastique on nomme le pas de géant. Toute la science cycliste consistait alors à avoir bon jarret et bon équilibre, comme maintenant d’ailleurs, mais avec cette différence essentielle que le pied faisait à chaque enjambée reprise sur le sol et qu’en définitive la malice était seulement de conserver le plus longtemps possible son élan. Les luxations de chevilles que cet exercice causa rapidement, une pierre suffisant à mettre à faux et déboîter le pied, l’histoire des débuts du cyclisme n’en souffle mot et préfère s’en taire. Mais si l’on songe que, de 1790 à 1855, pendant près de soixante-dix ans, nos pères, qui n’étaient guère moins spirituels que nous, se contentèrent en vélocipédie du mode de propulsion barbare du pied contre le sol, on cite avec plus de respect les noms des Michaux, des Truffault, des Dunlop, qui nous ont donné le cyclisme aérien moderne !
L’identification avec le cheval de cet instrument qu’on chevauchait, était naturelle. Aussi dès l’année suivante, 1791, ne tarda-t-on pas à rencontrer quelquefois, sous les jeunes gens excentriques qui essayaient de cette nouvelle distraction, des poutres arrondies en corps d’animaux et surmontées d’une tête. Les plus cavaliers montaient des célérifères à têtes de chevaux ; les plus fantasques, à têtes de lions ; les moins superstitieux, à têtes de cerfs. L’armée des célérifères ressemblait assez à nos chevaux de bois modernes où toutes les têtes d’animaux sont admises à l’honneur de tourner en rond.
La caricature tomba à coups de crayons sur les célérifères. La Révolution apaisée, au moins dans sa furie, le Directoire occupa l’ère des licences : les incroyables montaient « en céléifé » au Palais-Royal, non pour leur plaisir mais pour leur affichage. Une estampe du temps, conservée à la Bibliothèque Nationale, représente des élégants qui se poussent de la pointe d’un pied prétentieux et, le binocle d’or au bout du bras arrondi, tentent d’assassiner de meurtrières œillades les belles en mousseline transparente couchées sur des chaises.
Une autre estampe met la politique en célérifère. Un homme ivre, que la légende prend soin de nous appeler par son nom, Barras, quittant le pouvoir au lendemain du 18 brumaire, est à cheval sur la mécanique de M. de Sivrac : deux dindons le tirent, car il ne saurait, en son état chancelant, propulser sa machine, et deux gourdes de vin lui font escorte. Dessous, ces mots : Départ précipité, novembre 1799 ; dessus : Le Luxembourg, lupanar du Directoire.
Le célérifère, passé au crible de la Révolution, n’avait pas longtemps conservé son nom. À une époque où fleurissait le ci-devant, il n’y a guère à s’étonner que l’innocent ancêtre du cyclisme ait perdu son nom originaire et ait subi le rebaptême. Quelque jacobin qui sans doute avait plus d’amitié pour le mot velox, vite, que pour le mot celer, rapide, décida que le ci-devant célérifère se nommerait désormais vélocifère et que le cavalier de cette étrange monture s’appellerait un vélocipède (qui marche d’un pied rapide).
Aussi lorsqu’en 1804, à l’avènement de Napoléon Ier, le cyclisme naissant entre dans les mœurs et dans les théâtres, est-ce sous le terme de vélocifère qu’on désigne ce nouveau personnage. Le 29 floréal an XII (19 mars 1804) le théâtre du Vaudeville, sis rue de Chartres-Saint-Honoré, salle du Vaux-Hall, donna une comédie intitulée les Vélocifères, sous la direction de Désaugiers et sous la signature de MM. Dupaty, Chazet et Moreau. L’idée de cette pièce, et je la donne ici pour les friands d’antiquités, était celle-ci :
Un entrepreneur de voitures, un loueur, pour parler notre langue moderne, nommé Cassandre, fait de mauvaises affaires. Ses acolytes, les Gilles-Sapin, Gilles-Phaéton, Gilles-Cariolle, Gilles-Fourgon, Gilles-Versailles et Gilles-Diablotin, n’arrivent pas à le tirer d’embarras.
Cassandre cherche un expédient : « J’entends parler de tous côtés de nouvelles sortes de voitures. Et comme on dit qu’elles vont plus vite que les miennes, tout le monde y court. » L’inventeur de cette nouveauté est le bienheureux Arlequin : il a imaginé « une voiture qui, par la légèreté de sa construction et la combinaison de toutes ses parties, doit l’emporter sur tout ce que l’on a vu jusqu’à ce jour de plus léger. Aussi l’a-t-on surnommé vélocifère. » – Arlequin en effet, en habile homme, a fait breveter l’invention au nom de Cassandre dont, immédiatement, il épouse la fille Colombine, au grand désappointement des Gilles tous amoureux.
L’idée de cette pièce est certes plus du domaine de Guignol que de la comédie, mais ce document mais, qui témoigne de l’existence du cyclisme dès 1804, a du charme néanmoins pour les amis du sport.
Le cycliste du Directoire, du Consulat, de l’Empire, de la Restauration, fut ainsi ce pauvre hère porté sur sa tige de bois à roulettes et dont les pieds crevaient à chaque pas les flaques d’eau de la route ! Heureuse époque pour la cordonnerie, tristes années pour le sport !
Mais ce mode d’application de la force de l’homme contre le sol paraissait alors si inévitable et si rationnel que les efforts des constructeurs ne portent pas sur ce point. L’absence de direction facile dont étaient affligés dans leur rigidité les célérifères et les vélocifères frappa bien plus vite les chercheurs d’amélioration.
En 1818, un baron de Bade, un agriculteur ingénieur, M. Drais de Sauerbron, modifia ainsi le célérifère : à l’avant, la roue n’était pas montée directement sur la poutre de support du cavalier ; elle s’articulait sur cette poutre par un pivot qui lui permettait d’osciller à droite et à gauche. Désormais, plus besoin n’était pour se diriger de donner comme autrefois des coups de poing à droite ou à gauche dans la tête de sa machine : un gouvernail facile conduisait la roue d’avant, devenue roue directrice, dans les chemins où la désirait la fantaisie du cavalier.
Le baron Drais se grisa à la contemplation de son célérifère articulé, à tel point qu’il lui donna sur-le-champ le surnom de la Draisienne et qu’il commanda à son domestique de l’aller exhiber aux badauds de Paris dans le jardin de Tivoli. Mais, timidité ou faute d’entraînement, l’exécuteur des volontés du baron hautain ne put, à grands renforts de coups de jarrets, que faire courir les enfants à sa poursuite. Hué, effaré, perdant la tête, le domestique rentra auprès du baron que cet échec exaspéra : M. Drais quitta la France et mourut en 1851 à Carlsruhe dans un couvent.
Jamais certes la caricature n’avait plus harcelé un homme. Son sport, c’est, à en croire les satiriques du temps, la vélocipédrausiavaporiana ; sa machine, c’est une « mécanique économique très surprenante, pouvant, en cas de mortalité des chevaux, remplacer les diligences » ; la valeur de son invention, c’est « un brevet pour une sorte de voiture rapide qui fait quatorze lieues en quinze jours. »
Et cependant la raillerie ne parvint pas à démolir ces quelques pièces de bois qu’était une draisienne. Inventée en 1818, la draisienne, telle que l’avait construite le premier le baron Drais, servait encore en 1855 ! Seul un peuple ingénieux, qui a l’habitude de flairer les bonnes pistes, le peuple anglais, lui avait-il, à cette date reculée de 1855, apporté quelques perfectionnements de construction seulement. Le baron Drais garde donc dans l’histoire du cyclisme un grand nom, beaucoup moins par l’importance de sa découverte que grâce à cette circonstance inouïe de l’inintelligence des constructeurs et de l’indifférence des chercheurs. Les machines de Drais ont été en faveur quarante années de suite ; quel constructeur moderne en dira un jour autant ?
La draisienne fut vite adoptée par l’Angleterre, mais en ce pays de métallurgie intense, elle fut critiquée sur son point faible, sa construction. La draisienne était en bois ! Les Anglais, avec leurs yeux de gens pratiques, aperçurent que le bois enlevait à l’appareil toutes chances de solidité d’abord, de durée ensuite : des moyeux en bois s’usent rapidement et la pluie fait gonfler, jouer et craquer des articulations en bois ! On ferait la draisienne en fer !
En 1818 donc, quelques mois après la naissance de la draisienne en France, naquit en Angleterre le pedestrian hobby-horse ou hobby-horse, qui n’était que sa copie métallique. Nos voisins adoptaient ainsi, dès 1818, un principe dont ils ne se sont jamais départis en matière vélocipédique : s’approprier les idées françaises en les perfectionnant.
Le hobby-horse était en effet un très réel perfectionnement de la draisienne. Fin et distingué d’allures, il était à notre invention ce que le pur sang est à notre percheron. Aussi l’engouement du public anglais en fit-il rapidement un jouet chéri. Le constructeur favori, Knight, refusait les commandes devenues en quelques mois trop nombreuses ; un manège où l’on apprenait en quelques cachets l’art d’enjamber le hobby-horse, s’était ouvert sous la direction d’un nommé Johnson, 40, Brewer street, Golden square. Enfin le hobby pénétra à ce point dans les mœurs anglaises pendant quelques années, que le caricaturiste fameux Cruikshank daigna exercer sa verve sur l’échine du pauvre véhicule. Une série de charges amusantes, dont la plus connue est intitulée : Every man on his perch, or going to hobby fair, traduction libre : « En hobby, chacun enfourche son dada », raille avec humeur philosophique le sport embryonnaire dont les partisans chantaient déjà les merveilles.
Les femmes elles-mêmes, en Angleterre, sautèrent en selle de hobby-horse, et c’est encore aux caricatures du temps qu’il faut demander la preuve de l’existence de ce cyclisme féminin prématuré. Plusieurs estampes révèlent d’ébouriffantes amazones galopant dans les allées d’un château. En jupes courtes, le pantalon brodé tombant à la bottine : ce sont les grotesques ; d’autres représentent de pudibondes anglaises, aux robes droites et débordant sur les talons, véritables devancières de l’Armée du Salut : ce sont les convaincues. Il est en effet à noter que le peuple anglais a senti, dès qu’on lui a livré l’informe draisienne, quel merveilleux instrument de sport les perfectionnements pourraient en tirer ; les sceptiques s’en amusèrent certainement, mais la majorité des sportsmen accueillit et protégea même l’innovation : on vit en Angleterre, en 1819, de fameux hommes de cheval, comme lord Ermes, essayer la nouvelle bête à deux roues. En France, aujourd’hui encore, combien de cavaliers ne traitent-ils pas le cyclisme de barbarie et ne se cramponnent-ils pas aux crins de leur cheval dès qu’on leur parle de bicyclette ? Ce large esprit sportif a donné peu à peu aux Anglais, et malgré que toutes les grandes inventions cyclistes soient, comme nous l’avons vu et le verrons plus tard, nées sur la terre française, la suprématie dans les exercices physiques et particulièrement dans l’exercice vélocipédique.
En 1819, à Londres, autant de femmes montèrent en hobby qu’il y en a aujourd’hui à Paris qui montent en bicyclette. Un fabricant d’abord construisit à l’usage des dames peureuses une voiture mécanique à trois roues, The ladies hobby, qui avait ceci d’extraordinaire, à une époque où la propulsion par le pied frappant le sol était partout admise, qu’elle était mue par deux longues pédales d’orgue actionnant la roue de devant.
Malheureusement l’esprit des Anglais, si sportif fût-il, ne put faire des informes draisienne et hobby-horse un instrument de locomotion pratique. Le cyclisme en resterait-il là ? Les constructeurs s’ingénièrent à établir des machines extrêmement roulantes et légères, mais la tache originelle subsistait toujours, la propulsion par enjambées ! Les chevilles des cavaliers se luxaient ; les souliers – et c’était là le moindre malheur – dévoraient une paire de semelles par jour à ce frottement incessant contre le sol ; la vitesse obtenue n’était d’ailleurs appréciable qu’en descentes. Bref peu à peu le public de France comme celui d’Angleterre se lassa de cette première tentative curieuse et l’on attendit l’homme d’illumination géniale qui révolutionnerait l’antique vélocipédie !
On attendit cet homme pendant trente-cinq années ! Pendant trente-cinq années les chercheurs combinèrent des plans, tirèrent à perte de vue des droites et des courbes pour arriver jusqu’à la solution du problème : personne ne trouva au nid cet oiseau rare, un moyen pratique, simple et peu coûteux. Comment actionner ces deux roues autrement qu’en les poussant en avant par une pesée de pied sur le sol ?
Les inventeurs cherchèrent dans les calculs embrouillés ce qu’une heure de réflexion devait plus tard leur mettre sous la main. En 1820, un habitant de Liverpool, B. Smithe, imagine un Facilitator ou Car de voyage dont on comprendra toute l’ingéniosité hors d’application lorsqu’on saura que deux leviers sur lesquels pesait alternativement l’une ou l’autre jambe, mettaient, par l’intermédiaire de cordes, une bielle en mouvement ; la bielle actionnait une paire de tambours qui, eux-mêmes, transmettaient leur rotation aux roues motrices par une courroie de cuir !
En 1839 – près de vingt ans plus tard, tant la question cycliste est alors profondément sous terre ! – un homme de Cambridge, M. Revis, reprenant et « perfectionnant » une idée d’un M. Richard Merryweather, soumet à l’appréciation de ses contemporains une voiture d’où le service du pied était banni en tant que locomoteur. Tout par les mains ! Le véhicule est baptisé « voiture manumotive » ou « alleopode ». Les roues motrices n’avaient pas moins de six pieds (et qu’on se souvienne bien que trois pieds font un mètre !) et les bras seuls étaient chargés de traîner cet énorme poids ! Aussi les bras se refusèrent-ils vite à cette corvée et l’alleopode tomba avec ses rivaux, les véhicules compliqués, dans la fosse aux oublis.
Seize ans après, lors de l’Exposition universelle de 1855 en France, un carrossier français du nom de Lassalle présente une machine originale, un pédocaèdre, dont la complication certes n’est pas le défaut principal, car elle se compose d’une seule roue gigantesque qui supporte latéralement, se contrebalançant, deux cavaliers. Mais celui-là non plus n’avait pas trouvé la solution du grand problème cycliste : actionner les roues sans poser le pied à terre !
L’illumination du fils du serrurier Michaux. Pierre Lallement. – Le développement rapide du goût cycliste. – L’éclat de l’année 1869. – La fondation d’un journal cycliste, le Vélocipède illustré. – Fondation du premier club cycliste, le Vélo-Sport Parisien. – La première et célèbre course sur route Paris-Rouen. – Les premiers projets d’union et de fédération du monde cycliste. – La déclaration de guerre de 1870. – La dissolution presque complète du cyclisme français.
Le fils d’un serrurier français, en 1855, fut l’homme illuminé qu’or, attendait depuis près d’un demi-siècle.
M. Michaux était un serrurier en voitures établi à Paris. Chargé un jour de réparer une draisienne, dont le modèle depuis 1818 n’avait pas varié, il permit à son jeune fils de s’amuser avec ce grand jouet.
Ernest Michaux, né en 1842 à Bar-le-Duc, était, quoique tout enfant encore, bon ouvrier et surtout bon forgeron. Bien qu’il n’eût reçu qu’une instruction tout à fait rudimentaire, il s’assimilait facilement les idées qu’il voyait exécuter par autrui ; c’est ainsi que, sans connaissances spéciales, il construisait de petites machines à vapeur qui fonctionnaient fort bien.
Un dimanche donc (et je tiens ces renseignements nouveaux et absolument authentiques d’un aimable contemporain et ami d’Ernest Michaux, M. Biot), le fils du serrurier qui venait d’essayer deux ou trois fois la draisienne sur l’avenue Montaigne, proche de la cité Godot-de-Mauroy qu’habitait alors son père, se demanda tout d’un coup si, le pied ne frappant plus le sol, il ne serait pas possible à un homme de rouler sans tomber, ainsi que le fait un cerceau tant qu’il est actionné. Or, actionner une roue, était-ce si difficile ? N’en actionnait-il pas une lui-même chaque jour lorsqu’il repassait ses instruments sur la meule ? La meule était mue par une manivelle : c’était donc par une manivelle qu’il fallait mouvoir la roue d’une draisienne !
Cette géniale invention d’un enfant de quatorze ans, qu’il est si aisé aujourd’hui d’expliquer en deux mots et même de trouver banale, fut le premier anneau de l’immense chaîne cycliste. Sans elle certainement la vélocipédie n’existerait pas, car, encore une fois, l’idée de la manivelle, si simple fût-elle, n’était venue à la cervelle d’aucun chercheur pendant quarante années et sans doute depuis 1855 elle se ferait encore attendre. Pour quelle raison serait-elle venue ? L’inspiration, et réellement Ernest Michaux reçut là un coup d’inspiration comme on reçoit un coup de soleil, sans trop s’en douter, est une capricieuse qui généralement, fille de Jean de Nivelle, s’enfuit quand on l’appelle.
Fac-similé exact de la seule photographie qui existe du célèbre inventeur.
Ernest Michaux donc adapta à la draisienne réparée une paire de manivelles en fer, forgées à la hâte, et s’élança au hasard sur cette mécanique étrange, dans ce vide spécial qu’est un équilibre inconnu. Les chutes inévitables du début ne le découragèrent pas ; à chaque reprise il se sentait un peu plus d’aplomb ! Deux jours après, il était sûr de soi et parlait de son système à quelques amis. C’est ainsi qu’à la forge d’un serrurier parisien prit feu en 1855 l’incendie cycliste dont brûle le monde entier aujourd’hui.
Le vélocipède primitif qu’était encore le véhicule de Michaux attira assez d’amateurs pour que quelques années plus tard le serrurier fût à la tête de plusieurs ouvriers.
L’un d’eux, d’une rare intelligence, Pierre Lallement, né à Pont-à-Mousson, et venu à Paris vers 1863, tomba réellement amoureux du vélocipède, au point d’en perdre jusqu’à la notion exacte de l’imbécillité des badauds ! Un jour de 1863, par un beau soleil de mai, ne s’imagina-t-il pas d’aller monter son cheval de bois en plein boulevard Saint-Martin ? Les gamins le harcelèrent, le jetèrent à bas de sa monture et ameutèrent une telle foule que l’inventeur fut mené au poste…
Désespéré de cet échec, Lallement, qui était l’auteur de plusieurs procédés nouveaux de fabrication, partit en Amérique, à Ausonia, dans le Connecticut et chercha à s’établir. Mais la malchance mit toujours des bâtons dans ses deux roues : en 1866, au parc de Newhaven, même mésaventure lui arriva qu’à Paris sur le boulevard Saint-Martin ! Il se consola, se remit au travail, s’associa avec un nommé James Carrol qui prit avec lui un brevet ; mais exaspéré de l’indifférence du public américain et de la lenteur du succès qui n’arrivait jamais, il abandonna, à Ausonia, associé, mobilier et vélocipède, et reprit le bateau pour la France.
Lallement rentrait à Paris à l’époque propice. L’Exposition universelle de 1867 venait d’avoir lieu. Les curieux s’étaient approchés des machines de Michaux, les avaient examinées, en avaient demandé le prix et le maniement et les avaient achetées. En Angleterre, les « Michaux » étaient cotés 25 livres sterling, soit 625 francs. Lallement revenait donc à l’heure où la vélocipédie commençait à faire recette. Aussi se réinstalle-t-il en hâte à Paris, concurremment avec Michaux et s’efforce d’attirer la clientèle : le premier, il publie des catalogues ; le premier, il « construit sur mesure » des vélocipèdes pour toutes les tailles, etc., en un mot il témoigne de toutes façons possibles de son amour sincère pour le vélocipède et pour les bénéfices qu’il rapporte.
Tandis qu’il gagnait enfin quelque argent à Paris, son associé américain vendait le brevet qu’ils avaient pris ensemble, et Lallement, après un procès, encaissa une dizaine de mille francs pour sa part.
Après 1870, Lallement a disparu. Qu’est-il devenu ? Le goût des voyages l’a-t-il ressaisi ? Aucun de ses contemporains ne m’a pu renseigner.
Il convenait au moins de saluer d’un alinéa l’homme qui, le premier, et au prix de déboires incessants, est allé porter à l’étranger cette bonne nouvelle qu’un sport nouveau était né à Paris !
Michaux avait prospéré. Avec l’aide de commanditaires, MM. Ollivier frères, il était parvenu à fonder une très importante maison, sous la raison Michaux et Cie. De nombreux loueurs de vélocipèdes s’étaient établis à côté de lui, aux environs de la Porte-Maillot, les Favre, les Ripert, etc., qui, moyennant « dix francs à forfait » se chargeaient d’inoculer aux débutants la fièvre vélocipédique. En province, des clubs se fondaient, des magasins de location tendaient leurs écriteaux à l’entour des places publiques sans voitures et sans pavés ; toute la jeunesse qui se sentait un peu de vigueur à dépenser et pas beaucoup de respect humain (car de nos jours encore un cycliste passe pour un garçon au moins original ; quel adjectif lui appliquait-on en 1868 ?) voulait tâter de cette fraîche découverte.
L’enthousiasme des initiés se chargea de recruter des adhérents. Peu à peu les rangs des vélocipédistes se serrent ; on se sent les coudes et l’on veut se soutenir. Un journal spécial fait tout à coup son apparition, le Vélocipède Illustré, fondé par M. Richard Lesclide. Le monde cycliste frémit de joie : voici qu’on devient petite puissance ! Un club se fonde à Paris, le Véloce-Club, et dans chaque chef-lieu poussent des imitations du nouveau cercle parisien. Grenoble même se paye un double luxe : un cercle et un journal. Les deux feuilles vélocipédiques, comme il est juste, se déchirent entre elles ; une troisième pointe à New-York. Sur les boulevards, au jour de l’an, le jouet à la mode est le vélocipède minuscule descendant à l’aide de contrepoids le long d’une corde tendue. Le gymnase Paz, en plein cœur de Paris, affiche des goûts cyclistes, donne des leçons, vend des machines. Rue du Temple, pour attirer le badaud, un marchand de chaussures intitule son magasin « Au Vélocipède ! » Au Pré Catelan, chaque dimanche des courses ont lieu. Dans les théâtres, quelques acrobates commencent des tours d’adresse en vélocipède ; un aéronaute même, désireux d’en finir avec la vie, suspend un trapèze sous la nacelle du ballon, monte un vélocipède sur le trapèze et se tient en équilibre sur le tout, sans en mourir ! Les chutes du Niagara elles-mêmes ont à cette époque leur anecdote vélocipédique : le 25 août 1869, un professeur américain Jenkins les traverse sur une corde tendue, en vélocipède, à l’endroit même où Blondin les avait jadis passées. L’Italie, l’Amérique, l’Angleterre, la France ! En 1869, la foi cycliste flambait déjà aux quatre coins de l’univers !
L’activité des constructeurs eut la fièvre elle-même. Chaque cycliste de 1869 se croit à son tour inventeur et adresse à son organe attitré, le Vélocipède Illustré, la description de sa découverte. La bonne feuille insère le tout, en se réservant le droit de sourire et quelquefois de railler. La lecture de cette précieuse collection qui ne dure malheureusement que deux années, 1869 et 1870, tuée bientôt comme le cyclisme lui-même par la guerre de Prusse, constitue une des grandes récréations mentales que puisse s’offrir aujourd’hui un véloceman érudit.
La lecture en est amusante, mais elle est instructive aussi. Le Vélocipède Illustré est ainsi le gazetier qui nous raconte les anecdotes de 1869, et le professeur qui nous apprend les perfectionnements considérables survenus à l’époque, tels que la création d’un frein, la découverte de l’application du caoutchouc aux roues de bois cerclées de fer. C’est lui qui, dans le gigantesque combat que l’on se livra au commencement de la vélocipédie sur la question des machines à employer, enregistre les coups et console les vaincus : monocycle, ou bicycle, ou tricycle, quel instrument fallait-il choisir ? Chacun avait ses partisans et des partisans acharnés, croyez-le-bien ! C’est le 21 juillet 1869 qu’un inventeur de monocycle, M. Martin, croyant avoir été volé de son idée par un M. Darmand, attend son rival au Bois de Boulogne et le jette, cavalier et monture, dans un des lacs !
Vous faut-il d’autres preuves de la férocité réelle avec laquelle les inventeurs défendaient alors leur bien ? Voici ce que raconte, dans son numéro du 20 août 1869, le Courrier d’Albany :
« Un américain, sir Dunham, propriétaire des environs de Burnets-Field, avait eu l’idée d’utiliser pour son usage les rails peu surveillés des chemins de fer des États-Unis. Il avait fait construire un wagonet à quatre roues, très léger, de la largeur des rails, qu’il poussait au moyen de pédales : il visitait ainsi ses propriétés. Il savait l’heure des trains et circulait aux moments propices. Signalé plusieurs fois cependant par des mécaniciens qui l’avaient vu descendre à leur approche, il était toléré par les compagnies qui hésitaient devant le ridicule d’un procès.
Un M. F…, établi sur les rives du Mohawsk, le vit passer un jour dans son wagonet, trouva le moyen ingénieux et se fit construire un véhicule semblable.
La première fois que les deux rivaux se rencontrèrent, M. F… poliment enleva son instrument des rails et laissa passer sir Dunham. Mais la seconde fois, il exigea que sa politesse lui fût rendue. Les deux voyageurs se disputent et l’échange des mots vifs va se résoudre en coups de revolver, quand Dunham propose un duel moins banal que celui des armes à feu.
La voie courait sur un remblai de 100 pieds de hauteur. Chacun des adversaires recule de 200 mètres et, sur un signal donné par leurs mouchoirs, tous deux se précipitent l’un contre l’autre en pédalant désespérément.
Le choc fut terrible. Dunham eut le crâne fendu et mourut sur le coup. M. F… eut une jambe cassée qu’on dut lui amputer le lendemain. »
Après cette anecdote bordée de noir, le récit de tout autre semblerait fade. Elle suffira à montrer que l’enfance d’un sport comme l’enfance d’un peuple a ses hauts faits de barbarie.
Nous verrons dans les chapitres suivants de quelle importance ont été les perfectionnements apportés à l’outillage cycliste par l’année 1869 et par quelles phases inimaginables la moindre amélioration, qui nous semble si aisée aujourd’hui, si même démodée, telle que l’emploi du caoutchouc plein, a dû passer pour arriver lentement à la splendide machine moderne.
L’année 1869 fut encore l’année de la création des principaux clubs en France et l’année de la première installation réglementée des courses. Car il est un caractère distinctif de la vélocipédie d’avant 1870, qu’elle n’était guère considérée alors que comme chose de sport. On ne se soucie pas du vélocipède comme d’un instrument de route et d’excursions : on ne l’envisage que sur une piste et arrivant premier ! Il est en effet assez naturel que la qualité maîtresse du vélocipède, sa vitesse, ait tout d’abord frappé l’imagination avant que sa qualité secondaire, sa commodité, ait été devinée par ses partisans.
Le Vélo-Sport Parisien fut le cercle le plus épris du sport cycliste. C’est lui qui organise les courses à Paris, les dimanches et jeudis à l’Ancien Hippodrome ; dans la banlieue, à Saint-Cloud, au Raincy, à Enghien et à Pantin. C’est lui qui fait juridiction dans le monde des coureurs et ce sont ses statuts qui font loi.





























