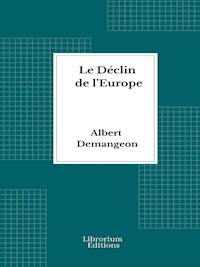
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La guerre aura sans doute amené l’humanité à détester davantage la guerre ; elle aura peut-être préparé la Société des Nations.
Mais elle aura certainement démontré avec force le rôle des facteurs économiques dans la vie du monde et que ce qui mène d’abord les hommes, c’est la sécurité des moyens de vivre, la conquête du bien-être matériel et le souci du pain quotidien. La recherche du progrès économique se place en tête des aspirations des peuples. On croit toujours que le moyen d’être heureux est de posséder la force économique.
Par elle-même, la guerre aura précipité l’univers entier dans cette course à la fortune. Elle a tant détruit de commodités, d’épargnes et de richesses que le travail matériel s’élève à des prix qu’il n’avait pas atteints depuis longtemps. Ce sera au détriment du travail non producteur d’objets matériels ; il y aura là, pour un temps indéterminé, une régression de l’esprit. Des années se passeront pour nos sociétés à reconstruire ce qui fut démoli et à recréer ce qui fut détruit ; et c’est dans la mesure où ses mains collaboreront à cette œuvre que se déterminera la valeur sociale d’un homme ; il y aura réfection de la hiérarchie sociale, déplacement de fortune.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
A. DEMANGEON
MAÎTRE DE CONFÉRENCES DE GÉOGRAPHIE À LA SORBONNE
LEDÉCLIN DE L’EUROPE
1920
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383835165
TABLE DES MATIÈRES
Introduction.
CHAPITRE PREMIER
L’affaiblissement de l’Europe.
I. La crise de production en Europe. — Le déficit des récoltes. Les fournisseurs de l’Europe, les anciens et les nouveaux.
II. Les dettes de l’Europe. — Les excédents d’importations. Le bilan des dettes.
III. Le déchet humain. L’émigration européenne. — Les pertes de vies ; le déficit des naissances. L’émigration et la race européenne dans le monde.
CHAPITRE II
La puissance financière.
I. La puissance financière des États-Unis. — Formation de la puissance capitaliste des États-Unis : l’excédent des exportations ; l’afflux de l’or ; le rôle de banquier du monde. — Expansion capitaliste des États-Unis : les organes financiers ; la prime du dollar ; les crédits à l’Europe
II. La puissance financière du Japon. — L’excédent des exportations ; l’afflux d’or ; les placements à l’étranger ; la poussée des affaires.
CHAPITRE II
La puissance maritime.
I. La flotte des États-Unis.
Les constructions navales : les entreprises du Shipping Board ; les chantiers de construction navale ; les tonnages lancés ; la flotte marchande américaine.
Les relations maritimes : la lutte contre l’Europe en Amérique du Sud ; le développement des lignes régulières dans l’Atlantique et dans le Pacifique.
La domination des routes maritimes : les Antilles et les isthmes américains ; les câbles sous-marins. La politique océanique des États-Unis.
II. La flotte du Japon.
Les constructions navales : le manque de fer ; les chantiers ; la flotte marchande japonaise.
Les relations maritimes : l’armement japonais dans l’Atlantique et dans le Pacifique.
III. Le commerce d’entrepôt.
Le commerce de réexportation de Londres et des ports européens. Le développement des relations directes des États-Unis. Le déplacement des routes maritimes vers l’Océan Pacifique.
CHAPITRE IV
La puissance industrielle.
I. Les États-Unis.
La colossale production de matières premières. — Le développement de la fabrication des articles finis. Les automobiles. Les produits chimiques. Les tissus. — L’organisation de l’exportation.
II. Le Japon.
La poussée industrielle, effet de la guerre. La sidérurgie. Les produits chimiques. Les industries alimentaires. Les manufactures de coton. L’industrialisation du Japon.
III. Le Brésil.
L’enrichissement du Brésil. La question de la houille et du fer. Les manufactures de coton.
CHAPITRE V
L’expansion du Japon.
I. Le Japon dans l’Océan Pacifique.
Position géographique du Japon. Politique de points d’appui dans le Pacifique. Le commerce du Japon avec l’Asie.
II. Le Japon et l’Amérique latine.
L’émigration japonaise vers l’Amérique latine. Le courant d’échanges entre le Japon et l’Amérique latine.
III. Le Japon et les colonies de l’Europe.
L’Inde britannique. Les Indes néerlandaises. L’Australasie. La Sibérie.
IV. Le Japon et la Chine.
Formes de l’expansion japonaise en Chine : échanges commerciaux, minerai de fer ; relations financières ; influences politiques. — Régions d’expansion japonaise en Chine : Mandchourie et Chantoung. — La mission du Japon et le péril blanc.
CHAPITRE VI
L’expansion des États-Unis.
I. Caractères de l’expansion américaine.
L’accroissement des exportations. L’extension des marchés de matières premières. L’offensive économique.
II. Les États-Unis en Europe et en Asie.
L’Extrême-Orient ; la Chine ; les Indes Néerlandaises. L’Australasie. — L’Europe ; la Grande-Bretagne ; la France ; les pays germaniques et Scandinaves ; l’Espagne ; la Russie. — L’Afrique ; l’Abyssinie.
III. Les États-Unis et l’Amérique latine.
La position de l’Europe dans l’Amérique du Sud. La propagande en faveur des affaires sud-américaines. Les formes de l’expansion des États-Unis : concours financiers et entreprises économiques. L’accroissement des transactions commerciales avec l’Amérique du Sud.
IV. Le panaméricanisme.
Tendances et faits. Les particularismes sud-américains. L’impérialisme yankee.
CHAPITRE VII
L’Europe et l’éveil des peuples indigènes.
I. L’Européen devant les peuples indigènes.
L’exploitation économique des peuples dits inférieurs. Les principales zones de conflit.
II. Les foyers de révolte.
Les États-Unis. L’Égypte. L’Inde.
CHAPITRE VIII
Et la France ?
Les conditions de la rénovation : avoir beaucoup d’hommes ; faire rendre le maximum à la terre ; fabriquer à force de machines ; étendre le commerce de mer ; associer les colonies à l’effort national.
Conclusion.
INTRODUCTION
La guerre aura sans doute amené l’humanité à détester davantage la guerre ; elle aura peut-être préparé la Société des Nations.
Mais elle aura certainement démontré avec force le rôle des facteurs économiques dans la vie du monde et que ce qui mène d’abord les hommes, c’est la sécurité des moyens de vivre, la conquête du bien-être matériel et le souci du pain quotidien. La recherche du progrès économique se place en tête des aspirations des peuples. On croit toujours que le moyen d’être heureux est de posséder la force économique.
Par elle-même, la guerre aura précipité l’univers entier dans cette course à la fortune. Elle a tant détruit de commodités, d’épargnes et de richesses que le travail matériel s’élève à des prix qu’il n’avait pas atteints depuis longtemps. Ce sera au détriment du travail non producteur d’objets matériels ; il y aura là, pour un temps indéterminé, une régression de l’esprit. Des années se passeront pour nos sociétés à reconstruire ce qui fut démoli et à recréer ce qui fut détruit ; et c’est dans la mesure où ses mains collaboreront à cette œuvre que se déterminera la valeur sociale d’un homme ; il y aura réfection de la hiérarchie sociale, déplacement de fortune.
D’autres étudieront cette évolution économique qui fermente à l’intérieur des sociétés et dont le dénouement paraît être conforme à l’idéal de justice du plus grand nombre des hommes. Pour nous, ce que nous voulons tenter ici, c’est de considérer le déplacement de la fortune qui apparaît comme l’un des faits capitaux de la guerre, non pas du point de vue social, mais du point de vue international. Il n’est douteux pour personne que l’Europe, qui régissait le monde jusque vers la fin du dix-neuvième siècle, perd sa suprématie au profit d’autres pays ; nous assistons au déplacement du centre de gravité du monde hors d’Europe ; nous voyons sa fortune passer aux mains des peuples de l’Amérique et de l’Asie.
Jusqu’ici c’était un fait élémentaire de géographie économique que l’Europe dominait le monde de toute la supériorité de sa haute et antique civilisation. Son influence et son prestige rayonnaient depuis des siècles jusqu’aux extrémités de la terre. Elle dénombrait avec fierté les pays qu’elle avait découverts et lancés dans le courant de la vie générale, les peuples qu’elle avait nourris de sa substance et façonnés à son image, les sociétés qu’elle avait contraintes à l’imiter et à la servir.
Quand on songe aux conséquences de la grande guerre, qui vient de se terminer, sur cette prodigieuse fortune, on peut se demander si l’étoile de l’Europe ne pâlit pas et si le conflit dont elle a tant souffert n’a pas commencé pour elle une crise vitale qui présage la décadence. En décimant ses multitudes d’hommes, vastes réserves de vie où puisait le monde entier ; en gaspillant ses richesses matérielles, précieux patrimoine gagné par le travail des générations ; en détournant pendant plusieurs années les esprits et les bras du labeur productif vers la destruction barbare ; en éveillant par cet abandon les initiatives latentes ou endormies de ses rivaux, la guerre n’aura-t-elle pas porté un coup fatal à l’hégémonie de l’Europe sur le monde ?
Depuis l’époque des grandes découvertes, l’Europe avait imposé à l’univers sa direction économique ; elle transportait sur ses navires les produits des pays lointains ; elle attirait dans ses ports le marché des denrées exotiques ; elle accumulait dans ses banques les profits du commerce pour les appliquer ensuite à l’exploitation des régions vierges ; elle produisait dans ses usines les articles manufacturés qu’elle vendait partout aux peuples mal outillés ; elle fournissait aux territoires vides les colons nécessaires à leur peuplement ; en un mot, elle dispensait au monde entier les trésors de son argent, de sa force et de sa vie. Par un de ces déplacements de fortune qui font surgir à la pleine lumière certains peuples à la place de certains autres, notre vieux pays est-il en danger de descendre, éclipsé par les jeunes nations qui montent ?
Déjà la fin du dix-neuvième siècle nous avait révélé la vitalité et la puissance de certaines nations extra-européennes, les unes comme les États-Unis nourries du sang même de l’Europe, les autres, comme le Japon, formées par ses modèles et ses conseils. En précipitant l’essor de ces nouveaux venus, en provoquant l’appauvrissement des vertus productrices de l’Europe, en créant ainsi un profond déséquilibre entre eux et nous, la guerre n’a-t-elle pas ouvert pour notre vieux continent une crise d’hégémonie et d’expansion ?
Dépeuplée et appauvrie, l’Europe sera-t-elle apte à maintenir sur le monde le faisceau de liens économiques qui compose sa fortune privilégiée ? Sera-t-elle toujours la grande banque qui fournissait des capitaux aux régions neuves ? Comme puissances capitalistes, le Japon et surtout les États-Unis sont devenus ses rivaux. Sera-t-elle toujours la grande entreprise d’armement qui transportait de mer en mer les hommes et les produits de toute la terre ? D’autres marines se construisent et s’équipent qui lui disputent ce rôle fructueux de roulier des mers. Sera-t-elle toujours la grande usine qui vendait aux peuples jeunes ses collections d’articles manufacturés ? Aux États-Unis et au Japon naissent et grandissent des industries qui visent les mêmes débouchés. Sera-t-elle toujours la grande puissance économique du monde ? Elle n’est déjà plus seule à l’exploiter, à le coloniser, à le financer.
On peut donc dire que nous assistons au déclin de l’Europe. Il est intéressant de chercher sur quels points de la terre on commence à voir son domaine se démembrer et quels sont les pays qui profitent de ce déplacement de fortune. Il apparaît nettement que, sur des territoires différents et à des titres divers, les héritiers de l’Europe sont les États-Unis et le Japon. Depuis longtemps la doctrine de Monroe avait marqué des limites aux ambitions politiques de l’Europe sur le continent américain ; l’essor prodigieux des États-Unis dans la production industrielle impose de même des limites à l’expansion économique de l’Europe ; l’Amérique latine, longtemps fief de notre commerce, cède peu à peu à l’attraction yankee ; bien plus, par une curieuse inversion des courants d’influences, la vieille Europe s’ouvre à la jeune Amérique comme une terre de colonisation. En Extrême-Orient, le Japon cherche à réaliser dans l’ordre économique la formule que ses missionnaires et ses diplomates propagent depuis les Indes jusqu’à la Sibérie : l’Asie aux Asiatiques. Et voici que les races, parmi lesquelles l’Europe avait longtemps recruté des esclaves et des ouvriers, commencent à réclamer le traitement politique qui sera le premier fondement de leur indépendance économique : c’est toute la fortune de l’Europe qui chancelle.
Ces déplacements de puissance se préparent sous nos yeux ; ils ne s’achèveront sans doute pas avant de longues années. Mais notre devoir et notre intérêt nous conseillent de tenir constamment ouvert ce chapitre de l’histoire de l’humanité qui commence. Nos éléments d’information se trouvent dispersés à travers le monde, partout où les Européens ont posé le pied. Nous tenterons seulement de grouper les faits les plus significatifs, en souhaitant que, dans chaque pays, des hommes mieux renseignés entreprennent l’étude locale de ce fait universel. Qu’il nous suffise, pour l’instant, d’en marquer l’ampleur et la portée[1].
↑
Nous citons, chemin faisant, les principaux ouvrages auxquels nous avons emprunté des renseignements. — La plupart de nos chiffres viennent de statistiques, publiées soit par des services officiels, soit par des revues économiques. — Au nombre de nos sources d’information, nous devons signaler beaucoup d’articles de journaux, français et étrangers, dûment vérifiés et confrontés. Citons particulièrement le
Bulletin Quotidien
et le
Bulletin Périodique de la Presse étrangère
, publiés par les Ministères des Affaires Étrangères et de la Guerre, dont certaines parties, par exemple l’Amérique du Sud, sont, pour les questions économiques, très sérieusement composées.
CHAPITRE PREMIERL’AFFAIBLISSEMENT DE L’EUROPE
La guerre a profondément atteint l’économie européenne. Pour imaginer ses effets désastreux et supputer leurs risques de durée, on est tenté de se reporter aux époques les plus douloureuses de l’histoire de l’humanité ; on évoque le souvenir de la guerre de Cent Ans pour la France et de la guerre de Trente Ans pour la France de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest. Des documents certains nous apprennent combien il fallut de temps aux malheureuses régions ravagées par les bandes et par les troupes pour se relever de leurs ruines et de quelle lourde hypothèque ces dévastations y chargèrent le développement de la civilisation. Au xviie siècle, notre province de Champagne souffrit tellement des ravages des Suédois et des Croates que l’industrie du fer, si prospère sous Henri IV et durant le début du règne de Louis XIII, fut presque réduite à la ruine ; la plupart des forges cessèrent de travailler ; plusieurs ne revinrent jamais à la vie ; on ne sentit qu’à la longue les effets de la paix, et, malgré les efforts de Colbert, il ne semblait pas à la fin du siècle que la métallurgie eût retrouvé toute sa prospérité d’autrefois. Plus près de nous, nous savons que les guerres de Napoléon ont laissé la France affaiblie alors que, de l’autre côté de la Manche, la révolution industrielle édifiait la fortune moderne de la Grande-Bretagne. Mais ces comparaisons ne suffisent pas à l’intelligence du présent parce que la grande guerre a été un fléau d’une grandeur jusqu’alors inconnue ; elle a mis aux prises des armées de plusieurs millions d’hommes représentant des pays de plusieurs centaines de millions d’habitants ; elle a mis en œuvre des engins de destruction formidables qui ont fauché des millions de vies humaines, annihilé des siècles de travail et d’économie, et même détruit la terre des champs. La guerre a porté le trouble dans une civilisation savante et ponctuelle ; elle a désorganisé les merveilles d’agencement qui la supportaient ; elle a jeté bas les fondements même de son existence : production intensive des champs, travail compliqué et spécialisé des usines, transports réguliers, relations universelles. Aussi quand on essaie de voir où le mal a porté, on constate que la guerre a eu surtout trois effets directs sur l’économie européenne ; en arrêtant la production, elle a obligé l’Europe à faire à l’étranger des achats qui l’ont endettée et rendue débitrice de ses anciens créanciers ; en détruisant les biens, elle l’a obligée à se reconstituer perdant ainsi les moyens de créer de nouvelles richesses à échanger ; enfin, en tuant des multitudes d’hommes, elle a tari une source d’énergie et de vitalité.
ILA CRISE DE PRODUCTION EN EUROPE
L’Europe, qui déjà bien avant la guerre ne pouvait se passer des envois de l’étranger en matières alimentaires, tombe de plus en plus sous la dépendance des autres pays. Tandis que les rendements de son agriculture s’abaissaient l’obligeant à de coûteuses importations, la production s’accroissait ailleurs, en vue de suffire aux demandes énormes des belligérants.
Nous pouvons prendre la France comme un exemple de ces pays agricoles dont la terre dut chômer faute de travailleurs. Si nous comparons en 1903-1912 et en 1918 les récoltes et les surfaces cultivées, nous constatons que le blé est tombé de 6 500 000 à 4 300 000 hectares et de 89 600 000 à 63 600 000 quintaux ; l’avoine, de 3 800 000 à 2 600 000 hectares et de 48 400 000 à 27 400 000 quintaux ; les pommes de terre, de 1 500 000 à 1 100 000 hectares et de 132 000 000 à 62 100 000 quintaux. Pour le blé, la production française a donc baissé de près de 30 pour 100 ; pour les pommes de terre, de plus de 100 pour 100.
En contraste avec ces productions réduites, nous voyons aux États-Unis, de 1900 à 1918, la récolte de blé bondir de 190 à 334 millions d’hectolitres ; celle du maïs, de 766 à 940 ; celle de l’avoine de 294 à 560 ; celle de la pomme de terre, de 77 à 135. La moisson de blé de 1918 ne connaît de rivale dans l’histoire agricole des États-Unis que celle de 1915 ; malgré l’accroissement continu de la population, elle a laissé libre pour l’exportation une masse de près de 110 millions d’hectolitres. La récolte de 1919 ne le cède guère en abondance. Tandis que l’Europe s’inquiète pour son pain quotidien, les États-Unis redoutent la pléthore, car leurs excédents de récolte rencontrent sur le marché le trop plein de l’Argentine et de l’Australie. Sans les grains du Nouveau-Monde, l’Europe ne mangerait pas à sa faim ; cette situation date d’avant la guerre ; mais la guerre a rendu critique la question des vivres ; pour la seule année de 1916, l’Europe reçut des États-Unis plus de deux milliards de francs de farine ; elle continuera à dépendre d’eux et des autres pays neufs pour une large portion de sa subsistance.
Pour combler le déficit des récoltes européennes, les pays qui travaillaient en paix ont développé leur production ; il en est même qui l’ont créée de toutes pièces. Nulle part cet essor ne fut plus rapide que dans l’Amérique du Sud ; une véritable révolution économique s’y prépare. En Argentine, d’énormes achats de blé se sont faits pour le compte de l’Angleterre et de la France ; partout on sème en blé de grandes étendues de terre qu’on avait jusqu’ici consacrées au maïs ; devant l’abondance des récoltes, on se demande avec inquiétude comment on pourra les emmagasiner, puis les embarquer pour l’Europe ; pour la seule année de 1917-1918, l’Argentine disposait de quatre millions de tonnes prêtes à l’exportation ; la vente du blé à l’Europe s’élève aux proportions d’une affaire nationale ; en 1919, on l’a réglée par une convention entre le gouvernement argentin et les gouvernements de Grande-Bretagne, de France et d’Italie. En 1918, l’Argentine exporta 4 325 830 tonnes de grains valant 535 millions de pesos (blé, 2 437 209 tonnes ; avoine, 646 765 ; graine de lin, 164 958 ; maïs, 825 935) ; ce commerce représente la grande fortune du pays ; au début de 1919, la grève des dockers de Buenos-Aires, qui menaçait de l’arrêter, apparaissait comme un fléau national. C’est aussi l’Europe qui absorbe presque toute la récolte de l’Uruguay.
Mais les pays de la Plata avaient depuis longtemps de vastes champs de blé ; depuis longtemps ils étaient les fournisseurs de l’Europe. Le fait vraiment caractéristique de toute cette évolution économique, c’est l’apparition du Brésil sur le marché du monde comme exportateur de blé. Avant la guerre, le Brésil produisait peu de blé ; il en importait même pour sa consommation ; comme la rareté du fret, conséquence de la guerre, compromettait ses approvisionnements, il se mit à développer les champs de blé dans les États du Sud de telle manière que la récolte non seulement suffît aux besoins du pays, mais encore permet des ventes à l’Europe. En 1917, on récolta 17,8 millions d’hectolitres de blé dans le Minas Geraes, 17,2 dans le Rio Grande do Sul, 13,2 dans le Sao Paulo, 3,6 dans le Parana, 2,7 dans le Santa Catarina. Tandis que le Brésil importait 24 973 tonnes de blé en 1906, il n’en importait plus que 187 tonnes en 1917 et il en exportait 24 047, valant 4 900 000 francs. D’autres cultures, surexcitées par la demande extérieure, se développent à l’unisson : des chargements de riz, de manioc, de haricots quittent le Brésil à destination du vieux monde. Tout l’ensemble du continent américain contribue donc à l’alimentation de l’Europe. Comme elle est incapable de payer ces fournisseurs avec ses propres produits, elle doit leur donner son or ou bien leur demander crédit. L’Europe fait des dettes sur toute la terre.
Pour bien d’autres approvisionnements, l’Europe passe sous la dépendance des autres pays. Depuis longtemps la Grande-Bretagne achetait de la viande en Argentine. La France, ayant souffert de grosses pertes de bétail, doit maintenant faire appel aux mêmes ressources ; de 1912 à 1918, le nombre des bêtes bovines est tombé chez nous de 14,7 à 13,3 millions ; le nombre des moutons, de 16,4 à 9,4 millions ; le nombre des porcs de 6,9 à 4 millions. Pour les moutons et les porcs, ces chiffres révèlent un énorme déchet. Pour les bêtes à cornes, la diminution paraît moindre ; mais l’âge moyen des animaux a baissé de telle sorte que leur poids, c’est-à-dire leur rendement en viande, se trouve fortement réduit ; de plus, nous possédons beaucoup moins de vaches laitières. Aussi les exportations de viande argentine ont monté de 200 millions de pesos or en 1913 à 376 millions en 1917 ; elles s’accroîtront tant que l’Europe n’aura pas reconstitué son cheptel ; avec ses usines frigorifiques équipées à la moderne, l’Argentine occupe, aux côtés de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, une place de premier ordre sur le marché de la viande. Comme Buenos-Aires en Argentine, Montevideo en Uruguay expédie des cargaisons de viande congelée vers le Havre, Bordeaux, Londres et Liverpool. Toute l’économie pastorale se trouve entraînée dans le même mouvement : pour la première fois en 1917 l’Argentine exportait du fromage en Europe. Au Brésil, de gros établissements frigorifiques se sont fondés près de Sao Paulo et dans le Minas Geraes : alors qu’en 1914 le pays n’exportait pas de viande congelée, il en expédiait 8 510 tonnes en 1915, 66 452 tonnes en 1917. Ailleurs c’est la production de sucre qui monte ; on peut dire que l’Amérique latine a sauvé de la disette de sucre les États-Unis et les pays de l’Entente ; Porto-Rico, Saint-Domingue et surtout Cuba ont été les gros fournisseurs ; mais d’autres pays, comme le Honduras, le Nicaragua, le Costa-Rica, la Colombie, le Venezuela, le Chili, le Pérou et la Bolivie, ont apporté leur contingent sur le marché ; quant au Brésil, il a exporté en 1917 plus de 13 000 tonnes de sucre, chiffre dix fois plus fort que celui de 1912. Denrée précieuse et chère, le sucre, impose à l’Europe une lourde dépense que, faute de produits d’échange, elle doit en partie solder avec de l’or. À ces vivres il faudrait ajouter des masses d’autres objets de première nécessité dont la guerre avait créé en Europe l’impérieux besoin : c’est ainsi que de grosses commandes de traverses de chemin de fer ont abouti à l’exploitation forestière de certaines parties de l’Amérique du Sud et à des expéditions énormes de bois.
Ces considérations ne nous donnent qu’une faible idée de ce que l’Europe a perdu par déficit de production. Il faut songer non seulement à ce qu’elle dut acheter pour vivre, mais encore à ce qu’elle dut acquérir pour combattre. Vaste machine industrielle avant la guerre, elle fut incapable de suffire à ses fabrications de guerre ; pendant 1916, elle reçut des États-Unis en moyenne 300 millions de francs d’armes et de munitions chaque mois ; les usines américaines faisaient des affaires d’or ; au bout des deux premières années de guerre, elles avouaient des bénéfices de plus de 4 milliards de francs.
On comprend que ces achats de denrées de consommation et d’articles manufacturés représentent pour l’Europe d’énormes dépenses qu’elle n’a pu solder comptant : de là les dettes formidables qui pèsent sur les nations belligérantes.
IILES DETTES DE L’EUROPE
La nécessité d’acheter pour suffire à leur consommation et l’impossibilité de travailler assez pour créer des produits d’échange ont profondément déséquilibré la balance commerciale des pays en guerre ; cette situation économique se traduit par un excédent des importations sur les exportations qui atteint des proportions jusqu’alors inconnues.
L’exemple de la Grande-Bretagne est particulièrement suggestif. Avant la guerre, elle avait bien un excédent d’importations ; mais c’était ainsi que se traduisait dans la balance de son commerce la masse des marchandises qui entraient chez elle pour payer les intérêts de ses capitaux placés au dehors. Avec la guerre, l’excès des importations prend des proportions colossales et signifie appauvrissement. En 1918, les importations de la Grande-Bretagne ont dépassé de 550 millions de livres sterling celles de 1913 ; les exportations ont été inférieures de 105 millions de livres sterling aux exportations de 1913 ; pour cette année 1918, l’excès des importations s’élève à 790 millions de livres sterling, soit 6 fois plus qu’en 1913 et 5 fois plus que la moyenne des dix années d’avant guerre ; pour le premier semestre de 1919, il atteignait encore près de 384 millions de livres sterling. Dans la baisse des exportations figure, pour une bonne partie, la diminution des réexportations, c’est-à-dire de l’élément le plus original et le plus productif du commerce britannique.
Pour la France, ce déséquilibre se marque, d’une manière plus brutale encore, dans les statistiques de notre commerce extérieur, ainsi que le montre le tableau suivant :
Années
Importation (millions de francs.)
Exportation (millions de francs.)
Excédent des importations (millions de francs.)
1905
4 778
4 856
− 88
1913
8 421
6 880
+ 1 541
1914
6 402
4 869
+ 1 533
1915
11 036
1 937
+ 9 099
1916
20 640
6 215
+ 14 425
1917
27 553
6 012
+ 21 541
1918
19 915
4 144
+ 15 771
Pour la France, comme pour les autres nations belligérantes, la guerre représente donc une perte énorme de richesse au profit des pays épargnés ou moins éprouvés par le fléau. On a calculé qu’une année de guerre avait à peu près détruit les économies de quatre années normales. Dès lors le bilan de la guerre s’établit par des chiffres de dettes formidables.





























