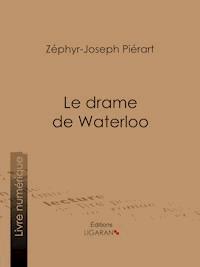
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "La France, sauvée, glorifiée par les héroïques phalanges de Jourdan, de Pichegru, de Hoche, de Moreau, de Brune et de Masséna, devait tomber, à l'intérieur, de lassitude, à la suite des gigantesques efforts qu'elle avait déployés pour assurer sa nationalité et sa régénération sociale. Lorsque ses plus grands dangers furent passés, lorsque les hommes audacieux qui avaient soutenu sa cause..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À la mémoire de deux malheureux maréchaux calomniés et d’une armée de héros sacrifiée par la faute de son chef
L’ouvrage qu’on va lire, sévère pour les hommes et les choses du passé, s’occupe peu de ceux du présent. Il invoque en faveur de sa libre circulation en France les déclarations si souvent répétées des organes du gouvernement de l’Empereur Napoléon III : que la presse ordinaire n’est pas soumise aux précautions qui régissent la presse quotidienne ou périodique, et que des ouvrages qui ne contiennent aucune attaque directe contre le chef de l’État peuvent circuler librement.
Il invoque aussi ces paroles solennellement prononcées au Sénat, lors de la présentation de la nouvelle loi sur la presse, par M. le président de la Cour impériale de Paris, rapporteur : « Ce sera un honneur pour le gouvernement impérial d’avoir mis par sa conduite le dernier sceau à l’affranchissement du livre. »
Le Drame de Waterloo invoque enfin en sa faveur ces autres mémorables paroles extraites des Œuvres de Napoléon III, rééditées en 1856 à Paris (t. II, p 352) :
Tout citoyen d’une république doit désirer d’être libre, et la liberté n’est qu’un vain mot si l’on ne peut exprimer librement par écrit ses pensées et ses opinions. Si la publicité avait des entraves dans un canton, elle irait porter ses lumières et ses bienfaits dans un autre ; et le canton qui l’aurait exclue n’en serait pas plus à l’abri de ses atteintes. La liberté de la presse doit donc être générale.
Quoi ! écrire encore sur Waterloo ? Mais c’est un sujet épuisé, sur lequel tout a été dit…
Pas autant qu’on le croit. En présence du militarisme nouveau et d’une guerre imminente avec la Prusse dans les plaines belgiques, c’est une question plus que jamais à l’ordre du jour. D’ailleurs, y a-t-il eu jamais un sujet historique qu’on puisse dire épuisé ? Quelle histoire a été plus souvent traitée que l’histoire romaine ? L’Allemand Mommsen vient de nous montrer qu’on ne la connaissait pas encore.
(L’AUTEUR.)
J’appartiens à cette génération de Français de laquelle Béranger a dit :
Je suis né dans le pays même où, à la veille de son entrée en campagne, Napoléon s’arrêta pour adresser à son armée la dernière de ses proclamations et donner l’ordre des mouvements qui servirent de prélude à la journée de Waterloo.
Il traversa alors le territoire de mon lieu natal au milieu de sa garde. Six jours après, celle-ci y reparaissait harassée, décimée, offrant le tableau de la plus effroyable défaite que jamais armée ait éprouvée.
J’eus un oncle qui figura parmi les combattants de cette malheureuse armée. Chasseur de la garde à Leipzig, il était entré en 1815 dans l’héroïque corps des cuirassiers du général Milhaud. Après le désastre, il devait repasser isolé de ses compagnons d’armes, reconduisant intact vers le lieu de ralliement un des trésors de l’armée qu’il avait trouvé exposé à la capture de l’ennemi, dans le désordre de la retraite, au milieu de soldats blessés ou mourants.
Les chemins, les champs et les bois en étaient couverts. Partout des armes abandonnées, des fuyards à la débandade, des blessés faisant retentir l’air de leurs plaintes, demandant des secours et des soins que nul n’avait pu encore leur donner. Plusieurs de ces malheureux, recueillis et soignés par ma mère, furent bientôt massacrés sous ses yeux par des hussards prussiens.
Ces cavaliers étaient les précurseurs des bataillons de Blücher. Ceux-ci s’abattirent le 20 juin, au nombre de plus de 15 000 hommes, au sein de mon lieu natal, mêlant à leurs farouches hourras des cris de mort et de vengeance, lardant, mutilant du bout de leurs baïonnettes les cadavres des malheureux soldats que leurs cavaliers venaient de massacrer. En même temps mon père, garrotté, frappé, insulté par ces furieux, était contraint à leur servir de guide, laissant à leur discrétion ses foyers, où ma mère était traînée par les cheveux, en proie aux menaces de mort de grossiers soudards qui prétendaient obtenir d’elle ce que nul n’avait en ce moment : des vivres, de l’alcool et de l’argent. Telles furent les scènes effroyables qui marquèrent alors les premiers pas sur le sol de la France d’un ennemi victorieux, impatient de représailles, et qui parut sur nos frontières dans toute la frénésie et les appétits qui accompagnent les batailles meurtrières, où les périls, les excitations de la lutte exaspèrent le moral, et où le manque de temps, la nécessité de marches rapides ne permettent guère de satisfaire les besoins physiques. C’est au milieu des récits de ces scènes effroyables que j’ai été élevé. Ils impressionnèrent vivement mon jeune âge, et de ces impressions il m’est demeuré une haine profonde contre les gouvernements militaires, les despotes et les ambitieux qui, dans le seul intérêt de leur grandeur personnelle, se plaisent à provoquer la possibilité d’aussi cruelles calamités.
Aux récits de mon père et de ma mère, à ceux des hommes de leur génération, aux impressions reçues dans mon lieu natal, j’ai joint plus tard les émotions de l’histoire. J’ai lu dans nos annales militaires la relation des évènements mémorables qui s’accomplirent aux bords de la Sambre, à Ligny, aux Quatre-Bras, à Waterloo ; j’ai même parcouru en tous sens, à différentes reprises, le théâtre de ces évènements. J’ai visité les champs, les bois, les coteaux qui furent témoins de luttes gigantesques, les plus acharnées, les plus sanglantes dont l’histoire ait gardé le souvenir. Partout j’ai fait parler les témoins encore vivants de ces luttes, interrogé les lieux, recueilli des renseignements, pris des notes. J’avais comme un pressentiment qu’un jour ces documents me seraient utiles. Ce jour est en effet arrivé pour moi vingt ans plus tard.
Forcé de passer momentanément au-delà de la frontière en 1851, à la suite d’évènements politiques contre lesquels je m’étais cru, comme tant d’autres, obligé de protester, j’ai revu les champs de bataille de l’hospitalière Belgique ; je me suis plu à parcourir de nouveau les lieux chers à ma jeunesse. Ce retour au foyer d’émouvants souvenirs, d’impressions premières, les a vivement réveillés dans mon esprit. J’avais les loisirs de l’exilé, le goût des travaux historiques : je résolus de raconter aussi la campagne de Waterloo et d’utiliser les notes que j’avais prises autrefois. Des chemins de fer nombreux sillonnent aujourd’hui les lieux illustrés par des évènements on ne peut plus mémorables. C’est la route obligée de la France vers l’Allemagne, la Prusse et les États du Nord, et de ces pays vers la France. C’est un coin de terre non seulement curieux à connaître par les grands évènements qui s’y sont accomplis, mais encore par ses sites pittoresques et les merveilles que l’industrie y crée chaque jour. Il deviendra sous peu le rendez-vous des touristes de l’Europe, comme il l’est déjà d’un grand nombre d’industriels et de marchands. J’ai pensé qu’on serait bien aise de posséder, sur des évènements dont on est à même de parcourir fréquemment le théâtre, un ouvrage nouveau, plus complet et plus exact que la plupart de ceux qui existent, et je me suis occupé de cette œuvre.
Selon l’habitude que j’ai contractée pour tout travail historique, j’ai joint à mes souvenirs, à mes notes personnelles, le plus de documents possible et puisés aux sources les plus diverses : il n’y a de bonne histoire qu’à ce prix. Nous indiquons ci-dessous en note les sources auxquelles nous avons eu recours.
Je ne me suis pas contenté de consulter ou de faire consulter ces ouvrages, ainsi que d’autres que je passe sous silence, afin de ne pas donner une nomenclature trop longue ; je suis retourné à différentes reprises sur les lieux, les plans en main. J’ai de nouveau fait parler des témoins oculaires, et cela aux endroits où l’on avait négligé jusqu’ici d’aller les consulter, et ils m’ont aidé à éclaircir des faits importants qui étaient demeurés obscurs, contestés ou méconnus. Il en a été de même pour certaines assertions dont j’ai pu reconnaître la parfaite imposture. Ce n’est qu’après avoir confronté, rapproché, commenté tant de renseignements divers, ce n’est qu’après un long travail de critique que je me suis mis à écrire. Aussi je me crois autorisé à dire que j’offre des aperçus tout à fait nouveaux sur des évènements qui, depuis quarante ans, avaient été inexactement racontés en France, imparfaitement jugés, et dont les principaux mystères étaient demeurés ignorés.
Des écrivains allemands, les premiers, avaient commencé à éclaircir le grand débat que ces évènements ont suscité ; aussi les ai-je suivis attentivement. J’ai apporté le même soin pour les documents publiés par le maréchal Grouchy, le duc d’Elchingen, les premiers qui aient aussi ébranlé la confiance aveugle qui a été apportée dans les récits que Napoléon a faits de la fatale campagne. Aujourd’hui, il m’est démontré avec la plus parfaite évidence que ces récits sont pleins d’erreurs, de faits controuvés, de suppositions forcées, de versions arrangées après coup, et que presque tous les historiens qui dans notre pays se sont appuyés sur ces récits ont mis au jour des ouvrages dont les principales bases sont à changer dans leur entier.
Selon Napoléon, Ney, Grouchy, la fatalité, la trahison, un concours d’évènements imprévus, sont les seules causes de l’issue de la journée de Waterloo.
De la fatalité, il y en eut beaucoup ; de la trahison, point, ou du moins sans action aucune sur le destin de la campagne : nous le ferons voir. Pour ce qui est du brave maréchal Ney, envoyé à la mort par la furieuse réaction qui suivit le désastre, il lui a été impossible de se justifier ; mais, contrairement à l’espoir de son accusateur, il a trouvé dans la personne d’un de ses fils un puissant avocat. Celui-ci, mû par les plus louables sentiments de piété filiale, a invoqué en faveur de la mémoire de son père des documents officiels, le registre d’ordre de l’état-major de l’armée, les attestations de plusieurs aides de camp ou généraux témoins oculaires des faits ; il a invoqué ces faits eux-mêmes. Il en a été de même de Grouchy. Les documents que tous deux ont mis au jour ont commencé une œuvre de rectification qu’il s’agit aujourd’hui de compléter.
Nous disons qu’ils ont commencé, attendu que, pour tout ce qui est des faits étrangers au commandement des deux maréchaux incriminés dans les assertions de Napoléon, les jugements du duc d’Elchingen et de Grouchy, ceux de ce dernier surtout, doivent être l’objet de quelques réserves. Ne pouvant s’affranchir d’un certain culte pour la mémoire de l’Empereur, Grouchy a cherché à le justifier pour tout ce qui ne le touche pas directement. N’ayant pas scruté avec le même soin les assertions qui concernent les autres généraux, il ne paraît que trop incliné, sur la parole de Napoléon, à leur donner des torts et à leur attribuer une partie des fautes de la campagne.
Jomini, l’un des écrivains militaires que nous avons aussi tout particulièrement consultés, est venu, qui, acceptant les réclamations du duc d’Elchingen et de Grouchy, et ne pouvant supposer que Napoléon ait osé altérer la vérité, arranger les faits sur la leçon des évènements, s’est attaché à concilier leurs assertions réciproques, tâche difficile toutefois, et que pouvait seul tenter un admirateur de Napoléon comme l’était Jomini. La tâche n’a pas été couronnée de succès. Sur de telles données et en se proposant de ménager la mémoire de l’Empereur, il n’y avait pas de solution possible. L’essai de Jomini ne nous a pas moins doté d’un des meilleurs morceaux de critique militaire qui soient sortis de la plume de ce tacticien illustre. Pour les fautes que Napoléon n’a pu entièrement déguiser, il est foudroyant de logique, de démonstration persuasive. Quant à celles qui résultent de la marche des opérations imprimées aux troupes, et dont Napoléon a su décliner la responsabilité, il les constate également, sauf à les attribuer à des causes dont le secret, dit-il, lui est demeuré inconnu. Le secret, il faut savoir le dire, existe dans les lenteurs, les indécisions, les illusions, l’obstination aveugle ou l’inertie du chef de l’armée française, résultat du parfait affaissement moral et physique dans lequel il s’est alors trouvé. Mais Jomini, de même que Grouchy et une foule d’autres hommes qui avaient déifié ce chef et l’avaient cru infaillible sous tous les rapports, étaient loin de supposer un tel affaissement. C’est pourquoi leurs écrits manquent de conclusion, de ces traits de lumière qui portent la conviction et fixent décidément l’opinion. Bons comme documents, comme exemples de lumineuse critique pour certains faits, ils sont insuffisants pour juger l’ensemble des évènements, leurs causes secrètes, les principes générateurs qu’ils ont eus du côté des Français. Il en eût été autrement s’ils eussent admis ces deux faits qui dominent entièrement l’histoire vraie de la campagne de Waterloo : Napoléon en dessous de lui-même, paralysé, aveuglé ! Napoléon, afin de cacher ses défaillances et les fautes graves qu’elles engendrèrent, altérant la vérité !
Le premier en France qui se soit placé franchement sous ce lumineux point de vue est le colonel de Baudus, ancien aide de camp des maréchaux Bessières et Soult, et qui à Ligny, à Waterloo, fut chargé de missions on ne peut plus importantes, et assista aux diverses opérations de l’état-major général de l’armée. Non content de montrer Napoléon tel qu’il le vit alors, c’est-à-dire inerte, mou, irrésolu, aveuglé, il a eu le courage, malgré tout le culte qu’il portait à sa mémoire, de l’accuser ouvertement d’avoir sciemment altéré la vérité. « L’empereur des Français, dit-il, une fois relégué sur le rocher de Sainte-Hélène, s’est constamment étudié, dans ses conversations avec ses compagnons d’exil, à dissimuler les fautes qui l’ont perdu ; il a voulu y déposer un sommaire mensonger de son histoire, à l’usage de ceux qui consentiraient à s’appuyer sur cette base trompeuse pour faire le récit des évènements dont sa carrière a été semée, ou qui auraient assez d’abnégation pour le présenter lui-même à notre admiration comme un être infaillible. » Ainsi parle le brave colonel dans son Introduction aux Études sur Napoléon, et les révélations curieuses de son livre prouvent qu’il a su se dégager de la base trompeuse qu’il signale et se montrer conséquent avec les principes posés par lui.
Longtemps avant le colonel de Baudus, un écrivain célèbre, Walter Scott, avait porté le même jugement. Mais cet écrivain appartenait à la nation même qui nous avait vaincus à Waterloo, à une nation souvent peu amie de la France. Il écrivait à une époque où celle-ci aimait en général à exalter les hauts faits d’une période de luttes viriles, afin d’humilier, d’amoindrir le plus possible l’autorité du gouvernement anti national que l’étranger lui avait imposé. À cette époque, l’Empire était une cause perdue. Les âmes généreuses qui n’ont jamais flatté que l’infortune se plaisaient à le glorifier en tout, afin de l’opposer comme un écrasant contraste au régime peu prestigieux des Bourbons. On s’appliquait aveuglément à faire d’un homme plus que faillible un dieu ; à tailler sa statue sur les proportions d’une idole gigantesque, sans prévoir qu’un jour cette idole pèserait de tout son poids sur l’esprit, l’âme et le corps de ceux qui l’avaient dressée. On considéra donc avec prévention les judicieuses paroles de Walter Scott, comme étant celles d’un ennemi injuste et passionné. Ces paroles, il est bon de les rappeler, maintenant que le jour de la vérité a lui et qu’on voit où nous ont conduits tant d’éloges exagérés, de panégyriques menteurs, de légendes imaginées à plaisir. Voici donc ce que disait, il y a passé quarante ans, l’auteur de Quentin Durward :
« Il est remarquable que Napoléon, quoique général lui-même et général distingué, n’accorda jamais un tribut d’éloges aux généraux qu’il eut à combattre. En parlant de ses victoires, il vante souvent le courage et l’intrépidité de ceux qu’il a vaincus. C’était une manière nouvelle de faire son éloge et celui de son armée, qui avait remporté l’avantage ; mais il n’accorde jamais aucun mérite à ceux qui le vainquirent à leur tour. Il déclare que jamais il ne vit les Prussiens se bien conduire qu’à Iéna, les Russes qu’à Austerlitz. Les armées de ces mêmes nations dont il ne sentit que trop la force dans les campagnes de 1812 et de 1813, et devant lesquelles il fit des retraites aussi désastreuses que celles de Moscou et de Leipzick, n’étaient, suivant lui, que de la canaille. De même, lorsqu’il raconte une affaire dans laquelle il a remporté l’avantage, il ne manque pas de se vanter que la fortune n’y a été pour rien ; tandis que ses défaites sont entièrement et exclusivement attribuées à la fureur des éléments, à la combinaison de quelques circonstances extraordinaires ou inattendues, à la faute d’un de ses lieutenants ou maréchaux, ou enfin à l’obstination des généraux ennemis, qui, par pure stupidité et de bévues en bévues, arrivaient à la victoire par le chemin même qui aurait dû les conduire à leur perte. En un mot, dans les mémoires de Napoléon il serait impossible de trouver, d’un bout à l’autre, l’aveu d’une seule faute, de la moindre imprudence, à moins qu’elle ne provienne d’un excès de confiance ou de générosité, parce qu’alors on se fait secrètement gloire de ce qu’on a l’air d’abandonner à la censure. Si nous ajoutons foi aux propres paroles de Napoléon, nous devons croire que c’était un être parfait et impeccable ; si non, nous devons le regarder comme un homme qui ne se faisait aucun scrupule, lorsqu’il s’agissait de sa réputation, d’arranger les faits à sa manière sans aucun égard pour la vérité. » (Walter Scott, Vie de Napoléon, tome XIII.)
M. de Lamartine, dans son Histoire de la Restauration, s’est montré également sévère à l’égard du grand vaincu de Waterloo, et nous ne pouvons faire autrement que d’avouer qu’il a été du petit nombre de ceux qui en France ont osé lui reprocher et le désastre et l’altération de la vérité dans le récit qu’il en fait. Ce n’est pas, toutefois, qu’il ait été pour nous d’un bien grand secours. M. de Lamartine, avant tout poète, appliqué plutôt aux effets littéraires d’un sujet qu’à ses démonstrations rigoureuses, a une manière d’écrire l’histoire assez commode. Il n’y cherche que l’occasion de portraits imagés, d’émouvantes et pittoresques peintures, et marche à ce but sans tenir compte de l’exactitude historique, de l’enchaînement des évènements, des circonstances de temps et de lieu, en un mot de cette partie de l’histoire qui, si elle n’en est pas la plus attrayante, n’en est pas moins la plus difficile et la plus indispensable : la critique. Son ouvrage est plein d’anachronismes, de contradictions, de descriptions tactiques et topographiques aventurées, de faits erronés, etc. Une chose, toutefois, nous a frappé dans ses jugements : c’est que, bien qu’il n’administre ni à lui-même ni aux autres la preuve des fautes et des assertions controuvées de Napoléon, il le juge comme si la démonstration de ces choses lui était donnée. Heureux privilège de certains hommes de suppléer ainsi par la révélation intuitive aux lumières, à la connaissance que d’autres n’acquièrent que par un long travail ! Aussi lui avons-nous emprunté quelques-uns de ses jugements, quelques-unes des pages admirables dont il a le secret.
Marcher sur les traces du colonel de Baudus et de Walter Scott et conformément à leur point de vue, formuler les mêmes jugements que M. de Lamartine et les étayer sur tous les genres de preuves, démontrer, en un mot, ce que ces trois écrivains n’ont pu ou n’ont pas eu la latitude de démontrer, telle est la tâche que j’ai entreprise. En la terminant, je me suis affermi dans la conviction que rien n’est moins véridique que les mémoires de Napoléon, notamment pour tout ce qui touche à ses fautes militaires, et qu’avoir recours à ces archives trompeuses et accepter aveuglément l’apothéose qu’il dresse lui-même à sa propre infaillibilité, c’est manquer à la mission de l’histoire. Cette mission nous impose le devoir de déclarer hautement, une fois encore, que Napoléon est la suprême cause du désastre de Waterloo, et qu’il n’a fait que déguiser ou cacher la vérité dans le récit qu’il a consacré à cet évènement.
Voilà le point capital sur lequel je me suis tout particulièrement appesanti dans mon travail. Je l’ai fait tout d’abord par suite du culte que je porte à la vérité, ensuite parce que c’était une occasion pour moi d’apporter ma petite pierre au grand travail de révision et de reconstruction de cet immense édifice de surprise, de grandeur et de séduction politique que notre siècle a vu surgir avec le nom de Napoléon au moment où il s’y attendait le moins, édifice qu’on s’est plu à embellir d’ornements de tout genre, mais faux pour la plupart.
Il n’est pas digne d’une grande nation d’exalter, de déifier un homme au point où l’a été le vaincu de Waterloo, le fugitif de la Bérésina et de Leipzig, le tyran qui ordonna la mort du duc d’Enghien, des pestiférés et des prisonniers de Jaffa, fit fusiller tant d’hommes de cœur qui luttaient contre sa politique, et qui se plut toujours à fouler aux pieds ce que les hommes ont de plus sacré : bonne foi, liberté, morale, humanité. Il est temps de replacer à son vrai rang cet homme et de ne plus faire de son règne une époque incomparable, qui décourage après lui ceux qui se sentiraient aussi portés à accomplir des actes mémorables. La France a eu de tout temps des héros et des grands hommes plus ou moins célèbres selon que les circonstances ont été plus ou moins propices à leur activité, favorables à leur gloire. Les soldats qui ont pris Sébastopol et affranchi l’Italie ne sont pas au-dessous de leurs devanciers. Donc, plus d’idole, de statue démesurée, plus d’apothéose, plus de culte idolâtrique, si ce n’est celui de la patrie commune, qui a su et saura toujours tirer de son sein des hommes supérieurs et à la hauteur de ses destinées.
Puisse mon livre éveiller ces sentiments, inculquer ces vérités aux enfants de la génération actuelle, et leur persuader qu’eux aussi peuvent devenir des héros et qu’il n’est rien dans le passé de mémorable qu’ils ne puissent tenter d’accomplir à leur tour. Oui, ils peuvent tout ce que leurs pères ont pu ; mais qu’ils n’oublient pas que le temps va venir où la moindre vertu civique aura mille fois plus de retentissement et d’hommages que les plus hauts faits de la gloire militaire. Puisse aussi le présent livre servir, sinon de base, du moins d’exemple à ceux qui seraient portés, en racontant la campagne de Waterloo, à imiter la marche critique que j’ai suivie et à prouver mieux que je ne l’ai pu faire combien avait été défigurée en France cette page mémorable de notre histoire. Puissé-je montrer à l’étranger qu’il a été possible à un Français d’être partout impartial et véridique en racontant les désastres dont sa patrie porte encore le deuil. C’est là, pensons-nous, faire bien plus d’honneur à son pays que de s’associer sciemment aux falsificateurs de son histoire. Le vrai patriote n’est pas celui qui égare ses concitoyens par de faux récits, des assertions controuvées, dont la créance en de graves circonstances peut devenir préjudiciable à leurs intérêts. Le bon citoyen est celui-là qui dit la vérité à son pays afin de le prémunir contre de nouveaux malheurs, et qui, placé en face des fautes commises, sait montrer comment et pourquoi elles ont été commises, afin d’apprendre à les éviter désormais. Aussi croyons-nous que l’apparition de notre ouvrage sera saluée avec plaisir par les vrais patriotes aussi bien que par tous ceux qui ont conservé dans leur cœur, avec le culte de la liberté, l’amour de la vérité et du franc-parler, de la bonne et consciencieuse histoire. C’est là l’unique récompense que nous ambitionnons.
Z.J. PIÉRART.
L’histoire doit être la justicière du passé ; elle doit donner des leçons au présent et servir pour les triomphes de l’avenir.
(L’AUTEUR.)
L’ouvrage dont on vient de lire le premier préambule, comme on l’a vu par la date de ce même préambule, était écrit en 1856. Alors il a été communiqué par l’auteur à un historien illustre, à des publicistes, à un ancien ministre de la République française, qui pourraient rendre témoignage de son existence à cette époque et de la nature de ses conclusions. Un an après apparut sur le même sujet l’ouvrage du colonel Charras : Histoire de la campagne de 1815. Cette histoire, écrite dans un esprit tout à fait semblable, décidant dans le même sens les questions que nous avions traitées, nous a ôté la pensée de mettre notre travail au jour. Il nous semblait faire désormais double emploi. Ce qu’il voulait prouver étant démontré jusqu’à l’évidence la plus parfaite par un homme de guerre d’une capacité notoire, il ne nous restait plus qu’à nous applaudir de n’avoir pas été le seul de notre avis et de voir que nos jugements pouvaient s’étayer d’opinions recommandables. Laisser désormais notre œuvre enfouie dans nos cartons était le meilleur parti à prendre. C’est celui que nous avons pris.
En 1861, un écrivain illustre et non moins grand citoyen que le colonel Charras publia aussi sur le même sujet un excellent livre. Nous voulons parler de M. Edgar Quinet, ce philosophe, ce prêtre de l’histoire, qui sait si bien la poétiser et en faire un grave plaidoyer des justes causes. Il terminait la préface de son ouvrage par ces lignes :
« Je me ferais scrupule de revenir sur des points qui viennent d’être approfondis, éclairés avec une supériorité incontestable par le colonel Charras, si je ne savais que d’autres ouvrages du même genre se préparent et ne tarderont pas à paraître. La France, je pense, ne veut pas, ne peut pas rester étrangère plus longtemps à la vaste enquête qui s’est ouverte en Europe, depuis près d’un demi-siècle, sur des évènements où elle est bien aussi quelque chose. D’ailleurs, il est des évènements inépuisables par leur nature même ; ils prennent la forme de chacun des esprits qui les racontent. L’erreur enracinée ne se détruit pas d’un seul coup ; il faut plus d’un effort pour l’abattre. La preuve la meilleure du mérite et de la vitalité d’un livre tel que celui de M. le colonel Charras sera toujours d’inspirer, non pas seulement une adhésion stérile, mais d’autres travaux entrepris dans un même esprit de dévouement à la France et d’équité pour le reste du monde. »
Nous savons positivement qu’en écrivant ces lignes M. Quinet faisait allusion à notre travail, qui lui fut connu en 1857, avant l’apparition de celui du colonel Charras.
Malgré cet encouragement donné à la publication de notre œuvre ; bien que nous apportions dans le débat des appréciations et des faits nouveaux puisés à des sources que n’ont pas connues les deux écrivains qui nous ont devancé en publicité ; bien que nous ayons trouvé que M. Quinet se soit un peu souvenu dans son livre qu’il avait été le chantre de Napoléon, et pas assez que celui-ci avait fait du malheureux Grouchy le bouc émissaire de son désastre, nous n’aurions pas pensé à mettre notre manuscrit au jour, sans l’apparition du volume dans lequel M. Thiers, en terminant l’Histoire du Consulat et de l’Empire, a parlé des mêmes faits. Nous avions espéré que l’illustre historien, profitant des travaux du colonel Charras et des sources nombreuses, pour la plupart officielles ou authentiques, qui existent sur la campagne de 1815, montrerait à son tour cette campagne sous son vrai jour, sous un jour auquel on n’est point accoutumé à l’entrevoir en France. Nous nous sommes trompé dans cette attente.
M. Thiers, toujours courtisan des opinions dominantes, peu préoccupé de dire ouvertement la vérité quand la vérité est une nouveauté contestée, une hardiesse dangereuse, s’est montré, en terminant son histoire de l’Empire, ce qu’il a toujours été, c’est-à-dire un écrivain subtil, très lucide, disant, résumant fort bien ce que tout le monde pense, mais se souciant fort peu de servir la cause de la vérité quand la vérité n’est entrée que dans les convictions du petit nombre. Pour celui qui cherche uniquement le succès et jusqu’à un certain point la popularité, cette attitude est la bonne. Mais telle ne doit pas être celle de l’écrivain consciencieux pour qui l’histoire est un apostolat, qui cherche, avant tout, à agir sur les opinions des masses pour les modifier, et s’applique par tous les moyens à rectifier l’erreur, à instruire, à éclairer, fût-ce même au détriment de son repos et de ses intérêts. En France tout le monde croit que les faits de la campagne de Waterloo se sont passés tels que Napoléon les a racontés. Démontrer le contraire est une tâche difficile, épineuse. M. Thiers ne s’est pas cru enchaîné par les devoirs d’une telle tâche. À l’exemple de la plupart des historiens ses devanciers, il a accepté les récits de Napoléon comme vrais de tous points, prenant même soin de les étayer sur tous les genres de vraisemblance. Les nombreuses rectifications qui résultent d’une foule de documents authentiques, des contradictions même que présentent les mémoires de Sainte-Hélène, sont considérés par lui comme non avenus. L’histoire du plus grand des désastres que la France ait jamais éprouvés, aux yeux de M. Thiers, doit demeurer telle que l’auteur de ce désastre l’a racontée lui-même. Il n’est seulement question que de l’embellir, de la solidifier par la pompe des amplifications, l’attrait des détails.
Pour nous, amant passionné de la vérité, et passionné jusqu’à la servir à notre détriment envers et contre tous, nous n’avons pu laisser passer les récits de l’historien de l’Empire sans protester.
Nous avons repris la plume, revu notre travail, nous imposant la tâche d’en examiner de tout près les passages les plus importants, afin de donner à nos assertions, à nos controverses une base plus solide encore, de telle sorte qu’en réfutant d’une manière définitive les mémoires de Sainte-Hélène à l’endroit de Waterloo, nous réfutions également M. Thiers, qui a fait de ces mémoires l’unique fondement de ses récits. Nous avons ajouté çà et là à notre manuscrit des passages nouveaux où l’historien de Napoléon est tout particulièrement pris à partie. Nous aurions voulu faire suivre l’apparition de nos protestations le plus près possible de la publication de son livre. Mais cela ne nous a pas été permis. Des obstacles divers, les uns matériels, les autres moraux, nous en ont empêché. Mais peut-être ce nouvel ajournement devait-il avoir lieu. Ce qui s’est passé depuis, ce qui se passe aujourd’hui dans la politique extérieure de la France, devait restituer à notre travail un nouveau et grand mérite d’à-propos.
Après quelques retouches que le temps nous a ainsi permis de faire, notre œuvre est demeurée ce que dans notre pensée nous avions désiré qu’elle fût, c’est-à-dire un plaidoyer chaleureux de la vérité, écrit avec toute l’indépendance et la sévérité que le sujet nécessite ; une espèce d’épopée à la fois patriotique, libérale et critique, un tableau coloré, enfin, qui pût intéresser tout particulièrement les masses, les éclairer, les édifier à propos de récits de bataille, récits pour lesquels elles ont toujours eu dans notre belliqueuse France une prédilection marquée. C’est par ce moyen que l’on pourra faire pénétrer au sein du peuple des rectifications et des enseignements difficiles à répandre par une autre voie. Il jugera à sa juste valeur l’idole qu’on lui avait fait adorer après l’avoir taillée dans des proportions gigantesques. Il verra que rien n’est divin ni infaillible dans l’humaine nature, et que les gloires les plus étonnantes sont entachées, quand on les examine de près, de bien des points noirs ou scabreux. Nous avons maintenu nos jugements les plus sévères, non seulement pour continuer à être véridique, mais encore pour satisfaire à un devoir rigoureux que les circonstances imposent en ces temps équivoques à tout homme de cœur.
Si l’on trouvait en nous lisant que notre langage est parfois empreint d’une certaine passion, qu’on se rappelle que c’est la passion du bien et du vrai, que notre ouvrage est un plaidoyer, une philippique faite, nous venons de le dire, pour agir sur les masses, et qu’on ne les a jamais remuées par des récits froids et incolores ; que, d’ailleurs, il est des circonstances où dans un intérêt sacré l’historien doit sortir de la tiède impassibilité de l’homme à qui le bien et le mal, l’imposture et la vérité sont choses indifférentes et pour lesquelles il importe peu de varier son langage. Il n’y a que les hommes sans idéal et sans ferveur morale, corrompus ou blasés de vertu, qui puissent désapprouver les élans d’une âme émue qui sait trouver des accents chaleureux quand il s’agit d’exalter le bien et de flétrir le mal. Quand le magistrat instructeur, organe de la vindicte publique, s’adresse au criminel que ses méfaits ont conduit sur la sellette, il ne l’épargne pas. Il le traite avec toute la sévérité des lois divines et humaines outragées, et la conscience des juges l’approuve. Eh bien, l’historien est le magistrat instructeur de l’opinion. Il est de son droit et de son devoir d’accabler de paroles indignées les tyrans, les imposteurs, les grands coupables de la politique. Leurs crimes et leurs infamies ne doivent attendre de lui aucun ménagement.
C’est ce que nous avons fait.
Z.-J. PIÉRART.
On le vit reparaître, profitant d’une conjuration militaire et libérale, qui allait aboutir sans lui et pour un autre principe. Comme autrefois il s’annonça, embauchant le peuple et l’armée par le prestige de sa gloire et de sentiments démocratiques que les masses aveugles lui attribuaient quand même. C’est ainsi qu’en fascinant et en séduisant le peuple il put encore maîtriser la fortune et ressaisir le pouvoir. Mais ce pouvoir, qui n’avait d’autre point d’appui que la force brutale, l’obligea, malgré lui, à recourir aux chances aléatoires d’une nouvelle lutte armée contre l’Europe. Ce fut la lutte du désespoir que nous allons raconter.
(L’AUTEUR.)
SOMMAIRE.– I. La France, après les héroïques efforts de 1793 et de 1794, tombe sous le despotisme militaire. Caractère du gouvernement de Napoléon. Sa chute. – II. Retour de l’île d’Elbe, préparatifs d’une nouvelle campagne. – III. Plan de campagne de Napoléon. – IV. Napoléon arrive sur la frontière. Proclamation qu’il adresse à son armée, – V. Composition et esprit respectif des armées française, anglaise et prussienne. Tableau rétrospectif des abus et des oppressions du système impérial. – VI. Forces et positions des Anglais et des Prussiens à la veille des hostilités. – VII. Ordre de marche donné par Napoléon dans la nuit du 14 au 15 juin 1815 et incidents qui en contrarient la parfaite exécution. – VIII. Défection de Bourmont. – IX. Marche sur Marchiennes-au-Pont et Charleroi. – X. Les Prussiens, attaqués avec impétuosité, se défendent avec courage. Combat de Montigny-le-Tilleul. – XI. Entrée à Charleroi Napoléon, au lieu de poursuivre ses succès, fait faire à ses troupes une halte intempestive. – XII. Torts que Napoléon eut d’associer à l’entreprise de sa nouvelle campagne des maréchaux en qui le soldat n’avait plus confiance. – XIII. Ordre donné le 15 juin à Ney. – XIV. Combat tardif de Gilly ; mort de Letort. – XV. Nouvelles fautes de Napoléon. – XVI. Réflexions sur la journée du 15 juin ; ses résultats. – XVII. Valeur très contestée des assertions de Napoléon sur les évènements de cette journée. – XVIII. Réponse à M. Thiers relativement à la prétendue activité de Napoléon : témoignages importants qui démentent cette activité. – XIX. Napoléon a falsifié l’histoire dans le but de cacher ses fautes. Il a chargé la mémoire de Ney. Documents authentiques et raisons qui le réfutent ainsi que M. Thiers.
La France, sauvée, glorifiée par les héroïques phalanges de Jourdan, de Pichegru, de Hoche, de Moreau, de Brune et de Masséna, devait tomber, à l’intérieur, de lassitude, à la suite des gigantesques efforts qu’elle avait déployés pour assurer sa nationalité et sa régénération sociale. Lorsque ses plus grands dangers furent passés, lorsque les hommes audacieux qui avaient soutenu sa cause, de leur personnalité indomptable, au milieu des plus effroyables crises, eurent été dévorés par les échafauds, elle vit présider à ses destinées des hommes sans croyances et sans principes, qui ne virent dans la Révolution que l’occasion propice de travailler à leur fortune personnelle, et qui donnèrent l’exemple de toutes les corruptions, de toutes les immoralités, de toutes les trahisons. Les anciens partis relevèrent la tête, et la Révolution, exposée à de nouveaux dangers, vit, cette fois, l’armée intervenir dans ses débats pour la défendre. Un soldat heureux, sous prétexte de sauver l’ordre public, confisqua les libertés publiques et mit à la place de la volonté nationale, librement représentée, sa volonté particulière. La nation se laissa éblouir par cet homme, dont les capacités militaires, administratives et gouvernementales, lui promettaient la sécurité au dehors comme au dedans. Mais Bonaparte, au lieu d’employer un pouvoir sans contrôle, des talents extraordinaires, à fonder la cité de l’avenir, à poursuivre les conséquences logiques, inéluctables de la Révolution, préféra plutôt replâtrer des préjugés, des institutions gothiques, des croyances usées, et faire du dogme barbare et suranné de la guerre l’objet tout particulier de son activité et de sa gloire. Au lieu d’être le plus grand citoyen de son pays, le plus puissant des réformateurs, le plus sublime des Wasington, en un mot, au lieu d’être le Dieu du monde moderne, comme il le pouvait, il préféra n’être qu’un souverain parvenu, un monarque intrus, un génie de destruction, un colosse d’ambition égoïste. Il méconnut la cause des peuples ; celle des idées, du progrès ; au lieu d’asseoir son pouvoir sur les intérêts de la démocratie, sur la reconnaissance et l’amour des masses, il ne chercha à l’étayer que sur la force brutale et la gloire des conquêtes. Il ne crut qu’à la puissance de l’épée, à celle des faits accomplis. Dans son pays, on le vit froisser, persécuter, opprimer la partie intelligente, indépendante et honnête de la nation, ne se préoccuper de plaire qu’à la partie ignorante ou corrompue, exploitant, pour son profit, le dévouement aveugle, l’esprit belliqueux et les instincts aventureux de l’une, et se rattachant l’autre par les intérêts matériels, l’amour des places, la soif des honneurs. Dans les autres pays il dédaigna ou méconnut la cause des peuples et mendia l’alliance des rois après les avoir humiliés. Grand capitaine ; grand administrateur, mais cœur sec et sans morale, petit par l’idée, il fonda un édifice gigantesque de puissance. Mais cet édifice, qui se perdait dans les nues, s’appuyait dans la boue et n’avait d’autre soutien que la force, s’écroula quand cette force vint à lui être infidèle. Alors le mauvais politique qui l’avait élevé se trouva seul contre la coalition des peuples et des rois, abandonné des intérêts égoïstes qu’il avait voulu servir et qui le renièrent au jour du dévouement et des sacrifices. Il tomba après avoir eu dans les mains les ressources, les moyens d’action les plus formidables que jamais souverain eût possédés, offrant l’exemple de la chute la plus complète dont l’histoire fasse mention.
Mais il devait, après un court exil, rentrer dans sa patrie amoindrie, humiliée, et qu’alarmaient les tendances d’un gouvernement nouveau pour les conséquences sociales de la Révolution. On le vit reparaître, profitant d’une conjuration militaire et libérale qu’il n’avait point préparée et qui allait aboutir sans lui et pour un autre principe. Comme autrefois, il s’annonça embauchant l’armée et le peuple par le prestige de sa gloire et de sentiments démocratiques qu’il ne partageait pas ; en fascinant, en séduisant de nouveau les masses, il put encore maîtriser la fortune et ressaisir le pouvoir.
Une nouvelle coalition de toute l’Europe se dressa, non tant cette fois contre la France, mais contre l’homme qui voulait encore une fois l’identifier à sa destinée et l’entraîner dans un abîme de douleurs, de sacrifices et d’efforts désespérés. Il fallut repousser cette coalition, et c’est alors que les bords si souvent illustrés de la Sambre, les champs de Fleurus, devinrent de nouveau le théâtre d’évènements mémorables. Nous raconterons ces évènements avec un soin tout religieux, mais non avec l’intérêt qui s’attache aux guerres véritablement nationales, aux vraies luttes d’idées, où la cause seule des peuples, celle de la liberté, sont en jeu. Toutefois, nous apporterons dans nos récits l’attention scrupuleuse que l’on doit à l’exposé d’évènements dramatiques, de catastrophes douloureuses et de traits sublimes d’intrépidité et de dévouement militaires.
Napoléon, par suite d’indécisions, d’illusions, et de lenteurs incompréhensibles que l’histoire a révélées, n’avait à opposer, en 1815, aux ressources de la coalition, qu’une armée active de 122 408 hommes et 350 bouches à feu. Le reste de ses forces, composées de gardes nationaux, de garnisons confiées à des lieutenants, à Rapp, à Lecourbe, à Suchet, à Brune, à Clausel et à Lamarque, en tout 52 000 hommes, étaient destinées à maintenir l’intérieur et à donner sur nos frontières le change à l’Europe et à la France. Rapp, Lecourbe et Brune derrière le Rhin, le Jura et les Alpes, devaient arrêter les Autrichiens et les Russes, tandis que l’armée principale agirait en Belgique contre les forces prussiennes et anglaises. Se porter inopinément et avec la plus grande célérité au point de jonction de ces forces, les accabler séparément avant qu’elles aient pu se concentrer et se réunir, courir ensuite aux Russes et aux Autrichiens et les écraser tour à tour à l’aide de la même tactique, tel fut le plan de Napoléon. Ce plan aventureux, qui faisait tout dépendre des chances d’une grande bataille, a été blâmé. Mais disons que, conforme au génie de celui qui l’avait conçu et au caractère de ses soldats, il était réclamé par la faiblesse disproportionnée de l’armée française, et l’état intérieur de la France, qui nécessitait des succès rapides. Le pays, par suite de la tiédeur civique que le régime impérial lui-même avait fait naître, n’était plus à la hauteur patriotique des grands mouvements que la Révolution avait su enfanter. Vu l’état de dissémination des armées coalisées, le plan de Napoléon était le seul qui pût donner les rapides succès que la situation réclamait. En effet, en cas de première réussite, il nous livrait la Belgique et les provinces rhénanes où l’empire avait encore des partisans. Napoléon se berçait de l’espoir qu’alors le ministère britannique qui lui était opposé ferait place à un ministère d’opposition composé d’hommes qui, amis de la paix et de l’indépendance des nations, avaient blâmé la guerre contre la France affaiblie, la meilleure alliée que l’Angleterre pût trouver dans l’avenir contre les envahissements des puissances du Nord. Le plan de Napoléon, en cas de réussite, redonnait, dans un bref délai nécessaire, de l’élan et du courage à ses partisans de l’intérieur, de la crainte aux amis des Bourbons, et peut-être devait-il ramener à celui qui l’avait conçu le concours de son beau-père, l’empereur d’Autriche, si intempestivement éloigné par la conduite étourdie de Murât. L’Autriche neutralisée, il devenait plus facile de battre les autres puissances et de les amener à la paix. Tels étaient les calculs de Napoléon, et malgré la critique qui en a été faite, notre impartialité nous oblige à reconnaître qu’ils étaient admirablement inspirés par une nette idée des nécessités du moment. Heureuse la France si des inspirations aussi heureuses se fussent retrouvées dans l’exécution ! Mais il n’en devait pas être ainsi.
Les différents corps de l’armée qui allait franchir la frontière sous la conduite de Napoléon étaient composés de vieux et de jeunes soldats. Parmi les vieux soldats se trouvaient des prisonniers revenus des déserts de Russie et des pontons de l’Angleterre. C’était tout ce qui restait des vieilles légions de la République, qui avaient aidé Napoléon à vaincre à Austerlitz, à Iéna, à Friedland et en Espagne. Les jeunes soldats appartenaient en partie aux levées d’hommes qui avaient combattu dans les deux précédentes campagnes, en partie aux contingents de 1814 et de 1815. Tous avaient cet enthousiasme et cette ardeur qui n’ont jamais manqué aux Français dans les débuts de nos grandes guerres.
Napoléon avait fait occuper sourdement à son armée la partie de nos frontières qui s’étend de l’Escaut à la Meuse. Cette armée se composait de cinq corps d’infanterie, de quatre de cavalerie et de trois cent quarante-six bouches à feu. Drouet d’Erlon concentrait sous ses ordres le premier corps à Valenciennes, Reille le second à Maubeuge, Vandamme le troisième à Marienbourg et à Rocroy, Gérard le quatrième à Mézières et à Metz, Lobau le cinquième à Avesnes. En deçà de cette dernière ville jusqu’à Laon, Pajol, Excelmans, Milhaud et Kellermann commandaient sous Grouchy, récemment promu au grade de maréchal, la cavalerie, forte de 30 000 chevaux. Le 12 juin, Napoléon, précédé de sa garde (12 900 fantassins, 3 700 cavaliers et 52 bouches à feu), partit secrètement de Paris pour se rendre au sein de son armée. Il visita, en passant, les places de Soissons et de Laon, afin d’en examiner et d’en faire compléter les moyens de défense, et le 13 juin au soir il entra dans la ville d’Avesnes. En même temps que lui s’étaient ébranlées les deux ailes de son armée, masquant leurs mouvements, aux abords de Lille, de Valenciennes, de Mézières et de Metz, par la présence et les démonstrations de détachements des garnisons et de bataillons d’élite de la garde nationale. Le 14 au soir toute l’armée était réunie de Solre-sur-Sambre à Philippeville, ayant son centre à Beaumont, où l’Empereur alla coucher avec sa garde. Ces deux dernières villes étaient situées dans une des portions de l’ancienne France que nous avaient laissées les traités de 1814 et que nous enlevèrent ceux de 1815. Il fut facile aux Français de s’y rassembler à l’insu des ennemis, le pays étant couvert de monticules et de bois qui cachaient à ceux-ci la flamme des bivacs, n’étant traversé par aucune grande route qu’ils crussent nécessaire de faire éclairer, et les Français y ayant d’ailleurs élevé partout, sur les chemins aux abords de la frontière, des barricades destinées à faire croire qu’on se disposait plutôt à repousser de ce côté une invasion qu’à se rendre envahisseurs. Les positions occupées alors par nos régiments furent tout à fait les mêmes que celles où s’étaient portées autrefois les colonnes du duc de Luxembourg et celles des armées de la Sambre avec Saint-Just, Kléber, Marceau, etc., lorsqu’elles allèrent cueillir les palmes de la victoire dans les champs de Fleurus. Au milieu était le champ de bataille de Bossut-lez-Walcourt, aussi deux fois illustré par nos armes. Derrière s’élevaient les coteaux non moins glorieux de Wattignies, que la garde, les corps de Reille, de Lobau et de Grouchy saluèrent en passant.
L’Empereur, arrivé à Beaumont, révéla à l’armée sa présence et ses desseins par la proclamation suivante, datée d’Avesnes le 14 juin, et qui fut lue le lendemain 15, au moment du départ, dans chaque compagnie, dans chaque escadron et dans chaque batterie, au milieu d’un recueillement solennel suivi de formidables acclamations :
« Soldats,
C’est aujourd’hui l’anniversaire de Marengo et de Friedland, qui décida deux fois du sort de l’Europe. Alors, comme après Austerlitz, comme après Wagram, nous fûmes trop généreux ! Nous crûmes aux protestations et aux serments des princes que nous laissâmes sur le trône ! Aujourd’hui, cependant, coalisés entre eux, ils en veulent à l’indépendance et aux droits les plus sacrés de la France. Ils ont commencé par la plus injuste des agressions. Marchons donc à leur rencontre ! Eux et nous ne sommes-nous plus les mêmes hommes ?
Soldats, à Iéna, contre ces mêmes Prussiens aujourd’hui si arrogants, vous étiez un contre trois ; à Montmirail, un contre six.
Que ceux d’entre vous qui ont été prisonniers des Anglais vous fassent le récit de leurs pontons et des maux affreux qu’ils ont soufferts.
Les Saxons, les Belges, les Hanovriens, les soldats de la Confédération du Rhin, gémissent d’être obligés de prêter leurs bras à la cause de princes ennemis de la justice et des droits de tous les peuples ; ils savent que cette coalition est insatiable ! Après avoir dévoré douze millions de Polonais, douze millions d’Italiens, un million de Saxons, six millions de Belges, elle devra dévorer les États de second ordre de l’Allemagne.
Les insensés ! un moment de prospérité les aveugle. L’oppression et l’humiliation du peuple français sont hors de leur pouvoir. S’ils entrent en France, ils y trouveront leur tombeau.
Soldats ! nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir ; mais avec de la constance, la victoire est à nous ; les droits, l’honneur et le bonheur de la patrie seront reconquis.
Pour tout Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr ! »
Vaincre ou mourir, telle était en effet l’alternative que la situation offrait à Napoléon et à ses soldats. Cette proclamation habile par laquelle il cherchait à recruter des partisans au-delà des frontières, où il identifiait avec si peu de légitimité la cause de la France, de la liberté, avec sa propre cause, cette proclamation où il qualifie de générosité les fautes de sa politique, et où il résume en peu de mots tout ce qui pouvait exciter l’amour-propre et les ressentiments de ses soldats, ces paroles calculées étaient bien différentes comme sincérité, élan de l’âme, foi au succès, de celles qui avaient jusque-là retenti aux oreilles de nos héroïques phalanges.
Ce n’étaient plus les mâles allocutions des représentants du peuple qui, pleins d’espoir dans la sainteté de leur cause, annonçaient à jour fixe l’entrée de nos soldats dans quelque ville ennemie. Ce n’était plus le joyeux enthousiasme des volontaires de la Révolution qui marchaient au combat au chant des hymnes nationaux et avec l’assurance du triomphe ; ce n’était plus aussi le temps des proclamations d’Austerlitz et de Iéna, lorsque Napoléon disait avec une superbe confiance : « Soldats, nous allons à Berlin, l’ennemi est à nous ! » Mais aussi, cette fois on ne combattait plus pour la liberté et l’avenir de l’humanité ; on ne sentait plus derrière soi une patrie enthousiaste et confiante et, au-delà des frontières, la sympathie des peuples. Après avoir fatigué les destins, désabusé et irrité les nations, Napoléon savait qu’il les avait toutes contre lui, et son génie plein de doute et de lassitude ne parlait plus que de mort, de lutte désespérée. Il y avait là un pressentiment qu’un grand holocauste se préparait, et que sur un champ de bataille les destinées de la France allaient s’accomplir.
Cependant, quel que fût ce mot d’ordre de désespoir, ses soldats l’acceptèrent avec empressement, les uns pleins d’enthousiasme, les autres mus par des sentiments purement stoïques. Mais c’est pour l’historien le lieu de faire connaître l’esprit, le caractère des soldats qui marchèrent alors sous les drapeaux de la France. Nous serons amenés tout naturellement à faire connaître l’esprit et les éléments constitutifs des deux autres armées. De part et d’autre il y eut en jeu dans ce terrible choc, cette sanglante épopée de 1815, des souvenirs, des entraînements et des mobiles divers. Les dépeindre ne sera pas sans intérêt. Il est instructif, quand on montre les hommes aux prises sur l’arène sanglante des luttes militaires, de dire de quelles passions, de quelles croyances aveugles ou légitimes ils furent les âmes dévouées. Cela nous permettra en même temps de faire un retour rétrospectif sur cette mémorable période de l’Empire que l’Europe traversa et endura au commencement du siècle.
Les soldats français étaient animés de sentiments divers. Les uns étaient tout dévoués à l’Empereur, ne croyaient, n’espéraient qu’en lui, ne voyaient rien au-delà. Pour eux c’était toujours l’homme du destin, un génie merveilleux destiné à dominer l’Europe. Son retour de l’île d’Elbe, évènement unique dans l’histoire, accompli sans aucune effusion de sang, l’avait encore davantage grandi à leurs yeux. Ils avaient oublié en lui l’homme de Moscou, de Leipzig, pour ne songer qu’à l’homme d’Austerlitz, de Iéna, de Friedland, de Wagram. Parmi ces enthousiastes, ces croyants, se trouvaient des soldats grossiers, ne doutant de rien, prêts à sacrifier à leur idole patrie, humanité. L’insolence de ces prétoriens était extrême à l’égard de leurs compatriotes comme à l’égard des ennemis. Dans leur pays ils s’étaient montrés provocateurs, intolérants, prêts à insulter et à appeler en duel une foule de citoyens paisibles. C’était de leur bouche qu’était sorti le terme de pékin, donné dédaigneusement comme marque de mépris aux citoyens de la classe bourgeoise. Selon eux, l’armée n’était pas faite pour la France, mais la France pour l’armée Gonflés d’orgueil et de présomption à la suite des derniers évènements, évènements pendant lesquels on les avait vus se faire les uniques dispensateurs des destinées de leur pays, ils s’étaient affranchis des liens de la discipline et s’adonnaient, même en France, à des excès que leur empereur n’osait ou ne pouvait souvent réprimer. Selon eux, si nous avions été vaincus par l’Europe, ce n’étaient point les fautes de leur chef ou le soulèvement unanime des peuples qui en étaient cause, mais la trahison. Ils discutaient les ordres de leurs supérieurs, les mouvements que leur faisaient exécuter leurs généraux, leurs officiers, et n’étaient que trop enclins à suspecter leur fidélité. Entre eux, point de cette bonne et douce confraternité qu’on avait vue autrefois régner dans les armées du Nord, de Sambre-et-Meuse et du Rhin. Les régiments se jalousaient l’un l’autre. La cavalerie professait un souverain mépris pour l’infanterie, et celle-ci était pleine d’orgueil du rôle important qu’elle jouait dans les batailles. Tous détestaient la garde, qui de son côté n’avait pour la ligne qu’un dédain superbe. Intraitables entre eux, insolents avec leurs compatriotes, ces soldats, pour la plupart, étaient cruels et sans quartier, préférant plutôt tuer l’ennemi terrassé que de le faire prisonnier.
On en vit, pendant leur courte campagne de la Belgique, se livrer indignement au pillage, forcer tous les habitants qu’ils rencontraient à crier vive l’empereur, brutaliser et menacer de mort jusqu’à des femmes, lorsqu’elles n’obtempéraient pas assez tôt à leurs injonctions. Toutefois, au milieu de cette soldatesque ignorante et brutale, et comme pour en refréner les excès, se trouvaient une foule de braves militaires aussi humains que courageux, sachant respecter les opinions, les croyances d’autrui, excellents cœurs, pleins d’urbanité et d’égards pour tous et de douceur pour leurs prisonniers, aussi pacifiques après la bataille que terribles pendant l’action. Leur dévouement à l’empereur était également excessif, ils ne croyaient qu’à lui, n’espéraient qu’en lui ; mais par éducation, par naturel, par principes, ils se gardaient bien de revêtir ces airs de brutalité et de coupe-gorge qui faisaient exécrer une partie de l’armée, en France aussi bien qu’à l’étranger. À côté des uns et des autres se trouvaient enfin un certain nombre d’anciens soldats, d’officiers et même de généraux comme Foy, Duhesme, Subervic, etc., dont le cœur était tout entier à la cause républicaine. Ils étaient dévoués à cette cause par l’effet de leur nature d’esprit, d’une intelligence plus cultivée, d’un caractère plus élevé, plus indépendant, par suite de leurs anciens services, de leurs souvenirs. Les uns avaient fait leurs premières armes dans ces campagnes enthousiastes de 92, de 93, de 94, etc., et s’en rappelaient le sublime élan et les vertus désintéressées. Les autres étaient d’anciens soldats des armées de Jourdan, de Hoche et de Moreau, des membres de la société secrète des Philadelphes qui n’avaient jamais cessé d’espérer en faveur de leur cause, même au milieu des journées les plus éclatantes de l’époque la plus florissante de l’Empire. Ces journées éclatantes même ne les avaient jamais ni éblouis ni égarés, et aucun d’eux n’avait perdu de vue les sublimes promesses de la Révolution et les grandes conséquences sociales qu’elle devait enfanter. Aussi tous, au milieu des triomphes enivrants de l’Empire, n’avaient pu s’empêcher de répéter en eux-mêmes, avec amertume et en soupirant, cette vérité si heureusement formulée plus tard par notre immortel chansonnier :
Et ces autres paroles extraites de la Napoléone, l’ode célèbre de Charles Nodier, que les Philadelphes chantaient en chœur dans leurs secrètes agapes :
Les soldats que de telles paroles savaient animer du plus noble enthousiasme étaient de ceux qui avaient su apprécier l’Empire à sa juste valeur. Aussi avaient-ils vu non sans amertume la France devenir le patrimoine d’un homme, soumise par lui à la discipline d’une caserne et, selon les paroles d’un général même de l’Empire, réduite à n’être plus qu’un cadavre politique semblable à la Turquie. Ils avaient vu dix ans de gigantesques efforts, le sang de plusieurs millions de martyrs, perdus pour la liberté et pour la cause du progrès ; trois millions d’hommes, la partie la plus virile de la jeunesse française, moissonnés dans des guerres stériles ou insensées ; la dette du pays, malgré tant de conquêtes, s’aggravant de plusieurs milliards ; des impôts irritants assis sur la substance du peuple ; des lois livrant les pauvres ouvriers à l’exploitation du capital, et, en cas de contestation entre salarié et patron, la moindre affirmation de celui-ci suffisant pour lui donner gain de cause ; le patrimoine des communes, ressource du pauvre, aliéné ; un simple décret augmentant la contribution foncière et doublant la contribution personnelle et mobilière, et cela pour faire face à d’énormes déficits que les 200 000 000 de francs de la fortune particulière de Napoléon auraient pu en partie combler ; la corruption des âmes aussi bien que celle des mœurs devenues un moyen de gouvernement ; le libertinage, une presse et un théâtre frivoles se substituant aux mâles et libres pensées d’autrefois ; le prêtre, le mouchard et le gendarme travaillant partout à abâtardir, à dégrader les âmes dans le pays de l’expansion franche et désintéressée, dans une contrée qui avait enfanté tant de grands citoyens, tant de dévouements civiques. Ils avaient vu un homme tournant vers de stériles questions de luttes extérieures, suscitées dans un pur intérêt dynastique ou d’ambition personnelle, l’attention, les forces vives du pays, tandis qu’à l’intérieur tous les genres de progrès étaient oubliés ou combattus. Ils avaient vu cet homme puiser dans de sanglants triomphes la force nécessaire pour mieux opprimer la France, et chaque lendemain de victoire marqué par une défaite de nos libertés. Ils se rappelaient par quels mensonges leur pays avait été amusé et trompé quand, pour lui faire accepter sa propre oppression, on lui montrait comme dédommagement la gloire de porter au moins aux nations l’indépendance et la prospérité ; et pendant ce temps la cause de la malheureuse Pologne était indignement reniée ; la Hollande et l’Italie, affranchies par la France républicaine, replacées sous le joug du pouvoir absolu ; l’émancipation des populations allemandes et hongroises méconnue, l’Europe centrale et alliée ruinée par le blocus continental. Ces généraux, ces officiers, ces soldats patriotes avaient vu de plus nos plus grandes illustrations littéraires réduites au silence ou proscrites, comme Mme





























