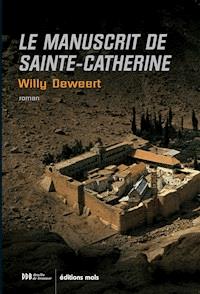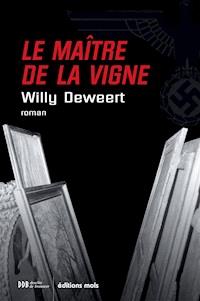
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Autres Sillons
- Sprache: Französisch
« Je suis né à Berlin le 22 août 1921... » Ainsi débute le récit de la vie de Nicolas Rambert, moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Maur.
D'abord nazi fanatique, devenu meurtrier par nécessité, cet amateur d'art et restaurateur de génie fuit l'Allemagne. A Zurich, il offre ses services à Helga Strausser, directrice d'une galerie pour le compte d'un groupe bancaire du même nom. Victime du chantage d'Helga, véritable incarnation du mal, il est contraint de devenir son homme de main.
Après quinze ans passés à la National Gallery, c'est une expérience intérieure d'une rare intensité qui le conduit au monastère. S'ensuivent quarante années de sécheresse spirituelle et de culpabilité. Pour l'aider, le père abbé lui enjoint d'écrire le récit de sa vie.
Ce roman étrange à plus d'un titre pose deux questions fondamentales : le mal peut-il servir le bien, un fil rouge relie-t-il les événements successifs de l'existence de chaque être humain lui conférant son unicité et son sens ?
Un thriller mystique aux frontières de l'indicible, là où la contemplation prend le relais de la parole.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Willy Deweert a été professeur de rhétorique au Collège jésuite Saint-Michel à Bruxelles. Il est notamment l'auteur du best-seller
Les Allumettes de la sacristie. Il vit à Bruxelles. Auteur du
Manuscrit de Sainte-Catherine et du
Maître de la vigne, il est l'inventeur du thriller mystique.
EXTRAIT
Je suis né à Berlin le 22 août 1921 dans une famille de modeste extraction sous le nom de Kurt Geissler. Mon père, Walter, blessé à la jambe au cours de la Grande Guerre, en conserva une légère claudication. Après l’armistice, il trouva un emploi dans une banque. Quant à ma mère, une grande et belle femme, d’une vive intelligence, infirmière durant le conflit, elle s’engagea en 1919 dans le mouvement révolutionnaire d’extrême gauche de Rosa Luxemburg. Suite à l’assassinat de cette dernière, elle se consacra corps et âme à ce qu’elle considérait comme un devoir de mémoire envers son idole. Quand je pense qu’elle a tourné casaque et adhéré au nazisme avec le même fanatisme ! Mes parents tiraient le diable par la queue. Le mark dégringolait à vue d’œil et les denrées alimentaires atteignaient des prix astronomiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Henri qui consacre sa vie aux plus démunis et à Patrick, mon correcteur attitré et ami cher.
« Au cours de la Grande Guerre, Hitler fut blessé deux fois ; la première en octobre 1916, lors de la bataille de la Somme ; il le fut alors à la jambe… en octobre 1918, pendant la quatrième bataille d’Ypres, il subit une forte attaque au gaz. »
William Shirer, Le Troisième Reich, Le Livre de Poche, Tome 1, page 43.
« Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d’autres. »
Marc, 12, 9.
« Qui fait le mal en reçoit le salaire et ne trouve, hors d’Allah, ni protecteur, ni aide. »
Le Coran, 4, 123.
RÉCIT DE NICOLAS RAMBERT
1
Je suis né à Berlin le 22 août 1921 dans une famille de modeste extraction sous le nom de Kurt Geissler. Mon père, Walter, blessé à la jambe au cours de la Grande Guerre, en conserva une légère claudication. Après l’armistice, il trouva un emploi dans une banque. Quant à ma mère, une grande et belle femme, d’une vive intelligence, infirmière durant le conflit, elle s’engagea en 1919 dans le mouvement révolutionnaire d’extrême gauche de Rosa Luxemburg. Suite à l’assassinat de cette dernière, elle se consacra corps et âme à ce qu’elle considérait comme un devoir de mémoire envers son idole. Quand je pense qu’elle a tourné casaque et adhéré au nazisme avec le même fanatisme ! Mes parents tiraient le diable par la queue. Le mark dégringolait à vue d’œil et les denrées alimentaires atteignaient des prix astronomiques.
Notre famille était incroyante. Un matin, en 26 ou 27, j’entrai par curiosité dans une église catholique proche de notre domicile. Face à la statue d’une belle dame, un monsieur avec une longue robe noire parlait d’un certain Jésus à un groupe d’enfants. Je n’étais pas timide. Je me joignis à eux. Quand les autres furent partis, il me dit s’appeler l’abbé Kreutz. Il me catéchisa. C’est ainsi que je devins catholique. Baptisé en secret, je n’eus pas droit à une communion solennelle qui n’eût pas manqué de susciter l’ire de mes parents. Je fis des études médiocres dans un Gymnasium où les coups et les brimades étaient le pain quotidien. Le dessin et Karl May m’aidèrent à m’évader. Le soir, dans mon lit, avant de m’endormir, je me racontais des histoires où je chevauchais aux côtés de Winnetou et d’Old Shatterand dans les plaines du Far West. Ma sœur Trudi naquit en 1924 dans une Allemagne en pleine débâcle économique. À Munich, un dénommé Adolf Hitler avait été condamné à cinq ans de forteresse suite à un putsch avorté. Dès la fin de la guerre, il avait adhéré à un parti ultranationaliste et pangermaniste fondé par Anton Drexler. Hitler l’avait rapidement supplanté. Je ne vais pas refaire l’Histoire que tout le monde connaît. En 1925, il quittait Landsberg avec, dans sa valise, Mein Kampf, un ouvrage dicté, pendant qu’il purgeait sa peine, à son fidèle ami, Rudolf Hess. Revanchards comme la majorité de leurs compatriotes, mes parents vouaient une haine mortelle aux décideurs du Traité de Versailles dont le diktat avait spolié leur pays. Subjugués par la prose de l’histrion, ils s’inscrivirent au NSDAP1. Assidus à ses meetings tonitruants, ils adulèrent ce tribun dont la voix rocailleuse au pouvoir magique déferlait sur les foules en phrases hachées contre les fossoyeurs du peuple allemand qu’il appelait à la vengeance. Ce messie nous libérerait des Alliés et des pantins de la République de Weimar. Démagogue de génie, promettant monts et merveilles, il scandait sa devise Deutschland erwache2. Qu’on embrassât sa « noble » cause et sous peu on verrait ce qu’on verrait. On a vu ! En 1933, il fut élu démocratiquement chancelier et plébiscité président de la république l’année suivante. À douze ans, je le vénérais comme un prophète. Mon père adhéra d’abord à la SA, ensuite à la SS, après la liquidation de Röhm en 1934. Ma mère ne demeura pas en reste, elle propageait l’idéologie nazie en s’adressant aux femmes lors de conférences organisées par le parti et en écrivant contre les Juifs, responsables désignés de la défaite, des pamphlets qui paraissaient dans le Berliner Morgenpost. Son frère, Gunther Meyer, un grand blond au regard d’aigle, beau, intelligent, d’une vaste culture, la joue balafrée, souvenir d’un duel estudiantin, partageait sa ferveur.
Je m’affiliai aux Hitlerjugend3. Étant donné la suite de mon existence aventureuse, je ne le regrette pas. J’aguerris mon corps. J’acquis un savoir-faire et une endurance à toute épreuve. Je me souviens encore de notre hymne :
Notre drapeau, vois comme il flotte devant nous.
Notre drapeau, c’est la promesse d’un avenir de paix.
Notre drapeau nous ouvre les portes de l’éternité.
Notre drapeau nous importe plus que notre vie.
Remarqués pour leur militantisme exemplaire, mon père et mon oncle connurent une ascension fulgurante. Le premier, recruté par Goebbels fut nommé Hauptsturmführer4. Quant à Gunther, conseiller du Reichsführer Himmler, il accéda au grade prestigieux de SS-Standartenführer5.
Notre niveau de vie s’éleva. Nous emménageâmes dans une belle maison à pignons et colombages entourée d’un grand jardin à Lichtervelde, un village pittoresque du sud-ouest de Berlin. Contre son gré, Trudi rejoignit la Jungmädelbund6. Nous recevions fréquemment du « beau monde » à notre table. Un soir de janvier 1937, mon oncle et ma tante Frieda, propriétaires d’une luxueuse villa à Dalhem, située à la lisière de la forêt de Grunewald, à cinq kilomètres de chez nous, vinrent en compagnie de leurs voisins, les Ribbentrop7. La conversation s’orienta sur la juiverie, obstacle majeur à la pureté de la race germanique, une tare à éradiquer au plus tôt. J’étais trop jeune pour comprendre les implications de tels propos.
Le bras tendu, aux cris de Sieg Heil, nous participions aux autodafés, aux retraites au flambeau, aux manifestations de masse. En extase, nous écoutions Hitler, Goebbels, Hess et les autres pontes du régime s’égosiller contre les Juifs, les capitalistes, les communistes, les Tziganes et autres homosexuels. Épurée de ces Untermenschen, l’Allemagne serait bientôt le phare du monde. J’étais dépourvu de tout esprit critique, endoctriné, fasciné, en particulier par le Führer, ses harangues frénétiques me mettaient en transes ; j’aurais tué père et mère s’il me l’avait ordonné. Les rares Allemands qui prévoyaient l’issue de cette folle démagogie se taisaient ou étaient éliminés.
La vie mondaine de mes parents était très chargée. Réceptions avec les caciques du parti à l’Adlon, le Deutscherhof, un des plus anciens et des meilleurs hôtels de la ville, dîners chez nous ou à l’extérieur, soirées à l’opéra où nous partagions la passion du Führer pour les mises en scène grandioses de Parsifal, des Niebelungen, de Tannhäuser, de la Tétralogie et des autres œuvres de Richard Wagner. Ce compositeur « messianique » exaltait la force et la grandeur. Dans ses écrits, il s’insurgeait contre le cléricalisme et le matérialisme, il dénonçait le mélange des races et célébrait la pureté des Germains d’où naîtrait la régénération de l’humanité. Du pain bénit pour les nazis !
Le soir, à la veillée, en guise de prière, mon père lisait des extraits de Mein Kampf, des éditoriaux de l’idéologue du parti, Alfred Rosenberg, publiés dans le Völkischer Beobachter et des articles de Hess. Je me souviens d’une phrase de ce dernier : « Celui qui fait la loi procède avec une implacabilité terrible ; si c’est nécessaire, il piétinera la racaille avec des bottes de grenadier. »
Je reviens à l’oncle que je révérais comme un dieu. À chacune de ses visites, il nous comblait de cadeaux, Trudi et moi. Son uniforme noir m’hypnotisait. Double éclair wagnérien brodé sur le côté droit du col, aigle romaine et svastika sur la manche gauche, trois galons surmontés de feuilles de chêne sur la pointe gauche du col. Quand je serais grand, je serais SS-Standartenführer.
1938. Anschluss. Accords de Munich. Tant en France et en Grande-Bretagne qu’en Allemagne, on crut naïvement que le spectre de la guerre s’éloignait. Je vois encore la photo du crédule Neville Chamberlain, débarquant à l’aéroport de Croydon, brandissant de la main le texte du traité de paix en présence d’une foule considérable. C’était mal connaître le scélérat qui nous dirigeait. Il rongeait son frein. Dépité de constater que le peuple n’était pas prêt à la guerre, il frappa un grand coup afin de réveiller les consciences. Son valet Goebbels révéla l’imminence d’un complot juif dont le but ultime était la domination mondiale décrite en détail dans Le Protocole de Sion, un faux antisémite du dix-neuvième siècle, qu’il avait répandu dans la population. Manière de provoquer la panique !
Le soir du 9 novembre, les SS et les Hitlerjugend incendièrent une centaine de synagogues, pillèrent sept mille cinq cents magasins juifs. Il y eut de nombreux morts et trente-cinq mille déportations dans les KZ8. Ils furent libérés contre des rançons exorbitantes. L’extermination n’avait pas encore commencé. La Nuit de Cristal fut très bien accueillie tant le viol du peuple par la Propaganda de Goebbels stimulait l’exécration du Juif. « Le Führer savait ce qu’il faisait », disait-on. Ma participation à cette monstruosité fut très active. Avec mes copains, aux cris de Juden Kaputt, nous faisions irruption dans un magasin, nous saccagions, brûlions, tabassions les propriétaires. Délirant ! Jamais je ne m’étais autant amusé. Fort du soutien populaire, Hitler envahit la Tchécoslovaquie, la Pologne, puis ce fut la guerre. Bientôt, nous serions les maîtres de l’Europe. Nos armées écraseraient des démocraties lâches et molles. Enrôlé dans la Wehrmacht en 1939, blessé à Dunkerque pendant la Campagne de France, décoré de la Croix de fer, je fus démobilisé.
J’avais un don pour la peinture. Pas encore très vaillant, je m’inscrivis néanmoins à l’École des Beaux-Arts. Après quelques mois, le professeur Illman m’orienta vers la restauration de tableaux. En 42, il confia ma formation pratique à Herman Zorn, un galeriste de la Tiergartenstrasse. Il s’avéra que j’avais la patte. Le travail ne manquait pas. Les œuvres d’art volées aux Juifs affluaient. Par ailleurs, le cours de la guerre tournait en défaveur de l’Axe9. La défaite de Stalingrad marqua profondément les esprits. Le moral commençait à flancher. Le danger se précisait. Plus moyen de fermer l’œil au cours de la nuit. Sirènes, courses aux abris, détonations de la flak, déflagrations. Les B17, Liberators et Lancasters déversaient des tonnes de bombes incendiaires sur les villes du Reich millénaire. Le 15 février 1943, un mois après le désastre de Stalingrad, un discours d’Hitler dessilla mes yeux : « Et maintenant, peuple, lève-toi, tempête, déchaîne-toi. » C’était exactement ce qui se passait, mais dans un sens inverse aux blatèrements du tyran. Je le vis tel qu’il était : menteur, manipulateur, mégalomane, un dément obsédé par sa propre gloire, indifférent aux souffrances de son peuple.
L’ambiance familiale était détestable. Mon père avait une maîtresse. Ma mère l’avait appris. Ils se criaient sans cesse à la tête. Trudi, aussi belle que triste, suivait un cursus de lettres à l’université ; son choix déplaisait à nos parents qui considéraient la littérature inutile voire nocive. Autre sujet de discorde : je n’étais pas encore marié. Engendrer de bons aryens était un devoir patriotique. Après l’avoir idolâtré, j’abominai l’oncle Gunther. Un soir de mars 1943, au cours du dîner, ses propos me pétrifièrent.
Depuis un certain temps, des personnes de mon entourage disparaissaient mystérieusement. Ainsi, un lundi matin, mon collaborateur chez Zorn, un Juif, Heinrich, avec lequel j’entretenais des liens d’amitié, ne se présenta pas à l’atelier. J’interrogeai le patron. Était-il malade ? En guise de réponse, il esquissa un geste fataliste. Les catholiques ayant mauvaise presse, je n’allais plus à la messe. Je me rendis néanmoins chez l’abbé Kreutz. À mon grand étonnement, je trouvai l’église et le presbytère fermés. Sa vieille gouvernante n’habitait pas loin. Elle m’ouvrit avec méfiance et me laissa entrer lorsqu’elle me reconnut.
— Notre curé a-t-il changé de paroisse ?
Elle me regarda l’air de dire : « Comment est-il possible que vous ne soyez pas au courant ? »
— Il a été arrêté il y a trois mois. On ne l’a pas revu. Elle ajouta en larmes :
— Nous ne le reverrons jamais.
— Pourquoi a-t-il été arrêté ? C’était un homme bon et inoffensif.
— Notre Führer n’aime pas les catholiques.
Je tombai des nues. Elle raconta. Un dimanche, pendant la grand-messe, des SS avaient investi l’église et emmené tous les fidèles. Elle-même n’avait dû qu’à son grand âge d’être épargnée.
De retour chez moi, je me souvins d’une petite phrase de l’abbé : « Les nazis sont des suppôts du diable. » Il m’avait exhorté à prendre mes distances avec eux. Conditionné par mes instructeurs des Hitlerjugend, j’avais rétorqué qu’Hitler était le plus grand homme politique de notre histoire, si pas de toute l’histoire. Il avait hoché la tête avec tristesse. Bien que catholique, j’avais participé à des pogroms et à La Nuit de Cristal. Les Juifs n’étaient-ils pas les assassins du Christ, qualifiés de perfides dans une des oraisons du vendredi saint ? Le Saint-Père n’avait pas condamné les nazis. Approuvait-il la répression des « perfides » ? Après la guerre, son silence fera l’objet d’une polémique qui n’est pas éteinte. Je lui trouve des circonstances atténuantes. Que pouvait-il faire d’autre pour prévenir l’occupation du Vatican et une persécution systématique des catholiques ?
J’en reviens à ce sinistre dîner. Dans les territoires occupés à l’Est, l’oncle commandait une section des Einsatzgruppen, chargés de l’extermination des Juifs, des handicapés, des Tsiganes, des cadres polonais, des commissaires du peuple soviétiques. Ce soir-là, j’appris de sa bouche ce que signifiait die Endlösung der Judenfrage, la solution finale de la question juive, décrétée l’année précédente par Hitler, et dont Himmler était l’artisan. Il se rengorgea ; il avait déjà liquidé plus de cent mille « nuisibles ». C’est le terme qu’il employa comme s’il parlait d’insectes. Il décrivit avec enthousiasme les camions à gaz mobiles que ses hommes utilisaient pour aller plus vite en besogne. Hilare, il enfilait les anecdotes ; il évoqua une « youpine » qui le suppliait d’épargner son enfant. « Une chienne et son chiot. Je leur ai collé une balle dans le cigare », s’esclaffa-t-il. Mes parents firent chorus. Sans transition, il s’en prit aux catholiques : « De mauvais citoyens qui obéissent plutôt à leur pape qu’à notre Führer bien-aimé. » Au prix d’un effort surhumain, je maîtrisai mon écœurement et ma colère. Prétextant un fort mal de tête, je quittai la table et gagnai ma chambre. Je m’écroulai en larmes sur mon lit. Zéro sur toute la ligne. Membre d’une famille dégénérée, complice d’une clique de monstres, je demandai pardon au Seigneur de mon aveuglement et du mal que j’avais commis. Je songeai à Heinrich, à l’abbé, à ses paroissiens, aux victimes de ce salopard de Gunther, à tous ces malheureux qui croupissaient dans les KZ ou avaient déjà été exécutés. La question revenait lancinante : pourquoi le Dieu d’amour tolérait-il le mal absolu ?
Herman Zorn m’avait à la bonne. Il écrivit à mes parents pour appuyer mon souhait d’habiter sous son toit. Ils donnèrent leur accord à contrecœur. J’emménageai dans une chambrette mansardée. À cause des bombardements incessants, la galerie et l’atelier avaient été installés dans les caves ; ce n’était pas l’endroit idéal pour les tableaux à cause de l’humidité, mais nécessité faisait loi. Curieux personnage, ce Zorn. Ses réticences à l’égard des nazis, son pessimisme sur l’avenir de l’Allemagne ne l’empêchaient pas de réaliser de juteux bénéfices grâce au pillage des biens juifs. Il augmenta mon salaire. Il engagea un jeune dont il me confia la formation. L’atelier était mon royaume. Quand je me trouvais face à un Dürer, un Sisley ou un Delacroix, absorbé par mon travail, tout le reste se dissipait. Reclus entre mes quatre murs, je récitais mon chapelet, relisais le Nouveau Testament et les quelques livres que m’avait donnés l’abbé Kreutz. Je ne sortais que pour faire des emplettes ou courir aux abris. L’ambiance était surréaliste. Les ruines de la future Germania, imaginée par Speer, les milliers de morts chaque nuit n’empêchaient pas Goebbels de proclamer l’imminence de la victoire. À la radio, Hitler vociférait : « S’ils ravagent nos villes, nous rayerons les leurs de la carte. Ayez confiance. Bientôt des armes terrifiantes anéantiront l’Angleterre. » Même sous les bombes, je ne ressentais ni peur, ni haine à l’égard des Alliés. Ils étaient dans leur droit. Ni pitié non plus pour mes compatriotes ; n’avaient-ils pas élu, en connaissance de cause, un psychopathe à la tête de l’État ! Tout ce qui arrivait se trouvait en toutes lettres dans Mein Kampf. Ils n’avaient pas l’excuse de n’avoir pas su où la folie du « petit caporal » les mènerait. Ils payaient cash leur égarement et leur connivence avec l’insoutenable. L’expiation venait du ciel comme si le Tout-Puissant était enfin sorti de sa réserve.
Mon existence bascula en juin. Un dimanche après-midi, je reçus la visite de Trudi avec laquelle je n’avais aucune affinité. La pâleur de son visage, ses traits tirés, son regard hébété, sa maigreur étaient révélateurs d’une crise profonde. Je lui proposai du café. Elle ne m’entendit pas. Je crus à une déception amoureuse. Assise sur mon lit, les bras croisés, elle demeura prostrée de longues minutes avant de parler en hoquetant. Un récit hallucinant. Son oncle et parrain, avec la complicité de sa tante Frieda, la violait depuis des mois. Menacée d’une mort atroce si elle divulguait à quiconque « les plaisirs de Dalhem », elle envisageait le suicide, seule échappatoire aux abjections que ce couple pervers lui infligeait. Horrifié, abasourdi, outré, je fus impuissant à la consoler. Elle avait dépassé les limites du supportable. Jamais je n’avais ressenti une telle fureur. Je l’étendis sur mon lit. Nous passâmes la nuit enlacés. Le lendemain, je la reconduisis à Lichtervelde. Deux jours plus tard, ma mère me téléphona, en larmes. Ma sœur infortunée s’était jetée sous les roues du métro.
Lors des obsèques, j’observai les deux criminels. Leurs visages affichaient un chagrin qui paraissait sincère. Frieda pleurait à chaudes larmes. L’oncle, très ému, eut l’outrecuidance de prononcer l’éloge funèbre de sa nièce « bien-aimée ». Une aryenne exemplaire, promise à un bel avenir, si sa jeune vie n’avait été brutalement interrompue par un Juif. L’assassin paierait son forfait au prix fort. Je ne bronchai pas. Le châtiment viendrait à son heure.
Animé d’une haine implacable, j’élaborai mon plan avec méthode et sans précipitation. Sévissant en Pologne ou en Ukraine, Gunther était souvent absent. Je repérai les lieux. Douze gardes, quatre domestiques et une cuisinière étaient au service de ces porcs. Je patienterais jusqu’aux vacances. En « bon neveu », je leur rendrais visite. Les abattre serait un jeu d’enfant. La vraie difficulté consisterait à disparaître avant la découverte des corps. Si j’en sortais indemne, je gagnerais la Suisse. En 1943, ce pays « neutre » refluait les Juifs leur refusant le statut de réfugiés politiques. Je n’étais pas Juif. Zorn traitait régulièrement avec la galerie Strausser à Zurich. C’est là que j’irais. Pour l’heure, il me fallait de l’argent, une arme et un Ausweis. Mon père possédait un Mauser et conservait quelques milliers de marks dans un tiroir de son bureau. Cynisme pour cynisme, au début du mois de juillet, sachant mon oncle présent au siège de la Gestapo, 9 Prinz Albrecht Strasse, j’allai le trouver. Je devais effectuer des recherches au musée de Leipzig. Sans hésiter, il me délivra le précieux sésame, se contentant de le signer et de le cacheter. Il me parla de Trudi. « Elle nous manque beaucoup », osa-t-il. Schweinhund !
Le 8 juillet, à la tombée de la nuit, en l’absence de mes géniteurs, je m’introduisis chez eux, m’emparai du Mauser et de quinze mille marks. Au préalable, j’avais demandé à Zorn de me prêter son Hanomag ; une jeune fille blonde comme les blés que je fréquentais souhaitait me présenter à ses parents. Ils habitaient Potsdam. Je voulais faire bonne impression. Il éclata de rire : « Tu es amoureux, Kurt. Quelle heureuse surprise ! Voici les clés de mon carrosse. Ne l’abîme pas. J’y tiens. » À condition qu’il n’y eût pas d’alerte, le dernier train pour Leipzig partait de Lichtervelde à vingt-deux heures dix.
Vingt heures trente. Dalhem. Je me présente au portail de la villa des Meyer. Les gardes me reconnaissent, me saluent et me laissent passer. Le maître d’hôtel m’introduit dans le salon. Gunther lit Der Sturmer, le torchon de Streicher. Frieda bouquine. Ils me considèrent avec surprise.
« Que veux-tu, Kurt ? Un problème ? » s’enquiert l’oncle. « Vous soumettre un document qui ne souffre aucun retard. » — « Montre-moi ça. » Une feuille dactylographiée à la main, je m’approche de lui, la lui tend, contourne son fauteuil comme si je voulais lui indiquer les passages intéressants. Je l’assomme avec la crosse du Mauser. Pétrifiée, Frieda ne réagit pas. Avant de l’estourbir à son tour, je lui murmure à l’oreille : « De la part de Trudi. » Je traîne les deux corps inanimés jusqu’à leur chambre à coucher jouxtant le salon. Je les mets au lit. Je les borde. J’appuie un oreiller sur leurs visages afin d’assourdir le bruit des détonations. En partant, j’éteins les lumières. Quelques instants plus tard, je quitte la villa non sans avoir signifié au maître d’hôtel que les Meyer ne voulaient pas être dérangés. Il faut une éternité à une Hanomag pour atteindre sa vitesse de croisière. Je m’énerve. Je cale deux fois. Non sans mal, j’arrive finalement à Lichtervelde. Trudi me protège. L’alerte quotidienne n’a pas encore retenti. J’abandonne la voiture à trois cents mètres de la gare. Je jette le Mauser dans un égout. Le train démarre à l’heure. Deux arrêts plus ou moins longs en cours de route à cause des bombardiers qui le survolent. Correspondance à Potsdam. Entrée en gare de Leipzig à trois heures trente-cinq du matin. Cent cinquante des huit cent quarante-cinq bornes qui me séparent de Zurich ont été parcourues.
Feu Gunther Meyer s’était contenté de signer et de cacheter mon Ausweis sans le dater. J’y avais inscrit un faux nom. Deux agents de la Sipo10 le contrôlèrent durant le voyage. Lorsqu’ils virent la signature, bras tendus, ils me saluèrent d’un vibrant Heil Hitler. J’eus tout le loisir de réfléchir à mon itinéraire. Sept cents kilomètres à pied par monts et par vaux en évitant les routes et les agglomérations. Pas une sinécure. Chaussé de mes bottines militaires, j’avais emporté mon barda de l’époque des Hitlerjugend, lorsque nos chefs nous dropaient de nuit à bonne distance du camp de base que nous devions regagner par nos propres moyens. Le minimum vital : couverture, gourde, trousse de secours, ciré, objets de toilette, torche, nourriture, une carte d’Allemagne, ma casquette de troufion et Lili, un poignard dont la lame est plus lourde que le manche, lacé à ma cheville, ainsi nommé en l’honneur de Marlène Dietrich, mon actrice préférée. Avec le temps j’étais devenu très habile au lancer du couteau. Je ne manquais jamais ma cible. À Leipzig, j’eus une idée. À cette heure de la nuit, il était aisé de voler une voiture. Faire tourner un moteur sans clé était une des choses qu’on nous avait apprises. Ni passant, ni patrouille, ni avion dans le ciel. J’avais le champ libre. Une Torpedo d’avant-guerre fit l’affaire. Je franchis deux barrages routiers exhibant à chaque fois mon Ausweis. Je dus m’arrêter un long moment. Des nuées de bombardiers regagnaient l’Angleterre. Aux environs de Suhl, j’immergeai la Torpedo dans la Hasel. En théorie, cinq cents kilomètres me séparaient de la frontière helvétique. En réalité, une progression rectiligne était impossible. Afin que personne ne me remarquât, je bifurquais tantôt à gauche, tantôt à droite. Il faisait beau et chaud. Je dormis cinq heures dans un bois. À mon réveil, ma première pensée fut que les corps avaient été découverts. Fugitif, recherché pour meurtres, j’avais l’avantage d’être déjà loin. Rapidement au courant pour le train de Leipzig, ils mettraient un peu plus de temps à s’apercevoir de l’« emprunt » de la Torpedo. Endurant, bon marcheur, cinq kilomètres à l’heure sur le plat, trois quand le relief s’élevait, j’avançais. À hauteur de Meiningen, je me restaurai de pain et de saucisson. Puis, emmitouflé dans une couverture, je dormis d’un sommeil de plomb à la lisière d’une forêt de hêtres. Trois orages d’une extrême violence ralentirent ma progression. Deux grosses frayeurs. Un bûcheron me surprit alors que je me sustentais au pied d’un arbre. Désireux d’engager la conversation, il appuya sa hache contre le tronc, s’essuya le front avec un mouchoir à carreaux, s’assit à mes côtés. Étais-je en vacances ? « J’adore les longues marches », répondis-je, ma main glissant le long de ma jambe vers Lili. « Vous êtes jeune. Pourquoi n’êtes-vous pas dans la Wehrmacht ? » — « Blessé à Dunkerque. Démobilisé. Je travaille dans une usine d’armement. Huit jours de congé. » Je l’observai. Râblé, basané, un regard franc, il inspirait confiance. « Et vous ? » — « Femme malade. Cinq enfants. Pas évident de nouer les deux bouts. » Une pause. Il me tendit une flasque de schnaps. L’alcool me fit du bien. Il me jaugeait. « Que pensez-vous de la guerre ? » — « Nous allons la perdre. » Il opina : « Notre peuple est victime d’un détraqué. » — « Nos parents l’ont élu. » Il hocha la tête avec fatalisme. — « Vous n’avez pas été enrôlé ? » — « Pied-bot, mauvais aryen, mauvais soldat. Si cette malformation m’a valu bien des moqueries, elle m’a préservé de mourir congelé sur le front russe. » Nous trinquâmes à nouveau. « Comment m’y prendre pour trouver de la nourriture ? » — « Si vous avez de l’argent, adressez-vous aux fermiers. Ils détestent les nazis qui réquisitionnent leurs produits sous prétexte d’alimenter nos glorieux guerriers. Vous payez. Ils ne posent pas de questions. » Je lui offris mille marks. Nous nous séparâmes bons amis. Son conseil s’avéra judicieux. Le neuvième jour, aux environs d’Eddingen, je commis une maladresse qui faillit me coûter cher. Je revenais à découvert d’une ferme lorsque soudain deux side-cars stoppèrent à ma hauteur. Un feldwebel exigea mes papiers. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je présentai mon Ausweis. Ils l’examinèrent attentivement. Brusquement, l’un d’eux poussa une exclamation. « Il vous a été délivré par le SS-Standartenführer Meyer, sauvagement assassiné en même temps que son épouse il y a une dizaine de jours. » Je mimai l’ahurissement et l’indignation. « Juden, m’écriai-je. Ces chiens ne reculent devant rien. Dieu soit loué ! Notre Führer bien-aimé veille à nous débarrasser de cette racaille. Heil Hitler ! » Mon baratin produisit son effet. Ils saluèrent, enfourchèrent leurs side-cars et disparurent dans un tourbillon de poussière. Si la télévision avait existé, ma bobine aurait été diffusée sur toutes les chaînes. Ils m’auraient embarqué. Nacht und Nebel. Ma photo devait avoir fait la une, mais ce n’était pas la même chose. Les clichés, de médiocre qualité, étaient souvent peu ressemblants.
Je me trompais. Une fois en Suisse, je consultai la presse allemande. Aucun quotidien n’avait fait mention de moi. L’assassin des Meyer était un Juif qui avait été arrêté et pendu. On n’avait pas voulu salir l’honneur de mes parents. Par ailleurs, je devais être activement recherché. J’en aurais bientôt la preuve.
Au cours de cette odyssée interminable, bien qu’ils fussent des salauds de nazis, je bénis mes instructeurs des Hitlerjugend qui nous avaient appris à nous tirer de n’importe quelle situation. Tout en marchant, je récitais le rosaire comptant les ave sur mes doigts.
Dix-huitième jour de cavale. Encore trente kilomètres. À proximité de Geisingen, suivant un chemin forestier, j’entendis venant d’en face les accents martiaux du Horst Wessel. Un orage avait détrempé la forêt. Je me jetai dans un fossé longeant le sentier. J’avais de l’eau vaseuse jusqu’au cou. Un groupe de jeunes en uniforme des Hitlerjugend me dépassa sans me voir. Ouf ! Il eût été stupide d’échouer si près du but. Lorsque je me relevai, dégoulinant, crasseux, je me déshabillai à la lisière d’une clairière. J’étendis mes vêtements au soleil. J’escomptais franchir la frontière la nuit suivante. Cet incident me retarda. Je passai la journée, nu, à soigner mes pieds et à me reposer. Par chance, ni le contenu de mon sac, ni mon argent, ni mon Ausweis n’avaient subi de dommages.
Après vingt et un jours d’une marche éreintante et avec beaucoup de chance, je pénétrai en Suisse, de nuit comme prévu, à travers bois, dans une région montagneuse. Alléluia ! J’avais réussi l’impossible. Je tombai à genoux, baisai le sol, remerciai le Seigneur même si j’avais enfreint le cinquième commandement : tu ne tueras pas. J’étais sûr qu’Il me pardonnait d’avoir expédié deux dépravés en enfer. En guise de réponse, je perçus une légère chaleur intérieure. Sale, dépenaillé, titubant de fatigue, après m’être débarrassé de tout ce qui faisait de moi un Allemand, je me couchai dans l’herbe et dormis jusqu’à l’aube.
Jeudi 29 juillet 1943. Zurich était distante de cinquante kilomètres. Si on m’interpellait, je dirais que j’avais perdu mes papiers et que je me rendais à la galerie Strausser. Je songeai à Zorn. Pourvu qu’il n’eût pas d’ennuis à cause de l’Hanomag ! Je marchai jusqu’à Baden. Au guichet d’une banque, j’échangeai mes marks contre des francs. Amaigri, barbu, je me fringuai façon milord dans un magasin de vêtements dont le patron m’autorisa à prendre un bain. Après un passage dans un salon de coiffure, j’avais la dégaine d’un jeune banquier dynamique. Le soir tombait. Hôtel. Restaurant. Repas plantureux. Heureux comme je ne l’avais jamais été. Nuit réparatrice dans un vrai lit. Le lendemain, je prenais le train pour Zurich.
Vendredi 30 juillet. Vers onze heures, je me présentai à la galerie Strausser, 14 Banhofstrasse, une des rues commerçantes de la ville.
Je demandai la directrice.
— Vous avez un rendez-vous ?
— Non, mais je viens de loin pour la rencontrer.
Helga Strausser naviguait dans la trentaine. Belle comme un soleil d’hiver. Grande et élégante. Coiffure jais à la garçonne. Visage ovale. Front haut, yeux verts écartés, oreilles discrètes, nez impudent, bouche fine, menton volontaire. Son regard polaire et inquisiteur mettait un frein à toute tentative de séduction. Je choisis de lui dire une partie de la vérité. J’avais fui l’Allemagne nazie parce que, catholique, je ne tarderais pas à finir mes jours dans un KZ. Elle me dévisagea sans aménité.
— Êtes-vous Juif ?
— Catholique né de parents nazis.
Je fis état de ma blessure de guerre, de l’école des Beaux-Arts, du professeur Illman qui m’avait orienté vers la restauration et de Zorn.
— Je connais Zorn. Illman est un maître. Vous avez votre diplôme ?
— Pour des raisons de sécurité, j’ai détruit tout ce qui était susceptible de m’identifier.
— Vous vous appelez ?
— Peter Dreyer.
— Bien sûr, ce n’est pas votre vrai nom.
J’esquissai un sourire.
— Mettez-moi à l’épreuve, vous constaterez que j’ai la patte comme disait Illman.
Les deux mains croisées sous le menton, elle m’observa un long moment en silence. La sueur coulait dans mon dos. Cette femme d’acier me tétanisait. Allait-elle me flanquer dehors ou tester mes capacités ? Brusquement, elle se leva et m’invita à la suivre. Elle m’introduisit dans un vaste atelier où un homme et une femme travaillaient devant leur chevalet respectif. Elle me mit face à une toile en très mauvais état.
— Campagne de Rome. Hippolyte Flandrin. Peintre idéaliste et religieux. Accordez-moi deux heures et vous aurez mon diagnostic.
Elle me les accorda. Après son départ, sous le regard ironique des deux autres, d’abord à l’aide d’une loupe, puis d’un microscope, j’examinai la toile dans ses moindres recoins. Quand elle revint, mon opinion était faite.
— C’est un faux. Il ne vaut pas un kopeck.
Elle sursauta.
— Un faux !
— Je possède une excellente mémoire visuelle. Le vrai est légèrement plus lumineux. Avez-vous une reproduction ?
Elle sortit sans un mot.
— Comparez attentivement les deux tableaux, lui suggérai-je lorsqu’elle revint. En dépit de son habileté, le faussaire a commis une erreur. Afin de lui donner sa patine, il l’a laissé au four une fraction de seconde de trop. En l’observant au microscope vous constaterez d’infimes différences, invisibles à l’œil nu. Je parie que vous avez un certificat d’authenticité.
— Oui, fit-elle froidement.
— Rédigé par le faussaire lui-même. C’était déjà dans les mœurs au dix-neuvième siècle.
Elle s’en prit sèchement à ses deux collaborateurs qui alléguèrent pour leur défense qu’ils n’avaient pas encore eu le temps d’examiner le Flandrin, arrivé hier. Elle se tourna vers moi.
— Je vous engage à l’essai.
J’étais aux anges.
De retour dans son bureau, elle précisa que j’aurais à restaurer des œuvres pour des particuliers ou destinées à la vente. Elle me procurerait des papiers d’identité.
— Date de naissance ?
— Le 22 août 1921.
— Signes particuliers ?
— Une cicatrice au thorax.
Elle prit une photo de mon visage.
— En attendant d’être en règle, vous occuperez une chambre au deuxième étage de la galerie. Je vous fournirai une tenue de travail. Il y a un restaurant au bout de la rue. Ne frayez avec personne. Salaire mensuel : quinze cents francs. Vous commencez lundi.
Lundi 2 août. Helga me remit un passeport au nom de Peter Dreyer, citoyen helvétique, né à Brienz, dans le canton des Grisons, le 22 août 1921. Elle devait avoir le bras long pour avoir obtenu dans ce pays xénophobe ma naturalisation en un week-end. Elle m’avait même trouvé un logement.
— Vous louerez une chambre chez Rina Vedel, 22 Bleicherweg. Prévenue, elle ne posera aucune question embarrassante.
Elle me présenta à mes deux collègues. Hedwig Yerly et Theo Bader m’accueillirent d’un signe de tête. D’évidence, ils ne me pardonnaient pas de les avoir ridiculisés. Le Flandrin avait disparu. Un troisième chevalet avait été installé. J’admirai la qualité du matériel mis à ma disposition. Un véritable laboratoire. En comparaison, chez Zorn, on bricolait. L’atelier baignait dans la pénombre de sorte à permettre un bon éclairage artificiel des tableaux. Je débutai ma carrière à la galerie Strausser avec Pommiers en fleurs, de Charles Daubigny. Peintre intéressant, influencé par son ami Camille Corot, d’abord classique, ensuite acquis aux idées de Monet et de Cézanne, il peignit des paysages en pleine nature. Un sacrilège aux yeux des vieux barbons. Victime de l’humidité, l’œuvre était mal en point : fentes dans le châssis, perte de flexibilité de la toile, nombreuses craquelures, couche picturale lacunaire en plusieurs endroits. Établir un diagnostic était la première démarche du restaurateur. Cette étape essentielle pouvait durer plusieurs jours. Après un long examen, je recourus au microscope et à la photographie aux rayons ultraviolets. Au cours de cette première journée, pas un mot ne fut échangé avec mes deux acolytes. Helga exigeait un rapport quotidien. À dix-huit heures, non sans appréhension, je lui remis le résultat de mes premières observations.
— Excellent travail, Peter. Vous êtes un pro. Votre estimation du temps de restauration ?
— Trois mois au bas mot.
Elle opina.
— À demain.
Rina Vedel était une quinquagénaire affable. En guise de bienvenue, elle m’offrit un verre de vin aigre. Une pendule invisible sonna sept coups. J’inscrivis mon nom sur un registre. Elle m’alloua une chambre au premier étage. Propre, rudimentaire, laide. Un lit, une table, deux chaises, une penderie, une armoire de bois blanc, un réchaud à gaz à deux becs, un évier à un bac. Les murs étaient tapissés d’un affreux papier peint à fleurs mauves. Au sol, un lino gris sale. Accrochée au plafond par un long fil, une seule lampe éclairait la pièce.
— Vous êtes mon unique locataire. La vie n’est pas facile, se plaignit-elle.
Elle embraya sans transition :
— Le loyer est de cent vingt francs. Le quartier est paisible. Vous serez bien ici. Votre lit est fait. Il y a des couvertures dans la penderie. La vaisselle est dans l’armoire. Les toilettes et la salle de bain sont au fond du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à demander. Encore une chose, moyennant un supplément de vingt francs par mois, je puis m’occuper de votre linge et de la chambre.
Après son départ, je me plongeai avec délice dans l’eau tiédasse du bain. Je confectionnai une omelette au lard agrémentée d’une bouteille de Pinot noir de Genève. Je rangeai mes maigres bagages. Je me couchai tôt, assuré de passer une nuit sans alerte, sans course aux abris, sans bombardements. Avant de m’endormir, je relus l’épisode de la Transfiguration dans une Bible, acquise à Baden. Seigneur, il est heureux que nous soyons ici11. C’était exactement ce que je ressentais.
Mardi 3 août. Lever à sept heures. Un café et deux tranches de pain avec de la confiture de fraises. À pied d’œuvre à huit heures précises. En l’absence d’Helga, je déposai mon rapport sur le bureau de sa secrétaire, Sylvie Geller, une jolie blonde à l’œil aguicheur. Je devrais me méfier. Pas question de m’aventurer sur le terrain spongieux des idylles éphémères. Protéger ma sacrosainte indépendance. Ce soir-là, après m’être restauré chez un Italien de spaghettis arrosés d’une demi-bouteille de chianti, je fis le point. Suisse en Suisse ! Malgré un emploi dans une galerie prestigieuse, un salaire décent, le temps n’était pas au beau fixe, il pouvait même se gâter rapidement si les nazis me traquaient. Je me posais aussi pas mal de questions. D’où provenaient les tableaux qui transitaient par la galerie ? « Pour des particuliers », avait-elle dit. Quels particuliers ? Il était de notoriété publique que de nombreux biens volés aux Juifs étaient écoulés dans ce pays qui s’enrichissait sur leur dos. Était-ce le cas de la galerie ? Il ne serait pas facile d’en savoir davantage. J’avais déjà compris qu’Helga ne tolérait d’ingérences ni dans sa fonction, ni dans sa vie privée. Sa beauté glacée, sa forte personnalité, son impénétrabilité m’intriguaient. J’avais l’esprit vif. Un visage était comme un portrait. Je décryptais aisément l’impassibilité d’une physionomie, le non-dit d’un regard, la portée d’un sourire. Ainsi, lorsqu’elle avait tancé Hedwig et Theo, son visage n’avait manifesté aucun signe d’irritation. Les mots sortaient de sa bouche comme s’il n’y avait pas de connexion entre ses paroles et son apparence. Femme d’affaires, femme d’action. Un jugement sûr, pas d’états d’âme, préoccupée de son seul intérêt. Elle m’avait engagé sans hésiter après la démonstration de mon savoir-faire, fourni des papiers en un temps record et trouvé un logement. Je gagerais que ces démarches ne lui avaient coûté que deux coups de téléphone. Tous filaient doux. Le mutisme était de rigueur. J’avais tenté d’engager la conversation avec le comptable Helmut Waltz, croisé dans un couloir, pimpant quadragénaire, courte barbe, nœud pap’, costard trois-pièces bleu ciel. Il s’était esquivé marmonnant quelques mots de bienvenue. Pendant la pause de midi, je poussai la porte de la salle d’exposition. Deux jeunes femmes étaient à la disposition de la clientèle. L’une d’elle me parut avenante. Je me présentai. Brenda Ackerman s’offrit à me faire visiter les lieux. Tout en admirant les œuvres proposées à la vente, je l’interrogeai.
— Nous sommes vingt. La directrice, sa secrétaire ; le comptable et la sienne. Trois personnes s’occupent de la promotion, des expositions et du catalogue. Avec vous, cela fait trois restaurateurs, deux demoiselles de magasin, Dora Culler et moi, deux femmes de ménage, deux gardiens de jour, deux de nuit, le portier, un molosse qui contrôle les horaires du personnel et pointe les retards qui sont retenus sur les salaires des contrevenants. J’allais oublier l’expert, Ulrich Kury. Un drôle de bonhomme, murmura-t-elle à voix basse. Ne vous y fiez pas.
— Qui loge au-dessus de la galerie ?
— C’est l’appartement privé de madame la directrice, dit-elle avec un respect mâtiné d’une nuance d’ironie.
— Elle y habite ?
Brenda éclata de rire.
— C’est une Strausser. Ils vivent dans des palaces. Ellemême possède au bord du Lac une villa qu’on dit somptueuse. C’est au premier qu’elle reçoit les clients huppés. Ils y accèdent en ascenseur depuis le parking souterrain afin de protéger leur anonymat. Une des femmes de ménage m’a dit qu’il était d’un luxe inouï.
Un garde fit son apparition. Elle s’enfuit comme si échanger quelques mots avec un collègue constituait une faute grave. Mine patibulaire, pectoraux de catcheur, démarche de plantigrade, il m’apostropha sèchement :
— Vous n’avez rien à faire ici, monsieur Dreyer.
Je m’excusai comme un enfant pris en flagrant délit de chapardage. En sortant, je me retournai. Il fonçait sur Brenda.
Lorsque je remis mon rapport, Helga le lut sans faire de commentaires. Ensuite, elle me pria de sa voix métallique de ne pas importuner le personnel. La porte de sa secrétaire était ouverte. Au passage, celle-ci m’adressa un clin d’œil équivoque. Au fond de moi, j’étais très satisfait de ma journée. La galerie était une dictature. Je songeai à l’expert qui avait dû en prendre pour son grade d’avoir envoyé le Flandrin à l’atelier. Et puis, cette petite phrase très significative de Brenda : « C’est une Strausser ! »
Après mon shopping, je me rendis à la gare, toute proche, où l’on trouvait des journaux anglais. Langue que je pratiquais. Ce qu’ils m’apprirent me combla. La Sicile libérée, les Alliés remontaient vers Rome. Mussolini avait été destitué et emprisonné. En Union Soviétique, la Wehrmacht reculait sur tous les fronts. Les villes allemandes étaient en ruine. Hitler et son gang n’en avaient plus pour longtemps. Quant aux Japonais, ils subissaient défaite sur défaite. En cours de route, j’achetai une radio. Bleicherweg, je trouvai ma logeuse dans tous ses états. Deux policiers l’avaient interrogée sur mon compte. « Ils reviendront », s’affola-t-elle. Je la rassurai. Je n’avais commis aucun délit.
— Même si la Suisse est un pays libre, il ne faut pas avoir commis de délit pour avoir des ennuis, en particulier à Zurich.
— Puis-je utiliser votre téléphone ?
— Je vous en prie.
Helga était toujours au bureau. Après m’avoir écouté, elle répondit :
— Ne vous faites pas de souci. Ils ne reviendront pas.
« Ils ne reviendront pas » à condition qu’ils ne soient pas de faux policiers.
Je passai la soirée en compagnie de Mozart.
Dès les premières pages, annoter l’impact de mon récit sur ma vie religieuse m’apparaît comme une nécessité. Nous sommes en 2000. Soixante-dix-neuf ans, membre de la communauté bénédictine de Saint-Maur12 depuis quarante ans. Abbaye millénaire fondée en 1003 par Ascelin, un moine de Cluny, très vite florissante, son histoire fut une suite de tribulations et de renaissances. Décimée par la peste en 1348, elle demeura à l’abandon jusqu’à sa restauration en 1363 sur l’ordre du pape d’Avignon, le bienheureux Urbain V. Rasée en 1793, lors de la révolution, reconstruite après la chute de Napoléon Ier, elle compte aujourd’hui une soixantaine de moines. De l’abbaye originelle, il ne reste qu’une superbe crypte romane, lieu propice à la réflexion et à la prière. En ce qui me concerne, prier est un mot à peu près vide de sens. En réalité, depuis mon entrée au monastère, ma vie intérieure est un trou noir. Je devrais être un homme de Dieu, je ne le suis pas. Mes oraisons s’apparentent à du bavardage mental. Mon âme est un désert rocailleux, rien n’y pousse. Plein de mon propre vide, chaque jour, je marmonne le psaume 139 selon lequel Dieu me ferait être et penser. Son amour m’enserrerait. Ce n’est pas ce que je ressens. Les jours se suivent dans un brouillard épais. À l’office, revêtu de la coule, j’éprouve le malaise de l’intrus. Qui n’est pas religieux ne peut comprendre à quel point cette situation est une rude épreuve. J’ai beau Le supplier de m’envoyer un petit signe, je demeure prostré à « Gethsémani » sans la présence d’un ange consolateur. Pouvez-vous boire mon calice ? Mon calice vous le boirez.13 Jour et nuit jusqu’à la lie. J’envie le visage limpide du père abbé. Son regard vous transperce, revient à lui-même d’où il remonte jusqu’à Dieu. M’y réfugier pour accompagner son ascension ! Il n’a de cesse de me réconforter : « Nombre de religieux connaissent la nuit de l’âme. La prière unitive est une grâce peu commune. Faites votre possible sans vous préoccuper du possible. » Paroles en l’air. Rongé par le remords, je culpabilise, j’erre, je déprime. Un égaré victime d’une énorme erreur de parcours.
Lors d’un octiduum14, un père jésuite expliqua que Saint Ignace attirait l’attention du retraitant au début des Exercices sur la consolation et la désolation. Deux contraires à bien gérer. Je m’entretins avec lui.
— Ténèbres, tumulte et vacarme me perturbent sans arrêt. Je ne connais que la désolation.
— La pédagogie divine est un mystère, répondit ce maître en discernement des esprits. Toutefois, quelle que soit la manière dont vous Le priez, soyez assuré qu’Il vous entend. Vous avez la foi sans la confiance. Trop crispé, vous décortiquez, discutaillez, ratiocinez. Le secret de la prière est le silence intérieur. Un creux, un espace d’écoute, une ouverture à ce qui n’est pas vous. Il se tient à votre porte, Il frappe en vain, il y a trop de décibels dans votre demeure.
Depuis, je m’exerce à singer le bouddhiste, mais le diablotin qui se trémousse dans ma caboche ne désarme pas. Ultime tentative pour rebondir, la thérapie que j’entreprends, si éprouvante soit-elle, chassera peut-être les fantômes qui squattent mon inconscient depuis si longtemps. Il me faut écrire pour exorciser mon passé et, loin de mon présent figé, sculptant mes souvenirs, dégager le ciel du peu d’avenir qui me reste.
Mon nom actuel est Dom Nicolas Rambert. Je dis « actuel » en raison des circonstances qui m’ont contraint à en changer quatre fois. Après ma formation et mon ordination, tour à tour bibliothécaire, sous-prieur, maître des novices, restaurateur occasionnel de fresques et de peintures. Aujourd’hui, diminué par l’arthrose et les rhumatismes, je ne suis plus d’une grande utilité. Je lis, je me promène, je vais m’asseoir au chevet des malades à l’infirmerie. C’est Dom Pierre de Guerigny, le père abbé, qui m’a incité à partir « à la recherche du temps perdu » dans le but d’élucider l’origine de mon blocage spirituel, qui ressemble à un refus inconscient d’assumer ma condition. « Des chemins tortueux mènent certaines personnes vers des lieux où ils ne se seraient jamais rendus si des occurrences particulières ne les y avaient conduits. Votre anamnèse mettra peut-être en lumière les causes de votre longue et douloureuse stérilité intérieure. » Je ne suis pas écrivain. Je ferai de mon mieux pour narrer la chronique de mes années de braise ; elle n’évoquera pas de verts pâturages, mais un univers impitoyable.
Mon supérieur a mis à ma disposition un ordinateur, une imprimante et un siège bureautique. En dépit du travail titanesque de l’informatisation de la bibliothèque et des archives, Dom Jérôme Lebrac m’initie aux arcanes du web comme un instituteur apprend à lire aux enfants. Les mains calleuses, les doigts raides, je tape à grand-peine sur les touches du tabulateur. Je lui ai demandé d’ouvrir deux fichiers. L’un, biog, consacré à hier, l’autre, st-maur, mon jardin en friche d’aujourd’hui.
17 décembre 2000. Troisième dimanche de l’Avent. Cette nuit, le thermomètre est descendu à moins onze. Malgré la chaleur du radiateur, ma vieille carcasse est percluse de rhumatisme. Une sensation de froid vrille ma colonne vertébrale. Comme je ne maîtrise pas encore le traitement de texte, je fais régulièrement appel à Jérôme qui me sort des pétrins dans lesquels je me suis fourré. Le plus enrageant, c’est de perdre ce qu’on vient d’écrire faute de l’avoir enregistré. C’est déjà arrivé deux fois.
J’ai soumis mes premières pages au père abbé.
— Votre mémoire est sans faille.
— C’est pour moi un sujet d’étonnement. Une fois ma madeleine trempée dans la tisane, mon passé ressuscite avec une précision surprenante. Il y a des événements que je ne souhaite pas me remémorer tant ils sont humiliants et traumatisants. Toutefois, je le ferai si vous le jugez utile.
En guise de réponse, il me bénit.
J’éprouve une grande admiration envers Pierre de Guerigny, soixante-trois ans, élu abbé en 1981. Homme d’une grande intelligence, humble et simple. On sort toujours de chez lui réconforté. Malgré « une reprise en main » par le pape, il se conforme aux directives de Vatican II. Ainsi, il a humanisé notre vie monastique en l’ouvrant sur le monde. Il a introduit les journaux, permis les sorties, invité des conférenciers, organisé des rencontres avec des communautés laïques ou religieuses. Les moines y ont gagné une liberté d’action et de pensée, bénéfique à leur équilibre. « La sagesse, dit-il souvent au chapitre, préserve l’espérance des illusions. La Résurrection n’est pas un mirage, mais un événement singulier qui nous révèle Celui qui rend caduques nos logiques et nos désirs de grandeur. » Homme de peu de mots, homme d’écoute, il n’use jamais du vocable péché, il lui préfère erreur de jugement. Il réprouve la culpabilisation à laquelle l’Église a trop souvent recours comme instrument de chantage. Depuis que j’ai commencé à écrire, je parviens à prier. Mal, j’en conviens, mais c’est mieux que rien. Le jeune homme dynamique que je fus interpelle le vieillard anémique que je suis. À travers les décennies, Peter Dreyer l’emmène vers sa destinée.
1. Parti National Socialiste des Travailleurs allemands.
2. Allemagne, éveille-toi.
3. Jeunesses hitlériennes.
4. Capitaine.
5. Colonel.
6. Ligue des jeunes filles.
7. Joachim von Ribbentrop était Ministre des Affaires étrangères.
8. Camps de concentration.
9. Alliance entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon.
10. Sicherheitzpolizei, service de sécurité de la SS.
11. Matthieu, 17, 4.
12. Abbaye imaginaire.
13. Matthieu, 20, 22-23.
14. Une retraite de huit jours.
2
Ce n’était un secret pour personne, la galerie dépendait de la Strausserbank, un impressionnant quadrilatère de pierres blanches auquel on accédait par la Waisenhausstrasse, située à cinq cents mètres du royaume d’Helga. Le lundi 9 août, j’y ouvris un compte pendant la pause de midi. Un jeune fondé de pouvoir, aimable, tiré à quatre épingles, s’ingénia à placer au mieux de mes intérêts les dix mille francs que je déposai à la banque. À l’époque, c’était une coquette somme, ce qui motiva l’urbanité onctueuse de son accueil. Il répondit à toutes mes questions. C’est ainsi que j’appris que Sixtus Strausser était directeur ; son fils, Kaspar, sous-directeur ; malgré son âge canonique, le fondateur, son père Hans-Jakob présidait toujours le conseil d’administration dont Helga Strausser, fille de Sixtus, était membre. Très volubile, il mentionna avec fierté qu’un boulevard de la ville, le stade et la patinoire portaient le nom du patriarche. Je le remerciai. Il me remit sa carte de visite. Il s’appelait Peter Hafner.
Helga, Theo et une partie du personnel étant en vacances, il incombait à Helmut Waltz d’assurer l’intérim de la directrice. Je me retrouvai seul avec Hedwig. Pas un cadeau. La quarantaine, mal fagotée, boulotte, courte sur pattes, atrabilaire chronique. Une laideur séduisante lorsqu’elle souriait. Pour l’amadouer, je devrais me mettre en situation d’infériorité comme un jeunet qui recourt à l’expérience d’une collègue chevronnée. J’attendis quelques jours avant de l’entreprendre. Mon diagnostic établi, je savais les étapes à suivre pour traiter le Daubigny. Le mardi 10, vers onze heures, affectant un air tracassé, je fis appel à elle :
— Comment vous y prendriez-vous pour retirer la toile du châssis sans l’abîmer davantage ?
Devant son air buté et revêche, je poursuivis :
— Je sais plus ou moins ce que je dois faire, cependant afin d’éviter de commettre une erreur et m’attirer les foudres de l’expert, l’avis d’une professionnelle me rassurerait. Un nouveau n’a pas droit à l’erreur.
« Professionnelle » la dégela. Elle m’expliqua comment procéder. Nous pique-niquâmes ensemble.
— Où avez-vous appris le métier, monsieur Dreyer ?
— Peter, je vous en prie.
— D’accord, moi c’est Hedwig.
Éviter à tout prix les questions délicates et orienter la conversation sur le présent.
— À Brienz, dans l’atelier d’un ami de mon père. Et vous-même ?
— À l’Académie de Berne.
— Vous travaillez ici depuis longtemps ?
— Quinze ans. Helga n’était pas encore directrice. Je fus engagée par sa sœur Gisela.
— Elle est l’aînée ?
— De trois ans. Hélas, elle fut assassinée en 38 et sa fin tragique ne fut jamais élucidée, ajouta-t-elle avec tristesse.
— Vous l’aimiez beaucoup ?
Elle hésita avant de répondre.
— Jurez de ne parler à personne de ce que je vais vous dire.
Je jurai.
— Oui, je l’aimais beaucoup. Très compétente et bien plus humaine qu’Agrippine – c’est le sobriquet de la patronne. Nul ne comprit le mobile de ce meurtre. Inoffensive, sans amant, elle vivait seule avec ses chats.
— Un crime de rôdeur comme disent les flics quand ils font chou blanc ?
— Ce fut effectivement la conclusion de l’enquête, mais personne ne fut dupe.
— Pourquoi ?
Un silence.
— Vous avez juré.
— Je suis catholique. Se parjurer est un péché mortel.
Elle esquissa un léger sourire. Nos croyances différaient.
— Elle est d’une ambition effrénée et d’un cynisme outrecuidant, deux jours avant l’enterrement, Helga occupait déjà le fauteuil directorial.
— Vous la soupçonnez d’avoir éliminé sa sœur dans l’intention de prendre sa place ?
— Gisela fut empoisonnée à l’arsenic. Tout le monde sait que le poison est une arme de femme. Un rôdeur l’aurait violée avant de l’étrangler. Il aurait ensuite mis la maison à sac pour trouver argent et bijoux. Rien de tout cela. Cerise sur le gâteau, Helga lui avait rendu visite la veille au soir.
— Les enquêteurs n’ont pas fait le rapprochement ?
— Peut-être, mais un juge classa l’affaire huit jours plus tard.
— Comment est-ce possible ?
— Le grand-père d’Helga, Hans-Jakob, était et est toujours l’homme le plus puissant de la ville, si vous voyez ce que je veux dire ?
— Je vois. Stade, boulevard, lycée Hans-Jacob Strausser. En conséquence, une affaire étouffée par un juge corrompu. Toutefois, pourquoi éliminer Gisela si elle était compétente ?
— Sa compétence n’était pas en cause. Helga voulait la place, elle l’a eue. Un point c’est tout !
Les révélations d’Hedwig me sidéraient.
— Est-elle mariée ?
— À ma connaissance, ni mari, ni amant. Une louve solitaire. Nul ne connaît l’adresse de son domicile privé.
— Il suffirait de la suivre quand elle quitte son travail.
— Qui s’y collerait prendrait un gros risque.
— Pourquoi ?
— Elle ne se déplace jamais seule.
Je changeai de sujet.
— Elle occupe le premier étage de la galerie ?
— Son poste de commandement. Là où elle magouille.
— Avec qui ?
— Les Frisés, pardi ! Une fois, je suis entrée dans la chambre forte attenante à son bureau. Bourrée à craquer de chefs-d’œuvre. D’où viennent-ils ? D’Allemagne, évidemment. Ce qu’on montre au public dans la salle d’exposition est de la poudre aux yeux. Les vraies transactions se font à l’abri des regards indiscrets et rapportent gros.
Soudain, son visage se rembrunit.
— Je vous en ai trop dit. Je vous connais à peine. Je devrais me méfier de vous. Vous avez juré, mais qui me dit que vous n’êtes pas à la solde d’Agrippine ?
— Soyez sans crainte, Hedwig. Considérez-moi comme un ami. Une dernière question : pourquoi le personnel vit-il la peur au ventre ?
— La moindre peccadille est sévèrement sanctionnée. Le faux Flandrin, par exemple, nous a valu à Theo et à moi une retenue de deux cents francs sur notre salaire de juillet alors même que nous n’avions pas encore eu le temps de l’examiner puisqu’il était arrivé la veille. En cinq ans, elle a licencié dix personnes pour des motifs anodins. Les restaurateurs sont moins menacés : les bons sont une denrée rare tout en étant eux aussi sous haute surveillance. En août, on est plus tranquille. C’est la raison pour laquelle je prends toujours mes congés en septembre.
— Quel genre d’homme est Waltz ?
— Un brave sous-fifre.
— Désolé pour votre amende, je vous rembourserai.
À dix-huit heures, en partant, elle m’adressa un sourire.
— Ne vous sentez pas obligé de me rembourser. Vous n’y êtes pour rien.
Étendu sur mon lit, je méditais les confidences d’Hedwig. Non seulement Helga était un despote, mais sans doute une criminelle et une receleuse de biens volés aux Juifs. « Les restaurateurs sont moins menacés : les bons sont une denrée rare. » À condition de s’occuper exclusivement de leurs oignons. La Strausserbank