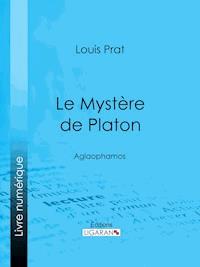
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Timon. Quel dieu, mon cher Arkésilaos, t'a envoyé le bonheur ? Ton visage respire la joie. Aurais-tu gagné cette gageure que tu fis, la semaine dernière, devant tes disciples, de convertir à la morale du Portique la courtisane Théodéta ? As-tu persuadé le vieil Epikouros de la nécessité d'étudier les sciences ? Ou bien, admire jusqu'où peuvent aller mes suppositions quand j'ai devant les yeux un philosophe qui sourit."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À CHARLES RENOUVIER
AU MAÎTRE
À L’AMI
Il faut que le dialogue philosophique soit un genre bien difficile pour n’avoir produit que rarement de ces chefs-d’œuvre dans lesquels le génie littéraire s’associe à l’explication et à la défense d’une forte thèse dont l’auteur n’entend abandonner aucun de ses avantages, ni prêter à ses adversaires des arguments trop spécieux, ou une vivante attitude de combat, capable d’intéresser le lecteur. C’est qu’à la difficulté déjà grande d’unir au raisonnement le sentiment indispensable à une œuvre d’art, et à l’argumentation la passion, il s’en ajoute une autre, très insidieuse pour le philosophe, et qu’il ne surmonte à peu près jamais, parce qu’il est toujours d’humeur trop dogmatique. L’auteur d’un dialogue philosophique, c’est-à-dire de l’imitation et de la fiction d’une controverse, s’il laisse voir son dogmatisme en ne sachant pas s’empêcher de dissimuler ou d’affaiblir les objections qu’il met dans la bouche d’un interlocuteur pour les combattre, manque à la première condition de l’œuvre d’art, le désintéressement. Il ne nous touche plus autrement qu’il ferait par l’exposition toute simple de ses pensées, son dialogue n’a plus le caractère esthétique.
Au fond, c’est même contre la philosophie, et non pas seulement contre une règle de l’art, que pèchent les dialogues dont les interlocuteurs ne présentent pas sincèrement et ne défendent pas dans leurs parties spécieuses, dans celles qui leur ont valu des adhérents, les doctrines dont l’auteur les prend pour les représentants. Il y aurait un grand avantage pour la méthode, pour le progrès des systèmes en précision et en exactitude, pour l’éclaircissement réciproque des principes dont dépendent les plus sérieuses opinions contendantes en philosophie, à ce que des œuvres de polémique philosophique, – et tels sont bien les dialogues, – eussent pour loi la plus franche présentation et la défense la plus intelligente possible des idées des adversaires auxquels l’auteur prête la parole. Il est vrai que le dogmatisme, ni celui qui se réclame de la révélation, ni celui qui prétend à l’évidence, ne peuvent aisément subir cette exigence esthétique, parce qu’il se mêle toujours une certaine mauvaise foi, de celle qu’on appelle intellectuelle, pour ne risquer pas de la calomnier, dans la manière dont un philosophe a coutume de traduire ou d’interpréter toute opinion qui n’est pas la sienne. Il y a une philosophie seulement, une seule, à laquelle il est possible, et qui peut du moins essayer, avec une bonne volonté parfaite, de pénétrer profondément, jusqu’à sa raison d’être, et de formuler dans ce qu’elle peut offrir de plus fort à un esprit en quête de vérité, chacune de ces doctrines principales qui ont régné ou qui règnent encore, plus ou moins transformées, dans le monde. Cette philosophie est le néocriticisme, parce que, ne regardant pas les vérités d’ordre transcendant comme susceptibles d’une démonstration proprement dite, sans pétition de principe, ou les premiers principes comme des objets d’affirmation nécessaire, irrécusable, elle cherche l’ultime appui de chaque doctrine dans une croyance demeurée toujours libre au fond. Les croyances fondamentales sont diverses et se classent comme mutuellement contradictoires. Il y a donc un intérêt supérieur à les reconnaître pour les étudier et approfondir les motifs logiques et moraux de préférer les unes aux autres.
La position du néocriticisme, à l’encontre des systèmes courants qui, soit ouvertement, soit comme il ressort de l’apparence qu’ils se donnent par leurs façons de s’exposer et de se défendre, prétendent à l’irrésistible démonstration, est celle d’une philosophie critique prise en un sens qui commence à peine à être compris en philosophie : celui d’une investigation conduite à des conclusions fermes. Et observons, en passant, que ce criticisme diffère essentiellement du criticisme kantien, car l’auteur de la Critique de la Raison pure se déclarait dans l’impuissance d’arriver à des conclusions dernières, simples et nettes, à l’aide des mêmes méthodes, du même principe et du même genre de raisonnements dont il usait et auxquels il se fiait naturellement dans le cours des deux critiques principales, et dans l’examen des deux raisons. Le néocriticisme conserve l’unité de la raison et ne consent ni à l’opposer à l’entendement, ni à lui trouver différentes ; lois, suivant qu’il s’agit de la théorie ou de la pratique. Ainsi volontairement placé sur le terrain le plus commun des motifs, tant logiques que moraux, apportés de divers côtés pour justifier des opinions, le néocriticisme manquerait son but, et sa méthode resterait confondue avec celle des plus ordinaires controverses entre dogmatiques, s’il ne mettait pas son effort à se rendre compte des raisons d’être mentales, et des ressources d’argumentation disponibles, pour les différentes causes, comme pour la sienne propre. Il doit pénétrer consciencieusement le tréfonds des doctrines contre lesquelles il ne peut se prononcer comme par une sorte d’arbitrage qu’après qu’il a atteint et reconnu les points où réside leur plus grande force.
La philosophie, ainsi comprise, devient inséparable de l’histoire de la philosophie, par cette simple raison, que, si l’on considère le petit nombre des thèses par lesquelles chaque doctrine notable réclame ce qu’elle a de valeur rationnelle et d’intérêt moral, les mêmes affirmations et les mêmes négations se sont produites et se sont opposées contradictoirement, à chaque époque de grande culture humaine, autant que l’autorité en a permis l’expression publique. On ne saurait dire qu’aujourd’hui encore, malgré le nombre et la diversité apparente des questions, et les variations de la terminologie, il se pose pour nous d’autres problèmes d’ordre fondamental en métaphysique et en psychologie, dont les solutions partagent les esprits, et auxquels toute connaissance transcendante reste suspendue, que ceux qui divisaient, au temps de Jules César, les académiciens et les aristotéliciens, les stoïciens, les épicuriens et les sceptiques.
On comprend par là ce que devrait être le genre du dialogue philosophique adapté au service du néocriticisme et de ses démonstrations ; il faudrait que tous les interlocuteurs s’y montrassent également intelligents et vivants, et défendissent jusqu’au bout leurs opinions. Le lecteur de la feinte dispute devrait être, comme un spectateur de drame ou de comédie, laissé libre de tirer lui-même la moralité de la fable, d’après les impressions qu’il reçoit de l’œuvre d’art, et non point soumis en esclave à la décision du penseur qui se suscite l’apparence d’un contradicteur, en ne lui prêtant que juste ce qu’il faut de mots pour acquiescer, ou pour préparer sa propre défaite.
Les philosophes illustres du XVIIe siècle, quand ils ont abaissé leur génie dogmatique à cette forme de démonstration, étaient dans un état d’esprit peu éloigné de celui des auteurs de catéchismes, et ne croyaient pas possible, ou, en tout cas, utile, de donner de la vraisemblance et de la vie à des discours qui n’auraient pu, suivant eux, qu’encourager l’erreur. Berkeley seul, parce qu’il vivait à un moment où la libre-pensée, en Angleterre, attaquait avec animosité les croyances théologiques et se répandait beaucoup dans la classe instruite, a reproduit assez exactement, dans son Alciphron, les opinions, hostiles à la religion et au clergé, de ceux qu’il appelait les petits philosophes ; et, en les réfutant, il a bien fait sentir, à quelques endroits, la passion qui les animait, et la sienne propre, inspirée par sa foi religieuse. Dans ses Dialogues d’Hylas et de Philonoüs, œuvre d’argumentation admirable, on ne peut pas dire qu’il ait présenté et formulé, ni réfuté, par conséquent, la véritable et puissante raison de la croyance naturelle à l’existence du monde extérieur, en dehors des doctrines métaphysiques sur la nature de ce monde. À cet égard, Hylas, l’adversaire de la doctrine de Berkeley, se montre polémiste insuffisant et médiocrement intelligent. Mais si l’on consent à ne voir en ce personnage que le défenseur de la matière, comme substance, dans l’acception et selon les arguments communément reçus, on peut certainement louer Berkeley d’avoir écrit un chef-d’œuvre dans ce genre de dialogue que nous essayons de définir comme le mieux adapté à la méthode néocriticiste.
Nous ne croyons pas qu’on puisse citer aucun autre ouvrage, ou du XVIIIe ou du XIXe siècle, dans lequel une importante question de philosophie soit traitée dans cette forme, à la fois avec sérieux et avec une suffisante compréhension des principes diversement invoqués pour le traitement des questions. Au contraire, il serait facile d’en rappeler quelques-uns, de ces deux époques, dans lesquels le mérite littéraire est éminent, mais où la satire remplace la doctrine, et l’imagination la dialectique. Nous avons nommé Denis Diderot et Ernest Renan.
La profondeur, la sincérité, l’indépendance d’esprit, l’étendue de la pensée, la puissance des conceptions, le génie esthétique de création des formes vivantes, la foi morale dominant le tout seraient les qualités nécessaires pour atteindre la perfection du dialogue philosophique, tel que nous le comprenons. Nous ne devons pas nous étonner qu’il faille remonter jusqu’à Platon pour rencontrer le philosophe qui en a approché. Et pourtant lui-même s’est le plus souvent contenté, comme on sait, de faire face aux coryphées de ses dialogues par des demi-muets dont tout le rôle est de couper le discours par des mots d’approbation bénévole, ou de recevoir par suggestion des idées, et puis d’autres, qui les mènent peu à peu à se contredire faute de s’être aperçus à temps des pièges où ils allaient tomber. L’enchantement de la dialectique, méthode alors nouvelle, l’embarras des définitions psychologiques, si difficiles à fixer, entre le vague et les équivoques, les rapports variables des idées dans le commun langage, et l’exigence scientifique de la méthode d’analyse imaginée par Socrate, enfin cette confusion des questions qu’il eût fallu diviser pour les éclaircir, et que la logique, encore si tâtonnante avant Aristote, laissait se mêler, telles sont les raisons qui nous expliquent les formes volontairement subtiles, et les longueurs fatigantes, et l’absence ordinaire de conclusions formulées, ou même qui puissent l’être, dans les dialogues platoniciens, et la difficulté de traduire les termes grecs en une terminologie philosophique moderne, fixe et cohérente, qui exprime exactement les mêmes rapports.
Platon, qui n’était pas seulement un philosophe, mais un grand poète en philosophie, est parvenu, en surmontant avec une grâce infinie qui a fait l’admiration des siècles, les difficultés d’une méthode aussi peu assurée. Il a su éviter le dogmatisme, tant affirmatif que négatif, en se montrant bien instruit des points forts et des raisons d’être des doctrines dont il a combattu les vues exclusives, – l’éléatisme, d’un côté, l’héraclitisme, de l’autre, – et en donnant une idée approfondie de leurs principes. Il a réfuté les sophistes dans la partie immorale de leur enseignement, et fait ressortir, dans leur dialectique, cette aveugle négation des idées générales qui réduit la connaissance à un empirisme hors d’état de se formuler lui-même. Les doctrines les plus contradictoires étaient de tous côtés en lutte à cet extraordinaire moment où elles se sont en quelque sorte nouées pour toute une suite de siècles, après la mort de Socrate. Celles qui se sont attirées la qualification de sophistiques, en un sens alors nouveau et défavorable, présentaient, dans la répudiation systématique du devoir, dans l’éloge de l’égoïsme et des beautés et des grandeurs de la force triomphante, dans le mépris que mérite la faiblesse écrasée, un caractère dont notre époque aussi commence à voir une forme nouvelle apparaître chez nos sectes littéraires décadentes, et chez quelques soi-disant philosophes. Platon a rendu en traits d’abord tout dialectiques, et puis progressivement vivants et passionnés, ce caractère, dans les personnages de son Gorgias, et il n’a pas laissé de partager sur l’instabilité des phénomènes et le néant, pour ainsi parler, du monde de l’expérience, la manière de voir de l’une des principales de ces sectes de sophistes que l’on se plaît souvent à croire qu’il n’a fait que combattre. La doctrine transcendante des idées en soi, et, sur d’autres points où la dialectique n’atteignait pas, la théorie de la création démiurgique, et les mythes, sortes d’hypothèses proposées pour tenir lieu avec vraisemblance de l’inaccessible vérité pure, formaient la grande réserve où Platon tenait renfermées les solutions des questions dont on avait à regretter l’explication définitive ou la preuve, dans les dialogues où elles étaient discutées.
En résumé, nous pouvons dire que Platon a donné place dans son œuvre à la représentation des traits les plus généraux des doctrines de son temps, quoiqu’il ne nous ait point instruit, comme devait le faire Aristote, de beaucoup de traits particuliers et curieux des anciennes philosophies ; non plus d’ailleurs qu’il ne devait être, comme lui, pour la postérité la plus reculée, le grand maître de la logique et le modérateur de l’esprit scientifique toujours enclin à se rapprocher de l’expérience ; mais il prit la tête des plus hautes pensées pour toute la suite des temps. Son école put devenir voisine du scepticisme, à un certain moment de l’antiquité, sur des points de méthode principalement, parce que la doctrine des idées n’étant ni clairement fondée dans son acception ontologique, ni psychologiquement construite, ne fournissait pas un principe de certitude ; parce que la théorie de la création démiurgique semblait aux philosophes plus symbolique que philosophique, et parce que la thèse de l’immortalité se justifiait par des mythes moraux, et s’expliquait par des métensomatoses, plutôt qu’elle ne revêtait une forme rationnelle, reliant le monde sensible aux idées purement intelligibles : mais le « divin Platon », obscur pour ses contemporains, n’en est que mieux devenu, et il est resté comme l’universel représentant, à travers toutes les phases du mouvement philosophique, du spiritualisme et de l’idéalisme en leurs transformations, et, dans une acception générale, de tous les efforts de la pensée pour élever la connaissance au-dessus de l’empirisme. On y embrasse, depuis les réminiscences des intuitions d’un monde primitif, depuis les idées innées et les vérités éternelles et nécessaires, jusqu’aux concepts synthétiques du pur entendement, et jusqu’aux noumènes situés hors du temps et de l’espace : les idées en soi, dont le monde reçoit les imparfaites images, les idées divines transmissibles, qui descendent pour constituer, d’espèce en espèce, dans l’individuel l’essence de l’universel, et les idées intelligibles qui nous sont visibles en Dieu, et même les idées sensibles, dont l’auteur est Dieu, qui les fait percevoir aux esprits sous la forme d’un monde où ils ont leur vie et leurs communications. D’un côté, avec l’émanation de l’Un, suivie de celle de l’Intelligence, le Démiurge, la chute des âmes ; de l’autre, avec la création e nihilo, les vertus divines partout présentes dans le monde, la chute d’Adam, la révélation du Logos, la descente de l’Esprit saint, c’est une doctrine réaliste qui fait corps contre les méthodes qui, n’admettant pour la connaissance de la réalité d’autres enseignements que ceux de l’expérience, ne peuvent la dépasser pour expliquer le monde à l’homme et l’homme à lui-même. Quand un néoplatonicien de la Renaissance, ou même certains philosophes anglais du temps de Berkeley, lisaient les Dialogues de Platon, ils ne croyaient pas y trouver des doctrines bien différentes de celles de Plotin. Et quand un chrétien comme Dacier, ou même encore comme l’abbé Grou, les traduisait, il pensait y reconnaître les dogmes du christianisme, un peu altérés seulement à certains endroits ; et Victor Cousin, à un autre point de vue, a paru croire que le vrai fruit à tirer de leur lecture était la confirmation du spiritualisme, tel que lui-même l’entendait.
Platon a conservé avec un art merveilleux, dans l’examen des méthodes hostiles au socratisme, et dans l’exposition de ses propres vues, même en ce qui touche la doctrine des idées, une certaine indétermination excluant les formules définitives, et il a eu de grandes, de sublimes échappées de théorie sur les origines morales, la constitution intelligible du monde, l’amour, la beauté, la divinité, sans que fût prononcé nulle part dans les Dialogues le dernier mot qui aurait formé de ce vaste ensemble un édifice rationnel achevé. Ce caractère unique offre, en la personne de Platon, un personnage à introduire hardiment en de nouveaux dialogues, et à traiter avec la même liberté que lui-même a traité son maître Socrate, auquel il a prêté tant d’idées auxquelles celui-ci n’avait certainement jamais songé. Le but serait analogue, c’est-à-dire que, de même que Platon entendait développer sous cette forme les pensées qu’il avait conçues et qu’il regardait sans doute comme le fruit semé dans son génie propre par le génie de Socrate, de même un philosophe néocriticiste se proposerait aujourd’hui, s’éclairant des lumières acquises en psychologie et en métaphysique depuis Platon, de présenter sa doctrine à l’état d’achèvement, telle qu’il aurait pu la construire en restant fidèle à ses tendances générales, et en découvrant les formules définitives et les arguments d’une logique inattaquable à opposer à ses adversaires, s’il avait délivré son esprit de l’obsession de la philosophie éléatique de l’être absolu.
Le platonisme ainsi interprété, ou pour mieux dire achevé, élevé à l’entière rationalité de ses propres vues, et porté à la perfection de celles qu’il a cherchées pour la révélation du monde moral, pourrait s’appeler le Mystère de Platon, et aurait de réelles analogies avec la doctrine cosmogonique et eschatologique de la personnalité, qui s’offre dans le néocriticisme comme la conclusion des analyses entreprises pour la constitution de la croyance rationnelle. C’est le plan que M. L. Prat s’est proposé et dont il commence l’exécution dans un premier dialogue historique dont la scène est le Jardin d’Académos, au temps de la vieillesse de Platon, et les interlocuteurs, des penseurs à vues très divergentes réunis autour de lui pour la célébration d’un certain anniversaire socratique. La controverse, largement ouverte à tous les amis de la grande mémoire, est le digne culte voué à l’incomparable héros de l’argumentation. L’auteur l’a traitée avec ce haut désintéressement esthétique qui convient à la méthode néocriticiste, telle que nous venons de l’expliquer. Il a montré le platonisme en opposition avec les systèmes que l’esprit platonicien avait à combattre, et il a conservé à chacun des personnages mis en présence ses idées et sa physionomie propre, en s’appliquant à prêter à chacun toute l’intelligence et toute la force possible dans le maniement des arguments favorables à sa cause. Il a décrit de véritables conflits d’idées luttant pour l’existence. La philosophie ainsi vue dans son histoire, à des moments bien choisis, ne se forme plus seulement de systèmes, d’abstractions coordonnées, mais de drames, d’opinions actives qui attaquent et se défendent avec les sentiments et les passions qui les doivent naturellement accompagner. C’est la philosophie vivante.
Les questions qui, à toute époque, dominent les autres, et déterminent leurs solutions par les leurs, aux yeux du penseur qui les reconnaît sous leurs formes changeantes, ces questions demeurant les mêmes, il est aisé de transporter dans les débats des anciens philosophes celles qui s’agitent dans les sociétés modernes. Il ne s’agit, à vrai dire, que d’une sorte de transposition par laquelle des termes qui, à travers une suite de modifications logiques ou grammaticales, nous sont venus à la place de ceux dont l’antiquité usait pour rendre des idées pareilles aux nôtres, ou voisines, ou analogues, soient employés en des acceptions vraisemblablement acceptables pour les personnages qu’on fait parler, en des cadres de doctrines et de discussions, avec des incidents d’où ressortent des similitudes piquantes. L’auteur du Mystère de Platon a pu, suivant cette méthode, faire discuter à des anciens la question de l’empirisme et du positivisme, en opposition avec la psychologie idéaliste a priori, et celle de la science considérée comme l’essentiel agent de la civilisation et du bonheur, d’une manière d’autant plus intéressante qu’il les a ainsi élevées a la plus haute généralité, et que la dernière surtout, prise du point de vue de l’antiquité, s’est trouvée soustraite a des causes d’illusion qui troublent aujourd’hui le jugement des deux côtés de la controverse.
Le personnage choisi pour être l’antagoniste de Platon, dans la querelle de l’empirisme et de l’apriorisme, est un jeune homme qui fut un temps son disciple, et qui, livré maintenant à des études spéciales, a pris en dégoût les spéculations philosophiques, qu’il traite d’irrationnelles et vaines en résultat, tandis qu’il voit les sciences d’observation grandir, toutes pleines de promesses pour l’utilité des hommes. Cet ardent adversaire des rêveries du vieux maître est Eudoxos de Cnide, géomètre et astronome, que l’histoire des sciences place à un rang élevé d’inventeur et rattache ordinairement à l’école de Platon. Ici, nous le voyons traiter sans respect, pour ne rien dire de plus, les preuves de l’immortalité de l’âme hasardées dans le Phédon, et opposer au genre d’argumentation peu scientifique employé dans cet illustre dialogue des objections assez fortes pour obliger Platon à reconnaître que ses démonstrations ne sont point apodictiques, qu’elles n’ont qu’une valeur relative à la condition intellectuelle des personnes auxquelles elles s’adressent. En présence d’un esprit plus exigeant, le philosophe n’abandonne pas seulement les symboles, il va jusqu’à ne plus chercher un appui sur l’existence de l’âme, – existence qui est déjà pour la preuve de l’immortalité une pétition de principe, – mais il s’élève jusqu’à l’idée la plus générale de l’entendement et de la conscience, ou personnalité, qui est en effet la condition fondamentale de toute connaissance. C’est au prix de cette transformation du concept de l’âme que Platon triomphe de la méthode empiriste d’Eudoxos, qui, pour soutenir sa cause, aurait à montrer comment de la sensation considérée dans l’objet et dans l’image, peut s’engendrer l’acte de sentir. Et c’est aussi la première des transformations dont l’auteur veut nous montrer la possibilité dans le développement historique de l’esprit platonicien.
Eudoxos ne donne pas son nom à ce premier dialogue ; il en déserte la scène à un certain moment sous le coup de l’indignation que lui cause l’exposition d’une doctrine théocratique, étrange, il est vrai, pour des oreilles grecques, et dont le porte-parole, que l’auteur a tenu à mettre en vedette, se pare d’un nom mythique lié aux traditions orphiques : Aglaophamos. Ce personnage curieusement inventé n’est pas un de ces orphéotélestes, très méprisés, que Platon a représentés (La Rép., I. II) assiégeant les maisons des particuliers pour leur enseigner les moyens d’expier leurs péchés, ou ceux de leurs parents décédés, et leur vendre à cet effet des amulettes, des indulgences, le mérite de certains sacrifices. C’est un théologien d’une tout autre portée, éloquent, inspiré, fanatique, narrateur de merveilles, un rêveur qu’à bien des traits de ses discours on prendrait pour un simple imposteur, si l’on ne le croyait plutôt fou, de ce genre de folie pour lequel on n’a pas encore inventé de nom particulier, ce qui fait que l’on confond quelquefois. Platon s’est intéressé à ce vieillard inoffensif, farouche en théorie seulement, qu’il a rencontré en Sicile et dont il a fait son hôte à Athènes. Une fois acceptée, la fiction dramatique à laquelle l’auteur a recours pour nous présenter le personnage d’Aglaophamos, se croyant ou se prétendant le prêtre d’un dieu inconnu aux Grecs, faisant remonter sa propre origine à l’âge des Héros divins, se disant en même temps venu, comme envoyé de ce dieu, d’un pays mystérieux, lointain, où il était revêtu de la suprême magistrature, il ne faudrait pas prendre pour une hypothèse invraisemblable l’existence, en Grèce, au IVe siècle avant notre ère, d’un penseur orientalisant, plus que socratique et plus que platonicien dans l’excès de son mépris pour une démocratie ignorante, incapable de gouvernement ; d’un rêveur ignoré, perdu au fond de quelque petit sanctuaire, qui aurait conçu l’idéal d’une corporation sacerdotale, semblable à celles qui chez plusieurs nations de l’Orient ont disputé l’autorité civile aux princes, différente de celles-ci seulement en ce qu’elle se guiderait exclusivement sur la justice et la sainteté pour la conduite du peuple, auquel elle assurerait le bonheur que seule peut lui donner l’entière soumission à des commandements divins.
La Grèce n’avait échappé que par une grande exception au sort commun des États où le régime théocratique fait prévaloir une notable partie de ses prétentions au gouvernement, dont cependant il ne parvient jamais à s’emparer totalement. La civilisation hellénique avait triomphé dans les guerres médiques. À une époque plus ancienne, l’esprit hellénique s’était refusé à suivre la voie commune des théocraties, voie ouverte cependant par un orphisme d’origine mal connue, que Pythagore et d’autres philosophes favorisèrent, au moins dans l’ordre spéculatif. Mais cet orphisme, qui n’avait pu se fonder comme religion de haute antiquité, tenta d’en conquérir le titre au moyen de traditions fictives et de la confection de poésies apocryphes, – c’est Platon qui nous l’apprend, – et resta, se mêlant plus ou moins à d’autres mystères, le représentant dans la Grèce d’une religion qu’on cherchait, capable de ramener à unité les mythes et le culte du polythéisme, et de conférer aux prêtres tout ce qui peut appartenir de pouvoir aux possesseurs de la science sainte et aux distributeurs des grâces divines.
L’auteur du Mystère de Platon donne à représenter à son Aglaophamos un système d’opinions religieuses qui, ainsi délimité, n’a réellement rien d’impossible pour l’époque où il le place, et il s’en sert pour faire discuter entre le révélateur prétendu, le positiviste par anticipation, Eudoxos, et Platon lui-même, ainsi forcé de se poser en défenseur du libéralisme, des questions dans lesquelles on reconnaît sans peine, d’un côté, les principes catholiques et les arguments catholiques, unis à ceux d’un socialisme autoritaire absolu, de l’autre, la revendication de la liberté de l’esprit. Il faut ajouter qu’en métaphysique, en théologie, Aglaophamos apporte dans le débat des idées qui anticipent historiquement, d’une façon bien naturelle pourtant, sur celles qui devaient présider au platonisme six siècles après Platon, et au christianisme dans ce que le christianisme a eu de commun avec ce platonisme. Quel que soit son éloignement des idées ordinairement discutées dans l’Académie, cet interlocuteur trouve dans son point de vue particulier de visionnaire des arguments qui ne sont pas sans prix pour l’imagination, contre le système qui, investissant la science de la fonction moralisatrice essentielle des hommes, fait d’elle aussi l’ouvrière du bonheur.
Enfin un dernier personnage donne de la vie au dialogue, dont sa fantaisie usurpe à certains moments la direction, contrairement aux droits consacrés du chorège : c’est Kalliklès, lui, le plus rude antagoniste de Platon dans le Gorgias, vieux maintenant, et son grand ami, passé de l’ardeur sophistique, et fort insolente, de sa jeunesse au caractère ironiste et universellement bienveillant. Ce changement d’humeur se traduit, chez cet interlocuteur, par beaucoup de curiosité mêlée à beaucoup d’incrédulité, un fonds de confiance exclusive dans le solide terrain de l’expérience, mais un goût bien décidé pour les jouissances esthétiques, les seules qui donnent, selon lui, un réel intérêt au spectacle des choses et à la lutte des idées. Il n’est pas interdit au lecteur de trouver, dans les traits de fantaisie de ce Kalliklès, certaines allusions aux opinions de vieillesse d’un illustre écrivain de notre temps, qui a laissé d’assez nombreux disciples.
C. RENOUVIER.
ARKÉSILAOS – TIMON LE SILLOGRAPHE (au jardin d’Akadémos).
Quel dieu, mon cher Arkésilaos, t’a envoyé le bonheur ? Ton visage respire la joie. Aurais-tu gagné cette gageure que tu fis, la semaine dernière, devant tes disciples, de convertir à la morale du Portique la courtisane Théodéta ? As-tu persuadé le vieil Epikouros de la nécessité d’étudier les sciences ? ou bien, admire jusqu’où peuvent aller mes suppositions quand j’ai devant les yeux un philosophe qui sourit, as-tu découvert le puits fameux où, si l’on en croit Démokritès d’Abdère, la Vérité demeure cachée ?
Non, Timon, et tu t’éloignes de la vraie cause le plus possible. Théodéta est retournée à Élée. Elle a moins de goût pour la philosophie que pour les philosophes, et ma gageure est perdue ; Epikouros reste convaincu que le soleil est de beaucoup plus petit que le Péloponèse ; enfin, tranquillise ton esprit : je n’ai pas rencontré la Vérité. Elle se dérobe à toutes nos recherches, mon cher ami, et pour moi, je me console en me persuadant que c’est chose plus agréable de chercher la Vérité que de la tenir. Serais-tu d’un avis opposé ?
Je me refuse à toute discussion, Arkésilaos, tant que tu t’obstineras à laisser en suspens l’esprit curieux d’un philosophe zététique. Je veux savoir la cause de ta joie, et je vais faire des suppositions de plus en plus étranges jusqu’au moment où tu m’arrêteras pour me dire : à toi le gage !
Tu chercherais trop longtemps ; je préfère te donner de suite le mot de l’énigme. Je suis heureux parce que j’ai découvert l’esprit de Platon.
L’esprit de Platon ?
L’esprit de Platon. Ma découverte t’étonne ?
Rien ne m’étonne. Je ne suis pas surpris mais un peu inquiet, et je me demande si, au moment où tu trouvais l’esprit de ton maître, tu ne perdais pas le tien.
Toujours plaisant, mon cher. Sois rassuré ; il est probable que j’ai encore aujourd’hui le peu de raison que j’avais hier. Écoute : connais-tu Poséidon ?
Le dieu armé du trident ?
Non, le scribe qui demeure sur le chemin du Pirée.
Je le connais très certainement ; il a fait trois copies de mes Silles. C’est le scribe le plus exact que jamais ait enfanté Athènes. Il est stupide comme un bœuf, et si attentif, quand il est à son ouvrage, qu’il ne commet jamais de fautes.
C’est bien le personnage. Tu sauras donc, mon cher Timon, que notre Poséïdon, le successeur et l’héritier du scribe Polémon qui mourut l’année dernière, est, présentement, possesseur de quelques manuscrits des anciens philosophes. Je suis allé, avant-hier, dans sa maison, pour acheter le traité du Ciel et le traité de l’Âme d’Aristotélès. Pour les deux manuscrits, il m’a réclamé trois mines. Je ne suis point avare, mais j’estimai le prix exagéré, et comme je me récriais : « Tu as raison, me dit-il ; je ne donnerais pas, moi, trois drachmes pour les deux traités ; mais de son vivant, mon maître Polémon en avait fixé la valeur à trois mines, et Zeus m’est témoin qu’à moins que tu ne paies trois mines les manuscrits ne quitteront pas les tablettes. Au demeurant, examine. Ce ne sont pas les traités des philosophes qui manquent dans la bibliothèque. Tu peux choisir ; je te donne par-dessus le marché celui que tu voudras emporter, et fassent les dieux que tu trouves un trésor parmi ces grimoires. Mais, j’en doute. Polémon, qui avait le nez creux, m’a assuré qu’ils étaient méprisables. »
Aurais-tu trouvé ce trésor, Arkésilaos ?
Sois-en juge, mon cher ami. Je commençais à craindre d’avoir perdu mon temps. Quel fatras ! Il y a là toutes sortes de volumes, des grands et des petits, tous traitant des problèmes philosophiques. Je déroulais, je lisais quelques lignes et j’enroulais aussitôt. Une courte expérience suffisait à me renseigner sur la sottise de l’auteur. J’allais abandonner toute recherche quand j’avisai, sur la tablette des livres de rebut, un volume assez gros que de plus gros cachaient. Le titre qui, sur le dos du livre se détachait en grandes lettres, m’étonna :
L’ÉGLISE SOCRATIQUE – LE MYSTÈRE DE PLATON
Je le pris avec les deux petits traités du Stagyrite et je payai Poséïdon, qui me regarda partir avec un air plus hébété que de coutume.
J’ai lu le Mystère, Timon ; il m’a révélé la pensée du maître. Cette pensée, j’en soupçonnais l’existence et je l’avais comme entrevue sous les symboles et les mythes des dialogues. Mais combien mon attente a été surpassée ! La doctrine de Platon prend là son essor et s’élève tellement au-dessus de la commune mesure de l’intelligence des hommes qu’il n’est qu’une parole qui la puisse caractériser : elle est digne d’un dieu.
Je ne saurais dire mon étonnement, Arkésilaos ; tu me parais, à présent, plus religieux que le portefaix Kléanthès alors qu’il explique à ses auditeurs la raison séminale des choses.
C’est qu’il faut être religieux, Timon, en présence d’un sanctuaire.
Voilà qui m’étonne encore davantage s’il est possible. Toi, Arkésilaos, comme moi disciple de Pyrrhon, que tu dis honorer à l’égal de Platon lui-même, tu te déclares le prêtre d’un nouveau dieu ! Je me demande anxieusement, mon cher ami, si tu ne veux pas te jouer de ma crédulité.
Ce manuscrit existe-t-il d’abord, et, s’il existe, qui pourra me persuader que ton vrai Paton n’est pas un pseudo-Platon ?
Le manuscrit existe, Timon, et je puis te le montrer. Quant à te persuader qu’il renferme la doctrine véritable de mon maître, je ne le saurais, puisque tu es déjà persuadé de l’impossibilité que tu sois jamais persuadé.
Essaie tout de même. – Platon, n’est-il pas vrai, n’est point l’auteur de ce volume ? Quelle que soit la sottise des scribes, un manuscrit de Platon ne serait pas resté si longtemps ignoré.
Platon n’est pas l’auteur. C’est un disciple et aussi un admirateur de Platon qui a écrit le dialogue. On voit qu’il s’applique à imiter la grâce aimable et étudiée, l’art délicat et si subtil du maître incomparable. Ai-je besoin d’ajouter qu’il n’y réussit qu’assez mal ? Mais l’auteur, et c’est là ce qui fait à mes yeux l’intérêt du Mystère, décrit ce qu’il a vu, répète ce qu’il a entendu ; c’est un témoin de bonne foi et qui comprend la portée des thèses qu’il expose. Qui est-il ? je l’ignore. C’est le porteur de la bonne nouvelle qui dit son mot et disparaît à jamais. Il a été initié à la doctrine cachée de Platon et, malgré Platon peut-être, il nous initie au Mystère.
Se pourrait-il qu’un Platon existât, inconnu de nous ?
Il existe, mon ami, et sa doctrine plus que celle que nous avons jusqu’à ce jour acceptée comme la sienne, serre de près la vérité. Elle ne se contente pas de discuter les problèmes, elle les résout. Si la vérité est quelque part, Timon, la vérité que peut atteindre l’intelligence des hommes est là. Le Mystère de Platon, d’ailleurs, n’est assimilable en rien aux mystères sacrés.
Durant des années, chaque fois que revenait le jour anniversaire de la mort de Sokratès, la plupart de ceux qui avaient écouté ses sages discours, des disciples, quelquefois des adversaires, se rencontraient dans le jardin d’Akadémos afin d’honorer la mémoire du père de la philosophie. Ils s’asseyaient sur un tertre, à l’ombre d’un platane, tout près de la statue d’Éros. Ils disputaient entre eux, s’interrogeant et répondant selon la méthode de recherche qu’ils tenaient du maître. Ils s’appliquaient, en ces réunions, à résoudre quelqu’un des problèmes où, de tout temps, s’est complu le génie des philosophes. Leurs idées paraissant étranges et nouvelles aux quelques Athéniens que la curiosité avait attirés, on disait d’eux qu’ils célébraient le Mystère de Platon. Tu vois, mon cher Timon, que le Mystère de Platon n’est pas un mystère.
Et je m’en réjouis, Arkésilaos. Je suis trop vieux maintenant pour être initié.
Es-tu de loisir ?
Toujours quand je veux l’être ; ne suis-je pas philosophe ?
Plus que tu ne voudrais le paraître. Tu ressembles, Timon, à des amants que je connais, qui se vantent de commander à la beauté dont ils sont les esclaves les plus soumis.
Vois-tu, au fond de la première allée, ce platane majestueux ? C’est le plus beau du jardin. Bien des fois, à son ombre, nos anciens philosophes se sont réunis pour discuter et discourir. C’est au pied du platane d’Akadémos, puisque ce beau jour t’appartient, que nous irons nous asseoir et lire le précieux manuscrit. Nous ne saurions choisir un endroit plus commode. Le Képhysès, qui coule tout proche, enverra jusqu’à nous la fraîcheur de ses eaux avec le délicat parfum des lauriers-roses, et, bercés par le doux chant des cigales, nous essaierons, en vrais philosophes, de pénétrer jusqu’à l’âme de la doctrine du vrai Platon.
EUDOXOS DE KNIDE – KALLIKLÈS D’ATHÈNES
Par Pollux, vénérable Kalliklès, j’ai cru un moment que je ne pourrais te rattraper ; ta démarche n’est pas d’un philosophe âgé mais d’un jeune homme !
C’est que je suis pressé, Eudoxos.
Serais-je importun ?
Non, mon ami. Mais, de grâce, ne prenons pas l’attitude de l’Hermès de bronze qui semble prêt à s’envoler et qui reste immobile. J’ai affaire au jardin d’Akadémos. Sois mon compagnon de route ; tu me diras, chemin faisant, ce que tu veux me dire, et tu prêteras à ma main l’appui de ton épaule robuste.
Je voulais t’offrir mes bons souhaits d’abord, et, ensuite, te demander ton avis sur un dogme de Platon que j’ai étudié dernièrement. Connais-tu le Phédon, les arguments de Sokratès en faveur de l’immortalité de l’âme ?
Comment ne les connaîtrais-je pas ?
Ils me semblent absurdes.
Absurdes ?
Oui, et je le démontrerai.
C’est que les dieux, mon ami, t’ont doué d’une âme peu commune et hardie, et ton audace est noble. Platon, tu ne l’ignores pas, a toujours été pour mes pensées un adversaire irréconciliable ; mais nous disputons depuis si longtemps que nous avons fini par nous aimer. Les dieux me sont témoins que je suis, le plus possible, éloigné de son dogme, mais je suis contraint d’avouer qu’il a hérité du génie de son maître Sokratès, et qu’il a vaincu Protagoras et Gorgias, pour ne citer que les plus habiles au combat des idées. Prends garde ! Convaincre Platon d’absurdité est une rude tâche et qui n’est pas sans péril. C’est un beau danger que tu vas courir.
Pourquoi te moquer, Kalliklès ? Platon est à Syracuse hors de portée de mes arguments.





























