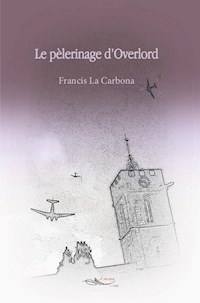
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
1984, dans le petit village bas-normand de Colleville-Montgomery, une succession de circonstances réunit une femme et un homme qui ont eu vingt ans pendant le deuxième conflit mondial. Quarante ans ont passé depuis le D-Day, Barbara et Matthias vont s’immerger dans “leur” guerre à l’occasion de la première célébration internationale du Jour le plus long. Commence alors un vertigineux plongeon dans une tranche d’existence où se côtoyaient les abnégations, les trahisons, les amours ; les résistances et les renoncements aussi. Comme tous ceux qui en ont réchappé, ils ont pris des virages et des directions qu’ils n’avaient pas prévus. Empêtré à jamais dans son secret, le bien vieux Baptiste va être l’involontaire cheville ouvrière d’une extravagance du destin. Quelque chose comme l’appendice d’une histoire mise entre parenthèses pendant quatre décennies.
À PROPOS DE L'AUTEUR
« Raconter une histoire, c’est partir sur un chemin jalonné de mots que l’on cueille, parce qu’ils se révèlent à l’intrigue et la font se façonner au fur et à mesure que l’on avance dans la construction. » C’est en ces termes que, bouclant son troisième roman,
Francis La Carbona affine son rapport à l’écriture. Dans sa Normandie d’adoption qui filigrane son ouvrage, il avoue un bien-être à cet exercice qui l’emporte sur l’amusement des débuts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francis LA CARBONA
Le pèlerinage d’Overlord
Du même auteur
– Noir soleil
5 Sens Editions, roman, 2020
– Esmeralda n’aimait pas Quasimodo
5 Sens Editions, roman, 2018
AVERTISSEMENT
Si les personnages de ce roman sont purement imaginaires, de nombreux décors sont constitués de ces villages bas-normands dans lesquels les premiers soldats du D-Day ont commencé d’enfoncer les lignes allemandes en juin 1944. Ainsi, parmi ces hauts lieux de la Deuxième Guerre mondiale, pourra-t-on arpenter les ruelles du bourg de Colleville-sur-Orne, renommé Colleville-Montgomery le 30 septembre 1944 en l’honneur de l’action des troupes de son libérateur sur la plage de Sword Beach, le jour du Débarquement.
CHAPITRE 1
Çà et là, le ciel pesant semble ramper sur le sol. On dirait une procession de baudruches aux boursouflures informes, sales, fissurées en plusieurs endroits. Certains de ces œdèmes en suspension égratignent leur camaïeu gris, presque noir, sur la cime des arbres, laissant suinter un crachin droit, régulier. Cela fait cinq jours que ces mastodontes arrosent copieusement la campagne bas-normande. Marquant de rares pauses, ils n’autorisent cependant pas la moindre percée du soleil, ni ne permettent à la lune de vaporiser ses poussières nocturnes orangées. Au sommet du clocher de l’église romane, les gargouilles vomissent à gros bouillon. Le mois d’avril est sur le point de tirer sa révérence, tout le village est poisseux d’une humidité ambiante qui s’insinue partout, donnant la sensation que l’hiver ne cédera pas sa place.
Dans le bourg tranquille de Colleville-Montgomery, on se croise, on se salue d’un signe furtif lorsque l’on devine un profil familier sous la capuche d’un imperméable ou sous un parapluie ruisselant, mais on ne musarde pas.
Barbara Chenant remonte la Grande Rue, tête baissée, les paupières à peine entrouvertes pour tenter de filtrer l’averse qui cingle son visage. Elle rase ces pierres multi-centenaires croyant entendre, par instants – sensation maintes fois éprouvée qui lui arrache un sourire –, quelque voix s’échapper des jointements ravinés par les années se mêlant au bruit de la pluie pour lui susurrer des bribes du passé. Au loin, à une cinquantaine de mètres, elle voit la silhouette cassée du vieux Baptiste Bredon qui pénètre de sa démarche hésitante dans la boutique du boulanger. Le bonhomme de quatre-vingt-dix printemps n’a pas vu sa bienfaitrice qui, sur les midi, ira le visiter dans sa maisonnette à la sortie de la commune, rue des Marronniers.
Bientôt quatre ans qu’elle mitonne ses déjeuners, l’écoutant, pendant ce temps, lui distiller les nouvelles du coin glanées dans les pages intérieures de son journal Ouest-France. Cet intermède quotidien suffit au bonheur du vénérable doyen dont la sollicitude de Barbara adoucit le crépuscule. Un jour, peut-être, lui donnera-t-elle les raisons profondes de cet altruisme manifesté quelques semaines, à peine, après avoir retrouvé sa terre calvadosienne, quittée pendant pas moins de trente-cinq ans.
– Je pourrais m’occuper de vous, si vous le souhaitez, Père Bredon, lui avait-elle simplement proposé.
Lui, tout heureux, avait fait ni une ni deux et acquiescé à ce chambardement en mettant cette offre de service sur le compte de la fidélité à leurs histoires imbriquées. Ami d’enfance de Marie-Louise, sa mère, il connait la gamine depuis son premier cri. Bien sûr, il y a eu cette longue éclipse pendant laquelle ils se sont perdus de vue après les bombardements du 6 juin 1944. L’habitation des Chenant malencontreusement endommagée aux trois quarts par un char Sherman, Barbara et Marie-Louise – veuve depuis le début de la guerre – avaient dû se résoudre à accepter un asile temporaire chez des cousins, dans la région tourangelle. Très entourées par leur famille, elles avaient rapidement adopté leur nouveau havre de paix. Pensant y oublier la parenthèse cauchemardesque du nazisme, elles s’y étaient même installées.
Néanmoins, parce que la persistance des racines est parfois surprenante, sa mère étant partie à son tour pour l’au-delà, Barbara avait fini par faire droit à une irrésistible envie de ressourcement, longtemps plus tard.
Mais, tandis que la bruine redouble en cette fin de matinée, il n’est qu’une interrogation pour la jeune retraitée : le facteur aura-t-il apporté le courrier qu’elle attend ? Elle force son allure. Derrière la vitrine embuée qu’elle dépasse, elle aperçoit Baptiste qui, comme à son habitude, montre d’un doigt gourmand à la commerçante une des pâtisseries appétissantes à laquelle il ne renoncerait pour rien au monde. Elle bifurque sur la droite, route de Caen, avant de s’engager rue du Tour de Ville. Encore quelques pas, puis elle ouvre fébrilement la boîte à lettres. Dedans, une enveloppe avec un timbre à l’effigie de Sa Très Gracieuse Majesté.
Barbara sourit, protège la missive des gouttes d’eau, se dépêche de tourner la clé dans la serrure de la porte du cellier pour se mettre à l’abri. Elle se débarrasse de son vêtement dégoulinant, l’accroche à la patère sous laquelle elle étale une serpillière, puis va déposer la missive sur le guéridon. Elle la couve du regard deux ou trois secondes. Les yeux dans le vague, elle s’interdit de la décacheter tout de suite, craignant de faire faux bond à son bon Père Bredon en s’abandonnant à l’allégresse enfantine qui l’envahit. Car elle n’en doute pas : Matthias Travisloane lui annonce, enfin, qu’il sera bientôt là.
Elle range machinalement ses quelques achats et songe qu’à son âge son impatience de découvrir un homme qu’elle n’a jamais vu a quelque chose d’incongru. Toutefois, cela n’émousse pas son plaisir. Leur amitié épistolaire de quelques mois est née d’une convergence de circonstances qu’ils ont attribuée à l’espièglerie du destin. Entamée avec circonspection par l’un et l’autre, leur relation s’est peu à peu affermie, affranchie des barrières de la retenue grâce à ce passé aux multiples similitudes qu’ils se sont raconté. Malgré cette connivence qui s’est imposée subrepticement à eux, ils ne se sont pas départis de l’authenticité des mots qui, curieusement combinée à l’éloignement et à l’absence, ont constitué un socle inébranlable. Un attachement particulier s’en est forgé.
Méditative de longues minutes, Barbara se rudoie. Après avoir préparé son propre repas qu’elle réchauffera à son retour, elle sort de nouveau pour rejoindre son protégé. Probablement doit-il être, déjà, en train de surveiller la rue en écartant le rideau défraîchi de sa cuisine.
Profitant d’une brève accalmie, elle peut rallier la minuscule demeure aux épais murs de pierre. À l’intérieur, un feu crépite sagement dans l’âtre de la cheminée au manteau de granit noirci par la fumée. Quoique la température dehors ne soit pas spécialement basse, les articulations usées du patriarche ont besoin de cette douce chaleur.
Amène, mais pas très attentive, Barbara s’attèle à sa tâche culinaire pendant que Baptiste ouvre le journal et chausse ses bésicles cerclées pour son exercice préféré ; scruter méticuleusement la rubrique nécrologique pour y déplorer, parfois, une disparition qu’il commente à l’aune de sa longévité :
– À peine plus de quatre-vingts ans… c’est tôt pour mourir !
Il y a dans cette remarque, quasi rituelle, les intonations d’une supplique. Celle qu’il adresse au Tout-Puissant afin de repousser cette issue inéluctable, terriblement injuste à son vieux cœur racorni. S’il a souvent cru perdre la vie pendant les deux guerres qu’il a traversées, regretté parfois que ce ne fût pas le cas, aujourd’hui il redoute l’approche du terminus comme il dit…
Barbara met le couvert, aligne la serviette à la droite du couteau et fait glisser dans l’assiette le frichti fumant et odorant. Aussitôt, Baptiste stoppe net sa lecture. Il se lève pour venir s’attabler, émettant les mêmes petits grognements de satisfaction qui, à cette heure-là, cadencent toutes ses mi-journées.
Il se met à déguster chaque bouchée avec lenteur, humant, goûtant, faisant durer ce moment de grâce où s’estompent les maux qui strient sa carcasse flétrie. Amusée, son ange gardien remise les ustensiles qu’elle a employés tout en lui certifiant qu’elle fera son ménage le lendemain :
– Je n’ai pas trop le temps aujourd’hui, indique-t-elle.
– À demain gamine. Tu as la tête ailleurs, dit-il goguenard.
– En revanche, la vôtre est bien sur vos épaules et elle fonctionne comme une horloge, Père Bredon, le taquine Barbara.
Derechef caparaçonnée, elle sort affronter la pluie qui a repris de plus belle. Refaisant le chemin en sens inverse sans traîner, elle répète les mêmes gestes : la clé, le ciré pendu au crochet, le feu sous la casserole et une nourriture ingurgitée prestement. Tenant la lettre entre ses mains fines, elle réfrène encore son empressement, par jeu. Elle passe par la salle de bains, y détaille dans le miroir intransigeant ses soixante-quatre ans, dont on lui dit qu’elle les porte bellement quand elle ne parvient pas à se défaire de la monotonie qui filme son visage. Elle retouche sa coiffure, dédaigne le rouge à lèvres auquel elle ne recourt qu’exceptionnellement. Hostile à toute forme de séduction, Barbara tient, quand même, à ne pas négliger son apparence et remercie Dame Nature de ne pas griffer trop durement ses traits.
Jugeant qu’elle a suffisamment joué de ces atermoiements, elle s’assied pour siroter un café qu’elle aime fort, sucré. Elle retourne sa cuillère pour s’en servir de ciseau, incise l’enveloppe, pince les feuillets entre le pouce et l’index, les retire : deux pleines pages d’une écriture penchée impeccable. Le raffinement qu’elle a progressivement décelé chez Matthias a commencé là et, à aucun moment, il ne s’est démenti. Elle prend une grande inspiration.
« Penzance, le 7 mai 1984
Très chère Barbara,
Tout d’abord, mille excuses de n’avoir pas répondu plus vite à votre dernière correspondance. Ainsi que je vous l’écrivais dernièrement, mon vieux père devenant de plus en plus chancelant, j’ai dû me consacrer entièrement à lui au cours des semaines écoulées. Surtout, n’en concluez pas que j’avais relégué à l’arrière-plan la finalisation de mon séjour en Normandie. Soyez assurée, au contraire, que cela me tient toujours autant à cœur. Aussi, je vous le confirme, je serai à vos côtés pour ce quarantième anniversaire du débarquement que votre pays souhaite commémorer avec faste. Je m’en fais une joie immense et, le croirez-vous, mes bagages sont déjà prêts !
Pourtant, nous le savons, l’émotion sera très forte. L’évènement qui va être célébré a, évidemment, structuré le monde, mais également sculpté nos petites existences. Mon infinie gratitude vous est acquise pour avoir, par vos confidences, fait écho à mes confessions. Je ne pouvais espérer plus belle catharsis. La pudeur que vous avez déployée en toile de fond à nos « causeries » de papier a été précieuse pour partager nos guerres respectives, sans que nous cherchions à établir une hiérarchie entre nos meurtrissures. J’espère simplement, par ce périple, par les souvenirs que nous allons réévoquer et d’autres que nous allons peut-être nous dévoiler de vive voix, ne pas rouvrir des blessures qui ont affleuré au fil de nos mois d’échanges. Du reste, pour ma part, j’avoue ignorer si mes cicatrices résisteront à ce plongeon dans le passé. Seuls ceux qui l’ont vécu dans leur chair peuvent comprendre une telle rémanence, n’est-ce pas ?
Dès le départ, afin de rendre envisageable et concrétiser ce rendez-vous qui va devenir une réalité, vous aviez suggéré un cadre que j’ai toujours en tête : nous laisser mutuellement l’initiative des épanchements pour ne pas, par un questionnement hasardeux, franchir la limite des secrets derrière laquelle l’accablement ne serait pas supportable. Mais, si j’ai adhéré sans réserve, je ne voudrais pas ternir par indélicatesse le lien que nous avons tissé. Alors, je vous en prie, si nécessaire rappelez-moi combien le silence est parfois le meilleur des compagnons entre deux êtres. Vous et moi avons payé pour le savoir.
J’ai hâte que vous me guidiez sur tous ces lieux (ils ont dû bien changer…) où, modestement, nous avons œuvré à la victoire sur la peste brune et, hélas, vu tellement des nôtres le payer de leur sang. Il est étrange d’imaginer que nous avons, peut-être, été proches l’un de l’autre à un instant donné, ou foulé les mêmes chemins à quelques minutes d’intervalle.
Mais voilà que j’anticipe nos futurs dialogues. Je vais donc en rester là, non sans terminer par les aspects pratiques. Le ferry sera à l’accostage à Roscoff le 3 juin, vers 8 heures du matin. Paul, notre ami commun, viendra me chercher (il va lui falloir se lever très tôt !) et me conduira jusqu’à vous. D’après lui, nous devrions arriver en début d’après-midi et, après avoir fait les présentations, il nous laissera commencer ce qui sera notre pèlerinage d’Overlord. Pour le retour, le 7 juin, nous partirions aux alentours de 15 heures afin de nous donner une bonne marge avant que le bateau lève l’ancre à 21 heures.
À très bientôt. Portez-vous bien.
Votre dévoué Matthias. »
Barbara repose les deux feuilles sur la petite table. Les yeux rivés dessus, elle attend un peu avant de les remettre à l’intérieur du rectangle qu’elle a décacheté. Il ira rejoindre les précédents qu’elle conserve précieusement dans un tiroir de son bureau, avec quelques objets témoins de faits importants dans sa vie ; comme cet exemplaire du journal Ouest-France du 8 mai 1945 qui titrait en caractères gras :
7 mai – 2 h 41
Capitulation de l’Allemagne
Pour elle, la venue de Matthias Travisloane aura tout d’un post-scriptum personnel à cette date, la même que celle qu’il a choisie pour rédiger ce dernier courrier.
*
Paul Corvis, ami de Barbara et Matthias, s’est retiré dans le Calvados, sur la Côte de Nâcre, patrie de son épouse Clémence, après une longue carrière de fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Il y a brillé par son intelligence et un don pour les relations interpersonnelles très vite détecté par ses patrons successifs.
Missionné dans une kyrielle de transactions épineuses, son premier véritable coup de maître avait été l’aboutissement, grâce au travail du petit groupe auquel il appartenait, d’un grand projet scientifique unissant des compétences franco-allemandes : la création de l’Institut Laue-Langevin, spécialisé dans l’étude du transport des neutrons, en 1967. En cette année qui suivait celle de la sortie de la France de l’O.T.A.N, cette réussite n’était pas mince. Elle participait de la relance de la coopération entre les deux pays qu’un prometteur traité, paraphé à l’Élysée, n’avait pas suffi à faire décoller, au tout début de 1963 ; Paul et tous les acteurs du rapprochement des ex-belligérants avaient même dû très vite déchanter, quelques mois plus tard, lorsque Konrad Adenauer, démissionnaire, avait été remplacé à la chancellerie par un Ludwig Erhard beaucoup moins francophile.
C’est à l’époque des discussions préparatoires à ce succès que Paul avait reconnu au bout du combiné le français trébuchant et approximatif de son homologue Allemand dans le dossier en cours :
– Hallo, Paul, c’est Werner. Vous intéressez le coupe du monde de football ?
– Euh… oui. Pourquoi ?
– Dans trois jours c’est finale, Angleterre-Allemagne, à Londres. Mon ministre donne à moi deux places. Il dit je demande si vous acceptez venir avec moi ?
La surprise avait été de taille. L’offre annulait l’escapade dominicale prévue avec sa femme, mais… le ministre Allemand… Allait-il se soustraire à ce qu’il soupçonnait être une de ces symboliques diplomatiques qui, sous des apparences insignifiantes, conditionnent un heureux épilogue ? À l’évidence, il ne devait pas prendre le risque d’un refus dont la portée pourrait dépasser sa petite personne. Alors, à sa mariée que décontenancerait cette annonce soudaine, il expliquerait le sens de cette fugue et il n’avait pas tergiversé :
– Vous me gâtez. Merci beaucoup Werner !
– Sehr gut ! Notre prochaine réunion c’est Paris, vendredi 29 juillet, ja ? Je prends billets avion, départ Orly lendemain matin, et nous assistons à le match 16 heures. Retour dimanche. Vous, la France, moi, Bonn. Si vous êtes okay, je réserve hôtel.
– Oui, oui, je suis d’accord. C’est formidable. Mais je paierai ma chambre. Du bist sehr nett1 Werner.
C’est comme ça qu’ils s’étaient assis côte à côte, le 30 juillet 1966, dans les tribunes du stade de Wembley, au beau milieu des supporters britanniques. L’un d’eux, à la gauche de Paul, se différenciait de ses congénères par des encouragements, certes vibrants, mais expurgés des chants exubérants, slogans et onomatopées environnants. Dans l’arène en ébullition il émanait de ce personnage un composé de prestance et d’humilité qui inspirait confiance. Très naturellement, tout au long d’une partie où la victoire mit longtemps à choisir son camp, les trois hommes avaient sympathisé, optant pour la langue de Molière que leur voisin Anglais maîtrisait à la perfection. Au coup de sifflet final scellant la défaite de la République fédérale d’Allemagne, surmontant sa déception, Werner s’était joint à Paul pour féliciter le bienheureux aficionado. Celui-ci, soucieux du proverbial fair-play d’outre-Manche, leur avait proposé de s’associer à l’immense liesse populaire sur les bords de la Tamise, dans l’un des pubs où, avait-il affirmé, il avait ses entrées ; une troisième mi-temps, version ballon rond ! Son ton poli, mais persuasif, avait refoulé l’embarras courtois des deux hommes n’ayant, par ailleurs, rien programmé :
– Vous ne le regretterez pas, gentlemen. Je me présente : Matthias Travisloane.
CHAPITRE 2
Une cinquantaine de minutes en Black Cab et tous trois s’étaient enfoncés dans l’atmosphère so british du Bacchus House, sorte de gentilhommière du XVIIe siècle dans le quartier de Rotherhite street. En maître de cérémonie autoproclamé, trop bien éduqué pour fanfaronner pendant que la voiture se frayait un chemin au milieu d’une marée humaine, Matthias avait préféré gratifier Paul et Werner de commentaires sur l’histoire des grands édifices de la ville qu’il avait fixés comme repères à leur chauffeur : Marble Arch, Buckingham Palace, Westminster, Big Ben et enfin Tower Bridge. Cette vadrouille tout en louvoiements touristiques, avait auguré d’un moment de convivialité qui, pour n’être pas prémédité, n’en serait pas moins de bonne tenue, en même temps qu’il serait sans sophistication.
Un peu moins feutré que d’ordinaire, triomphe national oblige, l’établissement niché à quelques encablures de la Tour de Londres était déjà en effervescence, s’embrasant des « God save the Queen » et « Pomp and Circumstance »2 repris en chœur par des dizaines de poitrines en pleine communion. Empoignant la première chope, Matthias avait désinhibé ses compagnons par une entame très consensuelle, dans l’une des alcôves capitonnées où on les avait placés :
– Messieurs, je porte un toast au football. Cette compétition a été palpitante de bout en bout et le dénouement une apothéose. Très beau match, n’est-ce pas ? Werner, je suis désolé.
– Oui, ja, dommage… C’est le sport. Peut-être on fait la revanche au Mexique, dans quatre ans… ?
– Ah non, avait coupé Paul dans un sourire malicieux. En 1970, c’est la France qui l’emportera !
On avait trinqué à ce pronostic auquel aucun n’avait accordé crédit, et l’on avait devisé sur les performances de tel ou tel joueur. Puis… les bières s’étaient succédé, nombreuses, au rythme des sujets qui avaient défilé, révélant plusieurs domaines d’accointances ; le sport, bien sûr, mais aussi les voyages, la musique et, plus insolite, la philosophie. Chacun y était allé de ses prédilections, agrémentées de savoureuses anecdotes faisant s’esclaffer les deux autres. La soirée s’était avancée de la sorte sur un ton bon enfant et l’on en était venu à livrer un peu de soi, ouvrant un registre plus intime ; plus long également. C’est ainsi que, des gorgées plus tard, dans un français perlé, Matthias avait précisé qu’il résidait chez son frère Gareth, à l’ouest de la ville, depuis la veille. Il s’en retournerait chez lui le lendemain, à Penzance, petit port en Cornouailles, dans le cottage qu’il avait retapé.
À leur tour, Paul et Werner avaient levé le voile sur leur lieu de vie en ce temps-là : en plein Quartier Latin pour le premier, dans les parages de la maison de Beethoven à Bonn, pour le second. Sous l’effet du brandy qui avait remplacé la Guinness, Paul s’était décidé à saluer le bilinguisme de Matthias. Impressionné dès les premiers mots échangés au stade, il n’avait pas voulu céder à cette curiosité trop tôt. Mais à présent que la glace était rompue…
– D’où vous vient pareille aisance, Matthias ?
– Oh je n’ai pas grand mérite, avait-il dit. Dès le berceau, mon père Anglais et ma mère Française m’ont inculqué les deux cultures et les deux langages. De surcroît, il était si peu question de prééminence entre eux qu’ils ont décrété que j’aurais la double nationalité. Du coup, en me partageant entre les deux ramures de ma famille, je vis au Royaume-Uni mais je chéris les deux territoires de la même manière.
Admiratif, Werner avait opiné du chef, nonobstant une acuité inexorablement érodée par les vapeurs d’alcool. Il y avait déjà quelques minutes qu’il tanguait sur la banquette en cuir, luttant avec difficulté contre une fatigue montante qui vitrifiait peu à peu son regard bleu acier. Ses deux acolytes avaient eu un sourire entendu ; il s’engluait dans la somnolence. Paul avait profité de cette extinction fugitive pour éclairer Matthias sur leur collaboration professionnelle :
– J’ai toujours aimé la négociation. Cette affaire d’Institut est complexe, mais passionnante ! Vous savez, entre la France et l’Allemagne c’est encore, parfois, très compliqué, avait-il conclu… Et vous, Matthias, que faites-vous ?
– Eh bien… je navigue. Je suis officier dans la Royal Navy. Ce n’était pas à proprement parler une appétence murie, étant jeune. Comme beaucoup, pendant la guerre j’ai touché à plusieurs activités, au gré des situations, et me suis retrouvé sur un croiseur Français pendant l’opération Overlord3. Ensuite, j’ai continué sur le même navire, en Provence en septembre 1944, et en Italie du nord en novembre. En revenant en Grande-Bretagne, je ne savais rien faire d’autre. Alors, j’ai intégré définitivement la marine parce que je me sentais bien sur un bateau, au grand dam de mon père qui me voyait reprendre des études pour graviter dans les hautes sphères de l’État. Vous voyez, au final, c’est assez banal.
– Mais… pourquoi l’armée britannique si vous aviez servi sous l’étendard tricolore ?
Pris d’un désabusement subit, Matthias avait avalé une rasade de son eau-de-vie avant de noyer ses pensées dans le fond de son verre. Visiblement, il était ébranlé par les souvenirs que convoquait Paul. Celui-ci avait éprouvé la gêne que l’on ressent à l’idée d’une inquisition involontaire, après avoir entrebâillé la porte d’une pièce recelant de vieilles gravures chargées d’une émotion tenace. Toutefois, drapé dans son élégance innée, son interlocuteur s’était extirpé de sa torpeur éphémère :
– C’est une longue histoire…
– Excusez ma maladresse, l’avait interrompu Paul.
Il s’en voulait terriblement d’avoir lézardé son humeur joyeuse.
– Parlons d’autre chose. Êtes-vous déjà venu à Paris ?
Reconnaissant à Paul de son discernement, Matthias avait enchaîné :
– Oui. J’ai un oncle, âgé, dans le treizième arrondissement. Notre principal contact consiste à nous envoyer une carte de vœux. Un de ces jours, il faudra que j’aille le voir car il se déplace très difficilement et souffre d’une solitude dont il ne dit jamais rien.
C’était l’instant qu’avait choisi Werner pour sursauter dans son assoupissement :
– Ah là, là… ma tête. C’est mieux si, peut-être, je laisse vous et je prends taxi pour aller me coucher.
Embrumé par l’excès de boisson, vexé de ne pas s’en être méfié, il avait puisé dans ce qu’il lui restait de lucidité pour tenter de sauvegarder les apparences. Magnanime, Paul avait volé à son secours :
– Non, non, nous allons rentrer ensemble, Werner. Il est tard et nous avons largement célébré le nouveau champion du monde, n’est-ce pas Matthias ?
Simultanément, Paul avait fouillé dans sa poche intérieure, en avait retiré une carte de visite, l’avait remise à l’intéressé :
– Vous avez été très généreux avec nous et votre hospitalité était très agréable. À charge de revanche, si vous venez embrasser votre oncle, par exemple. J’y tiens vraiment.
Tandis que Werner s’était hissé flageolant de son siège, Matthias avait poursuivi :
– C’est moi qui vous remercie, messieurs. J’aurais détesté être seul ce soir, pas plus que je n’aurais apprécié me mêler aux excentricités de nombre de mes concitoyens. Je vais commander un taxi qui vous raccompagnera et me déposera ensuite.
*
Sitôt dans l’habitacle, le trio s’était mis en sourdine, bercé par le ronronnement du moteur. Devant le porche de l’hôtel, on s’était séparé simplement, tels de vieux amis sûrs de se revoir.
Le dimanche matin, le temps de regagner ses pénates et chacun s’était inscrit à nouveau dans son horizon habituel ; en l’occurrence, se consacrer à un métier, à une famille, à des amis très proches et à organiser ses loisirs. L’été avait passé. Paul et Werner avaient redoublé d’efforts pour régler les ultimes points du couronnement de leur besogne collégiale et, à la mi-janvier, la signature d’une convention actait l’implantation du réacteur, objet de leur acharnement, en terre grenobloise. Sur l’instant, les deux chevilles ouvrières de ce chantier avaient balancé entre satisfaction du devoir accompli, et bien accompli, et tristesse de savoir que les techniciens allaient prendre le relai, les dépossédant de leur ouvrage. D’autres thèmes, d’autres entremises les attendraient, ailleurs, qui les éloigneraient, probablement à tout jamais, par-delà leurs promesses, très convenues mais peu probantes, de ne pas couper les ponts.
Matthias, lui, s’était embarqué, dès septembre, pour une mission de quatre mois dans l’Atlantique nord. Il aimait ces équipées où la vigilance était entrecoupée de silences propices à l’introspection. Elle était sa matrice de revivification pour l’homme qu’il était devenu au sortir de ses vingt ans, le cerveau encombré de l’indicible. Aussi singulier que cela pût paraître, de la part de quelqu’un qui maniait des engins capables d’envoyer un vaisseau par le fond, la mer avait, dans son prisme de vie, une place prépondérante ; le spectacle des éléments libres était son antidote à la résignation née des monstruosités perpétrées par le Troisième Reich. Parce que ce sentiment le menaçait encore, Matthias s’évertuait à espérer de l’Humanité en contemplant les flots indomptables autour de lui ; leur tumulte fut-il impitoyable.
Six mois après sa fiesta d’après match avec Paul et Werner, il avait rejoint le premier à Paris pour un déjeuner sous les lambris d’une vielle enseigne séculaire. S’y rendant tout en déambulant à Saint-Germain-des-Près, il s’était rappelé de l’enthousiasme de celui-ci lors de son appel surprise.
Paul se souvenait-il d’une certaine fête d’après match, en juillet dernier ? Et comment… Ah bon ! Matthias ferait un aller-retour de quarante-huit heures, en France, pour souhaiter la bonne année de vive voix à ce vieux parent dont il lui avait parlé brièvement dans le brouhaha du Bacchus House ? Formidable. Ils se verraient donc !
– Votre jour et votre heure seront les miens, avait insisté Paul.
C’était après avoir reçu de son oncle la sempiternelle carte au paysage de neige de la Saint-Sylvestre que Matthias s’était résolu à quitter son home sweet home, pour cette visite éclair. Afin d’en augmenter la saveur, l’intéressé n’en avait rien su jusqu’à ce qu’il ouvrît à son neveu tambourinant plaisamment contre la porte.
– Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour essayer de revoir ce Français, amateur de football, que tu avais abordé au stade à Londres, avait suggéré Shannon, sa mère, à qui il avait parlé de sa rencontre avec un de ses compatriotes. Il t’avait donné un bristol, non ?
– Mais oui. Tu as raison. Je ferai son numéro dès demain.





























