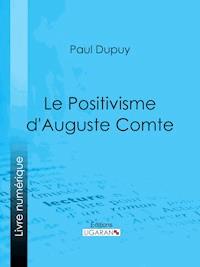
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous savons d'une manière très précise que Saint-Simon voulant restaurer, réorganiser la société au point de vue de la politique, commença par bannir de sa pensée toutes les considérations philosophiques et religieuses, cherchant son point de départ dans l'ensemble des sciences. Il eut même la pensée de les réviser, de les modifier, au besoin, pour ne se servir dans l'œuvre grandiose qu'il se proposait d'accomplir que de matériaux incontestables."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je suis arrivé à croire que M. Comte sera une étiquette dans l’avenir, et qu’il occupera une place importante dans les futures histoires de la philosophie. Ce sera une erreur, j’en conviens, mais l’avenir commettra tant d’autres erreurs.
RENAN.
Conformément à la prévision de Renan, M. Comte occupe une place importante en philosophie, ce qui ne l’empêche pas d’être arrivé à un point tournant de sa renommée. On lui a supposé une originalité qu’il ne possède point, et à laquelle il empruntait une grande partie de sa valeur aux yeux du public. Un nouvel astre de première grandeur venait de s’élever sur l’horizon de la pensée. Comparable sinon supérieur à Descartes, à Leibniz, Comte repensait toutes les sciences, en faisait un ensemble systématique, sur lequel il édifiait, comme leur couronnement, la sociologie, résultante du passé et principe fécond de l’avenir.
Pareille apothéose ne s’était point produite sans protestation. Les Saint-Simoniens ne s’étaient point faits faute de signaler tout ce qui, dans l’œuvre du disciple, rappelait celle du maître. Mais le disciple avait si bien endoctriné ses propres élèves qu’aucun d’eux, pas même Littré, ne se crut obligé de vérifier, d’une manière suffisante, une assertion qui portait une sérieuse atteinte à l’originalité de Comte. Ils se contentèrent de nier un fait qui devait plus tard devenir l’évidence même. Toutefois on le trouve mentionné par Pellarin (beau-frère de Littré), par Renouvier, par Ravaisson et surtout par Paul Janet. Tenu en haute estime par Stuart Mill (qui plus tard dut en rabattre), par Léon Bruhl, par Brunetière et quelques autres littérateurs d’un vrai mérite, Auguste Comte fut l’objet d’une étude sérieuse et approfondie de M. Alengry, qui trouve en lui l’étoffe d’un grand homme, mais qui déclare que c’est évidemment Saint-Simon qui a donné à Comte les cadres et les idées directrices de la sociologie. M. Alengry a dit également : « Saint-Simon a écrit un plan et Comte l’a réalisé ». Ce serait donc celui-ci qui serait le véritable fondateur de la sociologie. Bien qu’ayant débuté par la synthèse, il a surtout créé la philosophie de la sociologie. Or défaut préalable d’analyse, synthèse incomplète et fausse par conséquent, c’est ce que savent tous les élèves en philosophie.
Quelques années plus tard, M. G. Dumas, tout en témoignant de son admiration pour A. Comte et le déclarant, sous divers rapports, supérieur à Saint-Simon, reconnaît néanmoins qu’il lui doit la meilleure part de ses idées générales. Il ajoute : « Dans l’histoire des idées, Saint-Simon, avec sa production désordonnée, ses livres inachevés, ses théories incomplètes, apparaîtra toujours comme une première ébauche de Comte, ébauche vague par endroits, hâtivement dessinée par ailleurs, jamais bien arrêtée dans ses lignes, puissantes et géniales pourtant. Sans lui, Auguste Comte aurait sans doute écrit et pensé, mais il n’eût certainement fondé ni la philosophie positive ni la religion de l’humanité ».
De très bonne heure (17 ans) Saint-Simon songe à se faire une carrière physico-politique, ce qu’on appellerait de nos jours s’adonner à la physique sociale ou sociologie, s’y préparant par l’étude des sciences d’observation. S’inspirant d’autre part du catholicisme, qu’il a la prétention de remplacer, il veut instituer un autre pouvoir spirituel composé de savants et d’artistes, et qui régnera moralement sur l’Europe, comme étant l’organe d’une religion conforme aux données de la science humaine. Dans ces conditions nouvelles, tous les hommes sont appelés à travailler. Saint-Simon sera le pape scientifique de l’Europe régénérée dans ses croyances.
Maintenant voici le point de départ. Le XVIIIe siècle a détruit la foi catholique, sans la remplacer, et, par le mouvement irrésistible de la Révolution française, il a supprimé la monarchie traditionnelle, mais sans lui substituer des institutions durables. D’où un double besoin : celui des croyances à reconstituer, et celui de l’Administration générale à restaurer également. Or tandis que les écrivains catholiques, tels que de Bonald et J. de Maistre veulent en revenir, tout d’abord, à la foi et au pouvoir spirituel du Moyen Âge, Saint-Simon veut résoudre le problème par les données de la science réussissant à formuler une nouvelle synthèse. C’est sous l’inspiration directe de celle-ci que l’œuvre de rénovation doit être accomplie. C’est à elle, par conséquent, à instituer un pouvoir spirituel nouveau appelé à prendre la place de l’ancien.
À l’ancienne encyclopédie, œuvre de critique et de bataille, Saint-Simon veut substituer une nouvelle et véritable encyclopédie, qui sera une œuvre de coordination et de synthèse scientifique. Celle-ci devant être essentiellement une, il ne trouve rien de mieux que de mettre à sa base la loi de gravitation universelle, qu’il considère comme la loi unique du monde physique et moral. C’est bien de la synthèse, sans doute, mais sans analyse préalable. Mauvais exemple pour l’élève Comte qui agira de même, en se plaçant d’ailleurs à un autre point de vue.
Maintenant, comment faire procéder une morale et une religion de la synthèse ainsi constituée, savoir de la gravitation universelle ? Saint-Simon ne le tente point et s’en tient à des artifices provisoires, en morale et en éducation, pour les enfants et les ignorants. Mais les savants écriront l’encyclopédie, réorganisant le physicisme par la loi de gravitation. Plus tard, pour que le physicisme soit mis à la portée du vulgaire, les savants tireront de l’encyclopédie un catéchisme nouveau. La science sera renouvelée, la morale aussi sera renouvelée, chacun étant tenu de travailler. Le pouvoir spirituel sera ainsi désormais exercé, au nom de la raison, par un pape et un clergé physiciste : l’unité catholique de la foi se trouvera restaurée. Saint-Simon profondément pénétré de l’esprit du catholicisme, et traitant les protestants d’hérétiques, on peut lui appliquer, mais dans une bien moindre mesure, ce que disait Huxley du système de Comte : C’est du catholicisme sans christianisme.
La conclusion naturelle de l’étude de. M. G. Dumas sur Saint-Simon, c’est que ce fondateur du socialisme moderne, comme le disait Paul Janet, était le véritable père du positivisme. Pour Comte, pareille affirmation est la déchéance.
Sans être en apparence aussi explicite, M. Alengry reconnaît qu’on trouve, dans Saint-Simon, une doctrine complète sur la sociologie telle que l’a réalisée A. Comte. Un aperçu général de l’œuvre du premier en donnera la preuve. Cet aperçu je l’emprunte à M. Alengry.
L’État révolutionnaire des sociétés ne pourra prendre fin que par la réorganisation préalable des idées. « Le mal est dû à l’absence d’idées communes servant de lien aux esprits et aux volontés. Ces idées communes il faut les créer. La politique n’est pas encore guidée par une science ; c’est cette science qu’il faut créer. Elle doit avoir pour base une doctrine philosophique universellement adoptée. Une fois la réorganisation intellectuelle et scientifique opérée, la réorganisation sociale sera achevée. » D’où ces propres paroles de Saint-Simon : « Je conçus le projet de forger une nouvelle carrière à l’intelligence humaine ». D’où l’on voit que « le Saint-Simonisme est une théorie sociale et politique qui a pour base une rénovation totale des sciences, des idées ».
Cette rénovation est essentiellement philosophique, car elle est synthétique. L’esprit humain a parcouru la voie de l’a posteriori, qui est celle de l’analyse et des vues particulières ; il doit s’engager dans la voie de l’a priori, qui est celle de la synthèse et des vues générales. Toute rénovation philosophique doit être générale et synthétique, car la philosophie est la science des sciences, les sciences particulières n’étant que les éléments de cette science totale qui est une véritable encyclopédie. Les philosophes du XVIIIe siècle ont fait une encyclopédie destinée à renverser le système théologique et féodal ; ceux du XIXe siècle doivent aussi faire une encyclopédie pour constituer le système industriel et pacifique. Son aînée a détruit, elle-même bâtira. Ainsi donc conclut M. Alengry pour réorganiser les sociétés, il faut d’abord réorganiser les idées, c’est-à-dire toutes les sciences et les englober dans une vaste synthèse.
M. Alengry continue dans les termes suivants : « Pour réaliser cette immense entreprise, il faut se livrer à trois genres de travaux : 1° classer les sciences ; 2° les rendre homogènes, c’est-à-dire toutes positives ; 3° enfin couronner toutes les sciences par une nouvelle science, positive comme les autres, mais infiniment plus vaste, plus synthétique : la science politique ; c’est elle qui servira de guide à la rénovation sociale et à l’art politique. C’est elle qui couronnera l’édifice des sciences et préparera directement la réorganisation des sociétés » .
Maintenant voici la classification des sciences de Saint-Simon : « Tous les phénomènes dont nous avons connaissance ont été partagés en différentes classes : phénomènes astronomiques, physiques, chimiques, physiologiques ». Il n’y a point, dit-il ailleurs, de phénomène qui ne soit astronomique, chimique, physiologique ou psychologique. Or comme pour Saint-Simon : « La physiologie comprend : 1° la physiologie individuelle soit physique, soit psychologique, et la physiologie de l’espèce ou physique sociale, il s’ensuit qu’il classe les sciences dans l’ordre suivant : mathématiques, astronomie, physique, chimie, physiologie (physiologie, psychologie, progrès de l’esprit, marche future de l’esprit humain). Saint-Simon ébauche même un ordre de développement historique des sciences, fondé d’abord sur leur complexité croissante, puis sur leur rapport de plus en plus grand avec l’homme et ses sentiments ».
Parmi les sciences, les unes sont positives, telles que les mathématiques, l’astronomie, la physique et la chimie, car elles ont leur point de départ dans l’observation ; les autres sont conjecturales, c’est-à-dire théologiques et métaphysiques. Celles-ci doivent secouer le joug des métaphysiciens et des moralistes, et toutes les autres sciences étant devenues positives, il faut qu’il en soit de même pour la philosophie, la morale et la politique. Donc les phénomènes que celles-ci étudient doivent avoir pour méthode essentielle l’observation, et doivent être considérés comme assujettis à des lois invariables. Alors, mais alors seulement la classification des sciences formera un système homogène couronné par la science politique.
La physiologie sociale ou science politique a un objet distinct de la physiologie individuelle. « La première plane au-dessus des individus qui ne sont plus, pour elle, que des organes du corps social, car la société n’est point une agglomération d’êtres vivants, dont les actions indépendantes de tout but final n’ont d’autre cause que l’arbitraire des volontés individuelles. » La société, en effet, est surtout une véritable machine organisée, dont toutes les parties contribuent d’une manière différente à la marche de l’ensemble. La réunion des hommes constitue un véritable être. Cet organisme immense se développe comme l’organisme individuel, il traverse l’enfance, l’adolescence, l’âge mûr, et il arrivera à la vieillesse.
Il faut maintenant aborder la question de loi. Puisqu’on admet généralement aujourd’hui que les phénomènes astronomiques, physiques et chimiques obéissent tous indistinctement à la loi de la gravitation universelle, il est nécessaire d’étendre cette loi aux phénomènes physiologiques, surtout aux phénomènes physiologiques sociaux. Il n’y a pas deux natures : l’une morale, l’autre physique. Le développement social n’est que le prolongement du développement animal. Il n’y a qu’un ordre de choses : l’ordre physique. La science politique devient positive, au même titre que les autres sciences, et elle devient apte à servir de base à l’art politique.
Ainsi sera créée la philosophie générale, destinée à remplacer les anciennes métaphysiques et les anciennes religions, et ainsi seront satisfaites les tendances naturelles de l’esprit humain vers l’unité. Dans l’éducation, les études se termineront naturellement par un cours de philosophie positive.
Le progrès est la caractéristique essentielle de l’évolution sociale et, comme Condorcet son père spirituel, Saint-Simon ne considère à la fois qu’un seul peuple auquel il rapporte tous les progrès accomplis. Ce peuple varie suivant les époques : les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Arabes, puis les Anglais et surtout les Français. Pareille abstraction est légitime, car la marche de l’esprit humain est une et inaltérable, elle ne varie point suivant les temps et les lieux. Tous les peuples sont entraînés par le même courant, seule la vitesse de l’évolution est différente. Ce courant est celui du progrès qui est une impulsion universelle et nécessaire, sollicitant toutes les sociétés à améliorer sans cesse leur condition. Le progrès est une loi qui entraîne et domine les évènements et les êtres. Les hommes ne sont en face d’elle que des instruments, et rien ne peut arrêter, d’une manière durable, les progrès de la civilisation. Ni les grands hommes, ni les législateurs n’ont dirigé ce mouvement naturel et nécessaire, ils en ont pris conscience et l’ont résumé. L’évolution est inconsciente et mécanique. Tous les moments du progrès ayant été nécessaires, il n’y a ni à les louer, ni à les blâmer. C’est ce que n’a point fait Condorcet, car il a méconnu le rôle de la religion et celui du Moyen Âge, qui ont été des moments nécessaires dans les phases de la civilisation. Ils ont apparu quand il le fallait et leur rôle a été utile. Ainsi les institutions religieuses ont exercé sur les institutions politiques la plus grande et la plus légitime influence. L’institution religieuse, sous quelque aspect qu’on l’envisage, est la principale institution politique, et le Moyen Âge a été le berceau de la civilisation moderne. En effet, c’est au Moyen Âge qu’on voit l’établissement d’un pouvoir spirituel européen, ce qui était et doit être encore aujourd’hui la véritable base du système politique de l’Europe. L’esprit positif dans les sciences est même né dans cette période si décriée.
Le passé aide à comprendre le présent et à éclairer l’avenir. En effet, le problème de la science politique consiste à trouver la loi du progrès : d’où viennent les sociétés, où vont-elles ? Du passé bien observé, on peut déduire facilement l’avenir. L’étude de la marche que l’esprit humain a suivie nous dévoilera celle qu’il suivra. L’histoire nous dirige, elle est un fil conducteur aux hommes politiques.
D’où viennent les sociétés humaines ? du système théologique et féodal. Vers quel but se dirigent-elles nécessairement ? Vers le système scientifique et industriel. Observons le présent et l’éclairons par le passé, c’est-à-dire par l’histoire.
Saint-Simon a puisé dans l’histoire toutes ses théories. L’analyse des progrès de l’esprit humain lui a servi de base pour la conception de l’échelle hiérarchique de l’encyclopédie. C’est à l’histoire qu’il demande l’évolution des progrès, la considération des maladies du corps social, les considérations sur les Romains, l’appréciation du Moyen Âge, la loi de l’alternance des révolutions scientifiques et des révolutions politiques et, enfin, de l’histoire des communes, c’est-à-dire du mouvement scientifique et industriel qui occupe, dans son œuvre, une place si importante.
La science politique a pour objet, d’après Saint-Simon, les sociétés en mouvement, et elle se propose pour but de découvrir la loi de ce mouvement, la loi du progrès. L’état présent d’une société serait donc inintelligible sans la connaissance des phases qu’elle a d’abord traversées. Ce n’est que par l’observation philosophique du passé que l’on peut acquérir une connaissance exacte des vrais éléments du présent. Celui qui propose une nouvelle institution doit donc faire voir, avant tout, qu’elle est amenée par le passé et réclamée par le présent. La vraie méthode de la science politique est donc la méthode historique. Toutefois l’histoire ne rendra de services réels à la science politique qu’à la condition de devenir scientifique. La marche à suivre est de faire une histoire de l’espèce humaine, une sorte d’histoire universelle s’élevant au-dessus des égoïsmes nationaux. Depuis le siècle passé (XVIIIe siècle) on est entré, dans une voie meilleure, surtout Condorcet qui a essayé de constituer l’histoire, d’une manière vraiment philosophique, en la traitant comme une véritable science. Il a fait une série d’observations sur la marche de la civilisation et il a divisé les faits non en dynasties, mais en époques d’après la théorie générale du progrès. Mais l’œuvre de Condorcet n’est qu’une ébauche et le travail général et fondamental reste encore à faire.
L’unique problème de la science politique consiste à trouver la loi des progrès de l’esprit humain. L’histoire des sciences nous montre qu’elles ont commencé par être conjecturales avant de devenir positives. À son origine, l’astronomie n’était que de l’astrologie, la chimie n’était que de l’alchimie, la physiologie était infectée de charlatanisme, la psychologie nageait dans la superstition. Aujourd’hui l’astronomie, la chimie, la physiologie et la psychologie sont basées sur des faits observés. Ainsi elles sont positives, ainsi la masse entière de la connaissance humaine est devenue positive, car il n’y a point de phénomène qui ne soit astronomique, chimique ou psychologique. Le tout (la philosophie) et les parties ont dû avoir le caractère conjectural ; ensuite le tout et les parties ont dû avoir le caractère mi-conjectural et positif… enfin le tout et les parties doivent acquérir autant que possible le caractère positif. Comme la philosophie est le tout dont les sciences sont les parties, on en est au point que le premier bon résumé des sciences particulières constituera la philosophie positive. Telle est la loi des trois époques, qui se sont succédé nécessairement, et qui sont caractérisées par l’idolâtrie des choses visibles (le fétichisme de Comte), puis viennent le polythéisme, puis le déisme, et enfin viendra la loi de l’attraction universelle. Ailleurs Saint-Simon appellera la première époque : théologique, religieuse, et la seconde époque : métaphysique. À l’appui de la division de l’histoire en époques, Saint-Simon aurait pu citer l’exemple de Turgot.
Les sociétés ont été militaires avant d’être industrielles, car il n’y a que deux formes sociales possibles : les sociétés militaires qui ont pour but le vol, les sociétés industrielles qui ont pour but la production. Les métaphysiciens ont d’ailleurs aidé l’esprit à passer de la théologie à la science, et les juristes ont permis aux hommes de passer du militarisme à l’industrialisme.
La Révolution française a été le dernier terme d’une longue évolution. Elle aurait dû arracher le pouvoir spirituel aux prêtres pour le donner aux savants, et le pouvoir temporel aux nobles et aux militaires pour le donner au tiers État, aux communes, aux travailleurs, c’est-à-dire aux industriels. Mais la Révolution a avorté parce que les métaphysiciens et les juristes ont prolongé, au-delà du terme nécessaire, leur action préparatoire et dissolvante. Si donc l’on veut achever la Révolution, et faire régner l’ordre dans les sociétés, il faut prendre conscience du mouvement historique, rejeter à la fois prêtres et métaphysiciens, nobles et juristes, et accueillir les communes, c’est-à-dire les savants, les industriels, le tiers État.
Saint-Simon est particulièrement hostile aux juristes. Pour lui, ce sont des démolisseurs, des révolutionnaires, des esprits critiques, c’est-à-dire des métaphysiciens, et ils se donnent pour des constructeurs, et ils passent leur temps à légiférer, tandis qu’il faudrait organiser la société sur des bases industrielles. De plus, la théorie des droits de l’homme, qui a été la base de tous leurs travaux, en politique générale, n’est autre chose qu’une application de la haute métaphysique à la haute jurisprudence.
Au point de vue économique, au point de vue de la morale et de la religion, les différences entre Saint-Simon et Comte deviennent assez tranchées pour que je n’expose point sur ces divers chefs les idées du premier. Sous tous les autres rapports, à l’exception de la loi universelle de la gravitation, c’est essentiellement la pensée du maître qui trouve un écho des plus exacts, des plus fidèles dans le système de l’élève, chose bien naturelle, d’ailleurs, quand on sait par le propre témoignage de celui-ci que c’est Saint-Simon qui lui a révélé sa vocation de sociologiste. C’est ainsi que du père au fils la ressemblance frise le plus souvent l’identité.
Au lieu de parler spécialement de Comte, je viens de m’attacher à parler de Saint-Simon, dans cette préface, empruntant ce que j’en ai dit à deux des meilleures études qui ont été faites sur le prétendu fondateur du positivisme et de la sociologie. Je vise, en parlant ainsi, les deux ouvrages de G. Dumas et de Frank Alengry. Quiconque ne connaît A. Comte qu’à titre de fondateur du positivisme, serait bien surpris de rencontrer ici Saint-Simon partout où il s’attendrait à trouver le nom de Comte. Ce sont presque toujours les mêmes idées que le nouveau venu s’est appropriées, les forgeant à sa manière, et en faisant le marchepied du trône spirituel qu’il prétend occuper de haute lutte.
Je suis loin d’ailleurs de contester l’originalité de Comte, car il a inventé une politique qui se transforme en religion et celle-ci incline de plus en plus vers le fétichisme qui est, à la fois, pour ce grand philosophe, le point de départ et l’un des points d’arrivée de l’évolution humaine, c’est-à-dire de la sienne propre.
Avant d’en arriver au nouveau christianisme, Saint-Simon faisait probablement peu de cas du déisme, et se contentait de la morale de l’intérêt pour la pratique courante de la vie. Plus tard, il en vint à emprunter le sentiment de la charité au christianisme lui-même. Alors le Dieu traditionnel reprit sa place légitime, et la gravitation universelle perdit la sienne. Il y eut donc de la part du père du positivisme, suivant l’expression si juste de M. Dumas, un véritable retour à la religion. Comte a suivi une évolution analogue. Prenant son point de départ dans la science, il a voulu faire régir le cosmos et l’homme par les mêmes lois objectives, ce qui était aussi l’idée première du fondateur du positivisme. Mais arrivé à l’homme, il fallut battre en retraite et reconnaître un monde subjectif à côté du monde objectif ; l’élève n’en resta point là. Après avoir admis l’existence de deux méthodes, dont l’une propre au genre humain, Comte, grâce à Clotilde, proclama l’amour principe universel, et par conséquent fit pénétrer l’amour dans toutes les sciences. Puis toujours grâce à Clotilde qu’il adorait, il fit de l’humanité, dont Clotilde était le meilleur symbole, une véritable déesse, source et objet d’une religion nouvelle. Celle-ci devait se rapprocher le plus possible, comme organisation et comme esprit, du culte du Moyen Âge. Saint-Simon avait échoué dans le nouveau christianisme, et Comte alla se perdre dans le néocatholicisme, en faisant d’abord un même tout de la religion et de la science, les lois de celle-ci servant de dogmatique à celle-là. C’est ainsi que la religion positive fut une religion démontrée.
La catastrophe pour la science, nous le verrons plus tard, dépassa toute mesure imaginable.
AUGUSTE COMTE. APERÇU PSYCHOLOGIQUE
Auguste Comte avait un caractère entier et des plus insubordonnés. Il en donna des preuves soit au Lycée de Montpellier, soit à l’École polytechnique.
M. Georges Dumas a dit de lui qu’il n’a jamais témoigné d’un remords ou d’un regret, ce qui ne surprend guère ceux qui savent qu’il n’a jamais parlé de la conscience, lui qui a formulé un certain système de morale où elle n’avait aucun rôle à jouer. Il a d’ailleurs prouvé, dans une circonstance grave de sa vie, qu’il n’était rien moins que doué d’une certaine délicatesse de sentiment. Il épousa, comme on sait, en 1825, sa maîtresse Caroline Massin, fille naturelle d’un acteur. Elle avait été vendue par sa mère à un M. Cerclet qui l’abandonna bientôt, aussi, depuis deux ans, était-elle inscrite comme fille publique sur les registres de la préfecture de police. Est-ce à titre d’ami de Comte, ou d’ancien ami de la mariée, que ce M. Cerclet est mentionné dans l’acte de mariage comme témoin ? Quoi qu’il en soit, Mme Comte fit à son époux des infidélités sans nombre, dont quatre fugues bien caractérisées, et l’une pour aller retrouver le témoin susdit. Cet état de choses dura dix-sept ans. Il jette un singulier jour sur le moral d’un homme, à qui Lamennais attribuait une belle âme, et qui s’est conduit dans le cas que je signale comme un simple dégénéré aurait pu le faire.
Les premiers rapports de Comte avec son maître ont été convenables. En voici la preuve bien connue. Dans une lettre à Valat, il s’exprime de la façon la plus élogieuse à l’égard de Saint-Simon :
« C’est le plus excellent homme que je connaisse, celui de tous dont la conduite, les écrits et les sentiments sont le plus d’accord et les plus inébranlables. Il est franc, généreux autant qu’on peut l’être. Son caractère est estimé par les hommes de toutes les opinions. Il voit fort loin et au-dessus de son siècle, c’est pour cela qu’on n’apprécie pas encore suffisamment ses idées. C’est l’homme le plus estimable et le plus aimable que j’aie vu de ma vie, celui de tous avec lequel je trouve le plus agréable d’avoir des relations. Aussi je lui ai voué une amitié éternelle ; et en revanche il m’aime comme si j’étais son fils ».
C’est le même homme qui, avec la pleine conscience des services rendus, dans une autre lettre à Valat, lui disait que sa liaison de travail lui avait révélé à lui-même une capacité politique, dont sans Saint-Simon, il ne se serait jamais douté.
Plus tard le langage change du tout au tout. Il méconnaît son véritable prédécesseur et dit descendre d’Aristote, de Descartes, de Leibniz et même de l’apôtre saint Paul, qui est pour lui le véritable fondateur du christianisme.
Que penser de Comte lorsqu’il osait ainsi parler de Saint-Simon : « La funeste liaison de ma première jeunesse avec un jongleur dépravé… Séduit par lui, vers la fin de ma vingtième année, mon enthousiasme, jusqu’alors appliqué seulement aux morts, me disposa bientôt à lui rapporter toutes les conceptions qui surgirent en moi pendant la durée de nos relations… Écrivain stérile, vague, superficiel. Toujours incapable de rien créer, il se bornait à refléter les inspirations extérieures, même dans ses aberrations… Son éclat passager constituera pour la postérité l’un des symptômes caractéristiques de notre anarchie mentale et morale, puisqu’il résulta seulement d’un charlatanisme effréné, dépourvu du tout vrai mérite… Je ne dus rien à ce personnage, pas même la moindre instruction ». Ces intempérances de langage, ce défaut de justice, dans les jugements, me paraissent concorder avec le défaut de sens moral qui est pour moi une des caractéristiques de Comte. À moins que la psychopathie profonde et durable de l’élève n’eût supprimé, chez lui, tout souvenir (cas d’amnésie) des éminents services que lui avait rendus le véritable père du positivisme, Comte a fait preuve envers lui d’une ingratitude inqualifiable, allant jusqu’à la disparition de toute conscience morale. M. Georges Dumas, moins sévère, l’accuse d’inconscience, sur le même chef. Je m’en tiens au défaut de conscience.
D’ailleurs, d’une manière générale les appréciations d’Auguste Comte, concernant les gens qui lui déplaisaient, n’observèrent plus la moindre réserve, sauf quand il se contentait de les appeler métaphysiciens, expression dont il ne paraît point avoir jamais bien saisi le sens exact. Hommes et choses étaient souvent l’objet d’outrages les moins mérités et souvent les plus calomnieux. Ces intempérances de langage, ce défaut de justice, dans les jugements, me paraissent aussi concorder avec le défaut de sens moral propre à Comte.
Ce défaut de sens moral est, on ne peut plus manifeste, quand il parle de Jésus-Christ qu’il accuse d’avoir manifesté un mélange d’hypocrisie et de fanatisme, ajoutant que saint Paul, pour fonder le christianisme, dut se subordonner à un aventurier monothéique. Le même Comte prétend que les chrétiens s’attribuèrent le privilège du pardon des injures, solennellement démenti par leur divin modèle, proscrivant à jamais toute la nation juive pour venger une seule victime.
Or quelle fut la prière adressée par Jésus-Christ à son Père céleste ? Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font. Telles furent les paroles qui sortirent de ses lèvres. Ainsi Comte se montre, non seulement insensible à la grandeur morale du Christ, dans l’ensemble de l’exercice de son ministère, mais encore il le calomnie bien gratuitement et probablement sans s’en douter. Il devait ignorer les Écritures aussi profondément que la philosophie elle-même, peut-être même davantage, et ce n’est pas peu dire.
Comte a eu la prétention de créer une philosophie fondée sur le sens commun ; il en parle à plusieurs reprises. Or s’il est une chose qui lui ait manqué, très particulièrement dans sa Politique, qui est son œuvre sociologique par excellence, c’est surtout le sens commun. N’a-t-il point fait de toutes les sciences, les mathématiques comprises, des œuvres d’amour ! N’a-t-il point proclamé la supériorité de la logique, du sentiment sur la logique rationnelle ? N’a-t-il point voulu faire du mariage un exercice à la fois très tendre, mais purement sentimental, d’où son hypothèse des vierges mères se fécondant elles-mêmes par un procédé nouveau ? N’est-il point retombé dans un complet fétichisme par son adoration de la Trinité, dite positive, comprenant le grand Être (l’humanité), le grand Fétiche (la terre) et le grand Milieu (l’espace) ? N’a-t-il point admis un grand Être spécial, au moins pour les espèces animales les plus élevées ? Et parmi les animaux, n’a-t-il point agrégé les meilleurs d’entre eux à l’humanité, pendant qu’il bannissait du sein de cette dernière les hommes ne lui faisant point honneur. Toutes ces idées étranges ne sont-elles point frappées au coin de l’absurdité. Il ne s’agit point de manie, la chose est évidente ; ce ne sera pas même, si l’on veut, de la folie raisonnante, mais de pareilles idées sont le propre d’un homme dénué de tout bon sens, en un mot d’un détraqué. Il me semble d’ailleurs, que lorsque M. G. Dumas parle d’un état nerveux psychopathique, durable et profond, cela implique un trouble mental durable et profond. Cela me suffit pour la thèse que je développe, en ayant soin d’ailleurs d’appuyer mon dire sur deux citations que j’emprunte à l’excellent ouvrage de M. le professeur Régis, bien connu comme un éminent aliéniste.
« L’action des causes occasionnelles, morales ou physiques, sur le développement de la folie, est incontestable, mais elle ne doit pas être exagérée, et il faut bien savoir que, sans une prédisposition déjà existante, sans le concours de la semence et du terrain, comme dit M. Ball, cette action resterait inefficace ».
Or, Comte a été fou ; il a été atteint de manie et traité pendant un an par Esquirol. Dans son cas, il y a dû avoir, comme pour tout le monde, la semence et le terrain. La semence concerne sa digne et chaste épouse. Le terrain le concerne personnellement.
Sans être atteint d’une nouvelle manie, mais après avoir été sérieusement éprouvé, au point de vue psychique, Comte, arrivé à la période religieuse, c’est-à-dire mystique de son existence, a présenté des hallucinations qui lui remettaient sous les yeux sa chère, sa divine Clotilde, qui était pour lui le pur et véritable symbole de l’humanité, ou plutôt, dans celle-ci, c’était bien toujours Clotilde qu’il adorait. Ces hallucinations étaient provoquées par certains moyens dont se servait Comte, et qui, pour d’autres se portant bien, pourraient posséder la même efficacité, du moins on a pu le croire.
L’exemple donné par Comte d’un homme qu’on dit parfaitement sain et doué du pouvoir de s’halluciner, moyennant certains artifices, pouvant ne pas paraître suffisamment démonstratif, je vais faire encore appel à l’ouvrage déjà cité de M. Régis :
« L’hallucination n’est qu’un élément symptomatique de la folie qu’elle ne suffit pas à elle seule à constituer. Au reste, l’hallucination peut, dans certains cas, exister sans folie, et il est dans le monde des gens sensés qui sont sujets, surtout au moment du passage de la veille au sommeil (hallucinations hypnagogiques), à des hallucinations qu’ils apprécient très sainement. Toutefois, ces hallucinations ont été appelées à tort physiologiques. L’hallucination est toujours un phénomène morbide ». S’il en est ainsi, la diathèse morbide de Comte, son état nerveux psychopathique ou phrénopathique profond et durable, me paraît une explication suffisante du succès qu’il obtenait en matière d’hallucinations.
De par l’état nerveux psychopathique, de par son mysticisme messianique, de par un amour sans mesure qui le régénéra lui-même et qui lui fit changer, d’ailleurs, dans la politique, à ce qu’il reconnaît, le point de vue du cours, il est survenu une transformation absolue de la conception primitive de la doctrine. Comte n’en est point convenu, il a même prétendu tout le contraire et ses affirmations ont trouvé un accueil favorable, chez quelques-uns de ses admirateurs, par exemple M. Lévy Bruhl et M. Brunetière. Quelques-uns de ses élèves, néanmoins, refusèrent de le suivre jusqu’au bout de ses égarements. Je puis citer entre autres Littré, qui avait révélé le prétendu descendant d’Aristote, de Bacon, de Descartes, de Leibniz au monde scientifique. Je puis citer aussi M. de Blignières, auteur d’un livre sur la doctrine positiviste. L’orgueil de Comte était immense, il se considérait comme le souverain pontife de sa religion, voyait son image dans le Panthéon et aspirait à remplacer Napoléon sur la colonne Vendôme. Toute contradiction lui était odieuse et les sentiments qu’il dut d’abord éprouver, envers les disciples de sa première manière, furent changés du tout au tout. À l’égard de Littré, voici comment il s’exprime : « … celui de l’incohérente coterie graduellement formée du concours spontané de tous les faux positivistes, nominalement groupés autour du rhéteur usé que le positivisme a passagèrement décoré d’une auréole de penseur ». Quant à M. de Blignières, qu’il a dit antérieurement être un de ses meilleurs disciples, travaillant sérieusement à devenir prêtre de l’humanité, des mieux doués par les qualités du cœur et de l’esprit, il rompt avec lui dans les termes suivants : « D’après la corvée exceptionnelle (la lecture du livre de de Blignières) que j’ai scrupuleusement accomplie, je regrette de vous avoir traité d’avorté : l’expression était trop indulgente, car l’avortement suppose la fécondation, tandis que le mot vraiment convenable est finalement stérilité ». À la fin de cette diatribe, il dit enfin : « Des outrages analogues à ceux de vos ignobles lettres ». Ces Messieurs avaient commis un crime de lèse-majesté vis-à-vis du représentant de l’humanité dans ce monde, le chef auguste, de la religion définitive. Toute parole de lui devait être crue sans examen, car il était, lui, le pape d’un nouveau catholicisme.
Toutefois, dans les dernières années de sa vie, Comte, qui avait pris l’Imitation de Jésus-Christ pour sa lecture de tous les jours, sous l’influence probable du mysticisme dont il se nourrissait, et par défaut d’aliments suffisants, avait pris, dit-on, un aspect très particulier de douceur et de débonnaireté. Il paraît, par ses lettres à de Blignières, écrites peu avant sa mort, qu’il suffisait de lui gratter un peu l’épiderme pour le rendre à sa véritable nature. Le Messie psychopathique n’était point doux et humble de cœur comme le Messie du Christianisme, pour lequel, d’ailleurs, il n’éprouvait aucune sympathie. Jalousie de métier.
Il y a, nous l’avons vu une similitude incontestable et le plus souvent une identité complète entre le positivisme du maître et celui de l’élève, mais celui-ci, blessé dans son orgueil indomptable par le fait de la rupture survenue malgré la cordialité et l’intimité des premiers rapports, prétendit s’attribuer l’ensemble de la doctrine qui l’avait mis sur la voie des études sociologiques. Il imita donc en se l’appropriant le système de Saint-Simon dans sa grande généralité, et par cela seul qu’il ne lui rendait point justice, il conçut contre lui une haine qui ne fit que s’accroître avec les années. À mesure que, sous une forme différente, il développait la doctrine positiviste, plein d’admiration pour son propre génie, le rôle de messie lui parut fait pour sa taille. D’où nouveau motif de haine jalouse pour celui qui l’avait devancé dans semblable carrière. C’était encore une imitation, et, l’état psychopathique ou d’affection mentale aidant, il insulta au-delà de toute mesure la mémoire de celui qui avait été son ami et un bon père spirituel. Une autre imitation c’est d’avoir été dans une maison d’aliénés, une autre imitation c’est une tentative de suicide. Une dernière imitation c’est d’avoir imaginé une religion nouvelle, nouveau catholicisme et nouveau spiritualisme d’après Comte, pareille tentative rappelant le nouveau christianisme de Saint-Simon. Or, ce serait parce que celui-ci, au dire de l’élève, avait témoigné des velléités religieuses que lui-même se serait séparé du maître.
Tarde n’aurait-il pas pu dire que Comte avait l’esprit d’imitation très développé, et que cet esprit a été la cheville ouvrière de son existence ?
J’en ai dit assez déjà pour prouver que Comte n’était point comme caractère une nature d’élite. De tout temps plein de lui-même, il éprouvait les sentiments les plus hostiles contre tous ceux qui lui avaient fait quelque opposition. Cet état d’esprit sembla s’exagérer encore quand ce nouveau messie parut comme atteint d’une espèce de délire des grandeurs. On sait qu’aux jours de sa jeunesse il avait un tel respect pour les corps savants qu’il voulait charger l’Académie des sciences des fonctions de pouvoir spirituel, devant prendre la place et de la théologie et de la métaphysique. Cela dit, je cite quelques-unes de ses appréciations.
« L’établissement de l’Académie des sciences, due à Colbert, est un premier pas vers l’organisation d’un pouvoir spirituel ». À l’époque de la Convention, les Jacobins représentaient une ébauche du pouvoir spirituel. « Les savants occupés des sciences d’observation sont les seuls qui remplissent les conditions nécessaires pour réaliser cette organisation ».. Donc le système à constituer le pouvoir spirituel sera entre les mains des savants et le pouvoir temporel appartiendra aux chefs des travaux industriels « Les savants sont très inférieurs à la doctrine ». « Vices intellectuels et moraux rendant d’ordinaire les savants actuels profondément indignes d’aucune haute mission sociale ». « Dégradation morale et mentale des savants actuels ».
Or il y avait alors en France des savants qui s’appelaient Arago, Cauchy, Ampère, Cournot, Duhamel. Un homme ayant quelque sens moral, ou seulement quelque sens commun pouvait-il parler de la sorte ?
Je reprends mes citations.
« Tout ce que la Convention avait détruit doit être aujourd’hui supprimé définitivement, sans excepter les académies même scientifiques, dont la funeste influence mentale et morale a tant justifié depuis leur restauration, la sage abolition initiale ». « La religion de l’humanité exige aujourd’hui l’abolition radicale du régime académique, comme étant à la fois immoral et irrationnel, surtout en France ». « Il faut ôter les sciences aux purs savants, en brisant avec énergie le régime académique ». « Une dictature énergique peut supprimer le budget universitaire, l’Université et ses corporations métaphysiques, institutions abrutissantes et corruptrices. Les écoles spéciales (il indique quelque part, comme écoles à supprimer, les écoles d’artillerie et de la marine), pourraient toutes disparaître aujourd’hui, sauf les écoles vétérinaires, sans compromettre aucun service public et privé ». « La dictature dantonienne nous avait dignement délivré des compagnies scientifiques, lesquelles corrompent directement l’intelligence. Ni le clergé, ni même l’Université ne font autant que l’Institut, et surtout l’Académie des sciences, dévier la jeunesse française des dispositions synthétiques et sympathiques qu’exige sa mission actuelle. L’Académie des sciences, corporation aussi rétrograde qu’anarchique… ses ravages intellectuels et moraux ». « La marche générale de la réorganisation spirituelle exigera certainement, surtout en France, l’entière abolition préalable du vain simulacre d’éducation publique que le passé nous a transmis, et de l’étrange corporation universitaire qui s’y rattache ». « La science aujourd’hui compatible avec le charlatanisme, surtout chez les géomètres. Vices intellectuels et moraux des savants actuels, profondément indignes d’aucune haute mission sociale ».
Tous ces outrages portant à faux, ce qu’on peut dire de plus favorable pour Comte, c’est que la psychopathie, ou affection mentale dont il était atteint, lui avait enlevé toute la part de bon sens, si restreinte fût-elle, dont la nature avait pu le gratifier.
La médecine a aussi sa part d’outrages.
« Le sacerdoce doit compléter son domaine normal en y joignant l’office médical, dont la séparation provisoire a graduellement produit une dégénération mentale et morale qui rend urgente sa réintégration au sacerdoce. Une vénalité monstrueuse s’y combine avec une irrationnelle spécialité ». « Redevenues subalternes, les fonctions chirurgicales seront transférées à leurs meilleurs organes les constructeurs d’instruments, à ce préparés par leur éducation encyclopédique. La même préparation permettra de réserver les autopsies humaines au terrible fonctionnaire, institué par l’humanité, pour l’extirpation des meurtriers, dont les corps suffiront aux vrais besoins de la science régénérée ».
Impossible d’être plus étranger que Comte aux choses dont il parle. Il ignore les questions, mais il en raisonne.
« Nos prétendus médecins ne constituent réellement que des vétérinaires, mais plus mal élevés que ceux-ci ne le sont maintenant, du moins en France, et dès lors aussi peu capables de guérir les animaux que les hommes ».
C’était aux Gendrin, aux Trousseau, aux Andral, aux Velpeau, aux Rostan, aux Rayer, aux Beau, que s’adressaient de pareilles injures ! Ils n’en furent, il est vrai, jamais atteints, ces injures retombant de tout leur poids sur celui qui les avaient proférées.
Quant à l’appréciation de l’École normale, l’outrage y disparaît, mais la fausseté du jugement n’est pas moindre.
« Rien ne saurait être plus irrationnel que la moderne institution française, si étrangement qualifiée de normale, par un naïf orgueil métaphysique où l’on se propose directement d’enseigner dogmatiquement l’art même de l’enseignement, sans être nullement choqué du cercle profondément vicieux ( ?) qui résulte aussitôt d’une pareille prétention ».
Académies, Université, sciences et enseignement, dans les personnes qui les représentent avec une autorité que ne posséda jamais celui qui en dit tant de mal, par colère, rancune et insuffisance de jugement, tel est le spectacle auquel nous venons d’assister. Toutefois je rappelle, pour être équitable, que les vétérinaires ont trouvé grâce devant ses yeux.
Il n’en a pas été de même pour le journalisme. En voici la preuve.
« Tendance générale de la doctrine positive qui vient spontanément éteindre le journalisme. En terminant l’interrègne spirituel, la religion positive fera naturellement cesser l’usurpation qu’il suscita chez les lettrés Occidentaux. Le sacerdoce de l’humanité doit donc s’interdire toute participation à l’institution qu’il devra bientôt flétrir comme radicalement anarchique ».
Il n’en a pas été de même, non plus, pour les avocats et les littérateurs, dirigeant d’ordinaire la politique rétrograde, d’après Comte : « Quoi qu’il en soit, si une telle phase ne devait pas être nécessairement passagère, elle constituerait, ce me semble, la plus honteuse dégénération sociale, en investissant, à jamais, de la suprématie politique des classes aussi évidemment vouées par leur nature, à la subalternité, dans tout ordre vraiment normal ».
Maintenant voici la part faite au théâtre : « Le positivisme doit irrévocablement éteindre l’institution du théâtre, autant irrationnelle qu’immorale ».
Et enfin celle des livres : « Le véritable positiviste pourra, même dans le clergé, réduire sa bibliothèque à cent volumes. Aux dix tomes qui condensent toute la philosophie (celle de Comte), on en joindra vingt de poésie, plus autant pour l’ensemble des notions concrètes envers les données pratiques, la description des êtres et la connaissance du passé. La seconde moitié du recueil positif sera consacrée aux monuments dignes, par leur valeur originale, de survivre à la destruction systématique des immenses amas qui maintenant compriment ou pervertissent la pensée ».
Si Comte avait été à la tête des hordes musulmanes qui, sous les ordres du calife Omar, envahirent l’Égypte et brûlèrent, dit-on, tous les livres de la bibliothèque d’Alexandrie, ils n’auraient pas eu avec lui un meilleur sort. Que penser du jugement d’un homme capable, en plein XIXe siècle, de tenir le langage que je viens de citer ?
« Le positivisme n’hésitera point à placer la tendresse du cœur féminin au-dessus de la pureté.
Le peuple parisien chargé des communes destinées de l’Occident.
Phase dictatoriale seule vraiment française.
Désormais, plus de rétrogradation monarchique.
Unique interprète de l’avenir et du passé, Comte affirme qu’aucun Dictateur ne conservera la tendance monarchique.
La situation républicaine actuelle permet et exige la Dictature.
La connaissance de l’homme intellectuel et surtout moral n’a fait aucun progrès depuis la fin du Moyen Âge. Altération grave à beaucoup d’égards, sauf chez les principaux mystiques.
Les aperçus systématiques de l’éminent Vico, suivi du travail incohérent de Montesquieu.
Anarchie moderne. Dictature temporelle. Abolition à jamais du système parlementaire.
Les meilleures institutions du Catholicisme : le Purgatoire, le Culte des Saints et surtout l’Adoration de la Vierge, véritable Déesse des cœurs méridionaux.
La Métropole humaine (Paris) appartiendra bientôt aux Positivistes.
Les positivistes tellement appelés à dominer l’Occident qu’ils doivent déjà préparer leur dictature.
La crise dictatoriale de 1851 que les positivistes religieux seront seuls à juger comme la postérité.
Quand l’âme incorporée peut assez améliorer l’un des cerveaux qui la font revivre.
La maturité de la raison humaine complétant la positivité par la féchitivité.
L’Instinct sexuel ne concourt que d’une manière accessoire et même équivoque à la propagation de l’Espèce. L’Éducation positive fera partout sentir les vices d’un tel instinct.
Les femmes ne constituent point une classe ; elles ne doivent jamais être envisagées collectivement.
La Compagnie tristement fameuse qui s’en rendit l’organe naturel ne put alors que joindre à la haine insurmontable qu’elle avait inspirée le plus irrévocable mépris, justement acquis désormais à une congrégation où la plus ignoble hypocrisie dispensait si souvent de mérite et même de moralité ».
(Je ne mentionne ce passage que pour montrer le changement si considérable du Comte des derniers temps. On sait qu’il envoya un ambassadeur, disons mieux un légat au général des Jésuites, pour lui offrir son alliance contre les protestants et les libres penseurs).
Extrême imperfection de l’ordre si vanté de la nature. « Chacun sent aujourd’hui que les ouvrages humains, depuis les simples appareils mécaniques jusqu’aux sublimes constructions politiques sont, en général, très supérieurs, soit en convenance, soit en simplicité, à tout ce que peut offrir de plus parfait l’économie qu’il ne dirige pas, et où la grandeur des masses constitue seule ordinairement la principale cause des admirations antérieures ».
Cournot qui, lui, avait l’esprit droit et le jugement sain, professe une opinion précisément contraire : « Quelles combinaisons du génie humain pourraient soutenir la comparaison avec les créations de la nature ? (Essai sur les fondements de nos connaissances, II, p. 19) ».
« Les phénomènes humains sont nécessairement ceux auxquels la prévision rationnelle s’applique le mieux, vu la continuité qui distingue les conceptions sociologiques ». C’est le contraire de la vérité. Les prophéties de Comte en sont une preuve catégorique.





























