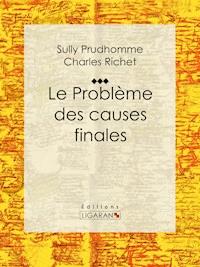
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au premier abord, rien ne semble plus enfantin que la théorie des causes finales, et il est facile de la tourner en ridicule. Le nez, disait Voltaire, est fait pour porter des lunettes. Il est certain que parfois les affirmations de beaucoup de finalistes sont plaisantes. Galien, dans son admirable livre sur l'utilité des parties, trouve une cause précise à tout ce qu'il raconte en anatomie ou en physiologie."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067149
©Ligaran 2015
L’origine de ce livre est un article publié par M. Charles Richet dans la Revue scientifique, où la théorie des causes finales était sommairement abordée. M. Sully Prudhomme, dans cette même Revue, répondit et donna une série d’articles, où le problème était envisagé sous divers points de vue et avec plus de développement. Puis M. Charles Richet formula une sorte de conclusion à laquelle M. Sully Prudhomme ajouta un commentaire et une conclusion dernière. Ce sont ces articles en forme de lettres que nous publions ici.
Il ne faut donc pas s’attendre à trouver dans cet ouvrage une étude méthodique, encore moins une solution arrêtée de ce vaste problème. On ne prétend y exposer qu’un échange de vues, peut-être suggestives, en tout cas très peu dogmatiques.
Cette prétention modeste ne saurait appeler que l’indulgence du lecteur.
PAR CHARLES RICHET
Au premier abord, rien ne semble plus enfantin que la théorie des causes finales, et il est facile de la tourner en ridicule. Le nez, disait Voltaire, est fait pour porter des lunettes. Il est certain que parfois les affirmations de beaucoup de finalistes sont plaisantes. Galien, dans son admirable livre sur l’utilité des parties, trouve une cause précise à tout ce qu’il raconte en anatomie ou en physiologie. Bien que quantité de faits allégués par lui soient étrangement erronés, il n’est jamais embarrassé pour leur inventer quelque raison d’être. Fénelon se livre aussi à cet égard à d’assez vaines dissertations. « Si l’air était moins dense, on ne pourrait pas respirer… Si l’air était plus dense, on ne pourrait pas marcher… » Bref, en général, la théorie des causes finales, par suite d’exagérations invraisemblables, est en discrédit auprès des biologistes.
Il se trouve même de fort bons esprits qui la considèrent comme une superstition indigne d’être mentionnée dans une philosophie scientifique.
Et en effet, en donnant une importance prépondérante aux causes finales, on risque de tomber dans un grossier anthropomorphisme. Prétendre que la terre a été faite pour l’homme, et que les animaux et les végétaux sont là pour notre usage ; que le soleil a pour destination de nous donner lumière et chaleur, que, pour éclairer nos nuits, la nature prévoyante a mis des étoiles à la voûte du ciel, et un astre luminaire qui empêche l’obscurité d’être profonde, ce sont là opinions qui sont d’un assez bon comique, et on a beau jeu de railler ces conceptions puériles.
Il est évident que l’homme est peu de chose sur la terre ; que la terre est un petit atome dans le monde solaire ; et que le monde solaire est un imperceptible atome dans l’immensité de l’espace. Ce sont là vérités qu’on enseigne à l’école primaire, et sur lesquelles il n’est pas besoin d’insister. De sorte que toute théorie qui à l’espace, à la matière et aux forces matérielles, chaleur, attraction, lumière, électricité, donne cette cause misérable, l’homme, mérite sans doute d’être étouffée sous le ridicule de notre exiguïté.
Et quand nous parlons de l’homme, nous entendons aussi tous les êtres animés. Les lois mathématiques, connues ou inconnues, qui gouvernent la matière n’ont pas à se préoccuper des êtres vivants, cet accident. Elles nous ont permis d’exister. Voilà tout. Mais, quant à supposer qu’elles existent à cause de nous, c’est une présomption extraordinaire que notre vanité humaine explique et ne justifie pas. Qu’importe à Sirius, dit-on parfois ? Eh ! oui, vraiment, qu’importe à Sirius qu’il y ait sur notre planète des oiseaux, des poissons, des insectes, des mousses, des chênes ou des hommes ?
Le monde est tellement vaste, et nous en connaissons un si petit fragment, qu’il serait déraisonnable de tenter de l’expliquer. Avec notre chétive raison, comment pénétrer les causes – nous ne disons pas les lois – de cet univers ? Quelques lambeaux de vérité apparaissent par-ci, par-là, arrachés aux ténèbres, par nos efforts. Mais ces lambeaux, qui nous pénètrent d’admiration, ne sont rien à côté de tout ce qui nous est fermé. Comment alors se permettre de juger la cause finale de l’univers ?
Notre ignorance est tellement profonde que je la comparerais volontiers à celle d’un spectateur qui, ayant fait une piqûre d’épingle au rideau d’un théâtre, va se mettre au fond de la salle, et de là s’imagine pouvoir juger la pièce qui se joue derrière le rideau, en regardant par le trou d’aiguille. Et certainement nous en connaissons beaucoup moins sur l’univers que ce spectateur n’en pourra connaître sur la pièce que le rideau lui dissimule.
Il faudrait tout savoir pour oser parler d’une finalité. Or, loin de tout savoir, nous ne savons rien.
Les peuples enfants ont conçu l’homme comme un être prédestiné pour lequel des dieux, ou un Dieu, ont tout fait. Toutes les choses, animées ou inertes, sont des présents que Dieu a faits à l’homme ou aux êtres vivants. C’est là la base de toutes les cosmogonies, et, quoique de telles légendes flattent notre amour-propre, nous devons les abandonner aux mythologies des temps préhistoriques.
Ainsi la matière n’a pas été créée pour l’homme ; les forces de la nature n’ont pas été créées pour l’homme ; les lois de la chimie et de la physique ne sont pas faites pour que l’homme puisse vivre. Nous croyons même que jamais l’intelligence humaine ne pourra comprendre le pourquoi des lois naturelles qui régissent la matière, même si, dans un temps plus ou moins éloigné, nous arrivons à comprendre le comment de quelques-unes de ces lois.
Mais cette impuissance de notre intelligence à saisir la cause du monde dans son immensité ne s’étend pas à toutes les parties de ce monde. En effet, le règne animé, végétal ou animal, à côté de l’univers, est un microcosme dont nous pouvons préciser quelques-unes des plus essentielles manifestations. Les botanistes et les zoologistes ont, à très peu d’exceptions près, décrit et classé les diverses formes des êtres vivants. L’anatomie et la physiologie ont éclairé maintes fonctions de ces êtres, et il semble bien que de cette étude une vue d’ensemble se dégage, avec la connaissance de quelques principes directeurs qui nous permettent d’être moins réservés que lorsqu’il s’agit des lois cosmiques.
Certes cette notion de quelques faits de détail ne nous permettra pas de savoir pourquoi il y a la vie. Quelque présomptueux que nous supposent les ennemis des causes finales, notre présomption ne va pas jusque-là. Mais, si nous ne savons pas pourquoi la vie existe, pourquoi il y a des êtres vivants, au moins pouvons-nous fort bien concevoir pourquoi telle forme de vie existe, et donner une explication, erronée ou non, vraie ou non, ingénieuse ou téméraire, mais passable en somme, de certaines particularités dans l’organisation ou la fonction des êtres.
Cette finalité première est même tellement évidente a priori qu’on ne peut guère songer à la nier. Les plus acharnés adversaires de toute téléologie doivent donc se ranger à notre opinion, au moins dans certains cas.
Par exemple, est-il possible de nier que l’œil ne soit affecté à la vision ? Ce serait, à mon sens, tomber dans un excès fantastique d’absurdité que de supposer qu’il n’y a pas un rapport de cause à effet entre l’œil et la vision. Ce n’est pas par hasard que l’œil voit. Il y a tout un agencement de parties, tout un mécanisme merveilleux, dans l’ensemble et dans les détails les plus minuscules, qui nous permet de dire avec certitude : l’œil est fait pour voir.
Je ne crois pas qu’on puisse se soustraire à cette nécessité. L’adaptation de l’œil à un but, qui est la vision, s’impose à nous avec une telle force que les sophismes les plus subtils ne pourront ébranler l’opinion de personne, voire celle des sophistes eux-mêmes.
On ne s’attend pas assurément à ce que je donne ici un exposé de l’anatomie et de la physiologie de l’œil ; mais cet exposé, même dans ses plus petites parties et dans ses considérations les plus techniques, ne serait, à vrai dire qu’un commentaire de cette simple proposition : L’œil a été fait pour voir.
Nous avons pris l’œil comme exemple ; mais nous aurions aussi bien pu prendre tout autre organe : l’oreille par exemple, ou le cœur, ou l’estomac, ou le cerveau, ou les muscles. Qui donc pourrait empêcher le physiologiste de prétendre que l’oreille a été faite pour entendre, le cœur pour lancer le sang dans les parties, l’estomac pour digérer, le cerveau pour sentir et percevoir, les muscles pour produire du mouvement ? L’adaptation de l’organe à la fonction est tellement parfaite que la conclusion s’impose d’une adaptation non fortuite, mais voulue.
Même dans les plus petits mécanismes, cette adaptation est extraordinaire : En anatomie, à chaque instant, on donne des raisons, qui me paraissent le plus souvent fort plausibles, pour expliquer la disposition de tel ou tel appareil. Par exemple, j’admets parfaitement qu’on fasse remarquer que le globe oculaire est protégé par l’arcade orbitaire, saillante et résistante ; par les paupières, mobiles et rapides dans leurs mouvements ; par les cils, qui défendent contre les poussières ; par la sensibilité délicate de la conjonctive, qui provoque un réflexe immédiat.
Ce ne sont pas là seulement des moyens mnémotechniques : c’est l’expression, selon moi, d’une réalité. Dire que l’œil est bien protégé contre les traumatismes, c’est énoncer non une théorie ou une hypothèse, mais bien un fait.
Et en effet, il n’y a que trois manières possibles de s’exprimer là-dessus : ou dire que l’œil est bien protégé ; ou dire que l’œil est mal protégé ; ou ne rien dire du tout. Dire que l’œil est mal protégé, cela est manifestement déraisonnable ; et quant à ne rien dire du tout, sous prétexte qu’en déclarant l’œil bien protégé on tombe dans la théorie des causes finales, c’est témoigner une prudence qui n’est pas de la prudence, mais une pusillanimité enfantine.
La physiologie, comme l’anatomie, nous montre une extraordinaire complexité dans le jeu des parties. Par exemple, pour entrer dans le détail, lorsqu’un corps étranger irritant vient toucher la muqueuse laryngée, cette excitation des nerfs laryngés va aussitôt, par un réflexe d’arrêt, provoquer la toux et suspendre l’inspiration. Est-ce que le physiologiste qui enseigne et étudie la physiologie n’a pas le droit, et même le devoir, d’indiquer que cette toux réflexe n’est pas sans cause ? Au contraire, il doit hardiment proclamer que cette toux réflexe a une cause finale, et une cause finale qui paraît bien évidente. Il faut que l’objet étranger soit expulsé au moyen d’une expiration violente ; il faut que, si cette expiration est sans effet, la respiration s’arrête, afin qu’une inspiration nouvelle ne fasse pas descendre profondément dans les bronches l’objet offensif.
Je pourrais citer une centaine d’exemples analogues, et plus encore peut-être ; car la physiologie tout entière n’est guère que la méthodique explication de ces divers mécanismes protecteurs. Quand un animal est asphyxie, le cœur se ralentit par l’effet du nerf pneumogastrique qui exerce son action modératrice. Or, si l’on coupe les pneumogastriques, le ralentissement du cœur ne se produit pas, et l’asphyxie est beaucoup plus rapide. Quand il fait cet exposé à ses élèves, le professeur de physiologie a bien le droit de leur dire que le nerf pneumogastrique a un rôle de défense, de protection dans l’organisme.
Non seulement le professeur doit enseigner ainsi, mais le savant doit faire la même observation ; car il est absurde de supposer une coïncidence fortuite entre l’intégrité du pneumogastrique et l’asphyxie plus lente.
La machine animale est comme un merveilleux appareil automatique dont toutes les parties ont un usage. Cela est si vrai que, lorsqu’on n’est pas arrivé à découvrir la fonction d’un organe, on s’obstine à la chercher. Nous ne savons pas du tout quel est l’usage de la rate. Les animaux dont la rate a été enlevée se portent aussi bien que des animaux intacts, et ils vivent des mois, et même des années, en un état de santé parfait. Faut-il conclure que la rate est inutile ? On ne trouverait peut-être pas un physiologiste pour soutenir cet étrange paradoxe. Nous continuerons donc à chercher quelles peuvent être les fonctions de la rate, tellement l’étude des autres parties du corps nous a appris que chaque organe était affecté à une fonction déterminée.
Jusqu’à ces dernières années on ignorait l’usage de la thyroïde, des capsules surrénales, du thymus et d’autres glandes ; mais on a pu en découvrir la fonction, de sorte que l’hypothèse d’organes inutiles devient de plus en plus problématique, ou, pour mieux dire, insoutenable. La Nature (qu’on écrive ce mot nature ou Nature, peu importe), la Nature n’a pas fait d’organes inutiles, et tout a un but.
Les zoologistes sont finalistes tout autant que les physiologistes peuvent l’être ; et dans bien des cas ils ont donné la raison d’être de certaines particularités de structure.
Le mimétisme, c’est-à-dire la ressemblance de l’être vivant avec le milieu dans lequel il vit, n’est certainement pas un phénomène fortuit. Il est en rapport avec la défense de l’être.
Lorsqu’on prend un crabe par la patte, il sectionne lui-même cette patte par une brusque contraction (autotomie), de manière à pouvoir s’enfuir et se libérer de son envahisseur. Est-ce là un phénomène fortuit, et comment n’y pas voir un fait de défense ?
Lorsque le poulpe est surpris par un ennemi, il verse un flot d’encre pour faire l’obscurité autour de lui. Est-ce par hasard que ce liquide est noir ? N’avons-nous pas le droit de soutenir que cette émission d’encre est en rapport avec la protection ?
Des livres excellents ont été publiés, riches en détails intéressants, sur les moyens de défense des animaux. Or, toutes les fois qu’on fait l’histoire de ces procédés de protection, on tombe forcément dans un système finaliste, puisqu’on est amené à dire que les diverses fonctions de défense ont pour but la sauvegarde de l’organisme attaqué.
Que nous puissions rendre compte de tout, il s’en faut assurément, et nous avons quelque peine à expliquer quantité de lois naturelles. Pour prendre un exemple entre mille, pourquoi la coloration des poissons qui vivent à des profondeurs que la lumière n’atteint pas ? Il est d’étonnants instincts dont la cause nous échappe. Mais point n’est besoin, pour accepter l’hypothèse finaliste, de tout saisir, dans ce microcosme, si vaste encore, du monde vivant planétaire. Il suffit d’avoir de-ci de-là quelques indications générales, sommaires, qui peuvent servir de jalons à une théorie plus générale.
Je suis donc absolument convaincu qu’il n’est pas possible de supprimer la théorie des causes finales de l’anatomie, de la zoologie ou de la physiologie. Le tout est d’en faire un usage modéré ; car, je le reconnais, il s’agit toujours d’une hypothèse, si vraisemblable qu’elle soit. Lorsqu’on dit : l’œil a été construit pour la vision ; l’iris, pour l’accommodation ; la cornée et le cristallin, pour la réfraction ; la rétine, pour la perception, on fait une hypothèse. En réalité, pour ne faire aucune hypothèse, on devrait dire : l’œil sert à la vision, l’iris à l’accommodation. Mais la perfection de l’instrument est si admirable qu’on a bien le droit d’y voir l’affectation à un usage déterminé.
Allons plus loin encore ; car, dans la recherche des causes finales, le détail ne suffit pas. Nous venons de voir qu’il serait ridicule de ne pas supposer aux organes une fonction, une adaptation, un but bien déterminé. Il faut maintenant chercher si, dans l’ensemble, les êtres vivants ont de grandes fonctions générales adaptées à un but.
Là, encore il me paraît qu’il est impossible de se refuser à admettre une cause finale.
Voici, par exemple, l’instinct de la reproduction, dont la force est prodigieuse, qui détermine les actes de quantité d’êtres avec une énergie sauvage que rien n’arrête. Dira-t-on que cet instinct de reproduction n’a pas une utilité, un but ?
Cet instinct irrésistible est absolument nécessaire à la vie de l’espèce, et on ne comprendrait pas la prolongation de la vie à la surface de la terre si cet instinct venait à faire défaut. La vie terrestre alors est-elle une conséquence ou un but ? C’est là le seul point litigieux entre les partisans et les adversaires des causes finales.
Les uns diront que la vie persiste parce qu’il y a un instinct et des fonctions de reproduction ; les autres diront qu’il y a un instinct et des fonctions de reproduction pour que la vie existe.
Pour moi, en voyant les moyens, à la fois minutieux et puissants, que la Nature a mis en œuvre pour assurer la perpétuité de l’espèce, je ne peux pas supposer que ces extraordinaires et compliqués mécanismes, d’une harmonie prodigieuse, soient l’effet du hasard. J’y vois là une volonté très arrêtée, comme un parti pris, en vue d’un résultat.
Si nous ne faisons pas cette hypothèse que la Nature a voulu la perpétuité de l’espèce, et qu’elle a pris quantité de moyens pour l’assurer, nous ne comprenons plus rien ; mais tout s’éclaire subitement si nous admettons que la Nature a eu un but, qui a été d’assurer la vie de l’espèce.
Ce qui est vrai des sentiments d’attraction est vrai aussi des sentiments de répulsion. J’ai cherché à trouver la raison d’être, autrement dit la cause finale, des sentiments répulsifs, tels que le dégoût, la peur, la douleur, et il m’a paru que ces sentiments répulsifs sont en rapport avec la destinée des êtres, qui est de vivre.
Autrement dit, de même que l’amour, pour la vie de l’espèce, est utile et nécessaire, de même la peur, le dégoût et la douleur, pour la vie de l’individu, sont utiles et nécessaires.
La peur, c’est la crainte de l’objet inconnu ou nouveau ; c’est la fuite devant un bruit violent ou un objet monstrueux. Par la fuite, l’être effrayé se soustrait au danger. Un être qui ne serait accessible à aucune sorte de peur ne mènerait pas bien loin son existence. Si l’huître qui bâille au rocher referme subitement ses valves quand l’ennemi approche, c’est sans doute parce qu’elle éprouve un sentiment voisin de la peur. N’est-ce pas ainsi qu’elle se protège ? Vraiment, que deviendrait-elle si elle n’avait pas peur ?
C’est une protection aussi que le vertige, ou peur des abîmes, qui nous empêche de nous avancer dans les chemins dangereux, surmontant des précipices. Et il me semble bien qu’on a le droit de conclure que la peur, dans ce cas, est un sentiment utile, car son efficacité protectrice n’est pas douteuse.
Si le lièvre n’était pas d’une proverbiale timidité, il y a beau temps qu’il n’existerait plus de lièvres : la peur le protège, comme elle protège les êtres vivants.
Je sais bien qu’on peut à la rigueur retourner la proposition, et dire que, s’il y a des lièvres encore, c’est parce qu’ils ont eu le sentiment de la peur. De sorte que la survie des lièvres serait la conséquence de la peur, au lieu d’en être la cause. Mais ceci me paraît une subtilité, très paradoxale, que je n’entends pas très bien.
De même le dégoût est aussi une répulsion protectrice. J’ai essayé jadis de prouver que le dégoût est en rapport avec l’inutilité ou la nocivité des objets. Les poisons végétaux sont amers ; les serpents, venimeux ou non, sont, pour tous les êtres, objets de répulsion ou de frayeur ; car souvent la peur et le dégoût se confondent. Pourquoi ne pas adopter cette idée simple qu’il y a une finalité au dégoût comme à la peur ; que ces deux instincts sont des instincts de défense ?
On ne comprendrait pas que l’être n’eût pas d’instincts protecteurs. Il est absurde de concevoir un carnivore ayant du dégoût pour la viande, un herbivore ayant du dégoût pour les herbes, un animal ayant un goût très vif pour les poisons, pour l’acide sulfurique concentré, par exemple. Il y a là une finalité tellement simple, tellement nécessaire, que personne ne peut la contester, ni même s’en étonner. C’est une vérité évidente a priori que le goût ou le dégoût des êtres vivants pour les choses n’est pas un phénomène de pur hasard, mais une loi en rapport avec la conservation de l’individu. L’enfant nouveau-né, s’il avait du dégoût pour le lait maternel, mourrait de faim ; et, si les animaux avaient du goût pour les plantes vénéneuses, ils périraient bien vite, empoisonnés par toutes les substances toxiques qui pullulent autour d’eux.
Ce que je dis du dégoût s’applique, avec plus de force encore, à la douleur, et j’avoue que les courtoises objections de M. E. Regalia à ma théorie sur la finalité de la douleur ne m’ont pas beaucoup ébranlé. Je persiste donc, au risque de faire une physiologie préhistorique, à croire que la douleur a une raison d’être, une cause finale.
Que toutes les douleurs soient toujours utiles, et à tel ou tel individu, je n’ai jamais prétendu l’affirmer. Il suffit d’avoir eu mal aux dents pour être persuadé qu’il y a des douleurs terriblement inutiles. Mais il ne s’agit pas des douleurs, il s’agit de la douleur ; ou, autrement dit, de la sensibilité.
Des êtres insensibles ne pourraient résister aux injures du monde extérieur, s’ils n’avaient pas pour les avertir cette sentinelle de la vie qui les protège. Quand on a sectionné à un animal le nerf de la cinquième paire, qui donne la sensibilité à l’œil, le contact des objets extérieurs avec l’œil ne provoque plus aucune réaction de sensibilité ; mais l’animal alors ne se défend plus ; en trois ou quatre jours, la cornée blessée s’ulcère, et l’œil est perdu.
Si notre intelligence seule était là pour nous préserver des traumatismes, des fatigues, des empoisonnements, des dangers de toute espèce, il n’y aurait probablement plus d’humains au bout d’une demi-semaine. Une intelligence, fût-elle dix fois plus puissante que la nôtre, ne fournirait pas assez de sagesse et de prudence pour éviter les périls qui nous assiègent. Notre sensibilité cutanée, si exquise, et toujours en éveil, vaut toutes les plus savantes déductions, et il n’y a pas, pour éviter un danger, de syllogisme aussi irrésistible que la douleur d’une brûlure, d’une morsure, ou d’une contusion.





























