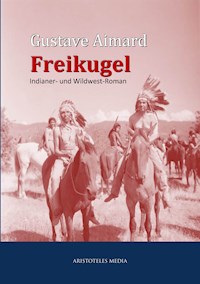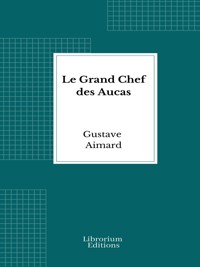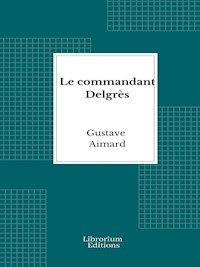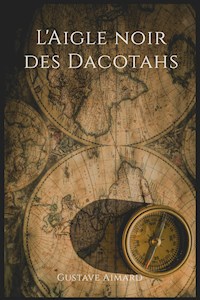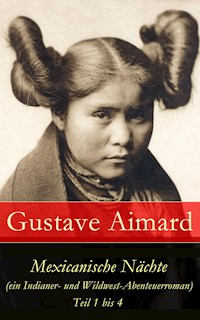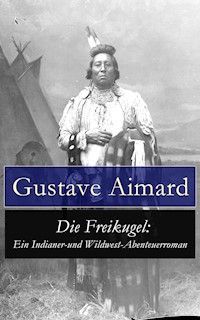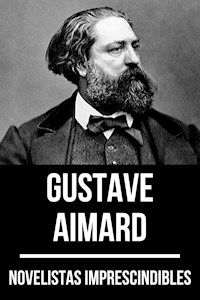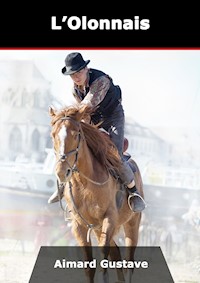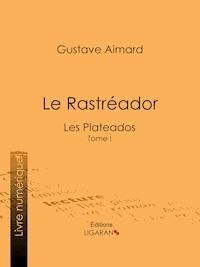
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La basse Californie est une immense péninsule commençant à la baie de Todos-Santos et finissant au cap San-Lucar, par-delà le tropique, fort avant dans la zone torride ; sa largeur varie entre 50 et 130 kilomètres ; elle est séparée en deux parties presque égales dans toute sa longueur par une Cordillère dont les pics assez élevés renferment de nombreux volcans ; l'océan Pacifique l'entoure du sud à l'est et le golfe de Californie ou mer Vermeille la baigne à l'ouest."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La basse Californie est une immense péninsule commençant à la baie de Todos-Santos et finissant au cap San-Lucar, par-delà le tropique, fort avant dans la zone torride ; sa largeur varie entre 50 et 130 kilomètres ; elle est séparée en deux parties presque égales dans toute sa longueur par une Cordillère dont les pics assez élevés renferment de nombreux volcans ; l’océan Pacifique l’entoure du sud à l’est et le golfe de Californie ou mer Vermeille la baigne à l’ouest. Le pays en est général aride, bien que dans certaines parties la végétation soit magnifique ; il est pauvre et très peu peuplé ; à l’époque où se passe l’histoire que nous entreprenons de raconter, cette région, presque complètement ignorée encore, ne possédait aucun commerce ; sa population, sauf de très rares exceptions, se composait de tribus indiennes nomades et indépendantes du gouvernement mexicain, dont elles ne reconnaissaient ni les lois, ni les coutumes.
Au temps de leur domination, les Espagnols nourrissaient de grands projets sur cette magnifique contrée ; ils y avaient fondé plusieurs établissements qui commençaient à prospérer, et lorsque la guerre de l’indépendance éclata, ils avaient achevé depuis quelques années à peine une large route qui, après avoir traversé toute la péninsule californienne, devait plus tard la relier à la Californie proprement dite et au Nouveau-Mexique.
Le 19 juin 1833, un peu avant le coucher du soleil, c’est-à-dire vers cinq heures et demie du soir, un cavalier apparut à l’un des tournants de cette route dont nous avons parlé plus haut, descendant les pentes abruptes de la Cordillère, un peu au-dessus de Nuestra-Señora-de-Guadaloupe, et semblant se diriger vers San-Diego del Rio, premier établissement important de la haute Californie, au-delà de la baie de Todos-Santos.
La route, aussi loin que la vue pouvaient s’étendre dans toutes les directions, était complètement déserte ; le cavalier avait fait sans doute une longue traite, car ses riches vêtements étaient couverts d’une poussière blanche et impalpable qui empêchait presque d’en distinguer la couleur, et son cheval, magnifique mustang des prairies, vigoureux animal aux jambes fines comme des fuseaux, à la tête petite et aux yeux pleins de feu, paraissait accablé de fatigue et n’avançait plus que péniblement, en buttant à chaque pas, malgré les encouragements et les caresses de son maître.
Ce maître était un fier et beau jeune homme de vingt-sept à vingt-huit ans au plus, appartenant à la race blanche sans mélange ; ses traits étaient expressifs, sa physionomie intelligente et un peu hautaine, mais sans apparence de morgue ni de roideur ; ses yeux noirs, grands et bien ouverts, regardaient droit et avaient une rare expression d’énergie et de franchise ; sa taille, au-dessus de la moyenne, était bien prise, admirablement proportionnée ; à la souplesse élégante de ses mouvements, il était facile de reconnaître que sous ses manières peut-être un peu efféminées, il cachait une vigueur peu commune, une adresse et une agilité remarquables : de longs cheveux d’un noir bleu s’échappaient de dessous les larges ailes de son chapeau en poil de vigogne et tombaient jusque sur ses épaules, encadrant d’une pâleur mate son visage, auquel une fine moustache soigneusement cirée, surmontant sa bouche un peu railleuse et garnie de dents éblouissantes, imprimait un cachet d’étrangeté qui, au premier regard, fixait l’attention sur lui.
Malgré la fatigue qu’il devait éprouver, le jeune voyageur se tenait droit et ferme sur sa selle, et ses regards erraient autour de lui avec une insouciance qui témoignait d’une grande liberté d’esprit.
Arrivé à un point de la route où s’élevait, à l’angle d’un sentier, une croix de pierre posée sur un piédestal assez curieusement fouillé, le jeune homme sembla hésiter un instant ; mais, prenant presque aussitôt son parti, il fit obliquer son cheval et s’engagea résolument dans le sentier, tracé au milieu d’un bois touffu d’orangers, de cédrats et d’arbres à cacao, qui sont des symploques et que nous prions le lecteur de ne pas confondre avec les cacaoyers ; ce bois descendait en pente douce, il prit bientôt les proportions d’une véritable forêt ; le voyageur commençait à s’inquiéter sérieusement, d’autant plus que depuis quelque temps il entendait un bruit semblable à un roulement continu, bruit qu’il ne savait à quoi attribuer, et s’augmentait au fur et à mesure qu’il s’avançait ; tout à coup les arbres s’écartèrent à droite et à gauche, semblables à un rideau qui se lève, le voyageur s’arrêta et ne put retenir un cri d’admiration à la vue du splendide paysage qui, subitement, se déroula devant lui.
Il était arrêté à mi-côte d’une colline assez élevée, dont les francs s’abaissaient en pente douce jusqu’à une plage de sable fin et d’un jaune d’or large de mille mètres environ et terminée par la mer, assez forte en ce moment et dont les lames échevelées et bordées d’écume accouraient se briser contre les rochers, ou couraient sur les galets avec un bruit ressemblant à celui d’un train d’artillerie galopant à toute bride.
Cette plage échancrée en demi-cercle formait un port naturel de peu d’étendue, dont la passe fort étroite était rendue assez difficile par une île boisée qui en partageait l’entrée et laissait à peine de chaque côté un passage suffisant pour un navire de trois à quatre cents tonneaux au plus ; d’énormes rochers s’élevaient à droite et à gauche aux extrémités de la plage, couverte en ce moment d’embarcations de pêche qu’une foule d’individus de tout âge et de tous sexes s’efforçaient, avec de grands cris, de haler au plein et de mettre à l’abri avant que n’éclatât la tourmente dont ils étaient menacés ; dans une échancrure de ce petit port, protégées d’un côté par d’énormes blocs de rochers et de l’autre par les derniers contreforts du bois que le voyageur avait traversé, on apercevait, groupées sans ordre, les unes auprès des autres, les huttes misérables et ouvertes à tous les vents d’une Rancheria de pêcheurs en ce moment à peu près déserte, tous ses habitants étant occupés aux embarcations, seule fortune de cette pauvre population.
Ce paysage, éclairé par les derniers rayons du soleil couchant, avait un aspect à la fois grandiose et primitif véritablement saisissant.
Le jeune homme se laissait aller ainsi à son admiration, sans songer à la fatigue, au vent et à la pluie qui lui fouettaient le visage, et peut-être serait-il longtemps encore demeuré ainsi absorbé dans ses pensées, si tout à coup le bruit d’un galop rapide ne lui avait subitement fait tourner la tête en arrière, mais l’obscurité, presque complète déjà, l’empêcha de rien distinguer.
– Qui va là ? cria-t-il.
– Dios me libre ! C’est vous, don Torribio ! répondit aussitôt une voix joyeuse.
– Bon, c’est toi, Pepe Ortiz, reprit le jeune homme ; tu arrives bien tard ?
– Mieux vaut tard que jamais, frère ! Depuis que je vous ai quitté je ne me suis pas arrêté une seconde.
– As-tu tué un des jaguars, au moins ?
– Allons donc, ils sont bien trop rusés pour cela ; c’est égal, j’ai suivi leur piste tout l’après-dîner ; je sais où les trouver ; cette fois, ils seront bien fins s’ils nous échappent.
– Hum ! fit don Torribio en riant, voici trois jours qu’ils jouent aux barres avec nous.
– C’est de votre faute, mon frère.
– Comment, de ma faute ?
– Pues ! Vous voulez voyager et chasser tout à la fois, cela n’est point possible.
– Ce sont eux qui m’ont suggéré cette idée ; ils suivent la même direction que nous.
– En apparence ; voilà où est leur rouerie ; si nous ne nous méfions pas ils nous conduiront comme cela jusque dans l’Orégon.
– Alors bon voyage, je ne les suivrai certes pas jusque-là.
– Bon, nous les reverrons ; les jaguars aiment à revenir sur leurs passées.
– En attendant, que faisons-nous ? Le temps se gâte de plus en plus, il tourne rudement à la tourmente, la place n’est plus tenable.
– Nous ne sommes qu’à une lieue tout au plus de San-Miguel ; seulement, il nous faut remonter la pente et reprendre le chemin d’en haut.
– Nos chevaux sont trop fatigués pour cela ; pauvres bêtes, depuis trois jours ces jaguars endiablés les ont mis sur les dents.
– Alors descendons, il y a une Rancheria de pêcheurs à quelques portées de fusil d’ici.
– Je l’ai aperçue un peu avant le coucher du soleil, mais je ne saurais maintenant dire dans quelle direction.
– Quant à moi, j’ignore complètement où peut se trouver ce pueblo ; je ne vois plus qu’un moyen, rentrer dans le bois et faire un jacal.
– Hum ! voilà un expédient qui ne me sourit guère.
– Dame ! frère, à la guerre comme à la guerre ; d’ailleurs une nuit est bientôt passée.
– Allons, puisqu’il le faut ! dit le jeune homme assez peu satisfait ; maudits jaguars !
Et il essaya de faire tourner son cheval.
En ce moment un troisième cavalier apparut aux côtés des deux interlocuteurs ; ce cavalier s’arrêta, examina un instant les étrangers à la lueur de son cigare et saluant respectueusement don Torribio :
– Eh ! señor mi amo, dit-il, à quoi bon perdre votre temps à faire un jacal qui ne vous abriterait que fort mal, quand il y a, à quelques pas d’ici, un pueblo où dans toutes les casas, à commencer par la mienne, on sera heureux de vous offrir l’hospitalité ? Méfiez-vous, l’orage qui commence n’est pas une tourmente ordinaire ; nous allons avoir un bon cordounazo, foi de Pedro Gutierrez, qui est mon nom, et je m’y connais.
– Vous avez sans doute raison, señor Pedro Gutierrez, répondit don Torribio, mais le pueblo dont vous parlez est loin encore, et nos chevaux n’en peuvent plus.
– Comment, le pueblo est loin ! s’écria le nouveau venu avec surprise, vous n’en êtes qu’à dix minutes à peine !
– Dites-vous vrai ? en sommes-nous si près que cela ?
– Plus près encore peut-être, seigneurie, je me charge de vous le prouver ; si fatigués que soient vos chevaux, ils iront bien jusque-là.
– Vive Dios ! Alors au diable le jacal et en route !
Pedro Gutierrez ne s’était pas trompé ; dix minutes plus tard, les cavaliers atteignirent le village et trouvèrent un abri, bien nécessaire en ce moment, dans la casa du digne homme que le hasard avait si providentiellement jeté sur leur route.
La population fort peu nombreuse de cette bourgade ignorée est entièrement composée de pêcheurs, ou, pour être plus vrai, de contrebandiers. Le commerce de contrebande qui se fait dans ce village perdu avec la France, l’Angleterre et les États-Unis est énorme et se chiffre par plusieurs centaines de mille piastres chaque année ; les transactions s’opèrent par l’intermédiaire de navires côtiers de cent ou deux cents tonneaux, tels que lougres, goélettes, sloops, balandres, etc., tous d’un très faible tirant d’eau et pouvant, par conséquent, s’approcher de cette côte assez dangereuse, à cause de nombreux bancs de sables mouvants dont sont obstrués les abords de la passe du port et que des courants sous-marins chassent sans cesse dans des directions différentes. Parfois des bricks et des bricks-goélettes mouillent à leurs risques et périls sur la côte, soit pour se débarrasser de leurs marchandises, soit, ce qui arrive le plus souvent, malgré eux, drossés par le vent et les courants, par lesquels ils sont entraînés et affalés dans ces parages.
Don Torribio fut reçu de la façon la plus hospitalière par la famille de Pedro Gutierrez ; après s’être séché tant bien que mal et avoir soupé de poisson bouilli, de frijoles rouges au piment et de tortillas de maïs, le tout arrosé de pulque et de mezcal, le jeune homme s’enveloppa dans son zarapé, s’étendit les pieds au feu sur un petate et ne tarda pas à s’endormir profondément, bercé par les sifflements du vent, qui faisait rage au dehors et secouait la cabane comme s’il eût voulu la renverser.
Tout à coup, il fut éveillé en sursaut, un peu après le lever du soleil, par de grands cris poussés près de lui ; il sauta sur ses pieds et regarda : il était seul dans la cabane ; il sortit en toute hâte afin de s’informer de ce qui se passait.
Un spectacle à la fois magnifiquement grandiose et d’une sublimité de désolation épouvantable s’offrait à ses regards.
Le ciel était d’un bleu indigo, le soleil déversait à profusion son éclatante lumière ; mais, contraste saisissant, le vent soufflait avec une force effrayante, tordant et déracinant les arbres, comme s’ils n’eussent été que des fétus de paille, les balayant au loin, soulevant des nuages de sable qui tourbillonnaient dans l’espace avec des sifflements lugubres ; les habitants du village, agenouillés sur le sol, priaient avec des larmes d’épouvante, tandis que les animaux renfermés dans les corrals tournaient affolés autour de l’enclos pour chercher une issue en poussant des cris lamentables.
Du côté de la mer, le spectacle était horrible et représentait l’image du chaos ; la mer bouleversée semblait bouillir, des lames d’une hauteur énorme, couronnées d’écume, accouraient du large avec une rapidité vertigineuse et venaient se briser sur la plage avec d’assourdissantes détonations ; courant sur les galets, et parfois entraînant dans leur remous, faisant tournoyer et réduisant en moins d’une minute en débris impalpables quelque barque qu’il avait été impossible de traîner plus haut sur la grève.
Et chose plus effroyable, à une portée de fusil à peine de la côte se trouvait un grand et beau brick complètement désemparé, échoué sur un rocher nommé le Frayle, dans lequel sa coque était engagée ; le pauvre navire était ballotté dans tous les sens, avec des secousses affreuses, par les flots en fureur, qui à chaque instant menaçaient de l’engloutir ; parfois les lames le soulevaient à des hauteurs prodigieuses, passaient par-dessus, le couvraient tout entier, puis le laissaient retomber avec un fracas épouvantable dans l’abîme ; on apercevait distinctement sur le pont du bâtiment des hommes, des femmes, des enfants, faisant des signaux de détresse et implorant des secours que nulle puissance humaine n’aurait pu leur donner ; par intervalles, les cris d’agonie de ces malheureux parvenaient jusqu’à la foule réunie sur la plage et la remplissaient de pitié et de douleur.
Près de la cabane dont sortait don Torribio, une quinzaine de pêcheurs étaient groupés, anciens marins pour la plupart, vieux loups de mer, contrebandiers intrépides ayant parcouru tous les océans et dont l’existence n’avait été, pour ainsi dire, qu’une lutte perpétuelle contre la mer, ils regardaient d’un air morne et consterné les péripéties douloureuses du naufrage de ce beau bâtiment, dont les membrures se disjoignaient les unes après les autres, et qui ne tarderait pas à disparaître au fond du gouffre béant dont les mugissements semblaient l’appeler.
Au fur et à mesure que le soleil montait à l’horizon, le vent diminuait de force ; la tempête arrivée à son apogée paraissait vouloir peu à peu se calmer ; cependant le vent soufflait encore en foudre et la mer était affreuse.
Don Torribio s’approcha du groupe des pêcheurs, et s’adressant à Pedro Gutierrez :
– Eh bien ? lui demanda-t-il.
– Vous voyez, seigneurie, répondit le marin en montrant le brick que les lames fouettaient avec rage.
– Oui, reprit le jeune homme, je vois qu’il y a là vingt-cinq ou trente de nos semblables qui vont mourir ; il y a parmi eux des femmes et des enfants : ne tenterons-nous donc rien pour les soustraire à la mort affreuse qui les menace ?
Ces braves gens regardèrent le jeune homme avec une surprise qui était presque de la stupeur.
– Voyez la mer, seigneurie, lui dit le plus âgé des pêcheurs ; ils sont condamnés ; avant une heure, il ne restera pas une planche de ce bâtiment.
– On peut faire beaucoup de choses en une heure, reprit vivement don Torribio ; pourquoi n’essaierions-nous pas de sauver ces malheureux ?
– Ce serait tenter Dieu ! répondit sentencieusement le vieux pêcheur.
– Vous vous trompez, señor, repartit aussitôt le jeune homme. Dieu, qui est la miséricorde suprême, voit avec joie les actes de dévouement ; en essayant de sauver ces malheureux, nous lutterons contre le démon, qui a suscité cette tempête, et Dieu nous aidera.
– Bien parlé et en véritable chrétien, seigneurie, s’écria le curé du village qui, s’était, lui aussi, approché du groupe ; l’Évangile dit : Aide-toi, le Ciel t’aidera ! Mais, hélas ! ajouta-t-il tristement, la mer est bien furieuse.
– Aussi est-ce un acte de dévouement que nous accomplirons ! s’écria le jeune homme avec âme.
– Ainsi soit-il ! murmura le curé en se signant.
Ce curé était un jeune prêtre instruit et de bonne famille, comme il n’en existe que trop peu dans le clergé mexicain ; il était entré dans les ordres poussé par une véritable vocation, et c’était par dévouement et humilité qu’il avait accepté cette pauvre cure, quand il lui aurait été facile d’en obtenir une fort riche dans une grande ville.
Après avoir serré la main du digne curé, don Torribio s’approcha d’un hangar sous lequel était remisée une excellente pirogue baleinière garnie de tous ses agrès, et se tournant vers les pêcheurs :
– À qui appartient cette pirogue ? demanda-t-il.
– À moi, seigneurie, répondit Pedro Gutierrez ; vous voyez qu’elle est prête à prendre la mer, si le temps était maniable.
– Maniable ou non, reprit nettement le jeune homme, elle va la prendre tout de suite. Sortez-la de sa calle couverte, je vous l’achète cinq cents piastres, et il tira d’une poche de ses calzoneras une longue bourse en filet à travers les mailles de laquelle on voyait briller l’or.
– Cinq cents piastres ! s’écria le pêcheur avec stupéfaction, c’est le double de ce qu’elle vaut !
– Peu importe ; j’en ai besoin, je vous en donne ce prix, donc elle est à moi ; il ne s’agit plus que de la mettre à l’eau.
– Je suis père de famille et pauvre, je ne puis vous refuser de vous vendre cette pirogue le prix que vous-même avez fixé, seigneurie.
– Bien, hâtez-vous de la mettre à l’eau, je veux l’essayer.
– Vous ne ferez pas cela, seigneurie.
– Et pourquoi ne le ferai-je pas ?
– Parce que ce serait aller à une mort terrible, certaine, inévitable, sans profit pour personne.
– Je suis convaincu du contraire, reprit vivement don Torribio en lui mettant 33 onces dans la main. Dieu, qui m’a inspiré la pensée de sauver ces malheureux en péril, ne me laissera pas mourir. Hâtez-vous, j’essaierai d’atteindre le navire, quand je devrais tenter seul ce sauvetage, que vous croyez impossible.
– Nous serons deux, seigneurie, s’écria aussitôt Pepe Ortiz en se frottant les mains en riant ; est-ce que vous supposez que je vous laisserai aller seul ?
– Moi aussi je vous accompagnerai, señor, dit le jeune prêtre avec une dignité simple et pleine d’abnégation.
Alors il se passa un fait singulier : tous ces hommes qui refusaient si obstinément de suivre le jeune étranger et de tenter avec lui une expédition qu’ils considéraient comme une folie et un défi jeté à la divinité, changèrent brusquement d’avis et voulurent tous l’accompagner, plutôt que de laisser leur curé, qu’ils adoraient, risquer sa vie.
– Bien ! mes enfants, disait le jeune prêtre les larmes aux yeux ; mais vous êtes tous des pères de famille ; moi, je suis seul, laissez-moi aller là où m’appelle mon devoir.
– Non, non, s’écriaient les pêcheurs, vous n’irez point, nous ne le voulons pas. Que deviendrions-nous, padre, si nous vous perdions ? qui soignerait nos enfants quand ils sont malades, qui consolerait nos femmes si vous mourriez si misérablement ?
Tout en parlant ainsi le vieux pêcheur Pedro Gutierrez et plusieurs autres avaient pris la pirogue, l’avaient portée sur le plein ; en un clin d’œil, tout se trouva prêt pour le départ.
– Nous avons besoin de vous ici pour organiser le sauvetage, señor padre, dit don Torribio au curé ; nous allons essayer d’établir un va-et-vient avec le navire, il faut que vous restiez sur la plage pour surveiller cette opération difficile.
– Soit, puisque vous l’exigez, je resterai, dit-il.
La pirogue fut alors traînée sur le sable de façon à être enlevée par la première grande lame ; don Torribio laissa à terre environ quatre cents brasses de ligne à baleine, après avoir épissé cette ligne à une autre d’environ cinq cents brasses qu’il emportait lovée dans une baille ; cela fait, Pepe Ortiz, Gutierrez, Tio Perrico le vieux pêcheur, don Torribio et deux autres marins montèrent dans la pirogue et se tinrent prêts.
Leur attente ne fut pas longue : une immense lame du large, haute comme une montagne, vint se briser à dix pieds en arrière des hardis aventuriers, accourut à travers les galets, souleva la pirogue et l’entraîna à la mer avec une rapidité vertigineuse.
– À la grâce de Dieu ! s’écria don Torribio.
– À la grâce de Dieu ! répétèrent les marins en se signant.
– Je vous bénis, mes enfants ! dit le prêtre en s’avançant dans l’eau au risque d’être emporté par la lame ; et joignant les mains avec ferveur, il ajouta : Seigneur, Seigneur, protégez-les !
Ces paroles furent les dernières que les aventureux sauveteurs entendirent.
Pendant quelques instants, ce fut un chaos horrible, sans nom, une lutte effroyable contre les lames, qui se ruaient sur la pirogue comme une armée en déroute et menaçaient à chaque instant de la remplir d’eau ou de la chavirer.
Les marins ne voyaient plus rien autour d’eux, que la mer monstrueuse, hurlante, acharnée à leur destruction ; don Torribio avait fort à faire à gouverner l’aviron de queue de façon à ne couper qu’en biais les lames qui se succédaient sans interruption ; mais heureusement le vaillant jeune homme avait sous ses ordres un équipage au cœur de lion, aguerri de longue date à ces luttes effrayantes contre les éléments, que rien désormais ne pouvait ni surprendre ni épouvanter ; ces braves gens avaient, en s’embarquant dans la baleinière, fait simplement et sans arrière-pensée le sacrifice de leur vie ; il ne devait y avoir de leur part ni récriminations ni défaillance.
Enfin, après une lutte qui se prolongea pendant plus de vingt minutes, la pirogue se trouva libre des lames de fond, et assez éloignée de la plage pour voguer avec une sûreté relative.
La bataille avait été rude ; chacun poussa un ah ! de soulagement, on approchait du navire échoué ; don Torribio calculait que dans une demi-heure la pirogue serait assez rapprochée, non pas pour accoster le bâtiment, ce qui, au milieu des brisants qui l’enveloppaient de toutes parts, était naturellement impossible, mais assez près de lui pour communiquer avec l’équipage.
De son côté, le brick avait aperçu la pirogue ; les cris et les appels redoublaient à son bord ; le vent continuait à diminuer rapidement ; la tempête expirait ; seulement l’agitation de la mer était extrême et devait, pendant plusieurs heures encore, demeurer dans le même état ; don Torribio le savait, cela le chagrinait fort, mais il n’y avait pas de remède.
Tout à coup du brick on héla la pirogue.
– Oh ! de la baleinière ! cria-t-on en français.
– Holà ! répondit don Torribio dans la même langue, quel est ce navire ?
– Le Lafayette, de Bordeaux, capitaine Pellegrin, venant en dernier lieu de la côte nord-ouest. Vous ne pouvez nous accoster, nous sommes sur des brisants.
– Je le sais, répondit don Torribio, mais nous pourrons établir un va-et-vient.
– Apportez-vous une ligne ?
– Oui, dont le bout est amarré à terre.
– Je vais vous lancer une bouée.
– Non, attendez ; mieux vaut que j’essaie d’atteindre le bord à la nage.
– Ne faites pas cela, vous ne réussirez pas.
– À la grâce de Dieu ! répondit le vaillant jeune homme.
Au même instant il éprouva une secousse, un de ses hommes venait de se laisser glisser à la mer ; cet homme était Pepe Ortiz ; tandis que don Torribio s’entretenait avec le capitaine le brave garçon s’était déshabillé, ne conservant que son caleçon ; il avait roulé l’extrémité de la ligne autour de ses reins et s’était dévoué pour son maître.
Don Torribio poussa un cri de douleur, mais reprenant aussitôt son sang-froid :
– À deux, nous réussirons certainement ! s’écria-t-il.
Et passant l’aviron de queue Tio Perico, qui le prit sans dire un mot, en une seconde il se débarrassa de tout ce qui pouvait gêner ses mouvements et à son tour il se jeta la mer.
À peine le jeune homme se trouva-t-il au milieu des lames qu’il comprit combien il avait eu raison de se lancer sans hésiter à la poursuite de son fidèle serviteur ; en se dévouant pour son maître, Pepe Ortiz lui avait certainement sauvé la vie ; seul, celui-ci aurait été dans l’impossibilité, malgré toute sa vigueur et son habileté de nageur, d’accomplir la rude tâche qu’il voulait s’imposer, il se serait inévitablement noyé avant d’atteindre le navire en perdition.
La ligne que Pepe Ortiz s’était attachée autour du corps, et qu’il remorquait, l’obligeait à faire des efforts prodigieux, le fatiguait et retardait sa marche ou plutôt son élan ; lorsque don Torribio le rejoignit, il n’avançait plus qu’avec une difficulté extrême, sa poitrine haletait.
– Laisse-toi couler, lui dit son maître, ne conserve que ta tête hors de l’eau et appuie tes mains sur mon épaule.
Le brave garçon ne voulait pas, il résistait ; don Torribio fut contraint de lui dire, pour l’obliger à lui obéir :
– C’est bien, nous mourrons tous deux ; tu m’auras tué par ton entêtement.
Pepe Ortiz ne résista plus.
Don Torribio nagea ainsi pendant quelques minutes, Pepe Ortiz appuyé sur son épaule ; lorsque les forces de celui-ci furent revenues, il recommença à nager, et alors son maître partagea avec lui le poids de la ligne, que l’on filait peu à peu de la baleinière.
Une demi-heure s’écoula ainsi, un siècle dans une si épouvantable situation ; enfin ils ne se trouvèrent plus qu’à sept ou huit pieds de l’extrémité du beaupré du navire, dont heureusement le bout-dehors de clinfoc s’avançait au-delà des brisants.
– Ohé ! cria le capitaine.
– Holà ! répondit don Torribio.
– À vous une amarre !
– Attendez ! répondit le jeune homme, et s’adressant à Pepe Ortiz : Peux-tu pendant cinq minutes maintenir seul la ligne ? lui demanda-t-il.
– Oui, mais faites vite, frère, répondit le serviteur.
En effet, il n’en pouvait plus, bien que doué d’une vigueur exceptionnelle. Son maître ne perdit pas un instant.
– Envoyez, cria-t-il au capitaine, nous sommes deux et nous apportons une ligne.
– Nous le savons, répondit le capitaine, c’est compris. À vous !
Il lança l’amarre si adroitement que don Torribio la reçut presque au vol ; cette amarre se terminait par une double chaise.
Don Torribio se hâta de passer Pepe Ortiz dans la première : il était temps, celui-ci allait couler ; pourtant il résistait, mais son maître ne l’écouta pas. Dès qu’il l’eut solidement attaché dans la chaise, lui-même s’installa du mieux qu’il put dans l’autre, puis il cria gaiement :
– Enlevez !
Deux minutes plus tard ils étaient sur le pont du brick.
Le premier soin du capitaine, après avoir chaudement embrassé les deux hommes, fut de les débarrasser des chaises et de soulager Pope Ortiz du poids insupportable de la ligne roulée autour de ses reins ; puis il leur versa un énorme verre de vieille eau-de-vie de France que ceux-ci avalèrent d’un trait et qui leur rendit toute leur vigueur première.
Ces braves gens, passagers, passagères, enfants et matelots, réunis sur le pont du brick, se serraient autour de leurs sauveurs et les accablaient littéralement de bénédictions, au grand étonnement des deux Mexicains, qui trouvaient tout naturel ce qu’ils avaient fait.
Heureusement que le capitaine s’interposa et réussit à renvoyer tous les bras inutiles à l’arrière.
– Vous êtes pilote ? demanda le capitaine.
– Oui, répondit sans hésiter don Torribio, quelle est votre position ?
– Vous la voyez détestable ; cependant la coque n’est pas entamée ; si je réussissais à me sauver d’ici et à m’échouer à terre, le navire serait perdu, c’est vrai, mais je sauverais non seulement tout mon monde, mais encore ma cargaison, qui est précieuse.
– Comment êtes-vous retenu ?
– Par l’arrière seulement, au dernier brisant ; il me faudrait une amarre solide à terre.
– Bon. Nous vous tirerons de là, répondit le jeune homme, laissez-moi faire.
– Je ne demande pas mieux ; ordonnez, vous êtes seul maître à bord.
– C’est entendu ; écoutez-moi bien : la ligne que je vous apporte ne vient pas de la pirogue, elle est amarrée à terre.
– Bien vrai ? s’écria-t-il joyeusement.
– Pourquoi mentirais-je ?
– C’est vrai, pardonnez-moi.
– Vous allez frapper un grelin solide après la ligne, que vous filerez ensuite tout doucement à la mer ; me comprenez-vous bien ?
– Vous allez voir.
Il se mit aussitôt à l’œuvre.
De terre, on ne perdait pas un des mouvements qui se faisaient à bord du brick ; aussitôt que don Torribio en donna le signal, la ligne fut halée ; au bout de trois quarts d’heure environ, il eut enfin la satisfaction de voir le câble se raidir.
Le capitaine avait fait débarrasser l’arrière du navire de tout ce qu’il contenait, de façon à reporter tout le poids sur l’avant ; de sorte que peu à peu, la mer aidant, le brick se souleva ; l’équipage vira alors au guindeau sur le grelin ; un mouvement d’avancée ne tarda pas à se produire, et bientôt le bâtiment flotta, laissant les brisants derrière lui.
Mais toutes ces diverses opérations avaient exigé du temps, sept heures s’étaient écoulées depuis que les hardis sauveteurs avaient quitté la terre dans leur pirogue ; la tempête avait complètement cessé, la brise était devenue maniable, la mer elle-même s’était considérablement calmée ; Tio Perrico avait accosté le navire et les quatre pêcheurs étaient montés à bord.
– À présent, dit don Torribio au capitaine, il s’agit non seulement de sauver la cargaison, mais encore le navire.
– Hum ! dit-il tristement, ce n’est guère possible.
– C’est facile, si la coque est bonne ?
– Je vous l’ai dit, elle est intacte.
– Très bien. Alors vous allez installer des voiles de fortune pour recevoir la brise, qui nous est favorable, vous vous ferez remorquer par ma pirogue et le canot qui vous reste ; moi, je vous conduirai au mouillage.
– Si vous faites cela, s’écria le capitaine les larmes aux yeux, vous me sauverez l’honneur !
– Bon ! répondit le jeune homme en riant, votre honneur est en bonnes mains, j’en réponds ; seulement hâtez-vous de faire ce que je vous dis.
– Tout de suite ! s’écria-t-il en lui serrant les mains à les lui briser.
Le capitaine suivit à la lettre les instructions du jeune homme, si bien que deux heures avant le coucher du soleil le brick était solidement affourché sur deux ancres dans un excellent mouillage, parfaitement à l’abri du vent du nord-est, le seul qui dans ces parages soit à redouter des navigateurs.
Le soir même les passagers débarquèrent et furent se loger au presbytère, où le digne curé leur avait offert l’hospitalité.
Son navire en sûreté, le capitaine voulut régler ses comptes avec l’homme qui l’avait si bien piloté ; mais don Torribio, bien entendu, ne voulut accepter rien autre chose qu’un remerciement cordial, ce qui chagrina fort le digne capitaine.
Ce qui fut caractéristique, ce fut la réponse que don Torribio reçut de Pedro Gutierrez au nom de tous ses camarades, lorsque le jeune homme voulut s’acquitter envers les braves marins, qui l’avaient suivi avec tant de dévouement.
– Seigneurie, dit le vieux pêcheur en le forçant à reprendre les trente-trois onces que le jeune homme lui avait payées, ma baleinière n’a pas souffert la moindre avarie ; elle vous serait inutile, donc elle n’a pas cessé de m’appartenir, et je la garde ; quant à ce que vous croyez nous devoir pour la besogne d’aujourd’hui, on ne fait pas des expéditions dans des conditions semblables pour de l’argent ; nous sommes assez payés par la satisfaction d’avoir réussi et surtout de vous voir sain et sauf au milieu de nous.
Don Torribio voulut insister, tout fut inutile.
Cette affaire ainsi terminée, le jeune homme se rendit au presbytère.
Poussé par un de ces sentiments complexes qui ne s’expliquent pas, mais auxquels on obéit pour ainsi dire instinctivement, don Torribio se proposait de demeurer quelques jours dans le pueblo. Pour quelle raison ? Évidemment, il n’aurait su le dire. Cette pensée lui était venue en apercevant par hasard – toujours le hasard ! – les passagers du brick se rendant, encore un peu émus des dangers terribles qu’ils avaient courus, au presbytère, où ils devaient loger ; ces passagers paraissaient fort riches, tout faisait supposer dans leurs manières et leur conversation qu’ils appartenaient à la plus haute société mexicaine. Soit modestie, soit fausse honte, soit tout autre motif, don Torribio désirait conserver le plus longtemps possible l’incognito vis-à-vis de ces étrangers ; il pria donc le curé de le faire passer aux yeux de ses hôtes pour un homme un peu au-dessus de ceux au milieu desquels il vivait, quelque chose comme capitaine de barque ou pilote, rien de plus, service que le prêtre hésita d’autant moins à lui rendre que lui-même ne savait absolument rien sur son compte, si ce n’est qu’il le croyait fort riche d’après la facilité avec laquelle il ouvrait sa bourse.
Ces étrangers qui avaient accepté l’hospitalité au presbytère ne formaient qu’une seule famille composée de sept personnes, quatre maîtres et trois domestiques ; le chef de la famille était un homme de cinquante-cinq ans environ, d’une distinction rare, de haute taille, bien fait et qui eût été remarquablement beau de visage sans l’expression singulière de ses yeux, dont la prunelle, comme celle des félins, possédait la singulière faculté de diminuer ou d’augmenter selon les émotions qui l’agitaient et lançait parfois de magnétiques éclairs ; cet homme avait le regard fuyant, ne se fixant jamais ; ses yeux presque toujours demi-clos laissaient filtrer à travers leurs longues paupières des lueurs étranges ; sa femme, beaucoup plus jeune que lui, – elle paraissait avoir tout au plus vingt-six ans, – était d’une grande beauté rendue plus intéressante encore par la pâleur mate de son visage et l’expression de mélancolie douce et résignée répandue sur ses traits ; puis venait une jeune fille de seize ans à peine, née sans doute d’un premier mariage, si admirablement belle qu’il serait impossible de tracer son portrait, si Raphaël n’avait pas laissé ces vierges sublimes qui semblent animées d’un souffle divin et dont elle paraissait être sœur ; enfin il y avait un charmant espiègle de neuf à dix ans, aux grands yeux noirs pétillants de malice, frisé comme un chérubin brun, que son père adorait. Puis venait une espèce de mayordomo, de race zambo, âgé d’une cinquantaine d’années, long comme un échaas, maigre à l’avenant, aux traits heurtés, à la physionomie à la fois sombre et hargneuse.
Le chef de la famille se faisait appeler simplement don Manuel, sa femme doña Francisca, la jeune fille doña Santa, et aucun nom ne lui aurait convenu aussi bien ; l’enfant Juan ou plus habituellement Juanito ; quant au sambò, il répondait, quand il daignait répondre, au nom singulier de Naranja, orange, nom qui sans doute lui avait été imposé à cause de la nuance d’un jaune verdâtre de son teint.
Au lieu de quitter le village et de reprendre son voyage, don Torribio avait continué à habiter la hutte assez incommode de Pedro Gutierrez, au grand étonnement de tous les pêcheurs ; la raison en était simple : don Torribio n’avait pu voir doña Santa sans en devenir aussitôt éperdument amoureux ; la première fois que leurs regards s’étaient croisés, le jeune homme, frappé comme d’un coup de foudre, avait baissé les yeux en tremblant ; un frisson avait couru dans tout son corps, il avait porté malgré lui la main sur son cœur, qui tout à coup s’était mis à battre comme s’il voulait s’échapper de sa poitrine et bondir vers la jeune fille.
C’était la première fois que don Torribio aimait véritablement ; cet amour était sa vie, sa joie, son bonheur ; au lieu de réagir et d’essayer de se retenir sur la pente fatale d’un amour sans issue possible, le jeune homme s’y abandonnait au contraire avec une douloureuse volupté ; heureux du présent, il ne voulait pas songer à l’avenir.
Aussi don Torribio ne quittait plus le presbytère, où, du reste, il était toujours bien accueilli, quoiqu’un peu froidement, par don Manuel, que l’assiduité du jeune homme devait surprendre, bien qu’il n’en pénétrât pas les motifs ; d’ailleurs, don Torribio n’était pour lui qu’un pilote habile peut-être, mais en somme un homme de rien, et qui pour lui devait être et était en réalité sans conséquence.
Quant à don Torribio, peu lui importait l’opinion de don Manuel sur son compte ; il n’en avait nul souci, il s’enivrait des regards enchanteurs et de la voix mélodieuse de doña Santa ; il ne voyait, il n’entendait qu’elle ; avec cette fatuité innée chez tous les amoureux, il se figurait que la jeune fille ne le voyait pas avec indifférence, et même éprouvait pour lui une certaine sympathie parce que, chaque fois qu’il se présentait, elle l’accueillait toujours avec un délicieux sourire de bienvenue, qui passait comme un rayon de soleil sur ses lèvres carminées.
Les choses durèrent ainsi pendant une dizaine de jours.
Dans son intéressant ouvrage sur les mœurs, les coutumes et les types spéciaux des habitants de la bande orientale, don Domingo-Francisco Sarmiento met en première ligne, comme étant le plus curieux, le plus extraordinaire et surtout le plus incompréhensible, le Rastreador.
Il faut avoir pendant de longues années vécu dans la bande orientale, c’est-à-dire dans les immenses pampas qui s’étendent de Buenos-Ayres à Mendoza, pour bien comprendre ce que signifie le mot Rastreador et la précieuse faculté que ce mot désigne.
Tous les gauchos de la bande orientale, tous les coureurs des bois des forêts américaines, tous les Peaux-Rouges sont plus ou moins Rastreadores, c’est-à-dire dépisteurs ou découvreurs de traces ; ceci, à la rigueur, est une science acquise basée sur l’observation continue et une longue habitude du désert ; mais le Rastreador proprement dit est tout autre chose et n’existe réellement que dans la République argentine.
Le Rastreador est presque un fonctionnaire public, ses affirmations font foi devant les tribunaux, parce que jamais il ne commet d’erreurs : tout ce qu’il dit, il le prouve.
Tous les terrains lui sont bons pour procéder à ses investigations ; il découvre une trace aussi facilement au milieu d’une ville populeuse qu’au fond d’un désert ; rien ne l’arrête, rien ne le trompe ; il va, il vient, furète de-ci de-là et toujours il arrive au but, quelle que soit l’habileté déployée par celui ou ceux dont l’intérêt est de ne pas se laisser découvrir.
Par exemple, dit Sarmiento dans l’ouvrage que, plus haut, nous avons cité, un Rastreador est appelé à Buenos-Ayres et conduit dans une maison où un crime a été commis pendant la nuit, sans que rien ne dénonce le coupable, sauf une empreinte à demi effacée le plus souvent ; le Rastreador, après avoir regardé cette trace, sort de la maison, suit la piste sans regarder le sol, si ce n’est de temps en temps, comme si ses yeux possédaient la faculté de voir en relief sur les pavés cette empreinte de pas, imperceptible pour tous ceux qui l’accompagnent ; il suit le cours des rues, traverse les places, franchit les jardins, puis tout à coup il fait un crochet, s’arrête brusquement devant une maison et désignant un homme qui s’y trouve, il dit : Le voilà, c’est lui ! Et cela est vrai ; le coupable n’essaie même pas de nier.
N’est-il pas évident que celui qui fait cela possède une faculté précieuse, étrange, incompréhensible ?
Dans la foule d’anecdotes plus ou moins extraordinaires contées par Sarmiento, nous en citerons une seule qui se rapporte à un Rastreador célèbre, nommé Calibar, et qui dépasse toutes les limites du possible.
Pendant un voyage que Calibar fit à Buenos-Ayres, on lui vola son cheval de fête ; sa femme couvrit la trace avec une bûche. Deux mois après, Calibar revint chez lui, vit l’empreinte déjà effacée et imperceptible pour tous autres yeux que les siens ; puis il ne parla plus de cette affaire. Un an et demi après, Calibar marchait la tête basse, dans une rue d’un des faubourgs de Buenos-Ayres ; tout à coup il s’arrête devant une maison, il entre, va tout droit au corral et voit son cheval, déjà noircissant et hors d’usage. Il avait retrouvé la piste de son voleur deux ans après le vol commis !
Quel mystère renferme cet état de Rastreador ? Quel pouvoir microscopique se développe-t-il dans l’œil de ces hommes ? C’est en vain qu’on essaierait de chercher l’explication de cette étrange énigme !
Dix-sept ans ou dix-huit ans avant l’époque où commence notre histoire, par une claire et chaude soirée du mois de mai, un peu après neuf heures du soir, un cavalier, qu’à son costume on reconnaissait au premier coup d’œil pour un gaucho, suivait au pas d’un superbe cheval des pampas, un sentier étroit frayé par les fauves dans une immense forêt située à quelques lieues à peine de Rosario.
Ce gaucho était un homme de haute taille, vigoureusement charpenté, frisant la cinquantaine, mais paraissant avoir conservé toute la verdeur et la force de la jeunesse ; ses traits énergiques étaient empreints d’une grande douceur, sa physionomie avait une rare expression de franchise et de loyauté, mêlée une teinte de mélancolie accentuée par le regard pensif ou plutôt rêveur de ses grands yeux noirs bien ouverts, bordés de longs cils, et dont la prunelle semblait chargée d’effluves magnétiques.
Le voyageur s’en allait ainsi rêvant, se laissant bercer par le pas de son cheval et fumant nonchalamment un cigare dont la fumée bleuâtre tournoyait au-dessus de sa tête et lui formait comme une auréole.
Après quelques instants le cavalier déboucha dans une espèce de carrefour ; soudain il arrêta son cheval, ses regards se fixèrent avec curiosité sur un pellon jeté au pied d’un arbre et faisant bosse, comme s’il cachait ou recouvrait quelque chose.
Le gaucho jeta son cigare presque consumé, mit pied à terre et, après avoir dépassé la bride de son cheval pour empêcher celui-ci de bouger, il marcha droit au pellon, qu’il enleva d’un revers de main.
Alors un cri de surprise lui échappa.
Sous le pellon, un enfant de six ans et demi à sept ans, blond et frisé comme un chérubin, ses petits membres serrés contre son corps afin de se garantir du froid, dormait comme on dort à cet âge, c’est-à-dire à poings fermés.
– Qu’est-ce que c’est que cela ? murmura le gaucho, et il ajouta avec intérêt : Pauvre petit, comme il dort !
Il demeura un instant pensif.
– Comment cet enfant se trouve-t-il, à cette heure, seul dans cette forêt peuplée de fauves ? Il y a un mystère là-dessous, reprit-il en hochant tristement la tête à plusieurs reprises.
Il se baissa, et pendant quelques minutes il examina attentivement le sol, comme s’il eût cherché à lire sur la terre l’explication de ce mystère ; enfin il se redressa en mâchonnant quelques paroles et, revenant à l’enfant, il le secoua légèrement pour l’éveiller.
Le petit être ouvrit de grands yeux bleus pétillants d’intelligence, et il les fixa en souriant sur celui qui avait si brusquement interrompu son sommeil.
– Que fais-tu ici, mon enfant ? demanda le gaucho en adoucissant autant que possible le timbre un peu dur de sa voix.
– Je dors, señor, répondit le bambin toujours souriant.
– Mais qui t’a conduit ici ?
– Un homme avec une longue barbe.
– Tu le connais, sans doute, cet homme ; tu sais son nom ?
– Je ne le connais pas ; je jouais sur le quai là-bas, où il y a tant de maisons.
– À Buenos-Ayres ?
– Je ne sais pas.
– Mais cet homme ?
– Il m’a demandé si je voulais monter sur son cheval, un autre homme m’a soulevé et m’a placé devant l’homme à la longue barbe.
– Le connaissais-tu celui qui t’a soulevé ?
– Non.
– Et l’homme à la longue barbe t’a conduit ici ?
– Oh ! pas tout de suite ; je suis resté trois jours avec lui.
– Tu n’avais pas peur de lui ?
– Pourquoi ? il était bon pour moi, il riait et me donnait des bonbons, tandis que sur le navire tout le monde me battait.
– Tu n’es donc pas de Buenos-Ayres ?
– Je ne comprends pas, señor.
Le gaucho réfléchit un instant, puis il reprit :
– Es-tu demeuré longtemps sur le navire ?
– Oui, très longtemps.
– Comment te nommes-tu ?
– Je ne sais pas.
– Mais comment t’appelait-on sur le navire ?
– Rubio.
Le gaucho fit un mouvement de dépit.
– Depuis quand es-tu là ?
– Depuis bien longtemps. L’homme à la longue barbe m’a fait descendre, il m’a donné à manger, puis il m’a dit : Dors tandis que j’irai faire boire mon cheval. Il m’a embrassé, il pleurait. Pourquoi pleures-tu ? je lui ai dit ; il a répondu : Pauvre petit, tu le sauras bientôt ; je suis forcé d’obéir, dors, sois bien sage, Dieu ne t’abandonnera pas. Il est allé à son cheval, je lui ai crié : Tu redeviendras bientôt ! Oui, oui, m’a-t-il encore crié ; dors en m’attendant ; tu es sous la garde de Dieu ! Et il est parti ; voulez-vous me conduire où il est ?
– C’est impossible, pauvre enfant, répondit le gaucho avec émotion ; mais tu ne peux rester ici plus longtemps, les bêtes de la forêt te mangeraient ; veux-tu venir avec moi ?
– Je veux bien, vous êtes bon, vous ne me ferez pas de mal ?
– Moi ? Oh ! bien au contraire, je t’aimerai, pauvre petit.
Et l’enlevant dans ses bras robustes, il l’embrassa à l’étouffer.
– Cela est bon d’être caressé, dit l’enfant toujours souriant ; si nous rencontrons les autres, vous empêcherez qu’ils me battent comme ils font toujours.
– N’aie pas peur, cher petit, je te défendrai ; personne ne te battra plus.
– Bien vrai ?
– Je te le promets.
– Oh ! s’écria le chérubin en lui faisant un collier de ses bras mignons, oh ! je vous aimerai bien.
Le gaucho remonta à cheval, posa l’enfant devant lui et il se remit en route, mais cette fois au galop ; le brave homme avait hâte d’arriver.
Tout le long du chemin l’enfant babillait joyeusement, le gaucho lui répondait en riant et badinant avec lui. À peine un quart d’heure s’était-il écoulé que l’homme et l’enfant étaient les meilleurs amis du monde : on eût dit qu’ils se connaissaient depuis longtemps, tant ils s’entendaient et se comprenaient.
Cependant les voyageurs étaient sortis de la forêt depuis longtemps déjà ; ils galopaient sur les bords d’une charmante petite rivière, affluent perdu du Parana. Tout à coup, ils aperçurent à une courte distance devant eux une lumière brillant dans la nuit comme un phare ; la distance fut bientôt franchie, et le cheval s’arrêta devant la porte d’un rancho qui, autant qu’on en pouvait juger dans l’obscurité, devait avoir une certaine importance.
Mais la venue des voyageurs avait depuis longtemps déjà été annoncée par trois ou quatre énormes chiens qui aboyaient et gambadaient autour du cheval.
Un péon vint saisir la bride de l’animal, et le gaucho pénétra avec assez de difficulté dans le rancho, portant le bambin dans ses bras.
Celui-ci, loin de se montrer effrayé des bonds et des cris des chiens, qui sautaient à qui mieux mieux après leur maître pour lui faire fête à leur manière, riait et jouait avec eux.
Plusieurs personnes, hommes et femmes, se tenaient dans la première pièce du rancho : la maîtresse de la maison d’abord, femme de trente-quatre à trente-cinq ans, fort belle encore, dont la physionomie douce et les regards bienveillants prévenaient en sa faveur ; les autres étaient des serviteurs et des servantes.
En apercevant son mari, la dame s’avança vers lui les bras ouverts, le regard humide et les lèvres souriantes.
– Tiens, Juanita, dit le gaucho en lui posant l’enfant sur les bras, Dieu m’a fait rencontrer ce pauvre petit être abandonné.
– Il sera le frère de notre Pepe, répondit-elle en embrassant l’enfant, qui lui rendit aussitôt ses caresses avec un abandon qui la remplit de joie.
– À la bonne heure, dit joyeusement le gaucho, cela fait qu’au lieu d’un enfant nous en aurons deux.
– Oui, reprit-elle en l’embrassant de nouveau, puisque Dieu nous le donne, c’est qu’il veut que je sois sa mère.
– Que la volonté du Seigneur soit faite ! répondit le gaucho avec sentiment.
Tout fut dit ; le pauvre abandonné avait une famille.
Deux jours plus tard, le gaucho, laissant les deux enfants, qui déjà se traitaient en frères, jouer et se rouler avec les chiens sous l’œil vigilant de sa femme, monta à cheval et partit pour Buenos-Ayres.
Don Juan Miguel Caballero, ainsi se nommait le gaucho, était né au Diamante, mais tout jeune il avait quitté sa famille pour courir la pampa, dont en quelques années il était devenu un des plus renommés gauchos et un des Rastreadores les plus célèbres. De Buenos-Ayres à Mendoza, dans toute la bande orientale, Juan Miguel Caballero jouissait d’une réputation devant laquelle chacun s’inclinait avec respect ; tous les autres Rastreadores reconnaissaient sa supériorité et le reconnaissaient pour leur chef ; on racontait de lui des faits d’une science surhumaine et d’une étrangeté extraordinaire ; c’était quelque chose d’incroyable, une espèce de seconde vue.
Bien que le Rastreador ne fût nullement intéressé, tous les gens auxquels il avait rendu service, et le nombre en était grand, avaient pris plaisir à lui prouver leur reconnaissance, de sorte que, malgré lui, il était devenu riche, relativement bien entendu, c’est-à-dire autant qu’un honnête homme peut devenir riche dans les Pampas ; en somme, cette fortune aurait été partout une fort belle aisance ; quel que fût son chiffre il s’en contentait et se trouvait heureux entre sa femme et son fils Pepe, qu’il adorait, et quelques bons amis sur lesquels il savait pouvoir compter au besoin.
Que désirer de plus ? Il avait une santé de fer, se plaisait à rendre service à ses voisins quand l’occasion s’en présentait, il jouissait d’une réputation sans tache, d’une célébrité dont bien d’autres à sa place se seraient enorgueillis, tout lui souriait dans le présent comme dans l’avenir : nous le répétons, il était heureux.
Pepe n’avait pas encore cinq ans ; il était donc un peu plus jeune que le bambin qu’on lui avait donné pour frère, et auquel Juan Miguel avait imposé le nom de Torribio ; Pepe était, lui aussi, un chérubin rieur et frisé ; seulement, au lieu d’être blond, il était brun ; quelques heures avaient suffi pour que les deux bambins, avec cette confiance innée chez les enfants, se trouvassent sur le pied de l’intimité la plus complète et s’aimassent comme s’ils eussent été véritablement frères ; ce que voyant, doña Juanita les prit tous deux sur ses genoux et se mit à les manger de caresses, que les enfants lui rendirent avec une ardeur qui porta sa joie au comble.