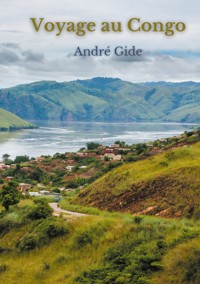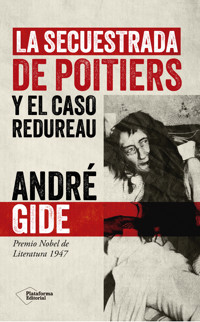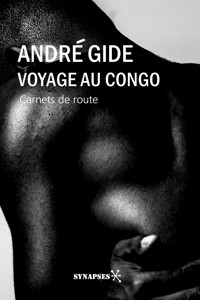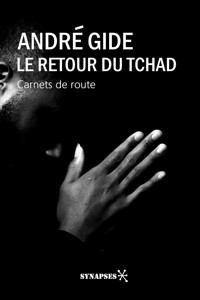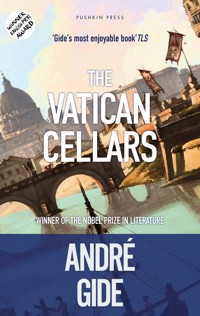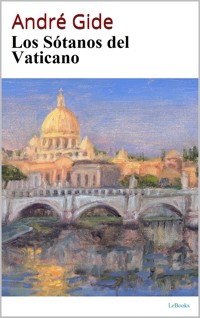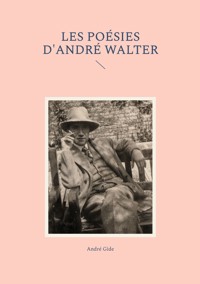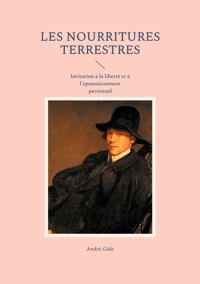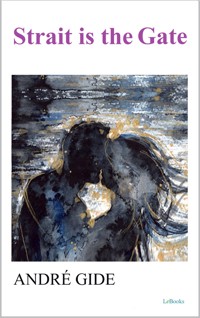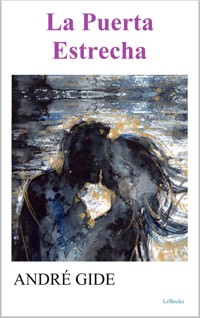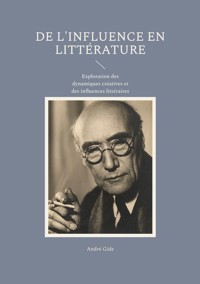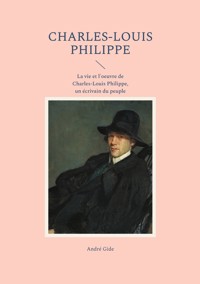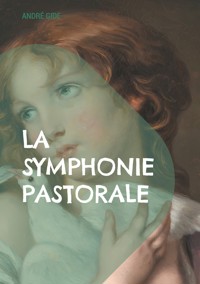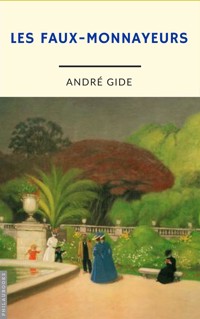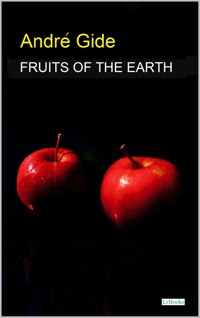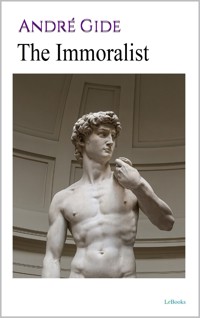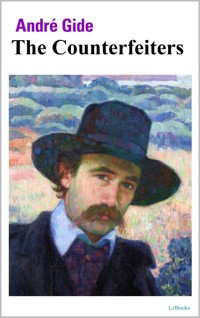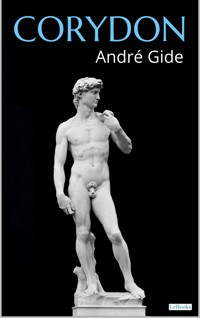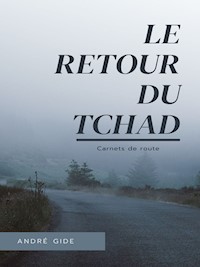
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
La suite du Voyage au Congo. Documents - Essais...
Das E-Book Le Retour du Tchad wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
littérature française, Afrique, Tchad, André Gide, récit de voyage, AVENTURES
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Retour du Tchad
Le Retour du TchadCHAPITRE PREMIER. Sur le LogoneCHAPITRE II. Retour en arrièreCHAPITRE III. Seconde remontée du LogoneCHAPITRE IV. Second séjour chez les MassaCHAPITRE V. À travers la brousse. Maroua, départ d’AdoumCHAPITRE VI. Léré, Binder, BibémiCHAPITRE VII. Reï BoubaCHAPITRE VIII. N’GaoundéréAppendice CONTENANT LES DOCUMENTS RELATIFS À LA QUESTION DES GRANDES COMPAGNIES CONCESSIONNAIRESIIIIIIIVDERNIERE HEUREI. 2II. 2III. 2Page de copyrightLe Retour du Tchad
André Gide
CHAPITRE PREMIER. Sur le Logone
20 février.
Nous quittons Fort-Lamy dans trois baleinières[1]. C’est le retour. Lente remontée du Logone ; assez exactement de la largeur de la Seine, me semble-t-il. Les eaux sont basses et les indigènes préfèrent à la rame la propulsion des perches sur lesquelles ils pèsent, quatre à l’avant, quatre à l’arrière, se penchant puis se relevant en cadence : ceci nous prive de leurs chants, réservés au rythme plus régulier des pagaies, mais cette avancée presque silencieuse effarouche moins le gibier et nous permet d’approcher de plus près les oiseaux qui peuplent les rives.
Dans cet étroit tunnel que forme le shimbeck de la baleinière, il ne fait pas trop chaud, et, si lente que soit la marche, elle entretient un exquis courant d’air. Étendu sur une chaise de bord, qui, de jour, prend la place du lit de camp replié, je relis le Barbier de Séville. Plus d’esprit que d’intelligence profonde. De la paillette. Manque de gravité dans le comique.
21 février.
Partis avant le lever du soleil. Une légère brume argente les bords du Logone, de proportions plus humaines que les bords du Chari. Austérité souriante des berges sablonneuses ; aucune mollesse. Quantité d’arbustes vert cendré, semblables aux saules et aux osiers de France. De même il y a, sur ces bords, des simili-cressons, des faux épilobes, des imitations de myosotis, des substituts de plantains. On dirait que les acteurs seuls ont changé, mais ni les rôles, ni la pièce. Qui tiendra l’emploi de la scrofulaire ?… Parfois c’est une plante de la même famille, une proche parente, comme il advient pour la balsamine. Mais c’est ce qui explique que l’on soit si peu dépaysé, encore que parfois les vedettes de nos contrées soient réduites ici au rang de comparses. Pour que le paysage prenne un aspect vraiment exotique, il faut l’intervention d’un de ces végétaux axés et réguliers : palmiers, cactus, euphorbes-candélabres, etc., dont nous n’avons pas d’autres équivalents dans nos contrées du Nord, que certains conifères.
L’inconvénient d’un voyage trop bien préparé, c’est de ne laisser plus assez de place à l’aventure. Pourtant nous approchons du lieu où le premier patron de notre boy Outhman (l’administrateur Noumira ?) trouva le moyen de se faire bousculer mortellement par les hippopotames. On nous signale précisément, non loin d’ici, une bande d’une trentaine de ces monstres, barrant le Logone, que les pirogues indigènes n’osent plus remonter. Allons toujours ; nous verrons bien.
Depuis que nous avons quitté Fort-Lamy, nous vivons de gibier, canards ou pintades. Selon mon habitude d’inviter imaginairement un ami, un inconnu parfois, à partager ma joie, ce matin je chasse avec Pesquidoux qui ne se doute guère, assurément, que je fus des premiers à m’éprendre de ses écrits. Des premiers avec Marcel de Coppet ; et nous nous amusions à Fort-Archambault, à nous remémorer ses anciens articles, qu’alors personne ou presque ne remarquait. – Oui, j’invite Pesquidoux à savourer avec nous ce canard « à la rouennaise », pour qu’il me dise s’il en a jamais mangé de meilleur.
Les hautes herbes du bord dissimulent le brusque effondrement des rives. Bosquets d’un vert plus sombre, peuplés de singes qui s’enfuient à notre approche. Grands arbres penchés sur l’eau ; leurs racines, déchaussées par le cours du fleuve, forment grotte. Avance somnolente. Ravissante paresse. Scintillement tendre de l’eau… Des appels de pintades. Au loin un troupeau de katambours[2]… Nous abordons et nous nous lançons au hasard des pistes, bientôt ne songeant plus à la chasse, tout à l’attrait de tant de nouveauté.
Certains arbres atteignent des dimensions stupéfiantes ; pourtant leur cime n’échappe plus aux regards comme celle des géants de la forêt équatoriale ; c’est une énormité trapue ; et, tout autour du tronc, s’étend un vaste espace ombreux, que l’arbre investit, sur lequel il règne, étalant ses branches colossales comme pour repousser toute autre végétation. Ces branches s’arquent, se voûtent et, de leur extrémité au loin retombée, touchent le sol. L’on respire un instant dans ces belles clairières couvertes ; mais, sitôt qu’on en sort, on est tout empêtré dans l’enchevêtrement confus des ramures ; on se courbe, on se glisse à genoux, on rampe ; au bout d’un quart d’heure de reptation on a complètement perdu le sens de la direction, et, dans l’absence de points de repère, jamais nous ne pourrions retrouver les baleinières, sans les indigènes qui nous accompagnent et qui, eux, ne s’égarent jamais.
Quelle erreur de s’imaginer les oiseaux et les insectes des pays tropicaux toujours parés de couleurs vives. Même les martins-pêcheurs, ici, sont noirs et blancs et ne rappellent que par la forme les martins-pêcheurs de Normandie, ces cris d’azur que jetait parfois le petit ruisseau de la Roque, jadis, à quoi répondait un cri d’émerveillement dans mon cœur.
Les tsé-tsés nous harcellent. On ne peut ni les tuer, ni les chasser. À peine parvient-on à les voir. Leur piqûre, sans être très douloureuse, devient à la longue extrêmement énervante.
Vers quatre heures, entrée en scène des hippopotames. Leur mufle énorme vient crever la surface de l’eau. Nous en comptons sept, mais sans doute y en a-t-il davantage. Ils respirent à peu près tous en même temps. Nos baleinières s’arrêtent. Marc tire sur eux quelques balles, puis, espérant les approcher, se fait mener sur l’autre rive. Presque en face de lui, je m’assieds sur un tronc d’arbre au bord du fleuve. Un grand singe qui vient boire, s’approche de moi.
J’entraîne Outhman dans la campagne. Une prodigieuse quantité de sauterelles couvre les arbres, les taillis ; lorsqu’on s’approche d’un buisson bas, elles partent en un vol épais, à grand bruit. Sous l’arbre, où elles sont trop haut perchées pour me craindre, une pluie continue de petits projectiles allongés : ce sont leurs crottes.
Hautes herbes sèches, sillonnées de sentes. Arbustes épineux. Traces d’animaux de toutes sortes, de lion en particulier ; mais nous ne voyons rien que des singes ou des pintades. Si : une troupe de katambours – on dirait de loin de petits chevaux – qui viennent s’abreuver dans le fleuve. Admirable coucher de soleil ; les herbes, le ciel, le fleuve se dorent. Nous sommes à l’endroit où le Logone fait un grand coude : en face de nous s’étend un banc de sable où nous allons passer la nuit. Immédiatement après le coucher du soleil, le ciel s’obscurcit : c’est la horde des sauterelles qui repart vers l’est. Leur passage n’a pas duré moins de cinq minutes.
Le paysage est moins vaste et moins vague : il se tempère et s’organise.
22 février.
Sur les bords du fleuve (côté Tchad) [3], bords assez abrupts. Des norias nous attirent – ou quel autre nom donner à ces appareils élévateurs, simple fléau, porteur à l’une de ses extrémités d’un récipient, à l’autre d’un contrepoids, qui balance le poids de l’eau qu’on prend au fleuve et l’élève sans peine à hauteur du champ qu’il faut irriguer. Rien de plus primitif et de plus ingénieux que cette élémentaire machine d’une élégance virgilienne. Une grande calebasse sert de récipient.
Un indigène s’occupe à faire monter l’eau ; un autre à la répartir, ouvrant et fermant tour à tour, d’un coup de houe, de petites écluses de terre. L’eau, d’abord, est précipitée de la calebasse, sur une claie, de manière que la terre ne soit pas creusée par la chute de l’eau, mais garde sa pente. Le champ tout entier est en pente légère. Ce sont des aubergines qu’on y cultive. Il y a pour ce seul champ, pas très grand, six norias à une vingtaine de mètres l’une de l’autre. Je note longuement ceci, car je n’ai vu parler de ces machines dans aucune relation de voyage au Tchad.
Arrêt à Logone-Birni[4] (autrefois Carnak). Le sultan vient à notre rencontre en pirogue. Boubou bleu, lunettes bleues : à la main une queue de vache teintée d’indigo, en manière de chasse-mouches. On est reçu par un concert de quatre instruments : deux tambours, une sorte de clarinette et une trompette extrêmement longue et mince, qui se démonte : elle rend des beuglements pleins d’harmoniques.
Un hôpital, avec 60 malades, dirigé, en l’absence du docteur, chef du secteur de prophylaxie, par trois indigènes. Ils prétendent arriver à guérir la trypanosomiase même à la troisième période. Excellente impression ; ordre, propreté, décence ; quatre microscopes ; registres bien tenus. Visible désir d’être à hauteur, de suffire et de satisfaire.
Divers arrêts le long du fleuve. Vaine recherche des hippopotames. Nous passons la nuit sur un vaste îlot de sable, à l’abri des lions, très nombreux, nous dit-on, dans la brousse avoisinante.
23 février.
Chose étrange : le Logone, tandis qu’on le remonte, s’élargit sans devenir apparemment moins profond, ni moins rapide. Les bords s’écartent, s’abaissent et le pays tout à l’entour semble s’enfoncer. Que j’aimerais le voir durant la crue qui, nous dit-on, le transforme en un lac immense semé, de loin en loin, de petits îlots de verdure où tous les animaux viennent se réfugier. Nous nous sommes arrêtés vers midi à Logone-Gana (sur la rive orientale). Je quitte la baleinière et m’y rends à pied. Important village, en terrasse au bord du fleuve, entouré de murs crénelés, assez hauts. On y entre en passant par une petite poterne. Sur les créneaux, des marabouts semblables à des sentinelles. J’en compte sept sur sept créneaux successifs. Immobiles, énormes, on les croirait empaillés. Les eaux, durant la crue, viennent battre le pied des murs, paraît-il. Maisons assez hautes ; tantôt rondes, tantôt cubiques, entassées sans ordre aucun ; ruelles tortueuses, petites places irrégulières, et tout à coup un arbre énorme abritant un petit marché. À travers tout le village circule une intolérable odeur de poisson. C’est le principal commerce du pays ; dans chaque courette, on en voit de petits et de gros, à moitié secs, étendus sur des claies.
J’achète un mark (qui vaut trois jetons de cinquante centimes) ; il en circule encore quelques-uns dans le pays – mais les indigènes ne les apprécient guère, car ils ne peuvent servir pour le paiement de l’impôt[5].
Oublié de noter la rencontre d’une bande de pélicans – les premiers. J’en compte quinze, qui voguent tranquillement comme des cygnes et ne s’envolent à notre approche que pour se reposer une cinquantaine de mètres plus loin. Ils sont moins beaux que ceux que j’ai pu voir au Jardin des Plantes (de quel pays ?), que ceux dont parlait si bien La Fontaine[6]. Ceux-ci sont gris ou blancs (je pense que les gris sont les jeunes) mais ont les ailes bordées de noir. Il me semble me souvenir que les autres sont tout blancs, avec des tons carnés et soufrés.
Mais cet après-midi, après la sieste, sur un tout petit îlot de sable au milieu du fleuve, j’en vois tout un peuple. Entre 100 et 150. Nous mettons pied à terre pour les cinématographier de la rive. Très peu farouches, ils reviennent après qu’on les a chassés. Marc, un quart d’heure auparavant, en avait tué un. Pas à faire. Animal trop sympathique, et trop peu défiant. Nos hommes le dépèceront ce soir, et de la peau tout emplumée se feront des toques.
Arrêt au soir à un autre village. Douboul (Divel, sur la carte allemande).
Le village flotte dans une vaste enceinte qu’entoure une forêt de rôniers. Très pittoresque, un bras mort du Logone vient l’affleurer. Marécages, fièvre, moustiques.
24 février.
Nuit presque blanche. De brusques clapotis, des claques d’eau. On dirait, tout à côté de ma baleinière, des gens qui se baignent ou des oiseaux pêcheurs pillant la rivière. À la fin la curiosité l’emporte et je me lève. Il fait humide et froid. Les feux du campement, sur la rive, sont presque éteints. Parfois un des Sara tousse, se soulève et souffle sur des tisons mourants, puis se rendort. La lune à demi pleine est au milieu du ciel. Ai-je dit que nos baleinières étaient entrées assez avant dans un bras mort du Logone ? un peu plus loin il s’achève en marais sous les murs du village. Le bruit qui me tenait en éveil, c’est celui des ébats des poissons. Ils sont si nombreux, que, par places et par instants, l’eau semble bouillir ; on les distingue au clair de lune, à demi sortis de l’eau, qui se poursuivent ou chassent les insectes, jaillissent et retombent dans un éclaboussement sonore. Tout au ras de l’eau, de grands oiseaux bizarres, que je ne reconnais point, au vol fantasque et silencieux, passent et repassent. Quatre grands échassiers, grues royales, marabouts ou jabirus, traversent le ciel, le cou tendu, les pattes allongées, en poussant un long cri rauque. Et soudain je comprends que les autres, ceux qui rasent l’eau, sont des chauves-souris.
Ce matin le Logone rejoint assez exactement l’image que je m’en faisais. Les rayons du soleil levant dorent le sable et la glaise de la rive camerounienne, formant une petite falaise abrupte que surmonte une crête de roseaux. De-ci, de-là, quelques rôniers ; le ciel et l’eau d’un bleu parfait. Sur la rive orientale, plus basse, une herbe verte, qui fait un bruissement soyeux lorsque la baleinière la frôle.
Dans un grand banc de vanneaux (?) deux coups de fusil en tuent et blessent onze, que poursuit, rattrape et rapporte un des noirs de notre équipage ; tandis que le reste s’enfuit en un nuage épais.
Nous nous arrêtons près d’un groupe de pêcheurs. Deux enfants en pirogue vont rechercher dans la campagne des paquets d’hameçons qu’ils avaient été cacher à notre approche, dans la crainte qu’on ne s’en emparât. Et, de l’autre côté du Logone, nous rejoignons un autre groupe de pêcheurs. Ils sont d’une complaisance, d’une gentillesse extrême, et d’une reconnaissance émue lorsque je leur tends un billet de cent sous pour un gros poisson qu’ils nous offrent.
Un village extrêmement misérable (Cameroun) où vivent accidentellement les gens engagés ou venus de Moosgoum pour la saison de pêche. Toutes les femmes, même les plus jeunes, ont des plateaux aux deux lèvres – non de bois, mais d’argent (ou métal blanc) – ainsi qu’aux oreilles. Encore que ces plateaux ne soient pas plus larges qu’un cul de bouteille, l’aspect est hideux.
Arrivée à Kolem vers trois heures. Pourquoi marqué si grand sur la carte ? Pas plus important que le village d’hier soir. Extrêmement pittoresque. Étangs d’eau croupissante, à quatre places, dans la ville ; l’un recouvert d’une épaisse crème verte, et de bois flottants. Et, ceinturant à demi la ville, mais en deçà des remparts, une très large pièce d’eau, qui, à la saison des pluies, doit être reliée au Logone. Ce large étang, parallèle au fleuve, entre dans la ville, et la ville reprend par-delà, comme il advient aux Martigues ; et plus loin encore, au-dessus de l’étang et de la reprise de la ville on revoit le Logone, puis l’autre rive. Nous n’avons rien vu de plus étonnant depuis Goulfeï.
J’insiste néanmoins pour que nous ne couchions pas à Kolem. Le voisinage de ces eaux croupissantes me fait peur. Nous repartons au soleil couchant, puis voguons à la clarté de la lune. Voici bientôt le banc de sable où nous allons pouvoir dîner et camper – où j’écris ceci avant de regagner mon lit dans la baleinière.
Sur le banc de sable, nos rameurs s’organisent pour la nuit qui s’annonce froide. Vingt degrés de différence entre le jour et la nuit. Et je parle de la température à l’ombre ; mais eux travaillent et peinent en plein soleil et toujours complètement nus. Je ne comprends pas comment ils résistent. (Mais certains ne résistent pas.) Des feux sont allumés, autour desquels ils se groupent. Ils s’étalent ou se recroquevillent, le ventre à la flamme. Une même natte en couvre deux, dos à dos, chacun faisant face à un foyer. Ils creusent le sable pour s’y étendre et en recouvrent les bords de la natte, pour être mieux à l’abri du vent – qui, Dieu merci, n’est pas très fort. S’il se mettait à souffler, ils attraperaient la crève. Jamais on ne me fera croire que ces gens, « qui n’ont besoin de rien », n’achèteraient pas des couvertures si quelque « magasin » leur en présentait. Je cherche si je n’ai rien à leur prêter et leur apporte la toile de mon lit (que nous avons fait remplacer par du cuir, à Fort-Archambault). L’un d’eux l’accepte avec empressement. Mais ils sont vingt-sept et je n’ai pu satisfaire qu’un.
Tâcher de faire sentir en quelques mots[7] la beauté surhumaine de la nuit sur ce petit banc de sable d’or, entouré d’eau, de ciel, de solitude et d’étrangeté. Parfois un vol de grands échassiers passe en sifflant comme un rapide de nuit : on entend le bruit de leurs ailes.
25 ou 26 février.
Plus un arbre, durant des lieues ; des rives à peine sorties des eaux. Paysage de plus en plus paludéen et tel que je le dépeignais dans la deuxième partie du Voyage d’Urien. Sur des bancs de sable, des compagnies de canards ; assez difficiles à approcher. Il y en a parfois tout un peuple ; quelques coups de fusil jetés au milieu du rassemblement en abattent une douzaine. Certains qui ne sont que blessés regagnent l’eau en voletant et plongent lorsque la baleinière approche. Il en est un en particulier sur lequel nous tirons par cinq fois ; il plonge, il nage entre deux eaux, reparaît plus loin. On voudrait l’achever. À la fin ce n’est plus qu’une épave, mais qui plonge encore et que trois nègres, qui nagent à sa poursuite, ont le plus grand mal à retrouver dans les roseaux. À chaque coup de fusil, s’il a porté, ils s’élancent de la baleinière, courant, nageant, se bousculant vers le gibier. Quels braves gens ! Que je voudrais comprendre ce qu’ils disent ! Peut-être qu’ils se fichent de nous, des coups que nous manquons ; mais leur joie est charmante, leur rire est si franc, si clair ; et leur sourire de jour en jour devient plus confiant, plus affectueux, j’allais presque dire : plus tendre. Et je m’attache à eux toujours plus. Marc a poursuivi longtemps, dans une lande incendiée, un troupeau d’am’raïs, mais n’a pu en abattre que deux. Un peu plus grands, mais de forme et de pelage moins charmants que l’antilope-Robert qu’il avait tuée l’autre jour. Un seul eût suffi pour tout notre équipage ; mais ils ne laisseront pas un morceau et sauront faire disparaître aussi les dix-huit canards que nous avons tués aujourd’hui. Ceux-ci ne sont pas tous de même espèce. Certains, gros comme des oies, portent une crête noire au-dessus du bec. Tous sont de chair succulente et même je ne sais si j’ai jamais rien mangé de meilleur.
Je tue également, au vol, un curieux oiseau gris à fine aigrette blanche, bec très long, gros œil de rubis, pattes jaunes presque échassières ; de la grosseur d’une corneille.
Kaséré ; village peut-être pas très pauvre, mais d’une saleté indicible. Le sol est fait par endroits d’une poussière de détritus. Pourtant les habitants ont l’air sain et heureux. Plus de pian, plus de gale ; enfin des peaux nettes.
Quelques arbres très beaux dans les cours et sur de petites places, – en particulier d’énormes palmiers doums, très ramifiés, d’aspect violemment exotique. Depuis deux ou trois jours, plus de tsé-tsés ; partant, plus de trypanosomiase (et alors pourquoi pas de bétail ?). Très peu de cultures. Les habitants vivent de leur pêche, que viennent acheter les gens de Maroua, apportant du mil en échange. Beaucoup de moustiques au bord du fleuve, où nous campons. Ce n’est qu’un bras du Logone. Nous avons quitté ce matin et ne retrouverons que demain soir l’autre bras, plus important, trop profond pour que l’on puisse avancer avec les perches. À mesure qu’on le remonte, chose paradoxale, le Logone semble avoir de plus en plus d’eau.
Mazéra ; dernier village Kotoko. Ce soir, tandis que Marc charge ses appareils, je m’approche d’un groupe d’enfants qui dansent au son d’un tambour. Apprivoisement difficile de quelques petits. Mais, comme la question d’argent s’en mêle, les mères traînent de force leurs rejetons vers nous, dans l’espoir d’une pièce de dix sous. La plupart du temps, les petits hurlent. Il faut ensuite les reconquérir très lentement.
26 ou 27 février.
On se lève dès 5 heures 1/2 ; mais vers 7 heures, quel breakfast ! Porridge, canard froid, rognons d’am’raï, flan, fromage, le tout arrosé d’un thé excellent.
Adoum continue à traîner la jambe ; sa plaie au-dessus du pied ne se cicatrise pas ; elle semble empirer au contraire. Après s’être entendu dire par des médecins français qu’il avait la vérole, alors qu’il ne l’avait pas, il a perdu confiance et ne veut plus recourir qu’à la médecine indigène. Un vieux noir (assez sympathique, ma foi) lui vend pour deux francs une poudre d’herbes, qu’il sort d’un petit sachet. Adoum répand sur le vif de la plaie cette sale poussière. Le lendemain le pied ne va pas mieux, et hier soir, descendus à terre, nous voyons le pauvre garçon assis sur le sable, la jambe malade ensevelie sous une épaisse couche de boue et de crottin. Ce matin, le tirailleur qui nous accompagne obtient qu’Adoum use de certain jus végétal qu’il préconise. C’est un latex visqueux dont le tirailleur apporte quelques gouttes sur une pierre. Adoum en badigeonne sa plaie et cela le cuit affreusement.
Le pays devient toujours plus morne. L’incendie ajoute à l’aridité sa désolation. À perte de vue, on ne voit que du roux et du noir. Un peu de vert, au bord du fleuve sur une rive, et sur l’autre une marge de sable d’or. L’azur du ciel est presque tendre et l’eau, participant du vert, de l’azur et de l’or, prend un ton d’une exquise délicatesse.
Petit village en formation, sans nom encore sur aucune carte. Une cinquantaine d’indigènes, souriants, accueillants, et qui, dès qu’ils nous voient, font tam-tam sous le plein soleil de midi. Des femmes qui ne seraient pas laides, sans ces terribles plateaux qui distendent leurs lèvres. C’est bien une des plus déconcertantes aberrations, et que rien n’excuse ou n’explique – car les théories qu’on sort à ce sujet (dépréciation des femmes pour leur permettre d’échapper aux razzias) – ne tiennent pas debout. Ces pauvres femmes, aux lèvres toujours ruisselantes, ont l’air stupides, mais nullement malheureuses ; elles rient, chantent, se trémoussent et ne semblent pas se douter qu’on puisse ne pas les trouver ravissantes. Il n’en est pas une seule au-dessus de quatorze ou quinze ans qui ne soit ainsi défigurée[8].
Nous arrivons vers le soir à Gamsi devant les premières cases en obus. C’est un tout petit village de la tribu des Massa, après le confluent des deux bras du Logone. Le soleil est près de disparaître ; tout est rose et bleu, vaporeux, irréel. Devant le village, un banc de sable.
Au milieu du fleuve, un curieux îlot allongé, une étroite bande de buissons sur lesquels va bientôt percher une prodigieuse quantité d’échassiers, blancs, noirs et gris. D’instant en instant de nouveaux arrivants, qui d’abord hésitent : tout est « complet ». Bah ! en se tassant un peu on finira bien par trouver place.
Un peu en aval, une grande île s’achève en angle obtus, à l’extrémité de laquelle un peuple de canards, de sarcelles et de grues va gîter pour la nuit.
À l’horizon une rampe de flammes ; c’est la prairie incendiée dont l’embrasement rougit un côté de la nuit. Immense plaine, très rares arbrisseaux de loin en loin ; ce dénuement magnifie encore les trois grands arbres du village. Parmi nombre de cases rondes, les premières en forme d’obus paraissent plus belles encore que je ne pouvais supposer. D’une perfection de forme qui fait penser à quelque travail d’insectes, ou à un fruit : pomme de conifère ou ananas. Dans l’intérieur des cases rondes, bétail, volailles et gens couchent ; mais non point pêle-mêle ; chacun a sa place attitrée ; tout est en ordre et tout est propre. Le toit, parfois, est soutenu par trois ou quatre grands troncs ou branches d’arbres, obliquement posés, et comme emportés dans un vortex ; presque à leur pied, le foyer, qui donne à la fois chaleur et ce qu’il faut de lumière pour distinguer, contre le mur circulaire, le troupeau de vaches ou de chèvres, séparé du reste de la case par un petit mur très bas, qui semble une margelle ; de sorte que le fumier et le purin ne viennent pas souiller le sol très net et propre de la case. Dans un petit coin à part, les poules. Et tout cela si exact, si bien agencé, proportionné, si net, si « cosy » que ce qui domine, c’est peut-être l’impression de confort.
Moosgoum.
Je m’étonne que les quelques rares voyageurs qui ont déjà parlé de ce pays, de ces villages et de ces cases, n’aient cru devoir signaler que leur « étrangeté ». La case des Massa ne ressemble à aucune autre, il est vrai ; mais elle n’est pas seulement « étrange » ; elle est belle : et ce n’est pas tant son étrangeté que sa beauté, qui m’émeut. Une beauté si parfaite, si accomplie, qu’elle paraît toute naturelle. Nul ornement, nulle surcharge. Sa pure ligne courbe, qui ne s’interrompt point de la base au faîte, est comme mathématiquement ou fatalement obtenue ; on y suppute intuitivement la résistance exacte de la matière. Un peu plus au Nord, ou au Sud, l’argile, mêlée à trop de sable, ne permettra plus cet élan souple, qui s’achève sur une ouverture circulaire, par où seulement l’intérieur de la case prend jour, à la manière du panthéon d’Agrippa. À l’extérieur, quantité de cannelures régulières, où le pied puisse trouver appui, donnent accent et vie à ces formes géométriques ; elles permettent d’atteindre le sommet de la case, souvent haut de sept à huit mètres ; elles ont permis de la construire sans l’aide d’échafaudages ; cette case est faite à la main, comme un vase ; c’est un travail non de maçon, mais de potier. Sa couleur est celle même de la terre, une argile gris-rose, semblable à celle des murs du vieux Biskra. Les fientes des oiseaux souvent blanchissent les sommets des cannelures et rehaussent inopinément leur relief.
À l’intérieur de la case règne une fraîcheur qui paraît délicieuse lorsqu’on vient du dehors embrasé. Au-dessus de la porte, semblable à quelque énorme trou de serrure, une sorte de columbarium-étagère, où sont disposés des vases et des objets de ménage. Les murs sont lisses, lustrés, vernissés. Face à l’entrée, une sorte de tambour haut, en terre, très joliment orné de motifs géométriques en relief et en creux, peints en blanc, en rouge et en noir : ce sont des coffres à riz. Leur couvercle de terre est luté avec de l’argile ; le dessus, complètement lisse, semble une peau de tambour. Des instruments de pêche, des cordes et des outils, pendent à des patères ; parfois un faisceau de sagaies, un bouclier en jonc tressé. Dans un demi-jour de tombe étrusque, la famille vit là, durant les plus chaudes heures du jour ; la nuit, le bétail vient la rejoindre : bœufs, chèvres et poules ; chaque bête a son coin réservé, et tout reste à sa place, tout est propre, exact, ordonné. Aucune communication avec le dehors, aussitôt que la porte est close. On est chez soi. « Je suis réellement d’outre-tombe. Et pas de commissions. »
En plus des humains et du bétail, ces cases abritent une faune particulière : des hirondelles à queue semi-blanche ont construit leur nid au sommet de la voûte ; des chauves-souris volettent autour du rayon unique qui fait transparaître leurs ailes ; de petits lézards courent le long des murs où les nids des mouches-maçonnes posent des sortes de verrues.
Qu’on imagine une vache pénétrant dans un de ces obus où elle couche. Elle a tout juste la place de passer en baissant la tête. La porte épouse exactement sa forme ; et ceci explique son élargissement à hauteur du ventre. Le cadre de la porte est en relief, souvent ornementé. En cet endroit seulement le mur est si épais que l’embrasure forme presque un couloir ; on dirait l’ouverture d’une conque marine. Certainement depuis des siècles ces courbes, ces arêtes, ces ébrasements sont les mêmes. Oui, vraiment, cela est beau comme un produit naturel. Ah ! pourvu qu’un administrateur trop zélé ne vienne pas, au nom des principes de l’hygiène, percer ces murs, ouvrir des fenêtres, réduire à je ne sais quel commun diviseur, ces purs nombres premiers !
Ces obus, de taille inégale, sont réunis par petits groupes. Souvent ils se touchent à leur base, mais sans s’entre-pénétrer toutefois, car toujours leur élan part du soi et les cercles tangents que tracerait leur plan sont parfaits. Le dessus du couloir qui les relie alors à mi-flanc forme terrasse. Parfois une tour ronde complète l’ensemble et rompt l’uniformité de l’aspect. Un mur très bas va d’une case à l’autre et rattache dans un embrassement circulaire toutes les constructions d’une même communauté.
Devant certaines de ces cases s’étend une aire de terre battue et lisse où les Massa arrosent le mil qui doit germer et fermenter pour la préparation du « pipi » (sorte de bière). Et cette aire elle-même, comme tout ce qui appartient aux Massa, est nettement dessinée, de forme parfaite.
En plus des obus et des tours rondes qui servent de lieu d’habitation aux indigènes et à leurs troupeaux, l’on voit, dans l’enclos, d’autres obus, sensiblement plus petits, sans cannelures en relief, mais parfois ornés de vermiculures et de quadrillages. Ces obus mineurs ne reposent pas directement sur le sol, mais sur un treillis de branches. Ce sont des greniers à mil, qu’il importe de mettre à l’abri des rats, des insectes et de l’humidité. Une double ceinture d’herbes tressées permet d’atteindre leur goulot pour puiser dans la provision.
À noter encore, de-ci, de-là, près des demeures, une sorte d’ampoule lisse, sur le sol, de soulèvement arrondi : c’est une tombe.
Le village, ce premier jour, est à peu près désert. Les gens travaillent aux champs. Nous décidons de gagner Pouss, où nous attendent les porteurs réquisitionnés pour nous accompagner bientôt à Maroua.
Le poste de Pouss, sur l’autre rive (camerounienne) du Logone, où nous arrivons à la tombée du jour, est très décevant ; dans un site assez morne, loin de toute case indigène. Assez sale, au surplus. Nous retournerons donc gîter à Mala.
Car, désireux de choisir le meilleur emplacement où filmer, nous avons voulu comparer à Moosgoum le plus important village suivant (après quantité de groupements de moindre importance), Mala, où nous ont conduits aussitôt nos baleinières. Le chef de canton est venu à notre rencontre, à cheval. Nous avons abordé pour le saluer. Il est énorme, ventripotent. Au demeurant, très aimable, souriant, déférent, manifestement désireux de nous prouver son bon vouloir. Grand boubou blanc, ceinture noire. Auprès de lui son vizir, ou je ne sais quel dignitaire, porte par-dessus le boubou une sorte de gilet tunisien caroubier. Les quatre chevaux du sultan et de sa suite s’impatientent. Nous repartons après échange de compliments.
Mala, vu du fleuve, est très beau. Quelques arbres, dans le pays alentour, aux abords immédiats du village et dans le village même ; des arbres énormes. Celui qui ombrage notre lieu d’abordage en particulier est monstrueux. Ce doit être un ficus. Le tronc, on ne peut plus bizarre, et d’une complication comme intentionnelle, semble un faisceau de lianes emmêlées[9].
La race des Massa est une des plus belles de l’Afrique centrale. On ne rencontre point parmi les indigènes de ce pays, de ces hideuses maladies de peau dont souffrent à peu près tous les indigènes dans les régions voisines du Congo. Non seulement les gens d’ici sont robustes, bien découplés et sveltes, mais propres, grâce à la proximité du fleuve, où ils se baignent plusieurs fois par jour. Les hommes portent le plus souvent une simple peau de cabri qu’ils laissent flotter par-derrière et qui, par-devant, les laisse complètement découverts. Parfois pourtant ils se vêtent d’étoffe qu’ils achètent à des nomades, car ils ne savent pas tisser, ou la matière textile leur manque. Les femmes vivent nues, quel que soit leur âge ; car je ne peux appeler vêtements les colliers de perles dont elles se parent. Il n’est pas une d’elles dont les lèvres ne soient affreusement distendues par des disques de métal. Les vieilles ont presque toutes une pipe à la bouche, là où le permettent les plateaux, c’est-à-dire à la commissure des lèvres. Ajoutons que le port des plateaux entraîne un continuel ruissellement de salive.
Mala.
Un vieillard impudique, à barbe blanche, couverture sur l’épaule, bâton à la main, très rhapsode, nous raconte, à travers notre interprète, l’arrivée dans le pays du premier blanc (l’explorateur Gentil).
« À l’arrivée du blanc, nous dit-il, tous les gens du village traversent le Logone et fichent le camp dans la brousse. Seul le chef du village ose rester et reçoit les colliers que le blanc lui donne. Les gens reviennent dans la nuit, mais restent terrifiés par cette arrivée d’un être surnaturel qui s’amène sur un bateau marchant tout seul, et qui le lendemain matin a déjà disparu… »
Nous écoutons ce récit sous le grand arbre dont j’ai parlé. À son ombre, qui s’étend jusqu’à l’eau, une centaine de personnes sont assises ; dont quarante-cinq que nous venons de choisir parmi les gens du village, pour composer notre troupe. Tous sont groupés autour de nous en cercles concentriques. Trois vieilles sorcières, trois vieux, qui ont perdu toute pudeur. Ils sont nus comme des Sara, mais sans plus le geste décent et ridicule de ceux-ci pour dissimuler leur sexe entre leurs jambes. Certains jeunes, charmants, dont un vêtu d’une peau de cabri, viennent s’asseoir à nos côtés, appuyés contre nos fauteuils.
Hier soir, sur notre demande, il y avait eu un vaste tam-tam. L’affluence croissait d’instant en instant. D’abord rien que des enfants ; puis bientôt tous s’en sont mêlés. Cela commença dès notre retour de Pouss, et, du train dont ils y vont, on comprend que ça ne pourra pas durer longtemps. Plus rien de commun avec le lent et morne monôme ou ronde, où certains coloniaux prétendent voir mimer des gestes sexuels, et qui, affirment-ils, se termine toujours en orgie. C’est net, précis, rythmé, comme leurs demeures, comme tout ce que je connais des Massa. Et varié. D’abord une marche très accentuée, un pied, puis l’autre, le talon frappant le sol d’une attaque brève qui secoue très fort les crotales que les femmes attachent au-dessus du mollet. Aucune mollesse. Filles et garçons forment deux monômes séparés évoluant l’un en reflet de l’autre.
J’ai dit « crotale » par simplicité ; en réalité ce sont des cornets de jonc treillissé, fermés à la pointe par une natte de fil. La base du cornet est relié à un disque de bois mince et sonore sur lequel retombent à chaque secousse une poignée de petits graviers encagés. Ce cornet est de proportions à épouser exactement le gras du mollet sur lequel il s’applique. C’est d’un travail charmant, aussi net que de la vannerie japonaise. La danse s’est animée, en changeant d’air. Au clair de lune ce lyrisme devient frénétique, démoniaque. Certaines femmes ont l’air possédées. Une vieille exécute de son côté un solo dans une petite cour. Elle se démène, gesticule, selon le rythme du tam-tam ; un instant se joint à la ronde, puis, tout à coup, cédant au transport, repart dans un espace vide, tombe et continue à danser sur ses genoux. Une toute jeune fille se sépare presque au même moment de la ronde, comme une pierre échappe à la fronde, fait trois bonds en arrière et roule dans la poussière comme un sac. J’attends les secousses, la crise d’hystérie ; mais non : ce n’est plus qu’une masse insensible, sur laquelle je me penche, doutant même si le cœur bat encore, car on ne la voit plus respirer. Un petit cercle se forme ; deux vieux se penchent et font des passes au-dessus d’elle en hurlant je ne sais quels appels ; auxquels elle ne répond point. Mais le tam-tam semble la réveiller ; la voici soudain qui se ranime ; pourtant elle est sans forces, elle se traîne et danse en se traînant, puis retombe définitivement sur le flanc, les bras étendus, les jambes à demi repliées, dans une pose exquise – d’où plus rien ne peut la tirer. Depuis la scène d’exorcisme chez les juives de Biskra que j’ai racontée dans mes feuilles de route[10], je n’ai rien vu de plus bizarre ni de plus terrifiant.
28 février.
J’ai vu travailler à la confection d’un de ces cornets dont je parlais hier. Un homme assujettissait les extrémités des joncs et fermait la pointe du cornet dans un travail de fil natté. Il procédait avec un poinçon qui soulevait légèrement les autres fils et permettait d’insinuer le fil qui devait relier l’ensemble. Celui-ci était enfilé à une longue aiguille.
Je n’imaginais pas qu’il y eût plusieurs façons d’enfiler une aiguille. Mais celle-ci n’a pas de chas. C’est seulement un éclat très fin et long d’une plante textile très résistante. L’extrémité opposée à la pointe est assouplie, décomposée en filaments, qui tressés avec le fil, l’entraînent à la suite de l’aiguille.
Toute la nuit les vols et cris d’oiseaux ; un vacarme extraordinaire. Nos pagayeurs ont dormi dans des obus ; enfin au chaud. Nous, dans nos baleinières, au pied de la petite falaise de trois mètres sur laquelle la ville est assise. Cette falaise n’est, à l’endroit où nous amarrons, qu’une pente douce, à cause de l’amoncellement d’immondices dont le rejet permet la propreté de la ville.
Le coup de fusil, qu’on tire du milieu du fleuve, le cri que l’on pousse, se heurtant aux courtes falaises des rives, ont un retentissement prolongé ; renvoyé de bord en bord il remonte ou redescend au loin le fleuve, rumeur durable, qui fait lever tout un peuple d’oiseaux.
Chasse au canard, en pirogue, au coucher du soleil. Après l’accablante chaleur et l’aveuglante lumière du jour, quel repos, quelle sérénité ! Le soleil disparaît cramoisi derrière un voile de brume. Le ciel se dore et l’eau reflète sa splendeur. Le Logone, large de trois cents mètres je pense, on le traverse sans perdre pied. Pas un défaut, pas une égratignure, pas une ride, rien que le mol plissement que fait l’esquif où je suis monté avec Outhman et un garde, et que dirigent avec des perches deux grands noirs, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière.
En prenant les noms des figurants de notre troupe, ce matin, nous sommes étonnés de la quantité de garçons et de filles qui portent le nom de Zigla. C’est aussi le nom d’un démon familier de la brousse que vont invoquer (et auquel vont sacrifier un cabri) les femmes qui attendent en vain un enfant. Si elles obtiennent enfin une grossesse, elles font vœu de donner à l’enfant le nom du génie[11].
Très importantes cultures de tabac, à fleurs blanches, larges et belles feuilles. Quantité de champs très petits mais d’autant mieux entretenus, enclos de claies ou de petits murs de terre dont les Massa vendent la récolte aux Bornouans ou aux Haoussas de la Nigeria qui circulent dans le pays en commis voyageurs.
Le groupe musical est de douze temps, la première note compte pour deux : les autres sont égales :
Le premier sol est très accentué, presque crié.
Une autre danse, sur une mélodie qui prend un autre caractère de ce seul fait que le la est remplacé par un si bémol. Seul le sol supérieur est pur.
Un autre :
et, encore ici, le si bémol vient remplacer le la, à la seconde partie de la danse – à ce moment le do lui-même est remplacé par un indistinct son intermédiaire ou composé du si bémol et du sol.
1er mars.
Hier soir, de nouveaux tam-tams. Moins nombreux que la veille ; danses aussi étonnantes. Cela dure deux heures, puis en un instant la place se vide et chacun va se coucher. On dirait une séance de gymnastique rythmique.
En y repensant cette nuit, il me semble que j’ai mal noté l’air d’hier et que les intervalles sont plus larges que nos tons, de sorte qu’entre le do et la dominante d’en dessous, il n’y ait qu’une note. Il peut paraître monstrueux que je n’en sois pas certain. Mais qu’on s’imagine cet air gueulé par cent personnes dont aucune ne donne la note exacte.