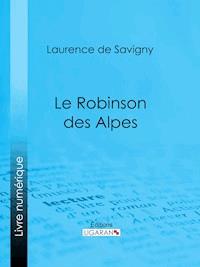
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Par une belle soirée d'automne de l'année 1718, une lourde berline de voyage, qui venait d'entrer dans la petite ville d'Annecy-le-Vieux, en Savoie, s'arrêta à la porte d'une auberge qui portait pour enseigne : Au Chasseur de chamois. Trois voyageurs en descendirent. C'étaient un homme d'un âge mur et deux enfants."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097924
©Ligaran 2015
Par une belle soirée d’automne de Tannée 1718, une lourde berline de voyage, qui venait d’entrer dans la petite ville d’Annecy-le-Vieux, en Savoie, s’arrêta à la porte d’une auberge qui portait pour enseigne : Au Chasseur de chamois.
Trois voyageurs en descendirent.
C’étaient un homme d’un âge mur et deux enfants.
L’auberge, de fort mince apparence, était peu engageante. Son bâtiment ne se composait que d’un long rez-de-chaussée surmonté d’une rangée de petites chambres, aux fenêtres carrées et fort écrasées sous la toiture ; le tout n’ayant guère l’aspect que d’un vaste hangar.
La cour qui précédait ce logis était encombrée de charrettes, de tonneaux, de sacs de grains, et, par là, montrait la condition rustique de ses hôtes habituels.
En avant de la façade, l’enseigne se balançait au vent. On voyait une espèce d’homme et une espèce d’animal, qui étaient peints en jaune sur un fond bleu ; et, ce qu’il y avait de particulier, c’est qu’en raison de l’exiguïté du tableau, le chamois était obligé de s’avancer vers le bout du fusil du chasseur pour se faire tuer.
La porte de la maison ouverte en laissait apercevoir l’intérieur ; et ce que l’on découvrait de l’aménagement de la grande salle ne flattait pas non plus le regard. C’était simplement une table de bois brut et des sièges semblables. La nappe de toile rousse était garnie de cruchons de terre, de vaisselle de grosse faïence, avec tout le reste assorti.
On devait bien penser que les plats du service étaient plus souvent remplis de noix et de fromage, que du fin poisson et du succulent gibier de ces contrées.
Cependant, les voyageurs, quoique d’apparence fort distinguée, entrèrent sans hésiter.
Sur le seuil, ils furent reçus avec cordialité par M. et madame Vateline, les maîtres du logis.
Comme il est d’usage, l’hôtelier apporta d’abord le registre sur lequel les étrangers doivent inscrire leurs noms et qualités.
Le voyageur écrivit :
« Le comte de Laverny et ses deux fils, Édouard et Lucien. »
Puis, la soirée étant déjà très fraîche, les arrivants se hâtèrent de s’approcher de la vaste cheminée.
Deux lampes de fer furent aussitôt allumées ; le foyer, attisé et ranimé par une brassée de fougère, jeta de vives flammes.
Alors, à cette clarté, on put voir distinctement la figure des étrangers.
Ils paraissaient être de condition élevée, et leur aspect était infiniment sympathique.
M. de Laverny, âgé de quarante-cinq ans environ, était grand, bien fait, avec une tête noble, des yeux pleins de lumière, une physionomie pleine de franchise. Le vent de la route avait fait tomber la poudre de ses cheveux ; il portait par-dessus ses habits une lévite brune à grand collet qui l’enveloppait entièrement. Ainsi, soustrait par les nécessités de la route au costume disgracieux du temps de la minorité de Louis XV, rien ne gâtait ses avantages naturels, et il inspirait infiniment d’attrait dès le premier regard.
Entre ses deux fils, il y avait peu de différence d’âge. Édouard, l’aîné, venait d’atteindre sa quatorzième année, et Lucien en avait treize.
Mais la figure, l’esprit, le caractère des deux enfants augmentaient considérablement cette différence.
Édouard, grand, brun et bien développé pour son âge, avait un visage d’une régularité parfaite, d’une expression extrêmement intelligente et déjà pensive ; sa pose, ses mouvements, ses manières étaient empreints de réflexion et d’une gravité douce. On voyait que son âme avait compté double les années qui lui étaient données pour s’élever et grandir.
Lucien, lui, était resté en arrière pour tout accroissement physique et moral, mais il faisait le plus joli bambin qu’on pût voir. Ses cheveux blonds bouclés ombrageaient une mine ronde, rose et mutine ; les traits en étaient retroussés ; les yeux bleus, le nez mignon, la bouche fraîche, se relevaient finement en pointe. Ces petits traits-là n’étaient faits que pour exprimer la gaieté, le plaisir, la malice, tout ce qui amuse et rend satisfait d’être au monde.
Cette différence entre les deux frères fut, dès le premier moment, attestée par l’accueil de la bonne hôtesse, madame Vateline.
Elle appela Édouard monsieur, comme son père.
Pour Lucien, ce fut autre chose ; le bambin tout de suite lui alla au cœur, et elle eut pour lui mille tendres gâteries. Elle lui apporta vite une tasse de lait chaud, en attendant le souper. Puis, s’apercevant qu’il avait pris froid aux pieds en voiture, elle l’assit sur ses genoux au coin de la cheminée, ôta ses souliers, enveloppa ses pieds de son tablier chauffé au foyer, et le tint douillettement appuyé contre sa poitrine, tout en l’appelant, à chaque propos, mon bijou, mon ange, mon chérubin. Quoiqu’à vrai dire, l’air angélique ne fût pas précisément celui qui se faisait remarquer sur sa figure.
Seulement, le petit bonhomme se laissait faire.
Pendant cela, maître Vateline préparait le repas.
Le souper fut très simple : le pain du pays, pétri d’orge et d’avoine, une pièce de bœuf des gras troupeaux des montagnes, des œufs, une jatte de crème recueillie dans l’étable, en firent tous les frais.
Mais le comte de Laverny était trop absorbé dans ses pensées, les enfants étaient trop heureux d’être arrivés au but du voyage, après une longue et pénible route, pour qu’aucun d’eux eût le temps de songer à ce qu’il mangeait.
À l’étage au-dessus, on mettait des draps blancs dans les lits ; on faisait bon feu dans les cheminées ; on posait sur la tablette le bougeoir allumé.
Ces arrangements terminés, M. Vateline conduisit les voyageurs dans leurs chambres.
Il était tard, pour des personnes qui avaient roulé jour et nuit en berline, depuis Paris jusqu’aux Alpes. Le froid de la vallée engourdissait les membres ; pourtant, M. de Laverny et ses fils restèrent encore quelques moments debout dans la chambre du premier.
Les enfants attendaient que leur père leur donnât le baiser du soir et leur dît d’aller gagner leurs lits, qui étaient préparés dans une petite pièce à côté, et le comte n’avait pas l’air d’y penser.
Même il avait ouvert la fenêtre, et, debout, les bras croisés, il considérait l’horizon, transparaissant à peine sous le voile de la nuit.
Il fit signe à ses fils de venir à lui.
Sa physionomie était empreinte d’une tristesse calme, d’une imposante gravité, et ce fut d’une voix pénétrée, mais ferme, qu’il leur dit :
– Mes enfants, voici la terre où nous allons désormais habiter. Notre voyage, ici, n’est pas un voyage, c’est une fuite ; notre résidence dans ce pays n’est pas un séjour choisi, c’est l’exil !
Cette révélation, si étonnante qu’elle fût, n’amena pas de trouble bien vif chez les enfants ; leur figure n’en fut pas altérée. Édouard avait déjà assez de force pour en soutenir toute la haute importance, et Lucien ne la sentait pas encore.
Le comte reprit :
– Depuis quelque temps déjà, à Paris, vous auriez pu vous apercevoir d’un changement autour de nous. Bien que nous vissions habituellement assez de monde dans notre hôtel de la rue du Temple, il en venait alors bien davantage, et il y régnait un incessant mouvement. De même, quoique ce quartier de Paris soit des plus populeux, vous auriez pu observer qu’il s’y formait certains rassemblements. Moi-même, mes enfants, je vous voyais moins souvent, ayant un grand surcroît d’affaires et de préoccupations dans ma vie habituelle.
C’est que, tandis que vous étiez si tranquilles dans l’heureuse ignorance de votre âge, autour de vous bien des esprits travaillaient, bien des cœurs s’agitaient.
Un complot s’était formé contre le régent.
L’Espagne, représentée par son cardinal-ministre Albéroni, et le prince de Cellamare, ambassadeur en France, désirait, par des raisons de haute politique, que le régent fût déchu du pouvoir. Ce prince, par les désordres de sa vie, avait aussi soulevé la nation contre lui : elle devait user des armes déposées en ses mains pour le déposséder.
Le duc et la duchesse du Maine se mirent à la tête de la conspiration : ce qu’il y avait de pur, d’honorable dans la société se rallia autour d’eux. C’est vous dire, mes enfants, que votre père ne fut pas des derniers à s’y joindre.
Les fils du comte l’écoutaient avec avidité ; ils ouvraient leurs grands yeux étonnés, ne comprenant pas bien encore, et déjà commençant à trembler pour leur père.
M. de Laverny poursuivit :
– Tout était prêt, les mesures prises, les opérations arrêtées pour ce changement du pouvoir souverain.
Le prince de Cellamare dut envoyer en Espagne le plan du complot, la liste des conjurés. L’abbé Porto-Carrera partit de Paris chargé du message.
On lui avait donné une chaise à double fond, dans lequel les précieux papiers étaient bien cachés. Une indiscrétion du jeune secrétaire d’ambassade perdit tout. Le régent, informé de suite, fit partir un courrier qui arrêta la chaise de poste et s’empara des papiers.
Le bruit de l’évènement se répandit parmi les affidés. Tout était résolu.
À cinq heures du même jour j’en reçus avis. À six heures, mon oncle, le duc de Laverny, était chargé de l’administration de tous mes biens en France. À sept heures, une voiture nous emmenait tous trois de Paris.
– Oh ! s’écria Édouard, que le ciel soit béni pour vous avoir accordé le temps si précieux de la fuite !
– Ce temps était mesuré bien étroitement, dit le comte. En sortant de notre hôtel, dans la rue du Temple même, nous rencontrâmes la voiture qui conduisait la duchesse du Maine prisonnière à la citadelle de Dijon. Le lendemain, j’appris en route que le duc du Maine était enfermé au château de Doulens… Et moi, grâce à Dieu, mon voyage était assez rapide pour me soustraire à la prison.
– À la prison, mon Dieu ! dirent en frémissant les enfants.
– Et au malheur plus grand d’être séparé de vous, mes deux bien-aimés ! dit M. de Laverny.
– Mon père ! mon père ! murmuraient les enfants du comte.
Dans tous ces importants évènements politiques, ils ne voyaient que leur père.
Et ils tenaient chacun une de ses mains, qu’ils baisaient en pleurant de son danger passé.
Le comte reporta ses regards sur l’horizon.
– Si j’ai choisi cette contrée pour notre exil, dit-il, ce n’est pas en raison des beautés naturelles qu’elle renferme. Non, je ne vous ai pas amené ici pour admirer les merveilles de ces montagnes des Alpes. Mais, fatigué de luxe, de prodigalités, d’oisiveté pervertie, de toutes les folies de la fortune par les mœurs actuelles de la capitale, et redoutant de voir mes fils élevés dans cette atmosphère corrompue, j’ai voulu vous conduire au sein d’une population pauvre, laborieuse et sage ; j’ai voulu que vous vissiez ces hommes simples, qui ne connaissent rien au monde, si ce n’est la famille, le travail qui la fait vivre, la religion qui la protège ; j’ai voulu que vous grandissiez dans ces pures contrées, pour en respirer la vertu.
– Oh ! vous avez bien fait, mon père ! dit Édouard avec exaltation.
– Tu seras content de nous, petit père, dit aussi Lucien en se jetant au cou du comte. Va, nous t’aimerons toujours de tout notre cœur, et nous nous conduirons bien ici, comme à Paris.
Pourtant le fils aîné de M. de Laverny était pâle d’émotion ; on sentait que l’impression de ce moment était profonde en lui, et qu’elle y demeurerait toujours.
Le joli bambin pleurait aussi sincèrement, car c’était sincèrement qu’il aimait son père ; mais, en même temps, il se frottait les yeux de sommeil, et pensait qu’il allait joliment dormir.
Le comte embrassa ses enfants, les conduisit dans leur chambre, les enferma doucement sous leurs rideaux.
Puis il vint aussi gagner son lit, calme, ferme au moment d’un si grand sacrifice, et s’applaudissant, dans sa conscience honnête, du parti courageux qu’il avait pris.
Le lendemain, le jour se leva pur et splendide.
Les voyageurs furent donc éveillés de bonne heure par l’éclat du soleil ; ils se levèrent et descendirent dans la salle de l’auberge.
Malgré l’heure matinale, madame Vateline leur avait déjà préparé un copieux déjeuner.
Le comte de Laverny et ses deux fils sortaient de leur lit, mais en si bonne disposition, qu’ils se sentaient prêts à faire honneur au repas, comme s’ils l’eussent acheté par l’exercice du matin.
La diligente hôtesse s’était levée plus tôt même que les soins de la maison ne l’exigeaient. Elle avait voulu confectionner pour Lucien une galette de fine fleur de froment, et le petit régal était prêt.
Aussi, dès qu’elle vit descendre son chérubin, elle courut à lui, s’informa d’abord s’il avait bien passé la nuit, puis alla lui chercher dans son armoire un petit fichu de mousseline imprimée, qu’elle lui noua au cou, dans la crainte qu’il ne ressentît la fraîcheur des montagnes.
Ensuite, elle l’emmena avec elle à l’office, et lui montra sa galette. Elle y joignit quelques pommes et des cerises sèches de la dernière récolte, fruits précieux, parce qu’ils sont les seuls du pays, et elle mit le tout dans un petit panier, en recommandant à Lucien de l’emporter avec lui pour son goûter.
Le jeune garçon souriait doucement à ces soins ; et il croyait parfaitement récompenser la grosse madame de ses bontés en l’embrassant sur les deux joues.
Le déjeuner, que le comte voulut partager avec le maître et la maîtresse de la maison, fut très gai.
M. de Laverny ne conservait pas d’inquiétudes sur sa position ; il savait bien qu’avec un homme du caractère du régent, l’affaire dans laquelle il se trouvait compromis serait promptement étouffée, et que l’oubli dans lequel lui-même tomberait bientôt à la cour, lorsqu’on ne l’y verrait plus, le protégerait bien plus que la frontière.
Il songeait donc seulement à choisir l’endroit de la Savoie dans lequel il s’établirait ; et, à ce sujet, il avait quelques renseignements de détail à demander à son hôte.
Lorsque le dernier cruchon du déjeuner fut vidé :
– Voici quel est mon plan, dit-il à M. Vateline. Comme la saison est très avancée, je profiterai du peu de jours que les neiges nous laissent encore pour faire visiter les sites les plus remarquables de vos montagnes à mes fils. Ensuite, lorsque la première bourrasque d’hiver nous chassera des hauteurs, les chemins étant encore fort praticables en plaine, il sera temps de parcourir la contrée pour y faire choix d’une résidence qui réunisse les conditions d’agrément et de salubrité.
– Ah ! monsieur le comte, dit l’hôte, nous ne pourrons vous offrir que de bien petites villes, et qui sont semées clair dans le pays. Mais enfin, il s’en trouve qui présentent les ressources nécessaires à la vie, et même le bien-être.
– Je compte sur vous pour me les indiquer, dit M. de Laverny.
– Eh bien, par exemple, Rumilly… Oui, il est probable que monsieur le comte choisira cet endroit. On y compte environ quatre mille deux cents habitants… ce n’est déjà pas mal !… puis, la ville est située dans les champs les plus riches, les plaines les plus fertiles.
– Mon cher hôte, dit le comte, quand on vient de Paris, on n’est pas jaloux de voir des villes populeuses… eussent-elles dix mille habitants ! On ne peut non plus s’émerveiller devant des campagnes fertiles quand on quitte la France.
– Mais c’est aussi près de là que se trouve le hameau de Sales, où naquit, en 1567, le célèbre saint François, que le nom de Sales, sa patrie, distingue des autres bienheureux portant le même nom que lui.
– Assurément, c’est là pour Rumilly un beau titre de noblesse. Mais voyons encore.
– Vous avez ensuite Bonneville, l’ancienne capitale du Faucigny, qui est fort citée pour son grand commerce de bestiaux et ses importantes fabriques d’instruments d’horlogerie.
– Mais, mon bon monsieur Vateline, quand on vient de Paris, on est également blasé sur la richesse du commerce et les beaux travaux de l’industrie.
– C’est vrai, dit l’hôtesse. Moi, si j’étais monsieur le comte, j’irais plutôt demeurer à Saint-Gervais. Ce bourg-là, voyez-vous, est situé au milieu de magnifiques prairies, qui jouissent d’une qualité toute particulière ; il s’y trouve des plantes aromatiques qui donnent au lait, et par suite au fromage, une saveur délicieuse ; de telle sorte que nulle part ailleurs, on n’en peut manger de semblable.
– Certes, dit le comte, voilà un très grand avantage ; mais quoique j’aime beaucoup le fromage…
– C’est la gloire de notre pays, monsieur le comte.
– Et je suis loin de la rabaisser ; mais avant de nous décider pour Saint-Gervais, on peut chercher ailleurs.
– Je vois, je vois, dit M. Vateline, il vous faut du pittoresque.
– Mais quand on vient dans les Alpes…
– Nous avons, par exemple, Menthon, d’où l’on peut admirer les plus magnifiques paysages de ces contrées. Placez-vous sur la hauteur et à l’instant vous avez devant les yeux le resplendissant lac d’Annecy, enveloppé de sites merveilleux.
– Bien alors… j’aimerais Menthon.
– Mais ce n’est pas tout ; des richesses historiques s’y trouvent aussi. Vous voyez un château situé à une hauteur prodigieuse, et dont quelques parties ont résisté à la ruine. Eh bien, c’est là qu’est né saint Bernard, fondateur des hospices du grand et du petit Saint-Bernard… On vous montrera encore la chambre dans laquelle il a reçu le jour. Puis, avant les souvenirs de nos temps, il s’en trouve des temps antiques ; au-dessus du village sont des restes de bains romains, où les soldats de César venaient fortifier leurs membres dans des eaux sulfureuses ; et au fond du lac (visible lorsque les eaux sont basses), la pile d’un pont commencé par ces conquérants, qui l’entreprirent on ne sait trop pourquoi, et l’abandonnèrent de même.
– J’aimerais fort Menthon ! dit Édouard, dont les yeux brillaient de curiosité.
– Maintenant, reprit l’hôte, je ne vous parlerai pas de Cluses, triste ville !… elle a été deux fois ravagée par le feu, ce n’est pas sa faute ; mais elle a eu le tort de se reconstruire sur un plan si large pour son peu d’habitants, qu’elle a l’air d’un désert.
– Il n’y a donc pas à y songer pour l’habiter, dit le comte, ni même pour la visiter.
– Oh ! pour cela ! vraiment si, il ne faut même pas y manquer. C’est tout auprès que se trouve l’ouverture de la fameuse caverne de Balme, dont vous avez sûrement entendu parler.
– Une caverne ! s’écria Édouard. Oh ! certes, nous voulons voir cela !
– Et vous avez raison, mon bel enfant, dit M. Vateline. Imaginez-vous une vaste profondeur, donnant entrée à une autre plus grande encore, mais où on ne peut pas pénétrer, et dont nul n’a jamais connu les ombres ni les mystères. Dans la première est un puits naturel creusé si avant, qu’une pierre jetée y produit des grondements pareils à ceux du tonnerre. Cet endroit est aussi le pays des échos. Au-dessus de Balme, un coup de pistolet tiré, est répercuté vingt fois dans les montagnes avec une intensité de son semblable à celle du premier coup.
– Nous espérons bien connaître tout cela, dit M. de Laverny. Mais voici bientôt l’hiver, et il nous faut chercher à le passer à l’abri d’un bon nid.
– Ah ! pour cela, dit l’hôte, vous pourriez bien penser à La Roche… C’est en cet endroit-là que s’élève une célèbre tour du douzième siècle, dressée sur une roche escarpée, qui donne son nom à la ville… Mais celle-ci est assez bien construite, et fut même autrefois fortifiée. Vous y trouverez tous les produits nécessaires à la table. De plus, de votre chambre bien chauffée, vous verrez à travers les vitres décorées d’images par la glace, un immense horizon, le Jura, le Parmélon, les montagnes de Thorens et de Saint-Laurent, le Môle, le Buet, et quelques pics de la chaîne du Mont-Blanc.
– Avec cela, dit le comte en souriant, on peut prendre patience pour attendre le printemps…
– Pour des excursions qui ne seront pas bientôt finies, je vous assure. Et voici de jeunes garçons qui vont s’en donner à cœur joie.
On pouvait en effet prévoir leur bonheur à venir par l’air d’attention animée avec lequel les fils du comte écoutaient l’énumération de ces merveilles qui leur étaient promises.
– Vous, monsieur Édouard, qui m’avez l’air d’un garçon érudit, dit M. Vateline, je vous recommande de vous faire conduire au village de Reposoir. Vous verrez là une des plus célèbres chartreuses. Elle fut construite, il y a cinq cents ans par Aimon de Faucigny et restaurée par un autre seigneur de ces cantons, le siècle dernier. Vous y verrez sa riche église, son grand cloître, consacré par les doctes religieux qui s’y sont abrités, et qui est aussi de la plus belle architecture.
– Et les bons pères, dit le fils du comte, nous en ouvriront-ils les portes ?
– Parfaitement. Ces portes ne sont fermées qu’au mouvement et au bruit du monde ; elles s’ouvrent toujours aux voyageurs isolés, soit qu’ils aient besoin d’éclairer leurs esprits aux grandes vérités spirituelles, soit que la fatigue et la misère leur fassent désirer seulement le lit et la table du couvent.
– Merci, monsieur Vateline, dit Édouard ; nous mettrons bien à profit vos bonnes instructions.
– Et vous, mon charmant petit Lucien, reprit l’hôte, que verrai-je bien dans nos contrées qui vous puisse beaucoup étonner et réjouir ?… Ah ! tenez, cela vous plairait-il de voir une rivière qui roule des paillettes d’or ?… Oui. Eh bien, allez à Allèves, et penchez-vous au bord du Chérau… Vous saurez que ces eaux, roulant entre de rustiques rivages, emportent avec elles ce précieux métal. Ensuite, en suivant quelque temps son cours, puis en traversant un étroit et sombre défilé, vous trouverez au-delà un amas de roches dits Rochers de Saint-Jacques. Ce sont des blocs de granit qui, en se détachant de la montagne, chacun tourné à sa manière, et se posant sur le sol au hasard, ont pris des formes de tours, de pyramides, de clochers, de portiques, comme s’ils l’eussent fait exprès pour amuser vos yeux, et vous composer un immense livre d’images.
– C’est cela ! dit Lucien. Père, tu me conduiras à Allèves.
– Je vous conduirai partout où il sera possible… Mais pour cela… voyons… il ne nous faut pas rester éternellement à table, et nous allons dès à présent commencer quelque petite excursion.
Il se leva en ajoutant :
– Pour aujourd’hui, comme il faut tenir compte de la fatigue du voyage, nous irons seulement à Annecy ; puis demain, au jour, nous commencerons nos courses aventureuses.
– Mais, dit Lucien, il va donc nous arriver des aventures ?
– C’est bien possible, dit M. Vateline.
– Et quoi donc ?
– Par exemple, des éboulements de terrain qui déroberont le sol sous vos pas, des avalanches qui vous envelopperont de nuages de neige, des coups de vent qui vous emporteront d’une cime de montagne à l’autre.
– Rien que cela ! dit en riant M. de Laverny.
– Oh quelle joie ! et que nous allons nous amuser ! dit Lucien.
– Vous dites, rien que cela ! monsieur le comte, reprit l’hôte. Et que diriez-vous donc si vous voyez mieux encore, par exemple une forêt qui marche.
– Ah ! j’avoue qu’il me plairait fort d’avoir un tel spectacle.
– Eh bien, cela est arrivé. Tous les jours, en raison de l’ébranlement du sol, il se produit des phénomènes plus extraordinaires. On voit se former dans les glaciers d’immenses crevasses, des rimages et des entonnoirs. Au pied de ces glaciers et sur leurs bords s’accumulent des amas de roches, de sable et de débris de toute nature ; ce sont les moraines, produites par l’éboulement des montagnes qui les dominent. Quelquefois, au printemps, ces éboulements, sur de plus grandes proportions, concourent avec les avalanches et les tourmentes de neige, à combler des vallées entières ; où les cols par lesquels on communique de l’une à l’autre ; tout chemin disparaît bientôt sous cet amas informe de terre, de roche, de neige, de blocs de glace. C’est alors, quand il arrive qu’une côte de montagne glisse sur ses flancs et descend des hauteurs, qu’on voit parfois sa forêt suivre ce mouvement et opérer sa majestueuse descente.
– Vraiment, en vous entendant, monsieur Vateline, dit le comte, on se réjouit d’être dans les Alpes, et on s’attend à toutes les merveilleuses surprises.
– Oui, c’est très bien, dit Édouard, mais dans tout cela, la vallée de Chamounix est ce qu’il y a de plus important. Et c’est sans doute cette excursion que nous commencerons demain ?
– Peut-être… on verra, dit le comte.
– Puis, poursuivit son fils, nous continuerons aux divers pics du Mont-Blanc, au mont Brevent, à la dent du Buet, à l’aiguille d’Argentières, au sommet du Géant…
– Certainement, messieurs mes fils, dit le comte, je vais vous donner ainsi toutes les montagnes des Alpes pour jouer aux quilles !… Non pas, nous ménagerons mieux nos plaisirs… Et maintenant la canne, le chapeau… et partons.
Le comte et ses fils descendirent la colline sur laquelle est situé Annecy-le-Vieux. Édouard remplissant déjà ses yeux des beaux paysages qui s’étendaient autour de lui. Lucien en faisant de même, mais portant aussi souvent son regard sur son petit panier garni par madame Vateline.
La vaste nappe du lac se déroulait comme une gaze azurée. À l’horizon, on avait les magnifiques panoramas des vallées du Fier et de la Filière. Mais partout on apercevait, entre des bouquets d’arbres, quelque pierre antique ; de l’étendue des herbages on voyait surgir quelques restes de constructions romaines.
La nature, qui efface si promptement les champs de bataille, recouverts en quelques jours de sa végétation, ne peut rien sur ceux où ont passé les antiques légions ; leurs camps laissaient partout quelque ouvrage qui s’enracinait à la terre ; et, après les siècles écoulés, dresse encore sa pierre éternelle.
Dans l’enceinte d’Annecy, les voyageurs ne trouvèrent qu’une ville de très peu d’importance à visiter.
Annecy, aujourd’hui, est un centre assez florissant d’industrie et de commerce ; les eaux du lac qui traversent la ville par trois canaux, y mettent en mouvement de nombreuses usines, des filatures, des fabriques d’étoffe de coton et de soie. Les monuments y sont remarquables, l’hôtel-de-ville, l’évêché, diverses églises, et surtout la bibliothèque publique et le musée, fort riche en médailles romaines, font prendre rang à la ville dans la civilisation de nos temps.
Mais au commencement du dix-huitième siècle, après avoir depuis longtemps oublié sa fondation antique, elle en était encore à ses temps féodaux, formée et agrandie à l’ombre du château des comtes du Genevois qui la domine, elle n’avait que la nullité imprimée en tous lieux par le vasselage.
Les voyageurs quittèrent donc bien vite son enceinte et se rendirent sur le côté oriental du lac, au pied de la montagne de la Tournette, l’un des points de ces contrées les plus riches en admirables perspectives.
Là ils firent une longue halte.
Des maisonnettes, dispersées sur les agrestes hauteurs, coupaient de leurs lambris de bois rouge les masses de sombre verdure ; des jardins, des haies vives, des arbres fruitiers, des plantes appartenant aux climats les plus favorables, donnaient à ce rivage un très riant aspect.
Au-delà se déroulait le majestueux cintre des Alpes.
Le comte de Laverny était assis sur un banc de gazon, ayant Édouard à ses côtés et Lucien à ses pieds.
À leur droite s’étendait une légère palissade de charmille enfermant un jardinet. Dans l’enclos, de jeunes paysannes dont la coiffe d’indienne garnie de dentelle noire ne gâtait pas trop la fraîche figure, se pressaient autour de nombreuses ruches d’abeilles, dont elles recueillaient le miel d’excellente qualité.
De l’autre côté, sur un plan moins incliné, de robustes garçons achevaient la récolte d’un champ de lin. La terre qui avait donné ses produits, était d’un jaune brun, parsemée de paille dans ses sillons. Mais, çà et là, quelques touffes de tardives fleurs de lin, échappées à la faux, élevaient leurs délicieuses petites fleurs bleues, balancées sous la moindre brise et dont le charme suffisait à parer cette argile.
Et tout le tableau, montagne, bois de sapin, maison rustique, modeste enclos, champ de lin, se répétait dans le lac, dont le reflet fidèle, aussi bien que les sommets superbes, peignait les essaims dorés d’abeilles et les fleurettes encore égarées sur le champ agreste.





























