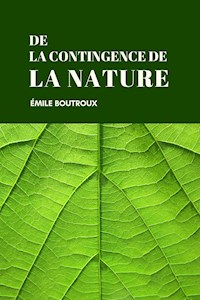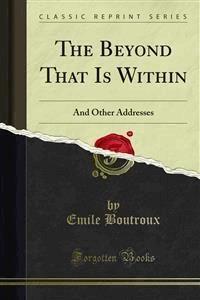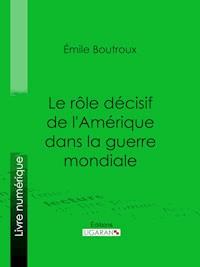
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "On peut tenir pour certain que les Allemands, en juillet 1914, n'envisageaient à aucun degré l'entrée en guerre des États-Unis. La guerre de 70 avait abattu la France. En 1914, c'était le tour de la Russie. L'Angleterre, sûrement, s'abstiendrait ; et, si la France était assez folle pour intervenir, on l'anéantirait immédiatement."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 42
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
On peut tenir pour certain que les Allemands, en juillet 1914, n’envisageaient à aucun degré l’entrée en guerre des États-Unis. Leur plan était fait ne varietur. La guerre de 70 avait abattu la France. En 1914, c’était le tour de la Russie. L’Angleterre, sûrement, s’abstiendrait ; et, si la France était assez folle pour intervenir, on l’anéantirait immédiatement. Plus tard, viendrait le tour de l’Angleterre, puis celui du Japon, ou des États-Unis. Pour le présent, on se contenterait, dans ces derniers pays, de la pénétration pacifique, si puissante quand elle est pratiquée avec la méthode, l’audace et la duplicité que les Germains savent y apporter.
Guillaume II affectait de s’intéresser à la grandeur des États-Unis. Quand l’Angleterre eut déclaré la guerre à l’Allemagne, il leur fit signe de profiter de la circonstance pour s’emparer du Canada et du Mexique.
Cependant, aux États-Unis, tous n’étaient pas persuadés que l’on pourrait, jusqu’au bout, demeurer neutre. D’assez bonne heure on agita la question de savoir si, tôt ou tard, on ne serait pas amené à aller combattre aux côtés des Alliés.
Cette éventualité faisait rire les Allemands. Quoi ! ces adorateurs du dollar, ces sportsmen, ces insulaires invétérés, si parfaitement indifférents au sort des peuples étrangers, iraient guerroyer de l’autre côté de l’Atlantique ? Était-ce concevable ? Cette nation, disaient les feuilles d’outre-Rhin, n’a point d’armée. Si elle essayait de s’en faire une, elle n’atteindrait même pas au niveau de la misérable petite armée anglaise. L’idée de transformer les Américains en soldats capables de se mesurer avec le soldat allemand n’était-elle pas du dernier comique ? Comment, d’ailleurs, les États-Unis pourraient-ils transporter leurs troupes à travers l’océan, dont les Allemands se rendaient maîtres au moyen de leurs sous-marins ? Enfin, quand même ils viendraient, dans une certaine mesure, à bout de tous les obstacles, les Américains n’auraient rien fait ; car, malgré leurs efforts, ils arriveraient trop tard. Le propre de l’Allemand, c’est d’avoir l’initiative des évènements. Comme l’Allemagne a fait éclater la guerre à l’heure marquée dans ses décrets, ainsi elle y mettra fin à l’instant qu’elle déterminera. En aucun cas l’Amérique ne sera admise à jouer un rôle. Elle est, elle demeurera quantité négligeable.
Tel était le point de vue allemand. Or, le 6 avril 1917, le Président Wilson proclamait l’existence de l’état de guerre entre l’Allemagne et les États-Unis. Quelle était la portée de cet évènement ?
L’Europe, depuis 1648, n’a saisi que par lueurs et très imparfaitement la signification de son histoire. À la clarté des évènements d’hier et d’aujourd’hui, nous discernons, durant les trois derniers siècles, une évolution capitale qui, hier encore, échappait à nombre de gouvernements.
Le traité de Westphalie était, dans le fond, la ruine de l’Autriche et l’annonce de son remplacement par la Prusse, comme puissance unifiante et dirigeante de l’Allemagne. Or, les progrès de la Prusse parurent alors un évènement secondaire, et l’Autriche de Charles-Quint continua, pour longtemps, de hanter les imaginations.
En 1756, la vanité de Mme de Pompadour unit la France et l’Autriche contre la Prusse. Frédéric II vainquit ; et le traité de 1763, en même temps qu’il préparait l’hégémonie prussienne dans les pays allemands, donna un corps à l’ambition, que commençait à nourrir l’Allemagne, de parvenir, sous la conduite de la Prusse, à s’unifier et à dominer en Europe.
Le sentiment national allemand, nous disent les historiens d’outre-Rhin, se redressa, lors de la conclusion de la paix d’Hubertsbourg : il se redressa en s’appuyant sur l’héroïsme de Frédéric II. Et, comme preuve de la puissance que, dès lors, posséda la Prusse, ces historiens ajoutent : Dès cette époque, l’État prussien était haï en Europe.
Que cette date de 1763 marquât ce qu’on appelle un tournant de l’histoire, l’Europe ne s’en douta pas. Lorsque Napoléon combattit la Prusse, l’Europe ne comprit pas que, dans cette lutte, il servait les intérêts du monde, et non pas seulement ses ambitions personnelles, d’ailleurs démesurées. Iéna eût dû être le point de départ d’une organisation de l’Europe destinée à empêcher la reconstitution de la Prusse : il fut l’origine de cette reconstruction même, et, avec elle, de la prussianisation de l’Allemagne.
En 1814 et 15 les yeux commencent à se dessiller. La Prusse, qui s’attribue le principal rôle dans l’écrasement de Napoléon, prétend acquérir une situation qui exprime et garantisse sa prépondérance en Europe. En ce sens elle réclame, outre la Saxe, l’Alsace et la Lorraine. Cette dernière conquête, notamment, en la rendant maîtresse de la France, hier encore la plus puissante nation du monde, marquerait son hégémonie universelle. Aux prétentions de la Prusse, l’Europe s’oppose. Ce n’est pas qu’elle considère le droit des nations. Les souverains qui naguère avaient invoqué ce principe contre Napoléon, l’oublient, maintenant que Napoléon est vaincu. Mais l’Europe comprend la pensée de la Prusse, et la déjoue. Si elle lui accorde une moitié de Saxe, elle lui refuse l’Alsace et la Lorraine. Au second traité de Paris, après Waterloo, l’Angleterre et la Russie obtiennent, au nom de l’équilibre européen, que la France ne soit pas mutilée.