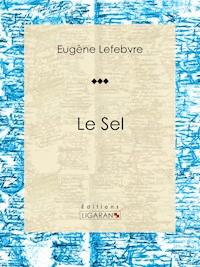
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Certaines matières minérales sont abondantes sur des points déterminés du globe et manquent complètement ailleurs: d'autres se rencontrent très fréquemment, mais toujours en petites quantités. L'or, par exemple, est de ces dernières : il n'existe peut-être pas de sable qui ne contienne un peu d'or..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054651
©Ligaran 2015
Abondance du sel dans la nature. – Sel marin. – Le sel dans l’air. – Sel gemme. – Origine du mot sel. – Opinions des anciens sur le sel. – Son caractère symbolique. – Le sel de l’esprit. – Vertus médicales du sel, suivant Pline. – Il rend la terre tantôt stérile, tantôt féconde.
Certaines matières minérales sont abondantes sur des points déterminés du globe et manquent complètement ailleurs : d’autres se rencontrent très fréquemment, mais toujours en petites quantités. L’or, par exemple, est de ces dernières : il n’existe peut-être pas de sable qui ne contienne un peu d’or ; mais dans les localités les plus favorisées, le métal précieux ne forme jamais de grandes masses. Le sel, au contraire, est très commun et presque partout très abondant.
L’eau de la mer recouvre les trois quarts de la surface du globe terrestre et forme en certains points une couche de 7 à 8 kilomètres d’épaisseur ; elle renferme en dissolution une quantité de sel qui s’élève environ à 3 pour 100 du poids de l’eau. Si l’on songe à l’immensité de la mer, on voit combien est grande la masse de sel qui s’y trouve contenue. Mais, en outre, les eaux appelées douces ne le sont que relativement : dans toutes il y a du sel, en proportion minime, il est vrai, mais en quantité suffisante pour que les chimistes puissent reconnaître sa présence. Chaque mètre cube d’eau de rivière contient en moyenne 10 grammes de sel : les eaux de source en sont souvent beaucoup plus chargées.
Si l’eau qui séjourne ou celle qui coule à la surface de la terre est toujours plus ou moins salée, l’air au milieu duquel nous vivons contient également du sel. Parmi les poussières solides qui flottent dans l’atmosphère, il y a des parcelles de ce minéral.
Nous les respirons sans cesse, de même que nous buvons le sel dissous dans l’eau : aussi n’est-il pas étonnant que notre sang et nos organes renferment du sel et que tous les êtres vivants, animaux et végétaux, en contiennent aussi.
À tous ces états, le sel est plus, ou moins caché : il ne se montre pas sous l’aspect de matière solide, pierreuse, que nous lui connaissons ordinairement : il faut des moyens délicats, des réactifs chimiques pour le découvrir ou déceler sa présence. Mais on le trouve à la surface du sol ou dans les entrailles de la terre constituant une roche, une véritable pierre : c’est alors le sel gemme. Il n’existe pas partout ; mais il est rare qu’un pays ayant une certaine étendue en soit absolument dépourvu. En Afrique, quelques populations vivent privées de sel ; mais cela tient surtout aux difficultés des transports dans ces pays sauvages.
L’usage du sel, comme condiment destiné à relever la saveur des aliments, est très ancien ; son origine se perd dans la nuit des temps : chez les nations civilisées, le sel est employé, en outre, à la fabrication d’un nombre considérable de produits utiles, le savon, le verre et tant d’autres. Aussi est-ce l’une des richesses minérales les plus importantes, une de celles que les hommes cherchent à se procurer en premier lieu : tantôt ils l’extraient de l’eau de la mer, et recueillent le sel marin qu’elle abandonne en s’évaporant au soleil ; tantôt ils mettent à profit et exploitent les bancs de sel gemme qu’ils ont pu découvrir. Heureux le pays qui peut ainsi se procurer en abondance le sel aussi nécessaire que le pain à la vie des habitants ! L’industrie du sel donne lieu à un commerce considérable, crée sur les côtes une pépinière de marins et de pêcheurs et fournit enfin la matière première indispensable à une foule de fabrications.
Quelle est l’origine du mot latin sal, duquel sont tirés les noms de sel, salt en anglais, salz en allemand ? Certains auteurs le font venir de salum, la mer. Il est plus naturel d’admettre que tous les noms du sel, ainsi que le mot grec άλς, dérivent d’un radical commun.
Le sel par son piquant rend agréables les aliments les plus insipides : aussi n’est-il pas de substance qui ait reçu de l’antiquité plus d’éloges, et de plus magnifiques. Suivant : Pythagore, il n’est, pas de table qui puisse s’en passer. Pline (XXXI, 7) le compare au soleil et dit que ce sont les deux choses les plus précieuses et les plus nécessaires dans la nature. Plutarque l’appelle l’assaisonnement des assaisonnements et le plus agréable de tous.
Il ajoute que le pain est bien meilleur quand il contient du sel, et que le pain et le sel peuvent suffire à la vie. Horace est du même avis. Il parle aussi du soin avec lequel on conservait chez les Romains la salière de famille (paternum salinum).
Aliment précieux, indispensable, le sel a pris un caractère symbolique. Le renverser à table était regardé chez les Romains comme un présage funeste, et la tradition s’en est conservée précieusement jusque dans notre société. En revanche, on plaçait, chez les Grecs comme chez les Romains, le sel devant un étranger à qui : on voulait donner une marque d’amitié. Démosthène emploie l’expression, « partager le sel, » comme synonyme de recevoir l’hospitalité. Au Moyen Âge, le partage du sel est aussi un symbole d’alliance et de fraternité. Aujourd’hui encore, dans quelques contrées de l’Orient, deux hommes qui ont partagé ensemble ou échangé ce présent de la nature, deviennent inviolables l’un pour l’autre. Le pain et le sel offerts sous la tente de l’Arabe assurent l’hospitalité : les Bédouins se mettent réciproquement dans la bouche un morceau de pain saupoudré de sel et contractent ainsi l’alliance du sel. Par suite d’une association d’idées analogue, la rétribution accordée pour un service rendu a pris le nom de salaire, c’est-à-dire indemnité pour le sel.
Il n’est donc pas étonnant que le sel ait joué dans les cérémonies antiques et dans toutes les religions un rôle auguste. On l’offrait à la divinité dans les sacrifices. Moïse le prescrit dans le Lévitique, parce que le sel est le témoignage de l’alliance que Dieu a faite avec les Israélites, alliance désignée dans les Nombres sous le nom de pacte éternel du sel. Les Romains employaient également le sel dans leurs cérémonies religieuses, et, lorsqu’ils offraient des sacrifices, le mélangeaient à la farine de froment, pour se rendre les dieux favorables.
Homère et Platon ne l’ont-ils pas appelé un corps divin très aimé des dieux.
Les Hébreux avaient reconnu eux-mêmes ou appris des Égyptiens que le sel a la propriété de conserver les corps ; ces derniers l’utilisaient dans la préparation des momies. Cette vertu merveilleuse est devenue certainement la cause d’une foule d’usages, notamment de celui qui consistait à frotter de sel le corps des nouveau-nés : ces frictions avaient pour but de donner plus de fermeté à la peau et plus de vigueur aux organes. Le sel devint donc tout naturellement l’emblème de la fermeté, de l’éternité, de l’immutabilité et enfin de la sagesse. Dans l’Évangile, les apôtres sont appelés le sel de la terre ; et lorsqu’on baptise les enfants, on leur met sur les lèvres le grain de sel de la sagesse (sal sapientiœ).
Employé à assaisonner nos aliments, le sel leur communique une saveur légèrement piquante, tandis que ceux qui n’en ont pas reçu paraissent sans goût : aussi a-t-on donné le nom de sel au piquant et à la sagacité de l’esprit. On dit que dans un discours, dans un écrit, il y a beaucoup de sel, et comme les Athéniens furent les plus spirituels des Grecs, on dit que c’est du sel attique. En latin, les mots sal, sales, sont employés pour désigner la vivacité et les pointes de l’esprit. Le sel noir (sal niger) d’Horace signifie raillerie amère ; un même mot salsus veut dire salé et spirituel, tandis qu’un homme dépourvu de sel (insulsus) ne peut être qu’un sot ; c’est du reste le portrait qu’en fait le poète Catulle.
De tout temps l’homme a cherché des remèdes à ses maux et des secours contre la maladie. Les facultés merveilleuses du sel devaient certainement être mises à contribution par la médecine ancienne : Pline nous a laissé de ses vertus mirifiques un catalogue qui peut servir de modèle pour une étiquette de spécialité pharmaceutique. Si l’on en croit cet auteur, on l’employait tantôt seul, tantôt mêlé au vin, à l’huile, au vinaigre, au miel, à l’origan, à la poix. Mais aussi, il guérit alors la morsure des serpents, les piqûres de guêpes ou de scorpions, aussi bien que la migraine, les ulcères et les verrues. Il est souverain contre les excroissances de chair, contre les maux d’yeux, de dents, contre les angines et les vers intestinaux ; rien ne résiste à son action, ni la goutte, ni les coliques, ni les cors aux pieds, ni les engelures ; en l’emploie encore avec le plus grand succès dans la jaunisse, l’hydropisie, la toux, ou bien lorsqu’on a été mordu par un crocodile.
Malheureusement il n’est pas de panacée qui n’ait ses détracteurs, et bien souvent nous trouvons dans les auteurs sacrés ou profanes le sel représenté comme un symbole de malédiction. En punition de sa curiosité, la femme de Loth est changée en statue de sel, et lorsqu’une ville doit être punie d’une manière exemplaire, le vainqueur déclare qu’après l’avoir rasée il sèmera du sel à la place où elle s’élevait, afin que rien n’y puisse pousser : le sel devient un instrument de vengeance après avoir été un instrument de vie. Mais ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est qu’on trouvera facilement chez les mêmes écrivains que le sel entretient la fertilité de la terre et que c’est un précieux engrais.
Nous rencontrons donc fréquemment, lorsqu’il s’agit du sel, les produits de l’imagination côte à côte avec la vérité ; de sorte qu’il est souvent difficile de démêler ce qui est réel, ce qui est exagéré et ce qui est faux. Les uns en font un présent divin ou un remède à tous les maux ; d’autres y voient un instrument de la vengeance céleste, peut-être ont-ils tous raison, au moins en partie. Pour décider la question, il n’est qu’un moyen, c’est de l’étudier à fond et de voir ce qu’est le sel, quelles sont ses propriétés, comment on se le procure et quel rôle il joue dans la nature.
Le sel est cristallisé. – Sa forme cristalline. – Sa structure intérieure. – Trémies de sel. – Leur formation. – Les cristaux de sel sont anhydres. – Pourquoi ils décrépitent au feu. – Sel cristallisé au-dessous de 0°. – Densité du sel. – Aspects du sel gemmé. – Transparence du sel pour la chaleur. – Fusion et vaporisation du sel. – Application de ces propriétés. – Solubilité du sel dans l’eau à diverses températures. – Densité de l’eau salée. – Pesé-sel. – Influence du sel sur la congélation et l’ébullition de l’eau. – Hygrométricité du sel. – Action du sel sur la glace. – Mélanges réfrigérants. – Influence de quelques substances sur la solubilité du sel dans l’eau. – Solubilité dans l’esprit-de-vin. – Flamme de l’alcool salé. – Son analyse au spectroscope. – Lumière jaune produite par cette flamme.
Le sel se reconnaît d’abord à sa saveur agréable et à son aspect particulier. Celui dont on se sert en cuisine ou sur la table est tantôt en grains fins, tantôt en petites masses ; on distingue dans le commerce ces deux variétés par les noms de sel fin et de gros sel. Mais si on les examine avec soin, on reconnaît qu’ils sont tous deux formés de cristaux, c’est-à-dire de fragments solides ayant une forme extérieure parfaitement régulière.
La forme cristalline est toujours la même dans tous les cristaux d’une substance : aussi doit-elle être rangée au nombre de ses caractères distinctifs. Les cristaux de sel sont cubiques : ils ont donc la forme générale d’un cube ou dé à jouer (fig. 1). Il ne faut pas croire cependant que chaque grain de sel ait la régularité du corps auquel nous venons de le comparer : ces cubes peuvent être brisés, accolés ou enchevêtrés les uns dans les autres ; mais, dans tous les cas, il est facile de reconnaître que les grains de sel ont toujours trois faces planes et perpendiculaires entre elles, dont l’ensemble forme chaque pointe du cube. On peut admettre que les molécules infiniment petites de sel ont elles-mêmes une forme déterminée, peut-être la forme cubique, puisque leur groupement se fait toujours de manière à donner naissance à des agglomérations ou cristaux cubiques.
Cette tendance des molécules d’un cristal à se réunir les unes aux autres toujours de la même façon, se retrouve pour le sel même dans les cristaux d’une certaine grosseur. Ils se groupent et s’unissent de manière à former des espèces de pyramides creuses, dont les faces sont composées de cristaux de sel disposés en escaliers : ces groupements portent dans les laboratoires le nom de trémies (fig. 2) ; dans l’industrie le sel qui se présente sous cette forme s’appelle sel en écailles. On explique de la façon suivante la formation des trémies à la surface d’une dissolution salée qui, en s’évaporant, abandonne le sel qu’elle contenait. Supposons qu’un petit cristal cubique se soit d’abord formé ; en vertu de sa plus grande densité, il tend à tomber au fond du liquide ; mais l’action capillaire le maintien à la surface (fig. 3). Bientôt il se forme d’autres cristaux dans le voisinage du premier : il est parfaitement démontré, en effet, que la présence d’un cristal quelque petit qu’il soit facilite la cristallisation. De nouveaux cristaux s’accolent au premier suivant ses quatre arêtes horizontales supérieures, et forment au-dessus de ce petit cube un cadre qui descend avec lui dans le liquide (fig. 4). De nouveaux cristaux se groupent autour du premier cadre de manière à en constituer un second (fig. 5) : après le dépôt d’un troisième, l’aspect serait celui de la figure 6 et ainsi de suite. Nous avons supposé qu’il se formait seulement une rangée de petits cristaux cubiques autour des arêtes horizontales du cadre précédemment constitué ; mais il peut aussi bien s’en former deux, trois ou quatre rangées contenues dans un même plan horizontal. Il suffit pour cela que le groupe cristallin ne s’enfonce pas dans le liquide, immédiatement après la formation d’une première rangée. On conçoit donc que la hauteur des pyramides creuses peut varier beaucoup par rapport à la largeur de leur base, suivant que ; le liquide est plus ou moins tranquille et que l’action capillaire est plus ou moins forte. Lorsque dans les salines on veut obtenir du sel en écailles, il faut conduire l’évaporation d’une certaine façon : et employer, quelques tours de main bien connus des ouvriers qui dirigent l’opération.
Un grand nombre de substances en cristallisant au milieu de l’eau peuvent se combiner à ce liquide, de sorte que les cristaux formés contiennent une proportion déterminée d’eau : l’alun, les cristaux de soude sont dans ce cas ; ces derniers, par exemple, contiennent près des deux tiers de leur poids d’eau (63 %). Il n’en est pas de même du sel ; ses cristaux sont anhydres, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas d’eau unie au sel en proportion définie ou, comme l’on dit, d’eau de cristallisation. Mais il reste toujours de l’eau interposée entre les lamelles cristallines. Il en résulte un effet curieux quand on chauffe brusquement le sel ; l’eau dont nous venons de parler se réduit subitement en vapeurs sous l’action de la chaleur, fait éclater les cristaux et en projette les fragments de tous côtés avec de petites détonations. On dit que le sel décrépite. Il suffit pour le constater de jeter dans le feu une poignée de gros sel ; on entend une véritable fusillade accompagnée de projections des parcelles cristallines.
On peut cependant obtenir des cristaux de sel contenant de l’eau de cristallisation. Il faut, pour cela, prendre une dissolution saturée de sel et l’abandonner à elle-même sous l’action d’une température de 15 à 20 degrés au-dessous de 0°. On voit s’y former des plaques cristallisées hexagonales qui ne ressemblent en rien au sel ordinaire. Qu’on les sépare, qu’on les mette égoutter, toujours à la même température, et qu’ensuite on les soumette à l’action de la chaleur, l’eau est chassée, le sel reste. On trouve, en comparant le poids du sel restant avec celui des cristaux primitifs, que ceux-ci contenaient :
Les chimistes regardent ces cristaux comme formés de 4 atomes d’eau unis à un atome de sel, et les représentent par la formule chimique : NaCl + 4 HO. Ils ne peuvent se conserver à la température ordinaire, et se détruisent même au milieu du liquide dans lequel ils se sont formés : il en résulte de l’eau et une poussière cristalline cubique, formée de sel ordinaire, c’est-à-dire anhydre. Les cristaux de sel pèsent environ deux fois autant que l’eau à volume égal : Karsten a trouvé pour leur densité le nombre 2,078 ; Kopp indique 2,15 et Buignet 2,145.
Le sel que nous employons journellement a été extrait, tantôt de l’eau de la mer, tantôt de celle des sources salées, tantôt enfin des bancs de sel naturel ; mais dans tous les cas, il a été l’objet d’une fabrication : on l’a fait cristalliser artificiellement. Celui que l’on trouve dans le sol, le sel gemme, n’a pas des propriétés moins curieuses. Le plus ordinairement il a un aspect fibreux et une couleur grise ou rougeâtre. Dans certains pays, il est translucide et même quelquefois tout à fait transparent : tel est le beau sel de Wieliczka, dont on trouve des échantillons dans tous les cabinets de minéralogie et que les physiciens recherchent particulièrement. Bien qu’il soit en masses énormes, sa structure intérieure est d’une régularité parfaite : quand on le brise à coups de marteau, il se casse dans trois directions perpendiculaires entre elles, de sorte que les morceaux obtenus ont leurs faces parfaitement planes et parallèles à celles d’un cube. C’est ce que les minéralogistes expriment en disant que le sel gemme se clive, suivant trois plans rectangulaires.
La lumière traverse aisément un morceau de sel gemme : cependant sa transparence est moindre que celle de l’eau ou d’un beau fragment de cristal ; mais il leur est bien supérieur sous un autre rapport. Les rayons du soleil ne donnent pas seulement de la lumière : cet astre nous envoie aussi de la chaleur. Celle-ci traverse l’air, puisque nous éprouvons une sensation de chaleur dès que la radiation solaire nous arrive à travers l’atmosphère. Le rayonnement calorifique traverse également les vitres de nos appartements et bien d’autres corps : mais aucun ne le laisse passer avec autant de facilité que le sel gemme. Pour constater le fait, on emploie l’appareil représenté dans la figure 7. Les rayons de chaleur partent d’une source quelconque A (lampe, boîte pleine d’eau bouillante, etc.), passent par l’ouverture d’un écran C et viennent tomber sur une pile thermo-électrique E : dès que celle-ci reçoit la chaleur, elle donne naissance à un courant dont on mesure l’intensité au moyen du galvanomètre G. On recommence ensuite l’expérience en plaçant sur le trajet des rayons de chaleur une plaque D formée d’une substance quelconque. L’effet produit sur le galvanomètre est moindre en raison de la chaleur que la plaque réfléchit et de celle qu’elle absorbe. La comparaison des deux résultats obtenus permet de déterminer la proportion de chaleur que des plaques de nature différente peuvent laisser passer.
En opérant de cette façon, on a trouvé que le sel gemme laisse toujours passer les 0,92 de la chaleur qu’il reçoit, et qu’en outre la chaleur est transmise avec la même facilité, quelle que soit son origine. Enfin, l’effet produit reste toujours aussi fort, même si l’épaisseur de la plaque de sel devient plus considérable. Il faut donc reconnaître que le sel gemme possède pour la chaleur une transparence complète et qu’il n’absorbe aucune portion de celle qui le traverse. S’il ne transmet que les 92 centièmes et non la totalité de la chaleur incidente, c’est qu’il y a en même temps réflexion : les 8 centièmes qui manquent représentent la quantité de chaleur réfléchie par la plaque de sel vers, la source de chaleur. On ne connaît pas de verre on de cristal qui soit aussi transparent pour la lumière que le sel gemme l’est pour la chaleur.
Le sel fabriqué et cristallisé artificiellement se comporte d’une façon toute différente : il ne : laisse passer qu’une quantité de chaleur beaucoup moindre, environ les 0,12 de la chaleur incidente.
Chauffé dans un creuset recouvert d’un couvercle, afin d’empêcher la décrépitation, le sel fond à 772°. Refroidi, ou bien coulé sur une plaque, pendant qu’il est fondu, il se solidifie et prend la forme d’une masse cristalline opaque qui ne décrépite plus au feu. À une température notablement supérieure à son point de fusion, le sel se vaporise sensiblement : il suffit d’en jeter un peu dans un foyer pour voir, apparaître, au bout du quelque temps, des fumées blanches de sel vaporisé.
Cette propriété a reçu une application assez importante : on l’utilise pour le vernissage des grès. Lorsque la poterie est à une très haute température et que sa cuisson est achevée, on projette dans le four quelques poignées de sel marin humide : l’eau et le sel se vaporisent ; leurs vapeurs, agissant sur le silicate d’alumine de l’argile, donnent de l’acide chlorhydrique et un silicate d’alumine et de soude vitreux, très fusible, qui forme à la surface des pièces une sorte de vernis ou de glaçure légère.
Tout le monde sait que le sel se dissout dans l’eau : cette solubilité présente cependant des circonstances exceptionnelles. En général un corps se dissout en plus grande quantité dans l’eau chaude que dans l’eau froide. Lorsqu’on veut faire du sirop de sucre, on a soin d’échauffer l’eau ; quand on laisse, au contraire, refroidir un sirop bien épais, préparé à chaud, on voit une grande partie du sucre se déposer en cristaux (sucre candi). La quantité de sucre qui peut rester en dissolution, est moindre à froid qu’à chaud, et c’est pour cela qu’il cristallise. Rien de semblable ne se produit avec le sel : il ne se dissout guère en plus grande quantité dans l’eau chaude que dans l’eau froide. Cela se déduit des résultats trouvés par Karsten et consignés dans le tableau suivant : les nombres inscrits dans la colonne sel indiquent le poids de matière solide contenue, à chaque température, dans 100 grammes d’eau salée.
On peut donc dire que la solubilité du sel reste à peu près la même à toute température : 100 grammes d’eau dissolvent de 55 à 40 grammes de sel quand la température varie de 0° à 100°. Aussi le sel ne cristallise-t-il pas lorsqu’on laisse refroidir une dissolution saturée à chaud : il faut absolument évaporer la dissolution et en chasser l’eau par l’action de la chaleur, s’il l’on Veut obtenir le sel qui s’y trouvait dissous.
L’eau salée possède une densité plus grande que l’eau pure et qui va en croissant à mesure que la quantité de sel dissous augmente. Pour s’en convaincre, il suffit de mettre un œuf dans un vase contenant de l’eau très salée (fig. 8), il flotte à la surface du liquide ; il tombe au contraire au fond lorsqu’on le place dans l’eau pure. Si on verse, dans un troisième vase, l’eau pure à la sur face de l’eau salée, il se fait un mélange des deux liquides dans les parties qui sont en contact : l’œuf mis dans ce liquide descend dans l’eau pure, et s’arrête dans un liquide salé dont la densité est égale à la sienne.
La densité de l’eau salée, contenant une même proportion de sel varie d’ailleurs avec la température. Le tableau suivant donne les densités à 4° et à 18°, 75 (15° Réaumur) de dissolutions salées dans lesquelles la proportion de sel varie de 1 pour 100. La première colonne Sel donne la quantité de sel contenue dans 100 parties de la dissolution.
On peut donc juger de la quantité de sel renfermée dans une dissolution par la densité de celle-ci. Mais la détermination d’une densité est une opération toujours assez délicate, aussi l’a-t-on remplacée par une observation très simple, fondée sur l’emploi d’un instrument nommé pèse-sel (fig. 9).
Le pèse-sel ou aréomètre de Baumé se compose d’un flotteur ordinairement en verre, lesté à sa partie inférieure et surmonté d’une tige sur laquelle on met une graduation. L’instrument doit être lesté de façon à flotter dans l’eau et à s’enfoncer alors jusqu’à la partie supérieure de la tige : on a marqué en ce point un trait auquel correspond le 0 de la graduation. Si l’on plonge l’appareil dans l’eau salée, il y flottera également, mais en s’enfonçant d’autant moins que l’eau est plus dense ou plus chargée de sel. On peut donc juger du degré de concentration de l’eau salée par la longueur de la tige qui émerge pendant la flottaison. Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus, on détermine sur l’instrument un second point de repère : pour cela, on fait une dissolution ; de 15 parties de sel dans 85 parties d’eau (densité. 1,1148), on y plonge l’aréomètre et on marque 15 au point d’affleurement. L’intervalle 0 – 15 est ensuite partagé en 15 longueurs égales et l’on prolonge les divisions, au-dessous du trait 15. On dit qu’une dissolution salée marque 22 degrés Baumé quand le pèse-sel y flotte en s’enfonçant jusqu’à la division 22. Connaissant le degré aréométrique, on peut connaître la densité du liquide et par conséquent la quantité de sel qu’il contient. Le tableau suivant montre que la proportion centésimale de sel est à peu près égale au degré de l’aréomètre :
La présence du sel en dissolution dans l’eau élève le point d’ébullition du liquide et abaisse au contraire la température à laquelle il commence à se congeler. Une dissolution saturée de sel bout à 109°, 4 et contient alors de 29,4 à 29,5 parties de sel pour 100 parties de dissolution. On utilise quelquefois cette propriété pour obtenir des bains-marie dont la température est supérieure à 100° : ainsi, lors de la préparation de certaines conserves alimentaires, on met les boîtes qui les contiennent dans un bain d’eau salée bouillante. Si, au contraire, on expose au froid l’eau plus ou moins chargée de sel, le point de congélation du liquide s’abaisse. La glace qui se forme alors contient toujours du sel, mais en quantité proportionnellement beaucoup plus faible que la saumure qui reste liquide. On peut de cette façon enrichir des solutions salées, en enlevant la majeure partie de l’eau sous forme de glace. Ce procédé est usité dans le nord de la Russie pour l’extraction du sel contenu dans l’eau de mer.
Le tableau qui suit donne les points d’ébullition et de congélation de quelques dissolutions contenant plus ou moins de sel. Il a été dressé par Karsten :
Le sel possède pour l’eau une certaine affinité : il se conserve, en effet, à l’air par un temps sec ; mais s’il fait humide, les cristaux de sel se mouillent et commencent, à entrer en déliquescence. Cet effet est beaucoup plus prononcé avec le sel gris de cuisine : celui-ci contient toujours un peu de chlorure de magnésium dont la déliquescence est plus grande que celle du chlorure de sodium pur. Aussi les ménagères ont spin de conserver la boîte au gros sel dans un endroit chaud et à l’abri de l’humidité : cet appareil leur sert en outre de baromètre ; quand le sel se mouille, elles y voient un pronostic pour la pluie.
Mis en présence de la glace, le sel en détermine la fusion. Que l’on saupoudre de gros sel un morceau de glace bien, transparente, chaque grain creuse un petit trou dans la glace qu’il fait fondre, et se dissout dans l’eau ainsi produite. Ce procédé est employé dans certains pays pour faire disparaître rapidement la neige qui tombe dans les rues : on l’a essayé en France, à Paris notamment. Il faut évidemment employer à cet usage du sel impropre à la consommation et par suite exempt de l’impôt, afin que le prix de revient de la matière soit aussi faible que possible. L’emploi du sel dans ces conditions a cependant un inconvénient : la neige et le sel mélangés forment tout d’abord une bouillie liquide dont la température est d’environ 20 degrés au-dessous de 0 : aussi est-il fort désagréable d’y marcher.
L’abaissement considérable de température qui se produit alors s’explique aisément. La glace pour se fondre exige de la chaleur : abandonnée à elle-même dans une chambre chaude, elle fond peu à peu en empruntant à l’air la chaleur nécessaire à sa fusion : la met-on dans l’eau tiède, elle fond en prenant la chaleur de l’eau qui se refroidit. On démontre en physique que pour fondre un kilogramme de glace, il faut autant de chaleur que pour échauffer le même poids d’eau liquide depuis 0° jusqu’à 79°. Or, quand, on met le sel sur la glace, celle-ci fond aussitôt, sans avoir le temps de prendre de la chaleur aux corps voisins : comme, d’un autre côté, la fusion ne peut s’opérer sans chaleur, la glace en emprunte à elle-même et au sel qui la recouvre : leur température s’abaisse puisqu’ils perdent de la chaleur ; il en résulte un mélange réfrigérant.
Le mélange du sel avec la glace pilée ou la neige est très souvent employé comme moyen de produire du froid ; les proportions les plus convenables sont : un quart de sel et trois quarts de neige ; dans ces conditions, on obtient un froid de 21° au-dessous de 0°. Les physiciens et les chimistes ne sont pas seuls à se servir de ce mélange : les glaciers provoquent la congélation des sirops et des crèmes en plongeant les vases ou sorbetières qui les contiennent, dans un seau plein de glace pilée et mélangée de sel.
La solubilité du sel dans l’eau est modifiée et diminuée en général par la présence d’autres substances. Une dissolution saturée de sel, dans laquelle on verse de l’acide chlorhydrique, laisse déposer immédiatement une grande partie du sel qui y était contenu. Il en serait de même, si l’on ajoutait du chlorure de magnésium au liquide salé : cette propriété est appliquée dans l’extraction du sel marin ; son emploi constitue la méthode des coupages. (Voir chap. IV, 3°.)
Un fait analogue se produit avec l’alcool. Lorsque celui-ci est pur et complètement exempt d’eau (alcool absolu), il ne dissout pas le sel ; tandis qu’il y a dissolution d’une quantité plus ou moins grande de sel, quand l’alcool est mélangé d’eau.
La flamme de l’alcool dans lequel on a fait dissoudre du sel présente une teinte jaune particulière. Si l’on s’en sert la nuit pour éclairer l’intérieur d’une chambre, les objets perdent leur couleur propre et paraissent tous posséder la teinte jaune de la flamme. La figure des personnes ainsi éclairées n’a plus son aspect rosé et prend une apparence cadavérique particulièrement désagréable. Le changement de couleur est surtout remarquable pour certaines substances très richement colorées : le bichromate de potasse est ordinairement d’un rouge brun très foncé ; il paraît alors presque blanc : le biiodure de mercure, dont la teinte rouge est plus vive peut-être que celle du beau vermillon, devient blanc avec une pointe de jaune pâle. Vue à travers une plaque de verre de couleur verte, la flamme de l’alcool salé est jaune orangé. Ces phénomènes sont faciles à observer, et tout le monde peut répéter l’expérience.
Elle réussit également, si l’on introduit un fil de platine imprégné d’eau salée dans la flamme d’une lampe à esprit-de-vin ou d’un bec alimenté par un mélange de gaz d’éclairage et d’air (bec Bunsen) ces flammes, dont la teinte ordinaire est d’un bleu pâle, deviennent aussitôt d’un jaune éclatant, tout à fait semblable à celui que produit l’alcool salé. L’effet obtenu tient donc à la présence du sel dans la flamme et non pas à la nature de celle-ci.
Étudions cette flamme de plus près et analysons-la au moyen du spectroscope (fig. 10). Le tube C reçoit, à travers une fente étroite, les rayons partis de la flamme du bec Bunsen dans laquelle un support muni d’un fil de platine maintient un peu de sel : ces rayons traversent le prisme placé au centre de l’appareil, se séparent s’ils ont des réfrangibilités différentes, et viennent alors donner dans la lunette B une image colorée et étalée de la fente par laquelle ils sont entrés. Si la lumière émise est homogène, c’est-à-dire si les rayons sont tous de même nature, ils se dévient également dans leur passage à travers le prisme, mais ne fournissent alors qu’une simple ligne lumineuse, dont la position et la coloration changent en même temps.
L’expérience ainsi faite montre que la lumière émise par une flamme, où se trouvent des vapeurs de sel commun, est très sensiblement homogène. L’image de la fente du spectroscope apparaît comme une simple raie lumineuse : d’un beau jaune et qui correspond à la raie noire D du spectre solaire (fig. 11). Si l’on emploie un instrument ayant un fort pouvoir dispersif, la raie jaune se dédouble en deux lignes séparées l’une de l’autre, mais très rapprochées. Cette réaction est si extraordinairement sensible, que le sel marin renfermé dans les poussières atmosphériques suffit pour produire le phénomène. En regardant à travers le spectroscope la flamme obscure du bec Bunsen, dans laquelle on n’a pas mis le fil de platine, on voit apparaître la raie jaune, par intervalles. Ces éclats intermittents correspondent au passage des parcelles salées contenues dans l’atmosphère et que le courant d’air amène dans la flamme.
Analyse du sel par la pile. – Il est composé de chlore et de sodium. – Propriétés du chlore. – Propriétés du sodium. – Flamme du sodium. – Son action sur l’eau. – Synthèse du sel. – Sa composition exacte.
Qu’est-ce que le sel ? Est-ce un corps simple, ou bien est-il possible d’en séparer des matières diverses ? Faisons fondre du sel dans un creuset sous l’action de la chaleur, et plongeons dans la masse deux baguettes de charbon communiquant avec les pôles d’une forte pile ; une décomposition s’opérera par le passage du courant. À l’électrode positive, se dégage un gaz d’une odeur très forte, d’une couleur verdâtre et qui a reçu pour cette raison le nom de chlore. En même temps, se réunissent sur l’électrode négative des globules fondus, volatils, même à cette température et pouvant brûler au contact de l’air avec une flamme jaune : si on les recueille, après leur solidification, on verra qu’ils sont légers, mous, faciles à couper au couteau : ils présentent alors une section brillante comme celle de l’argent et d’un éclat métallique très prononcé ; mais ils se ternissent rapidement à l’air. Le corps auquel nous avons affaire est un métal ; mais c’est un métal qui se rouille ou s’oxyde à l’air avec la plus grande facilité : aussi n’y conserve-t-il pas son brillant métallique. On a donné à ce métal le nom de sodium. Comme le chlore et le sodium n’ont pu jusqu’ici être décomposés par aucun moyen, on les regarde comme des éléments ou corps simples, et l’on dit que le sel commun est un composé de chlore et de sodium : c’est du chlorure de Sodium.
Indiquons, en quelques mots, les propriétés les plus importantes du chlore et du sodium.
Le chlore est gazeux, d’un jaune verdâtre, plus lourd que l’air : 1 litre de chlore pèse environ 5 grammes, tandis que 1 litre d’air ne pèse que 1 gramme 3 décigrammes. Un froid de 40 degrés au-dessous de 0°, ou bien une pression de 4 atmosphères à la température de 15° suffit pour transformer le gaz chlore en un liquide jaune.
Si l’on verse de l’eau dans un flacon de chlore et qu’on agite, le gaz se dissout et donne une dissolution jaune pâle, employée dans les laboratoires et dans l’industrie sous le nom d’eau de chlore.
Même en petite quantité et mélangé à beaucoup d’air, le chlore produit, quand on en respire, une vive oppression et détermine une toux violente. Si l’on continue, il peut survenir des crachements de sang : aussi ne faut-il le manier qu’avec certaines précautions.
Le chlore est un des agents chimiques, les plus énergiques. Le phosphore, l’arsenic, l’antimoine qu’on y introduit (fig. 12) s’enflamment en s’unissant à lui. Tous les métaux, même ceux qui sont le moins altérables, l’or et le platine, se combinent au chlore dès qu’on les met au contact de ce gaz.
L’hydrogène mélangé au chlore se combine peu à peu avec lui : cette combinaison est subite et accompagnée d’une violente explosion, lorsqu’on fait tomber la lumière solaire sur le mélange, ou qu’on en approche une allumette enflammée. Il se forme dans ces circonstances un composé de chlore et d’hydrogène, l’acide chlorhydrique. L’autre élément du sel est le sodium. Ce métal, d’un blanc d’argent, a des propriétés assez différentes de celles que nous sommes habitués à trouver dans les métaux usuels : il est très léger et pèse moins que l’eau à volume égal ; sa densité n’est, en effet, que les 0,97 de celle de ce liquide. Le sodium fond vers 95°, 5, température inférieure à celle de l’eau bouillante le liquide ainsi obtenu bout à la température rouge.
Le sodium est très altérable à l’air ; aussi doit-on le conserver au milieu d’un liquide non oxygéné, tel que l’huile de naphte ou de pétrole. Chauffé au contact de l’air et à une température notablement supérieure à son point de fusion, il finit par s’enflammer il brûle alors avec une flamme jaune, qui présente tous les caractères indiqués (page 21) pour la flamme de l’alcool salé. C’est donc à la présence du sodium, qu’est due cette lumière caractérisée par la double raie jaune de la figure 11. Un composé quelconque au sodium donne le même aspect à la flamme du bec Bunsen.
Le sodium, est peu altérable dans l’oxygène ou dans l’air sec, à la température ordinaire : cependant on reconnaît que le métal fraîchement coupé est très brillant, et qu’il se ternit rapidement : cet effet est dû surtout à l’humidité et à l’acide carbonique contenus dans l’air. Le sodium décompose, en effet, l’eau pour s’emparer de son oxygène et donne alors de l’oxyde de sodium ou soude. L’expérience se fait en projetant un fragment de sodium à la surface de l’eau contenue dans un vase : le métal, plus léger que l’eau, reste à la surface du liquide : mais la chaleur dégagée par sa combinaison avec l’oxygène de l’eau détermine sa fusion, de sorte qu’il prend la forme d’un globule fondu. Celui-ci court rapidement à la surface de l’eau, soulevé et poussé par l’hydrogène qui se dégage tout autour de lui.
On peut rendre manifeste le dégagement d’hydrogène, en approchant du globule métallique une allumette enflammée : l’hydrogène s’allume et brûle avec une flamme colorée en jaune par un peu de vapeur de sodium. Quant à la soude, on constate sa présence dans l’eau où elle s’est dissoute. Le liquide peut, en effet, ramener vivement au bleu la teinture de tournesol rougie par un acide : si on y trempe le doigt, la dissolution de soude produit l’effet d’un liquide savonneux, parce qu’elle, attaque la peau en formant un savon avec la matière grasse qui entre dans sa composition.
Au lieu d’exposer le sodium à l’action, de l’eau ou à celle de l’air, plaçons un morceau de ce métal dans une petite capsule attachée à un fil de fer, et introduisons le tout dans un flacon plein de chlore (fig. 15) : le sodium s’allume, brûle en répandant une épaisse fumée et, quand le métal est brûlé, la couleur jaune du chlore a disparu ; il ne reste dans le flacon qu’une poussière blanche : c’est du sel. Nous pouvons donc faire du sel avec le chlore et le sodium : seulement il faut une proportion exactement déterminée de chacun de ces corps : 23 de sodium pour 35,5 de chlore. Après avoir analysé le sel, nous venons de le reconstituer avec ses éléments et d’en faire la synthèse ; nous trouvons ainsi qu’il est formé de
N’est-il pas curieux de voir un métal semblable à l’argent et un gaz vert donner par leur union une poudre solide blanche : celle-ci possède une saveur agréable ; elle est tout à fait inoffensive, tandis que le chlore est suffocant, même à dose très faible et que le sodium brûle au contact de l’eau en donnant de la pierre à cautère. C’est en effet le propre des composés chimiques de posséder des propriétés et des caractères essentiellement différents de ceux de leurs composants.
Le sel est un aliment nécessaire. – Il existe dans les liquides de l’organisme. – Le sel favorise les combustions organiques. – Il maintient l’albumine à l’état de dissolution. – Il facilite la digestion. – Rôle du sel dans les phénomènes d’absorption. – Expériences d’endosmose. – Le sang est salé et alcalin. – Quantité de sel contenu dans le sang. – De la quantité de sel nécessaire dans l’alimentation. – Travaux de Milne Edwards sur ce sujet. – Conclusions. – Observations faites en Angleterre. – Influence de l’impôt sur la consommation du sel.
Le sel joue un rôle des plus importants chez l’être vivant : il entre dans la composition du sang de tous les animaux et de l’homme en particulier. Aussi est-ce le plus employé de tous les condiments ; on pourrait même dire que c’est un aliment nécessaire. La presque totalité, des hommes en font usage : si quelques peuplades paraissent s’en passer, il ne faut pas oublier que le sel est fort répandu et que les aliments ordinaires en contiennent toujours naturellement. On raconte que des seigneurs russes, voulant réaliser des économies, privèrent un jour de sel leurs paysans : ces malheureux devinrent gravement malades, hydropiques ; au bout de peu de temps leur santé était si délabrée qu’il fallut leur fournir de nouveau cet aliment. Un physiologiste a voulu vérifier le fait sur lui-même : il se soumit à une alimentation absolument exempte de sel et put constater, qu’à partir de la fin du troisième jour, des désordres graves se produisirent chez lui.
Pendant le siège de Metz, en 1870, la privation la plus sensible fut le manque de sel : tous les aliments, viandes, pain, légumes, paraissaient sans saveur, faute de ce condiment auquel nous sommes habitués.
Tous les liquides, tous les tissus de l’économie, excepté l’émail dentaire, contiennent du sel marin : mais, en outre, on trouve dans les liquides organiques, ici de la soude, là de l’acide chlorhydrique libre ou combiné à différentes bases. Il n’est pas douteux que le sel leur en fournit les matériaux : la soude du chlorure de sodium est nécessaire à la composition du sang, de la salive, de l’urine, et de la bile qui lui doit son alcalinité ; l’acide chlorhydrique communique au suc gastrique d’importantes propriétés.
Quel est le rôle du sel dans les phénomènes de nutrition ? Comme il est assez complexe, nous indiquerons successivement les points principaux. L’usage du sel amène une augmentation dans les combustions : chez l’homme soumis à un régime fortement salé, la proportion durée s’accroît d’une façon très notable et la température moyenne s’élève sensiblement. Cet accroissement dans la combustion organique est lié à l’augmentation du nombre des globules du sang : une personne prit chaque jour pendant deux mois 10 grammes de sel de plus qu’à l’ordinaire ; les globules augmentèrent dans la proportion de 26 à 29 ; en même temps, l’eau et l’albumine diminuèrent sensiblement. Cet accroissement du nombre des globules rouges n’est pas dû à une action génératrice des globules, comme l’est celle du fer : il provient de l’action conservatrice exercée par le chlorure de sodium sur les éléments globulaires, sur les hématies





























